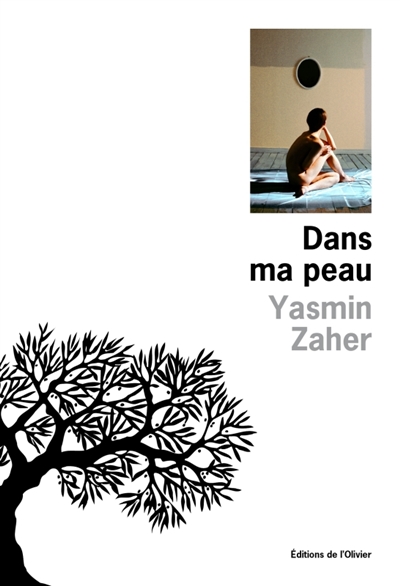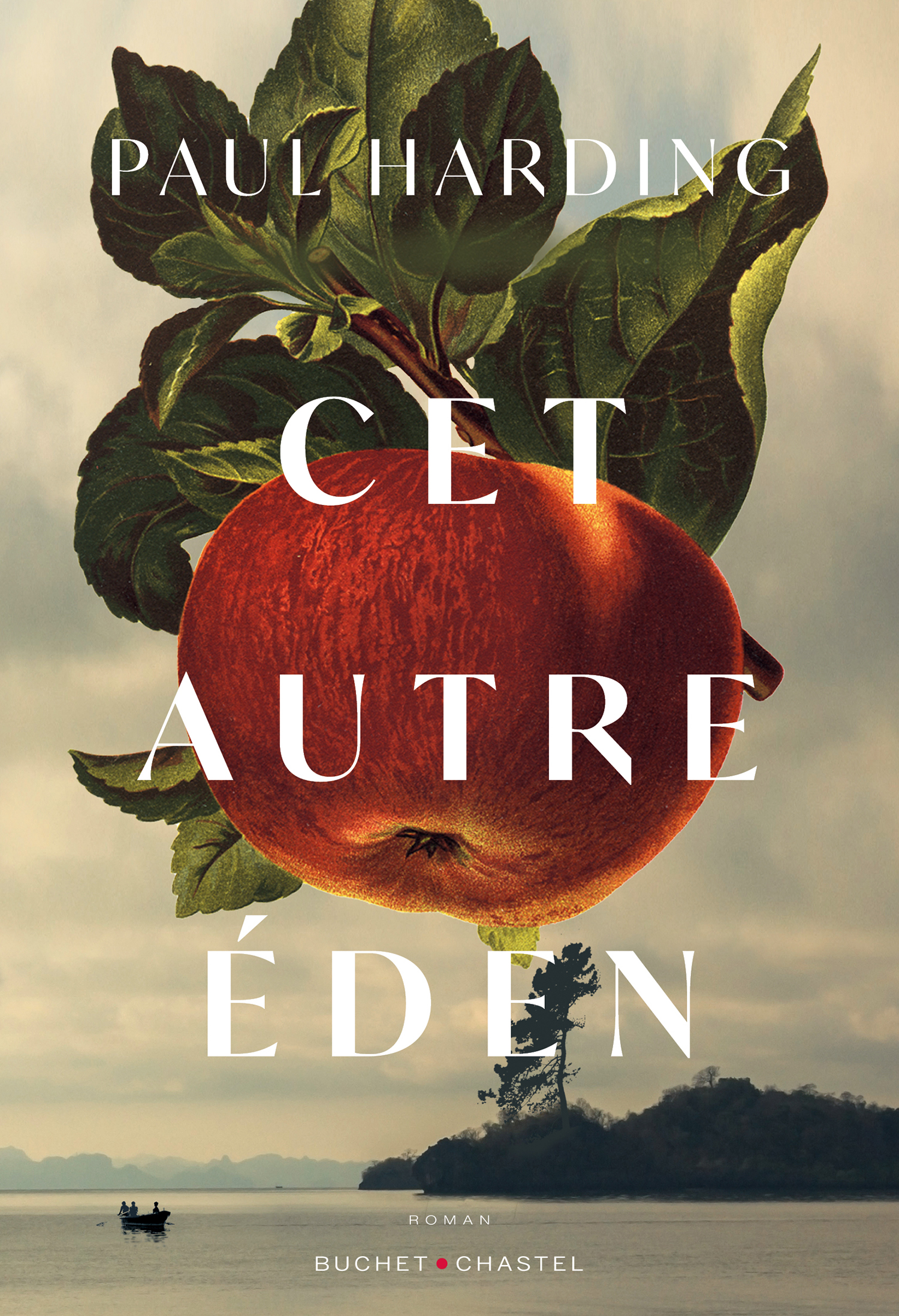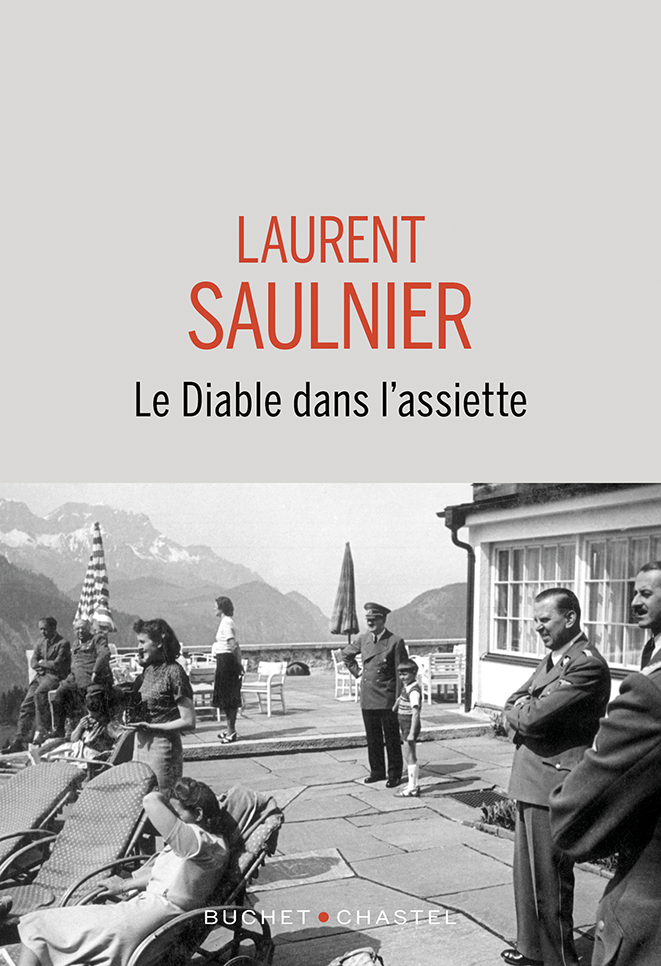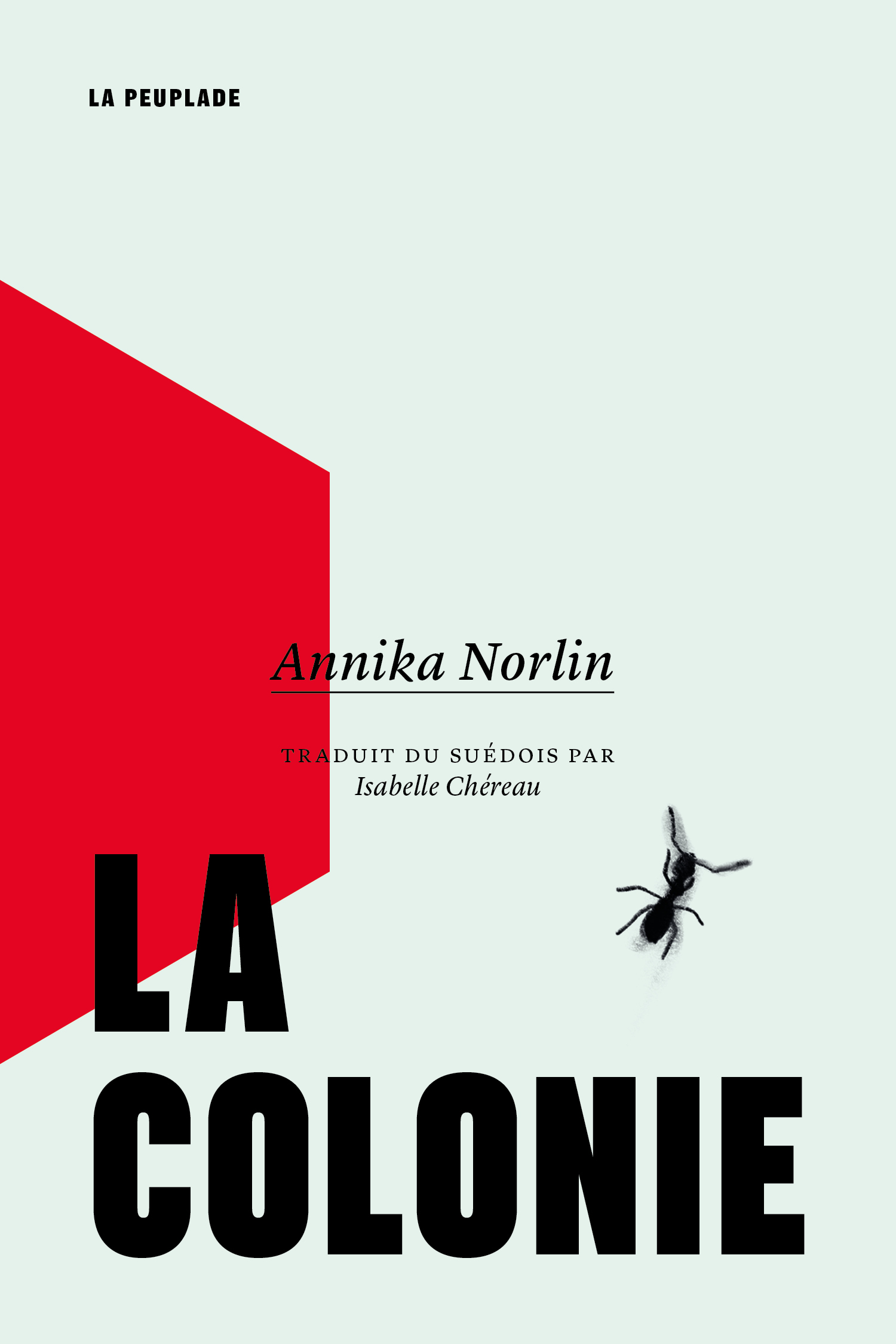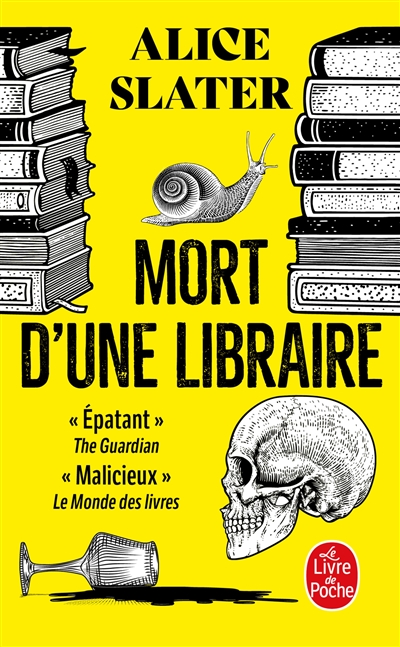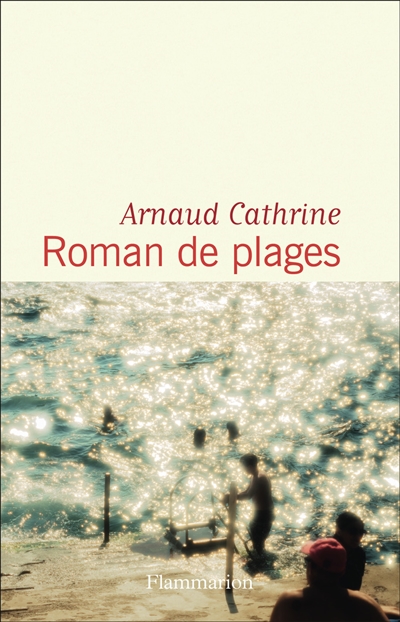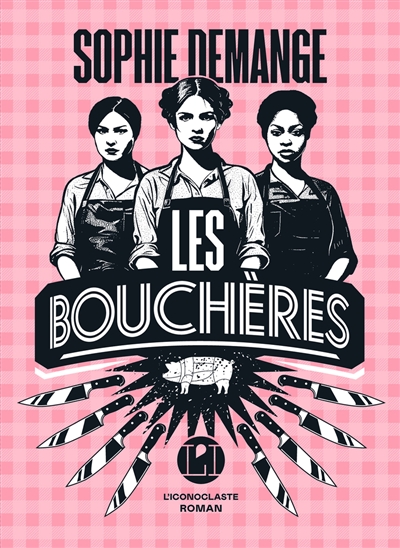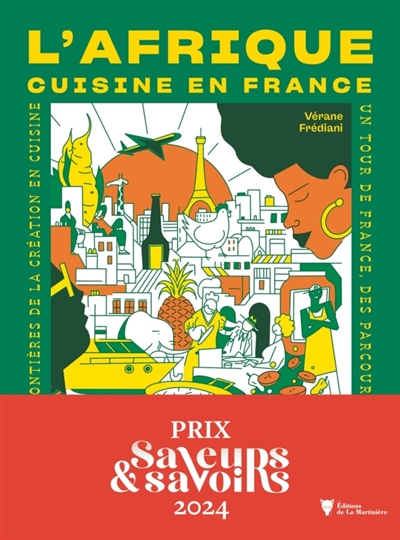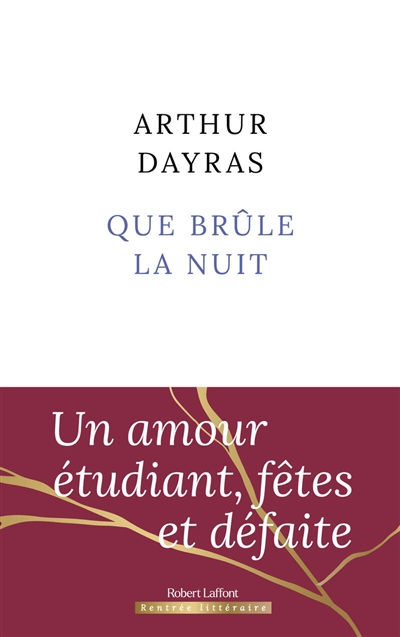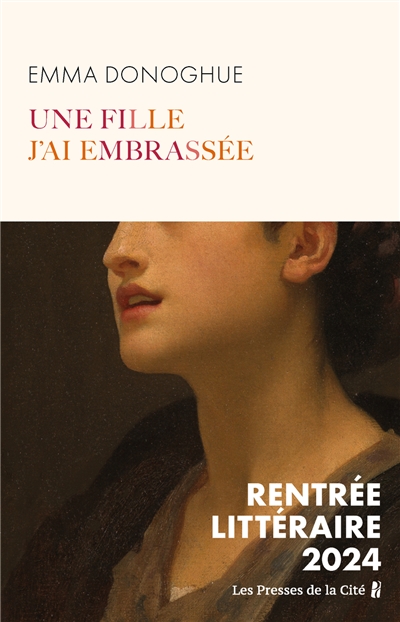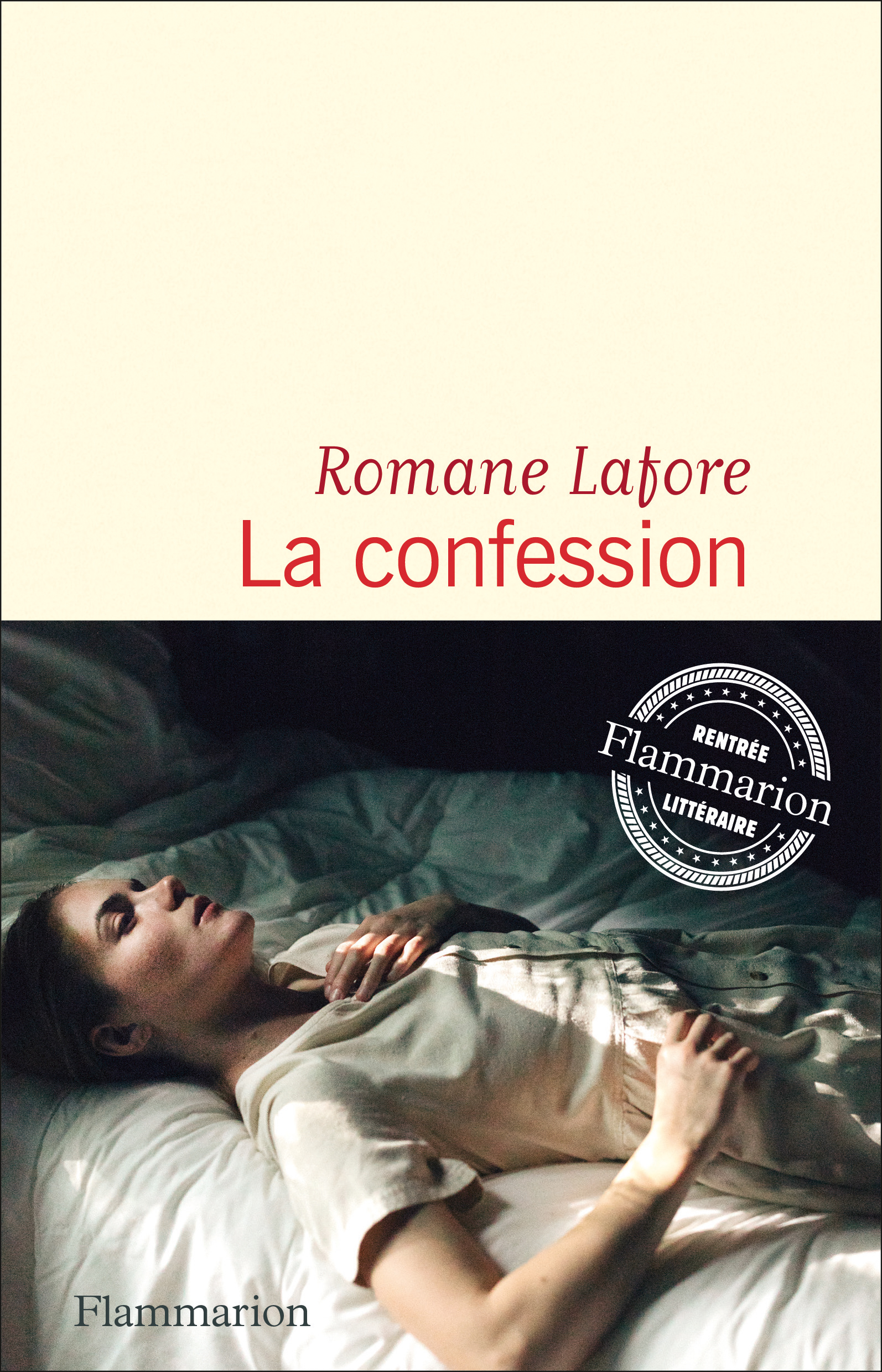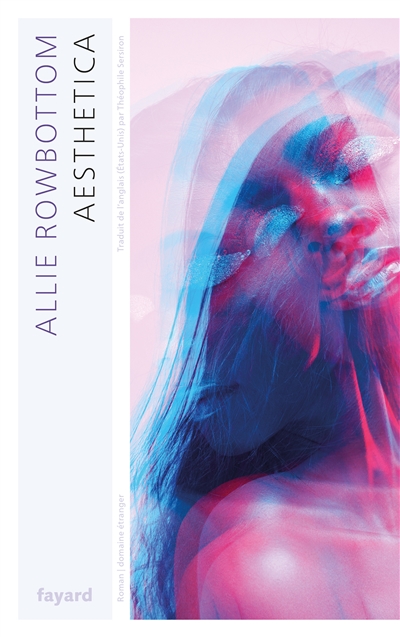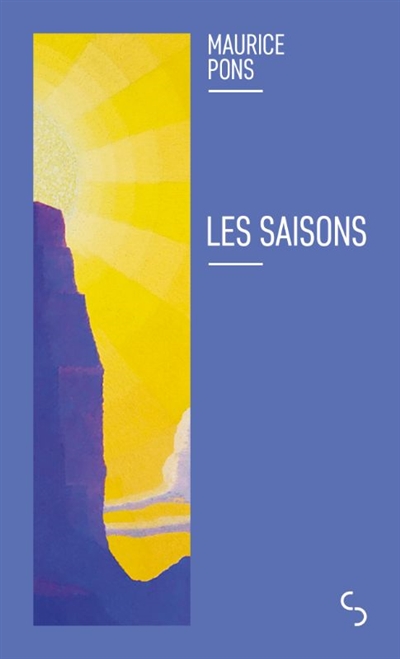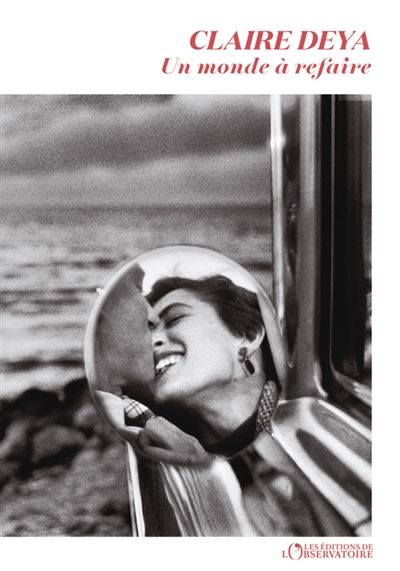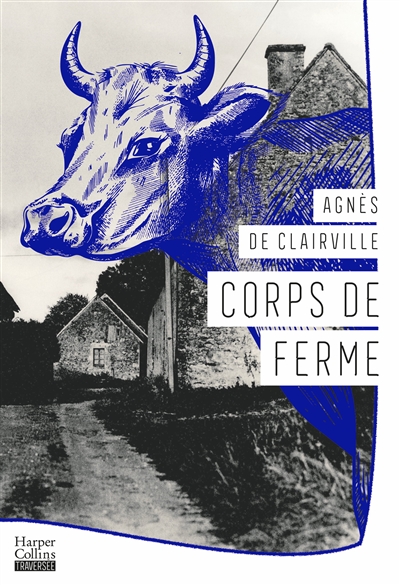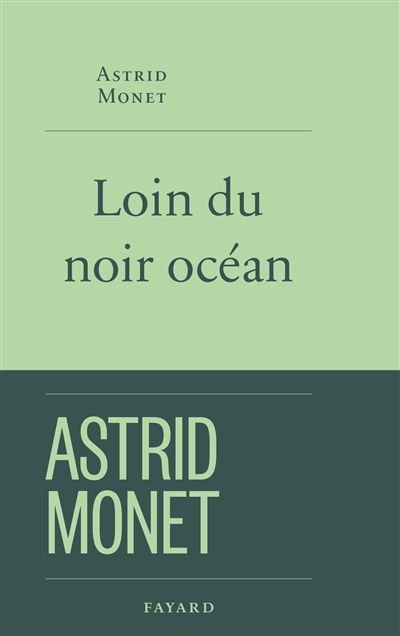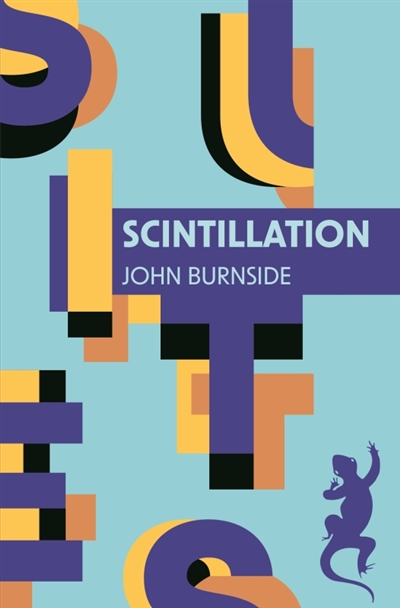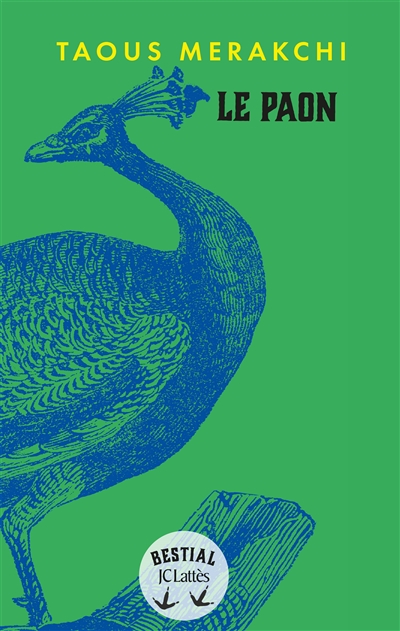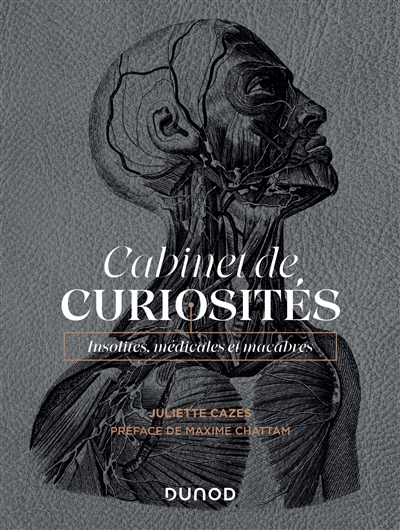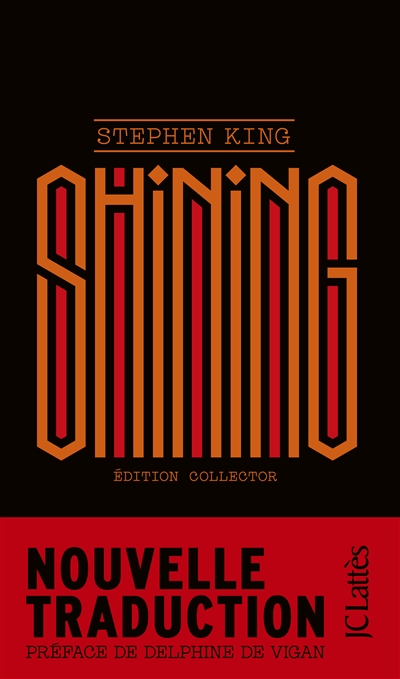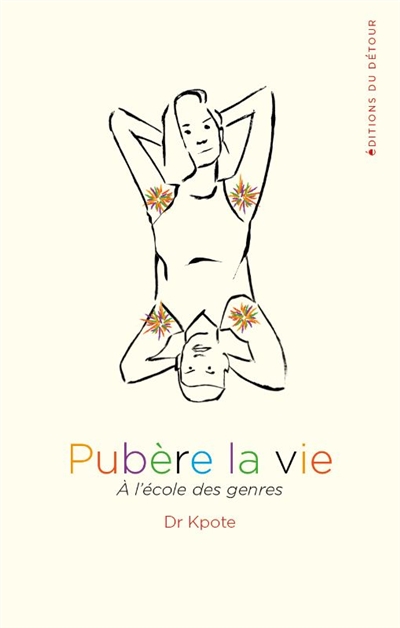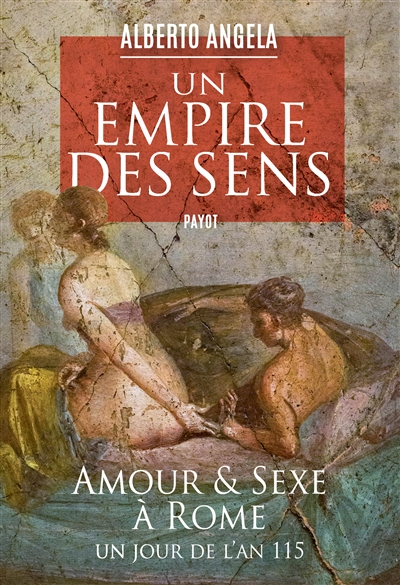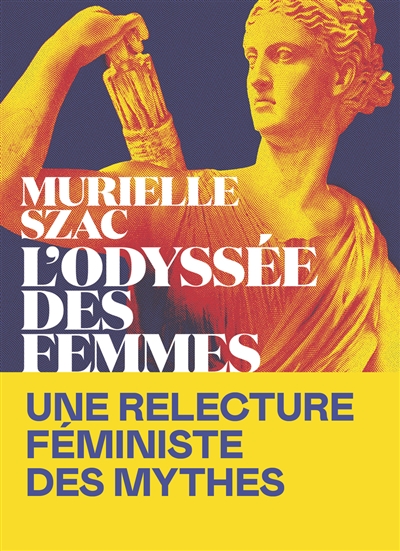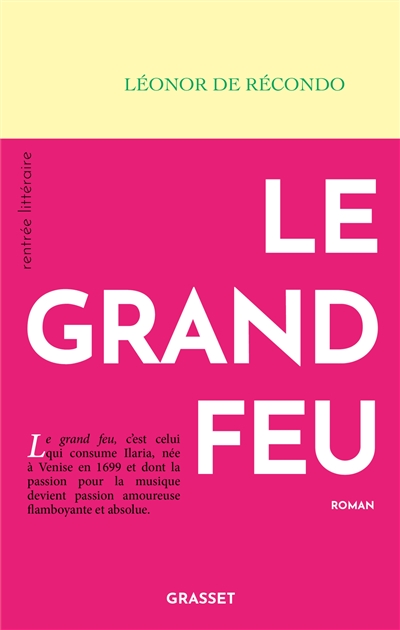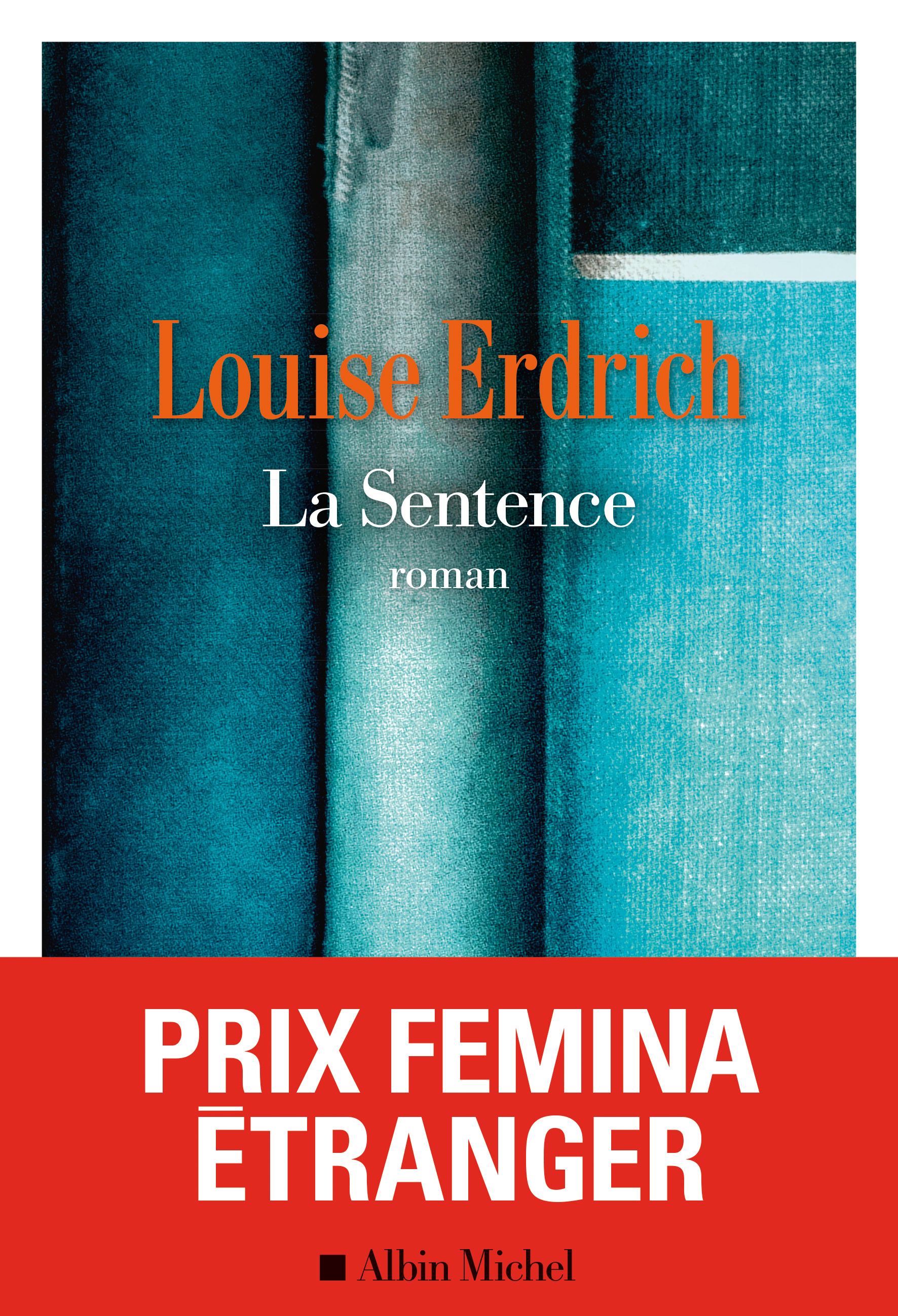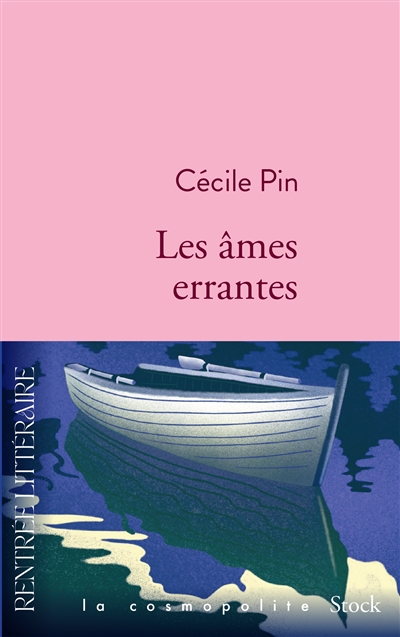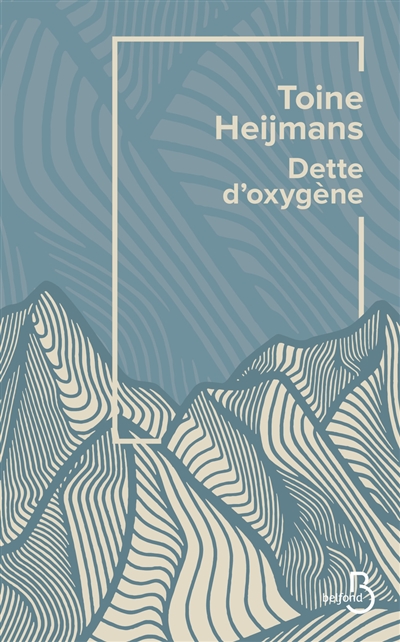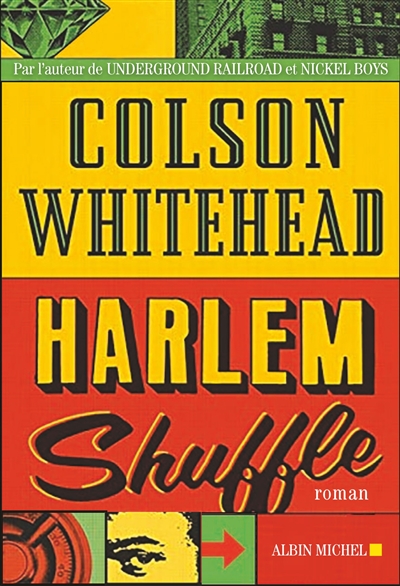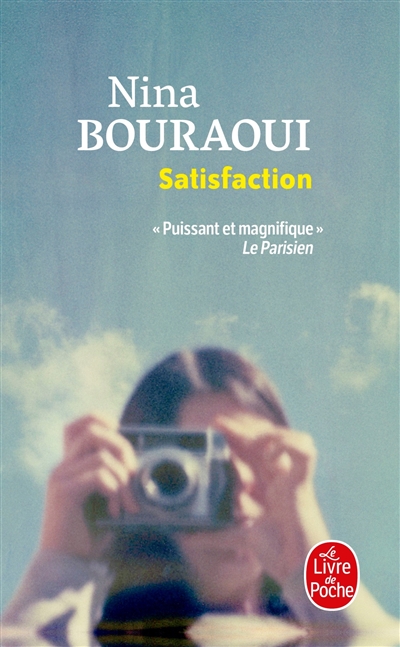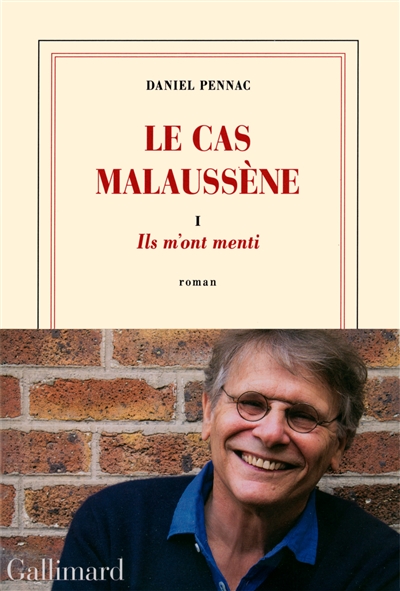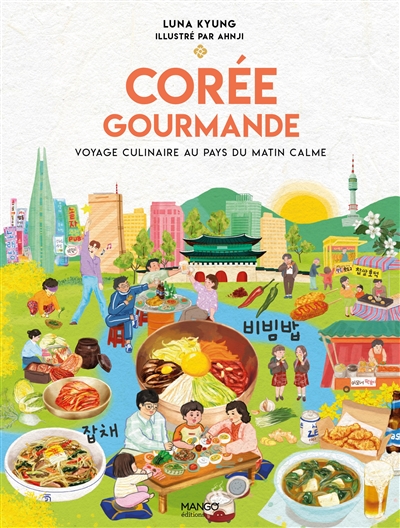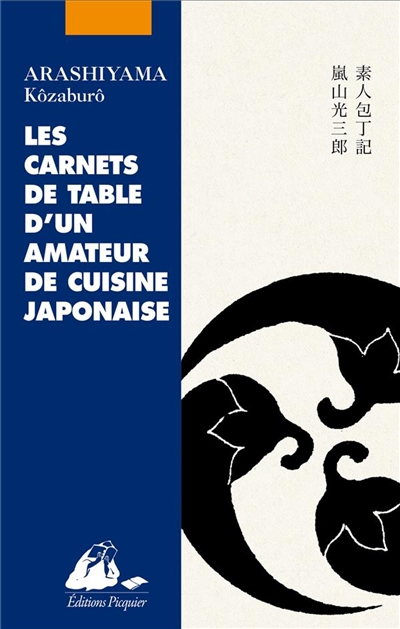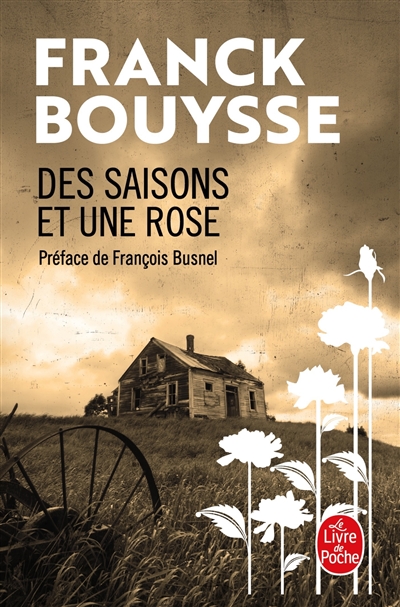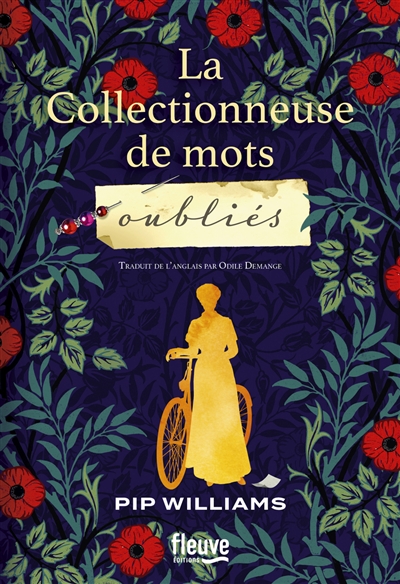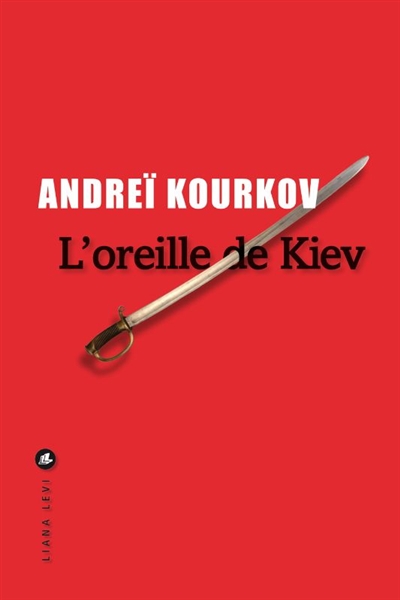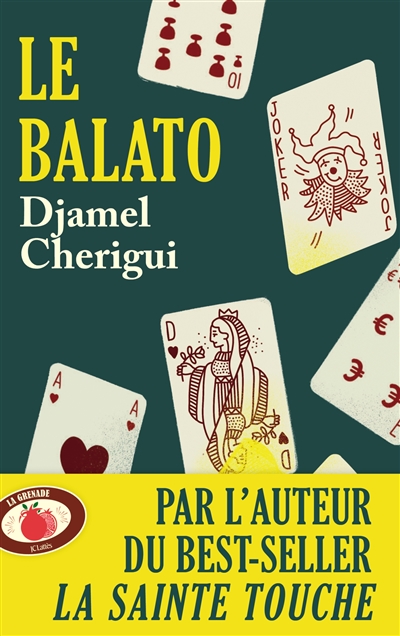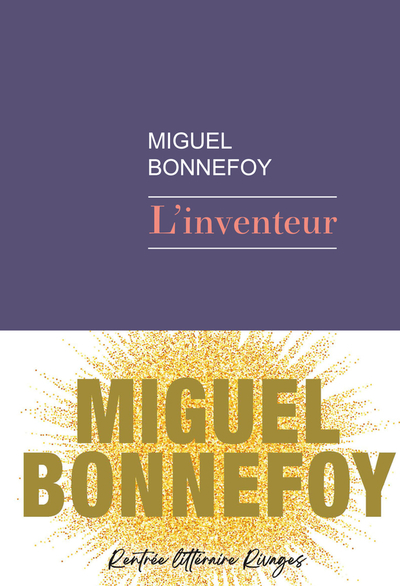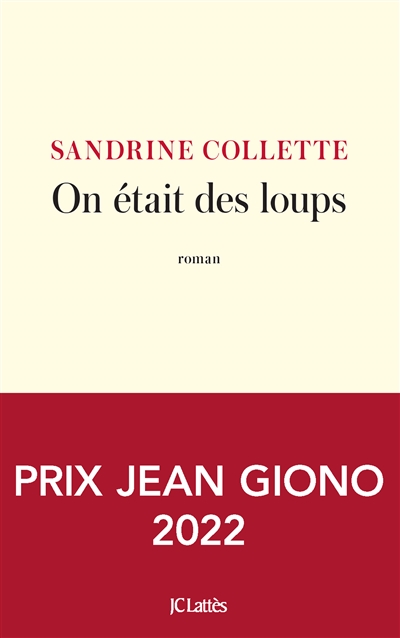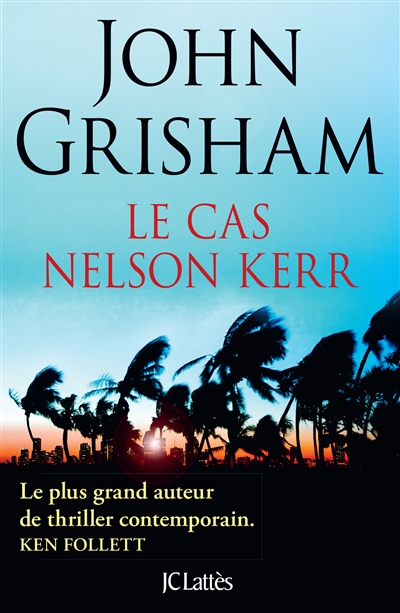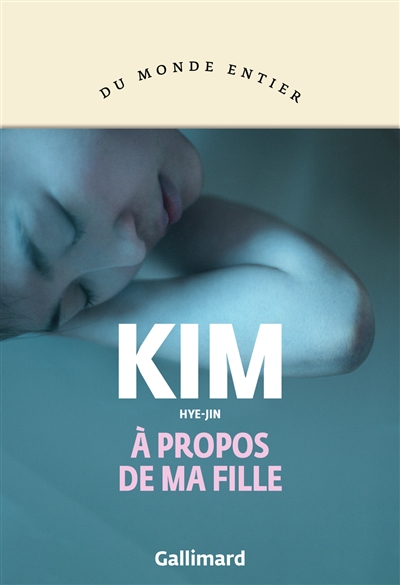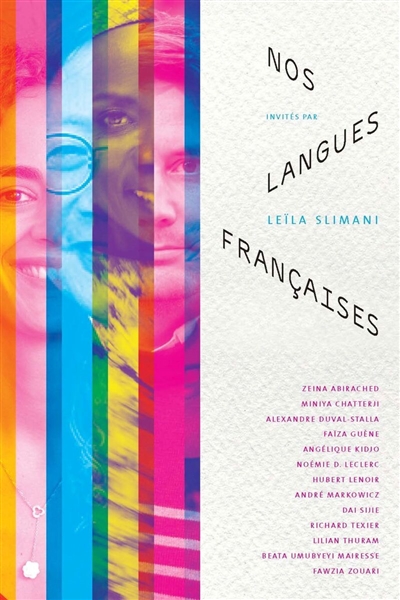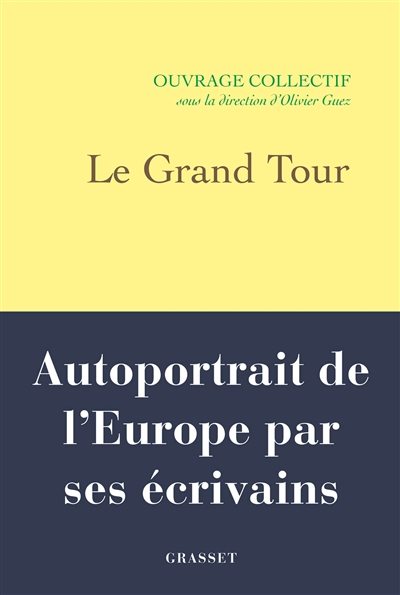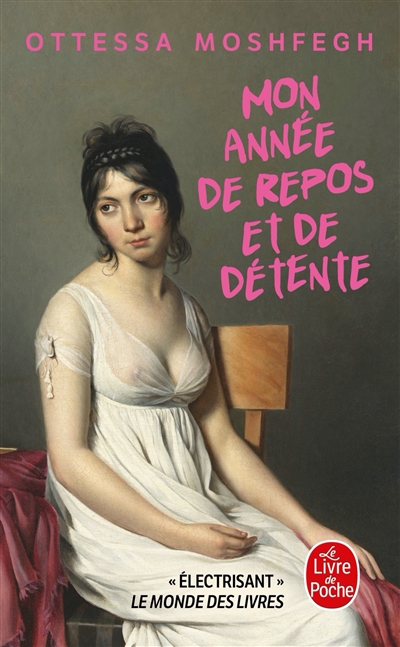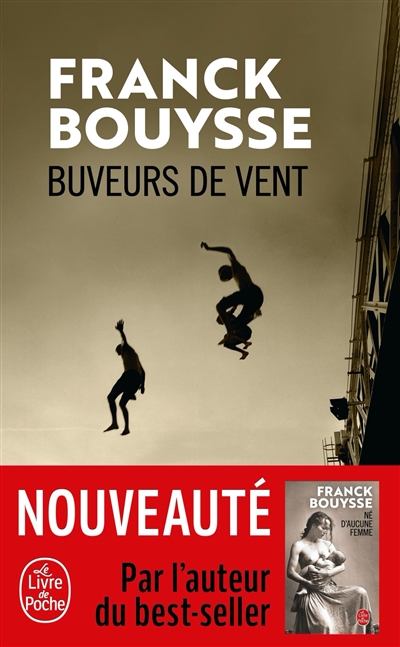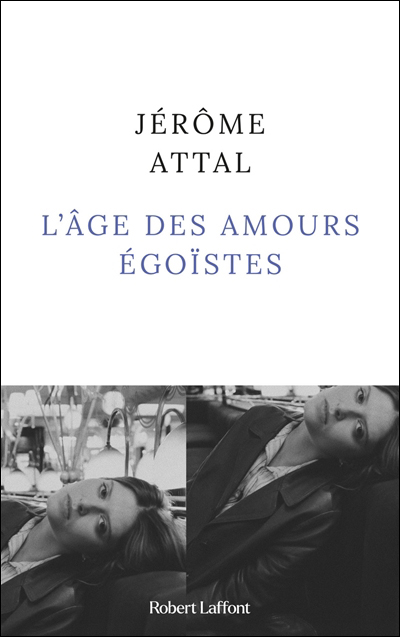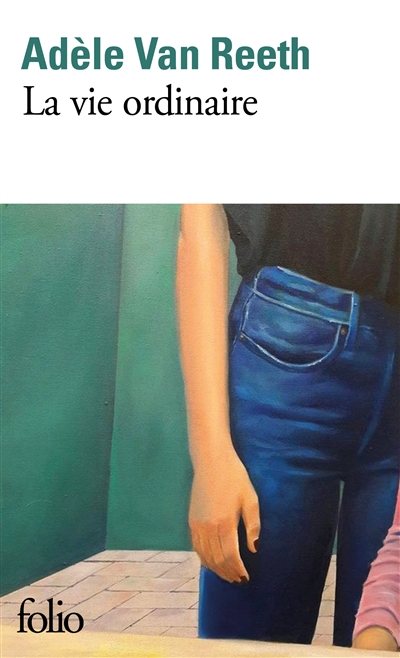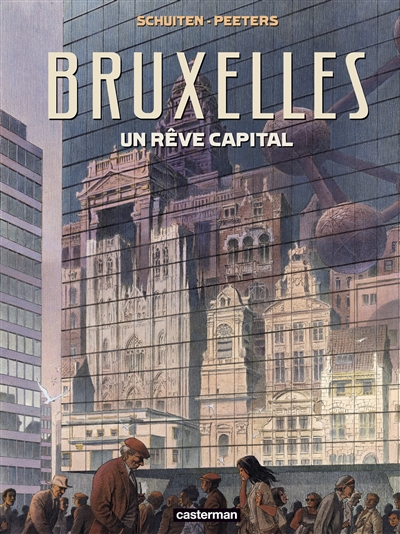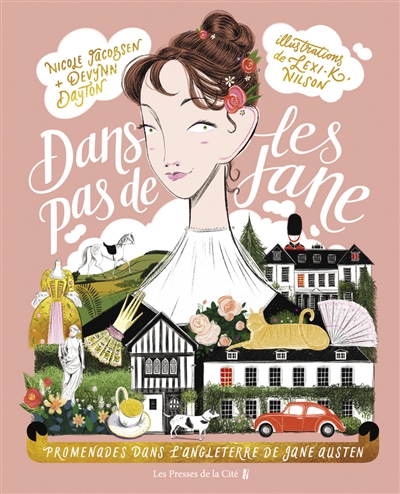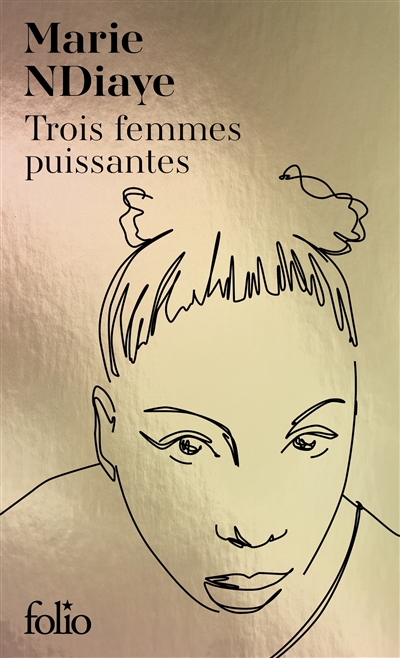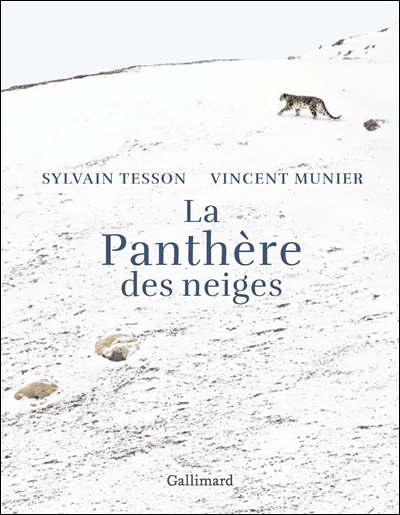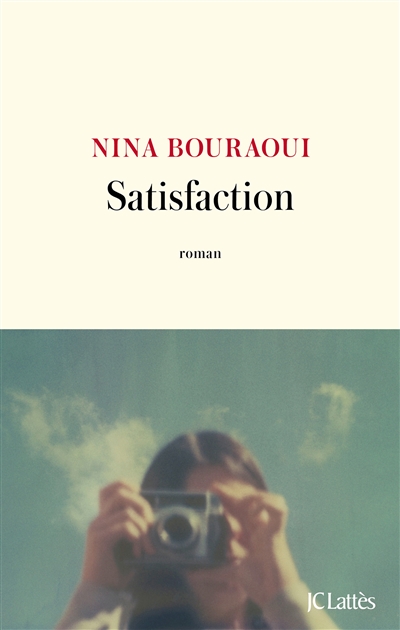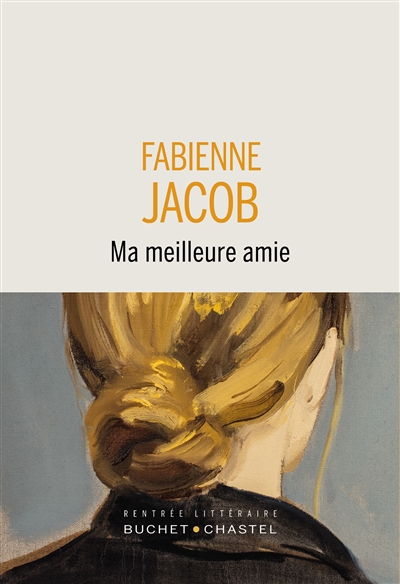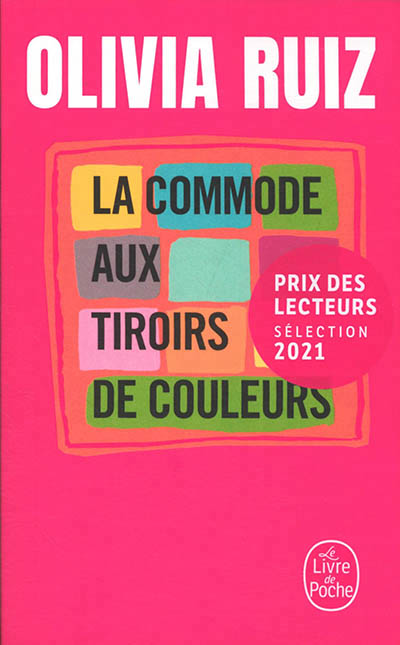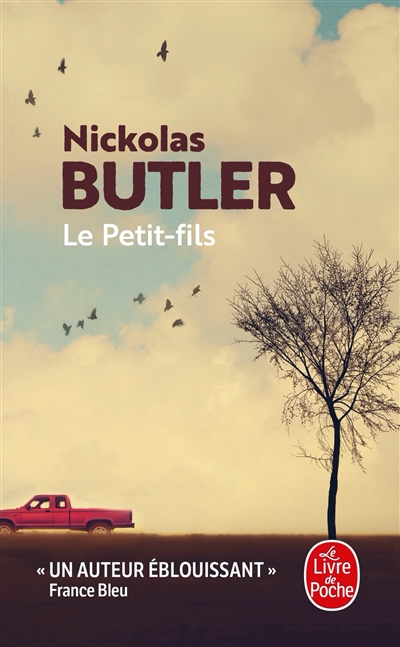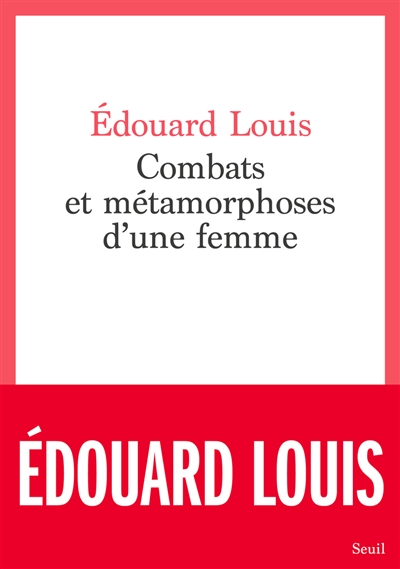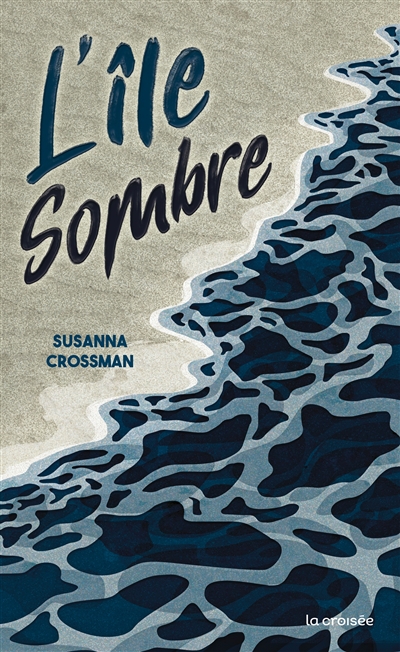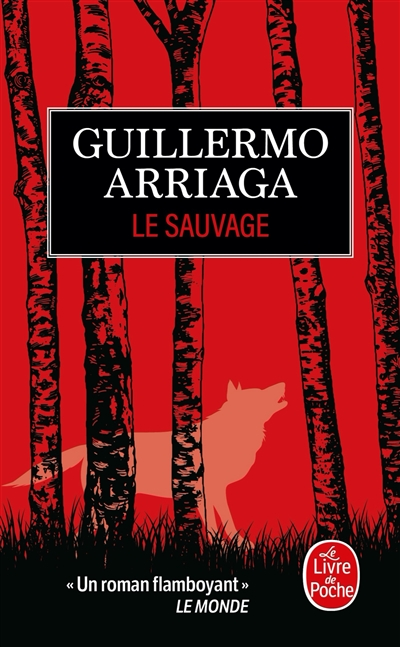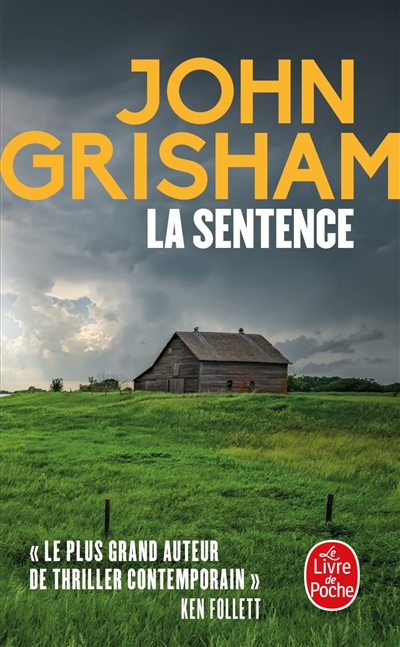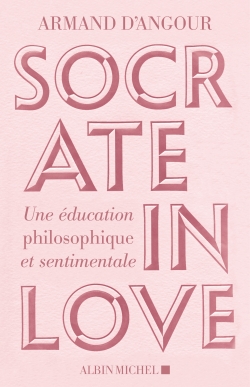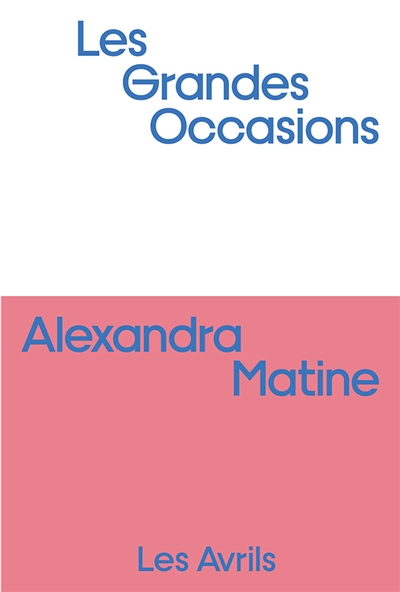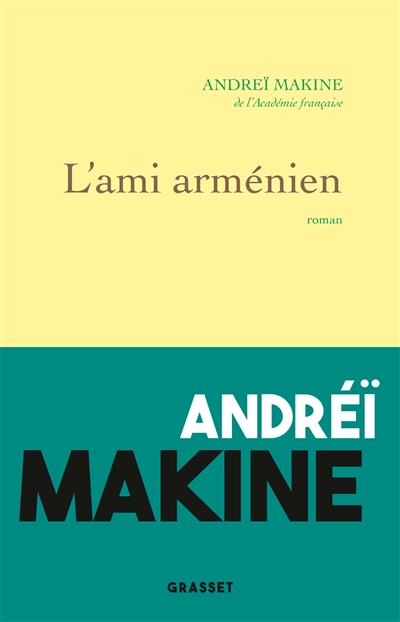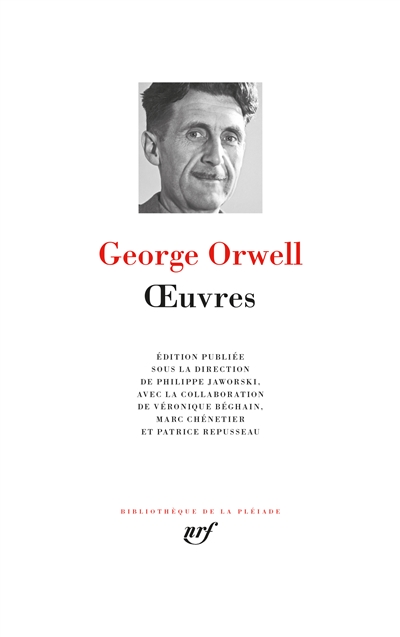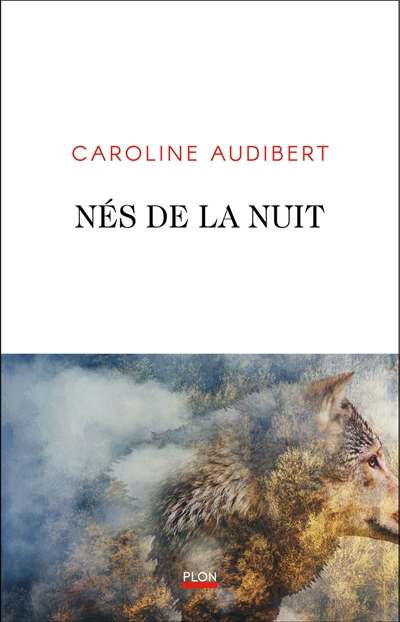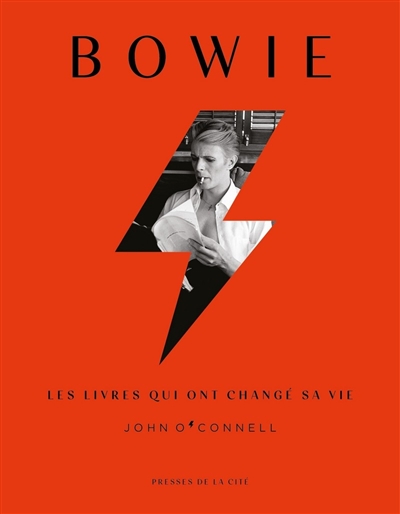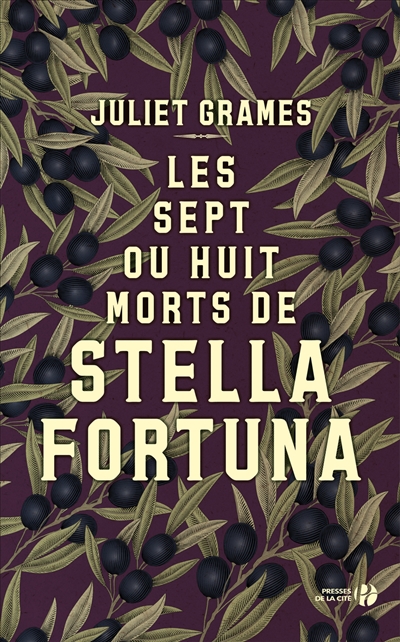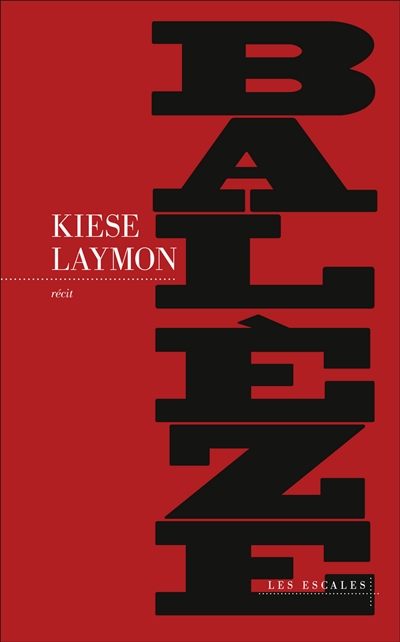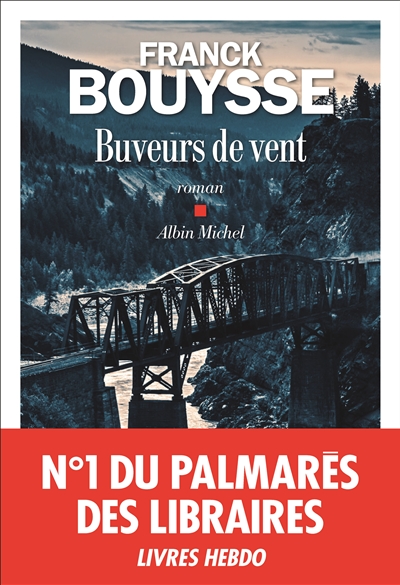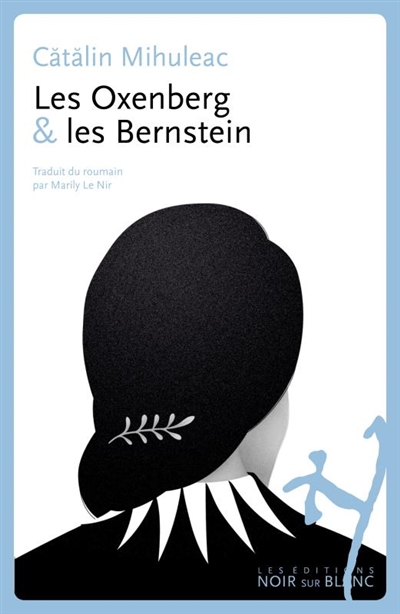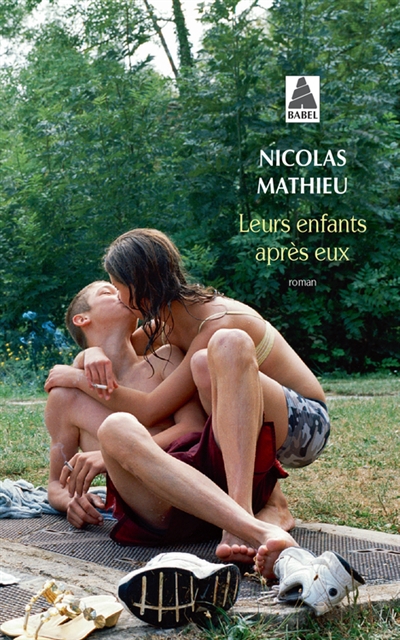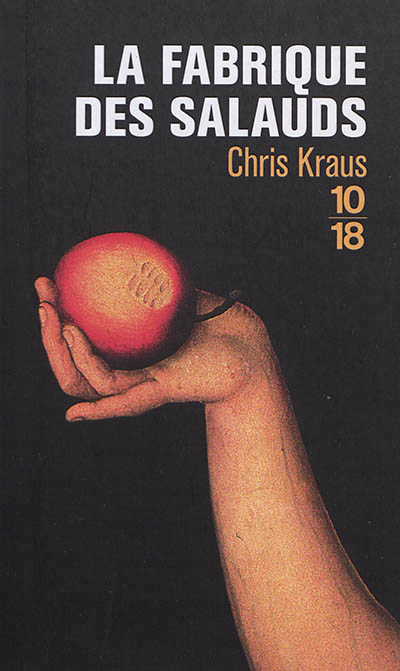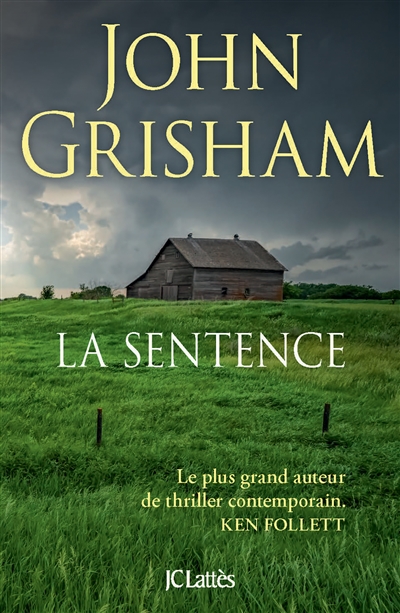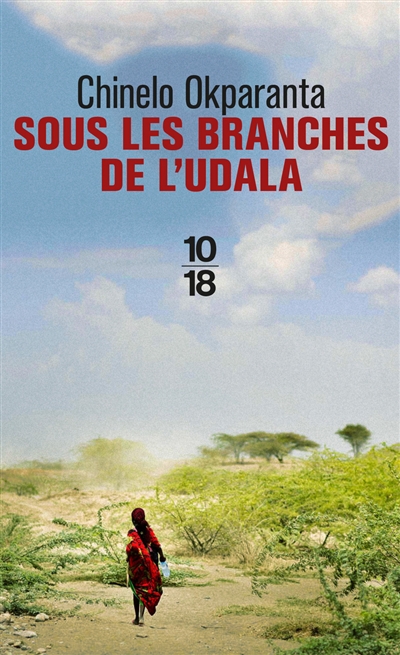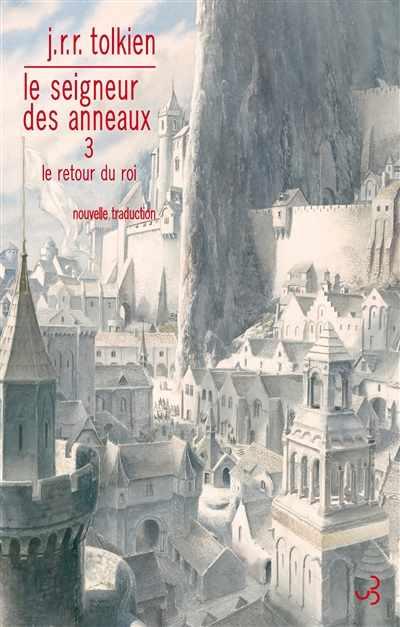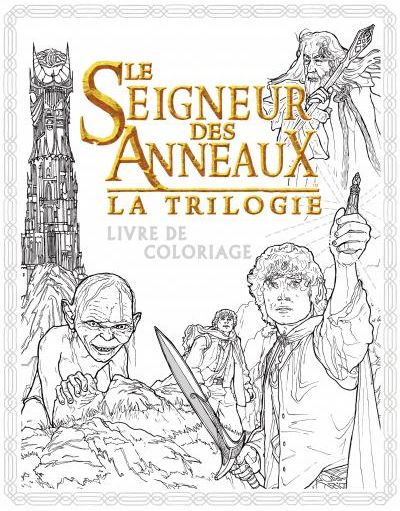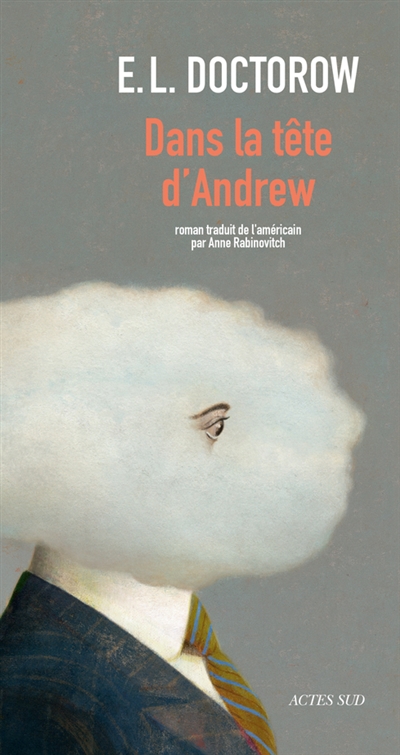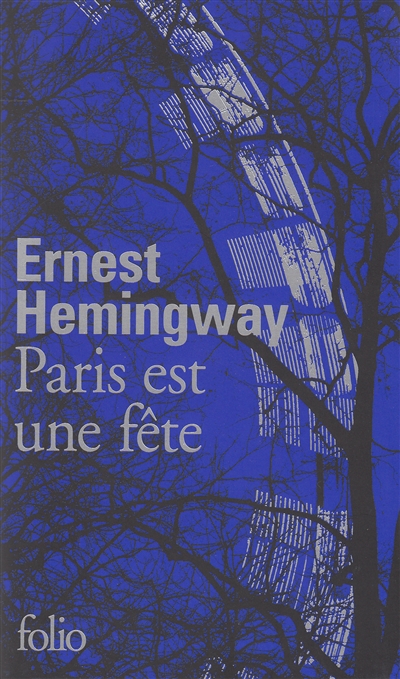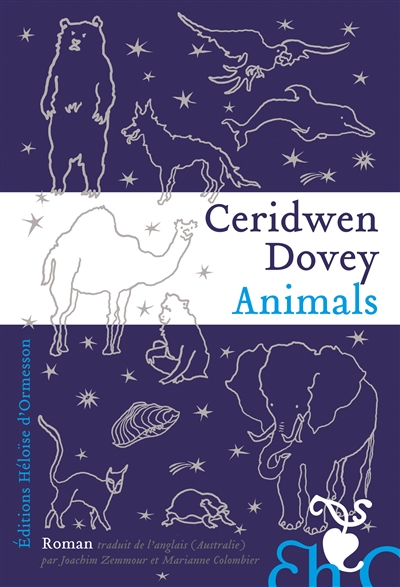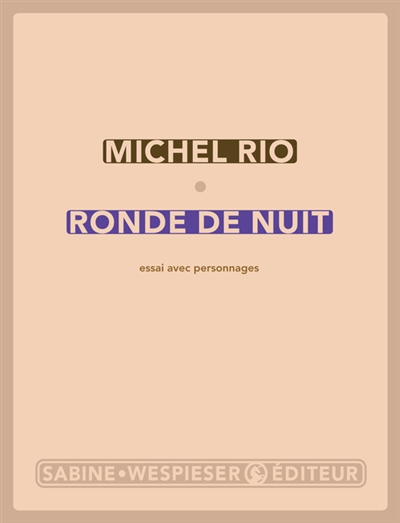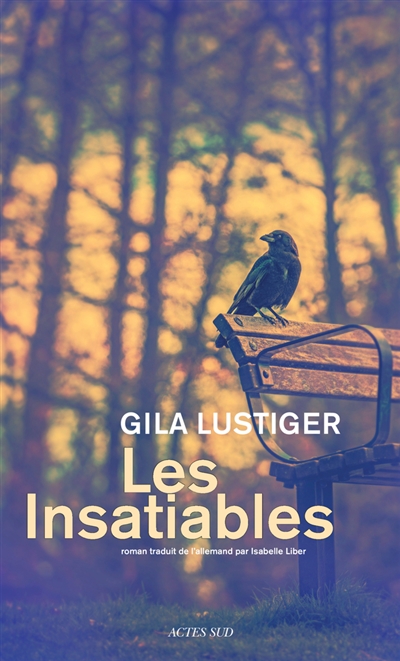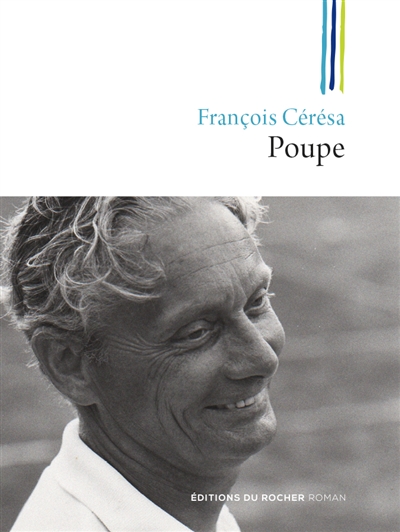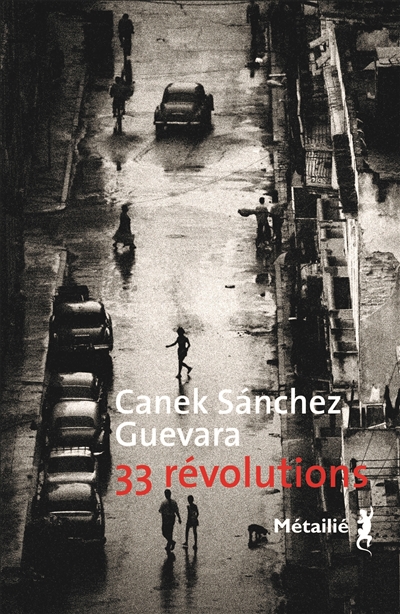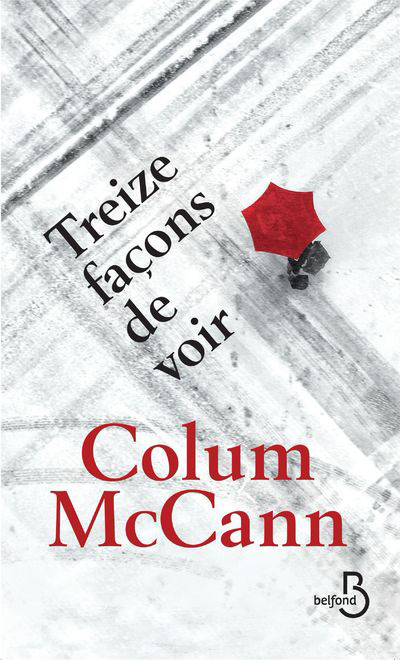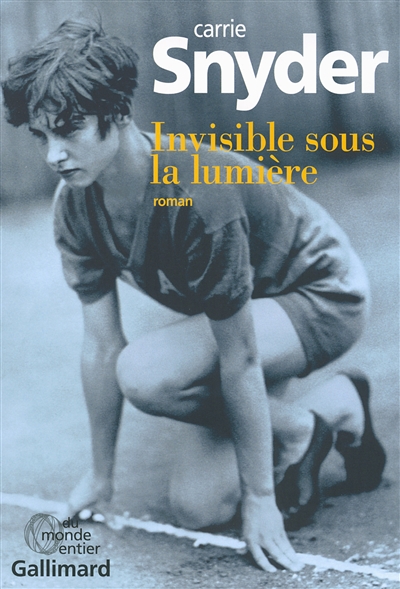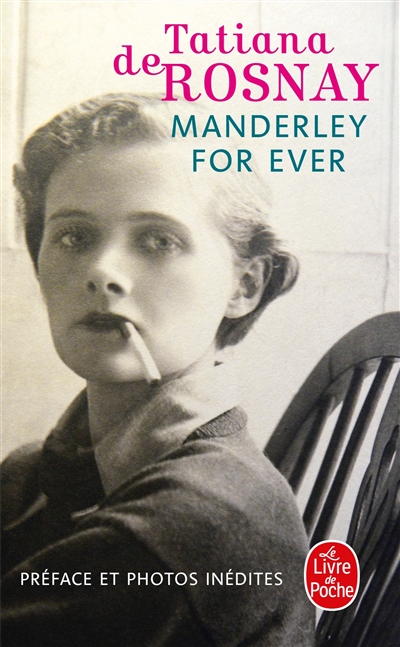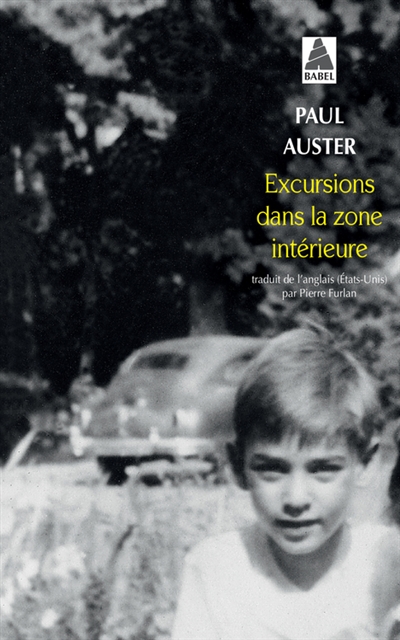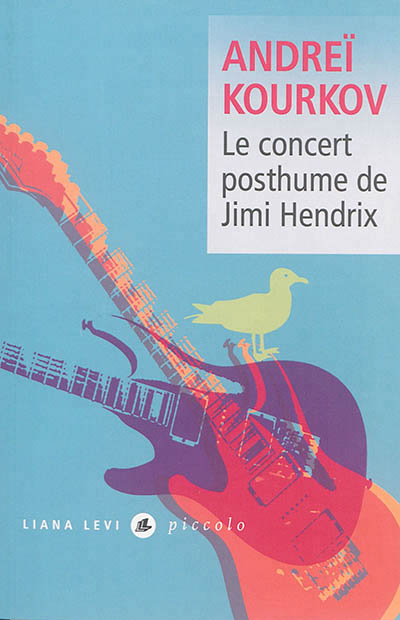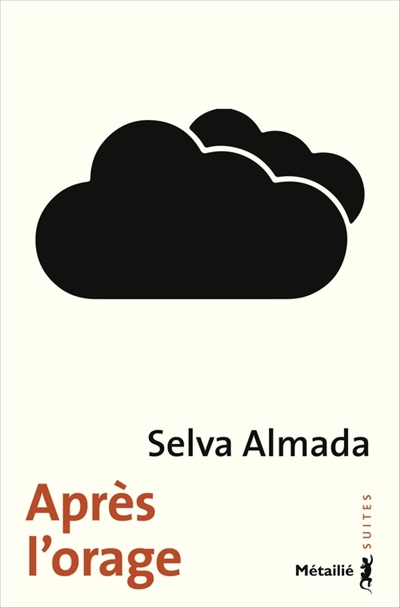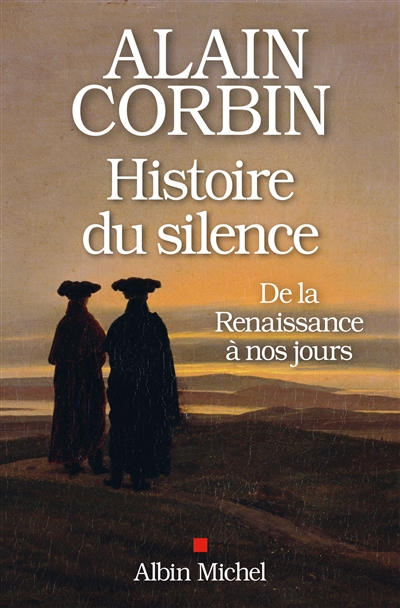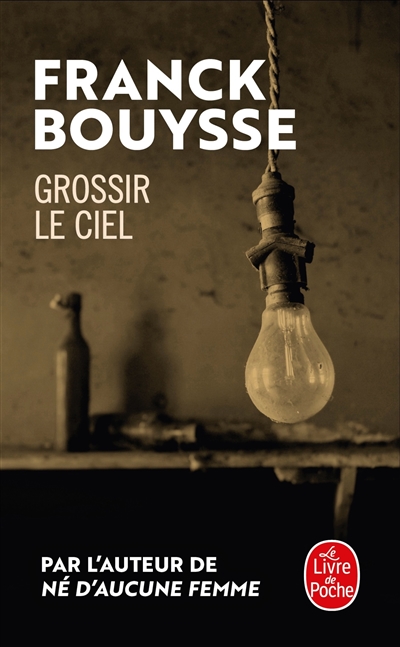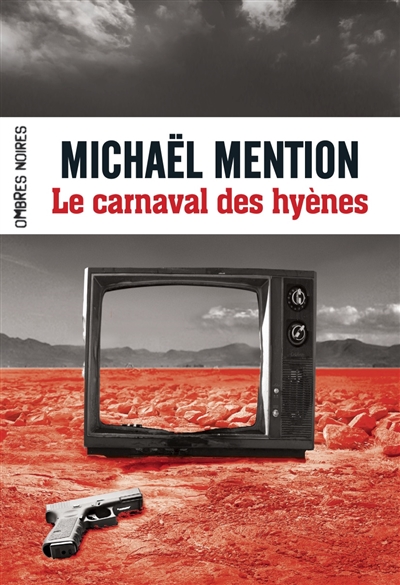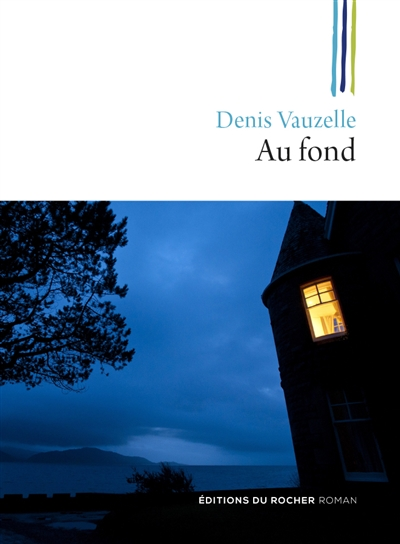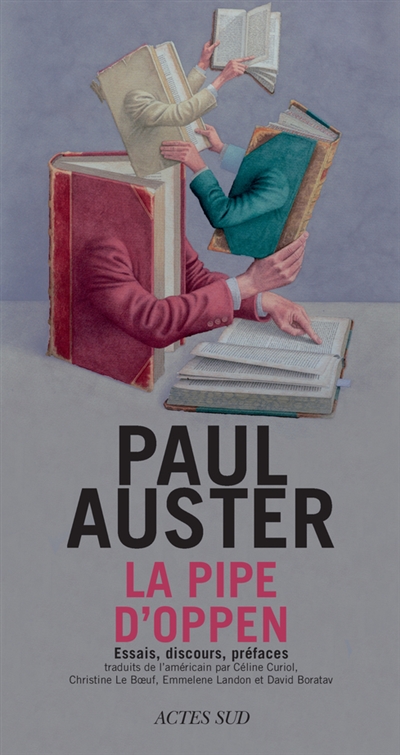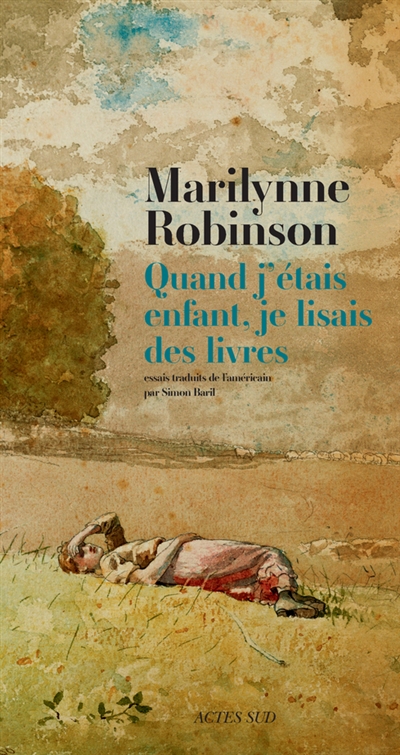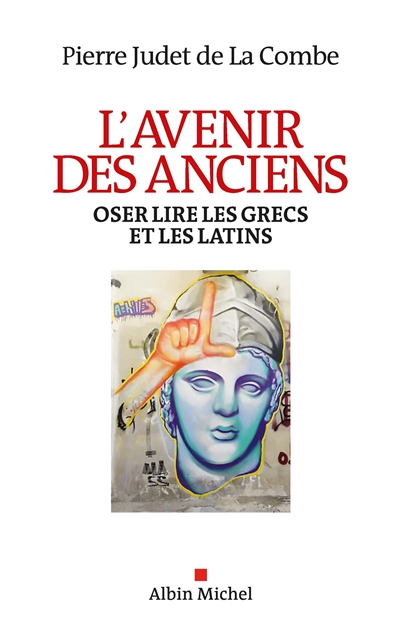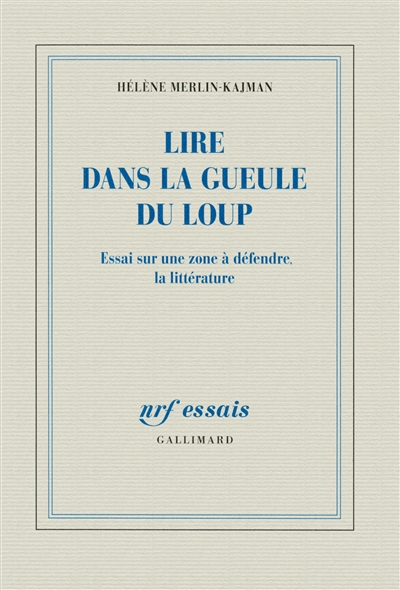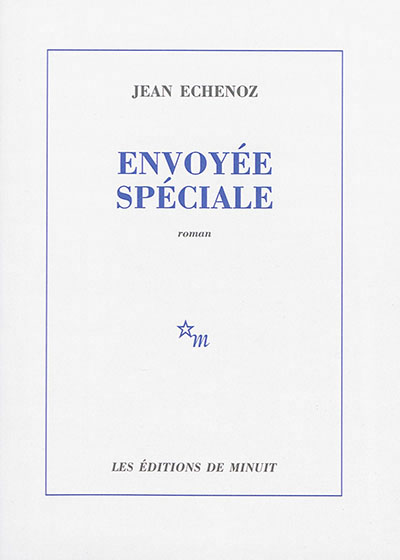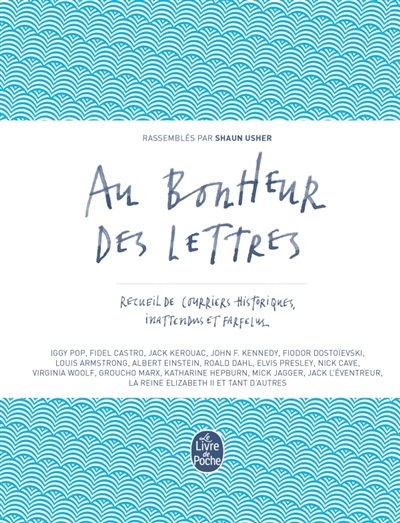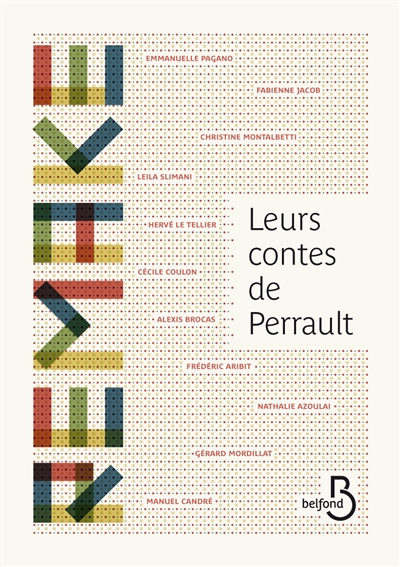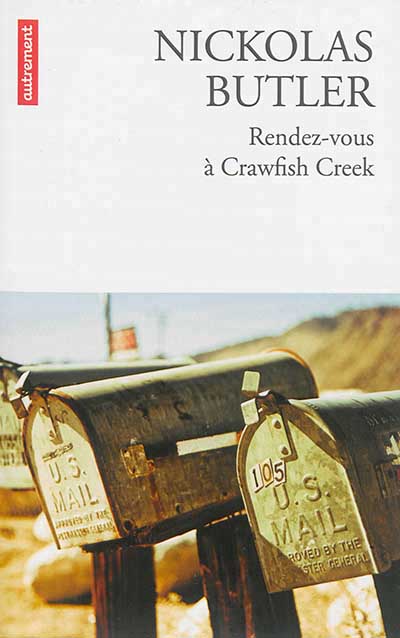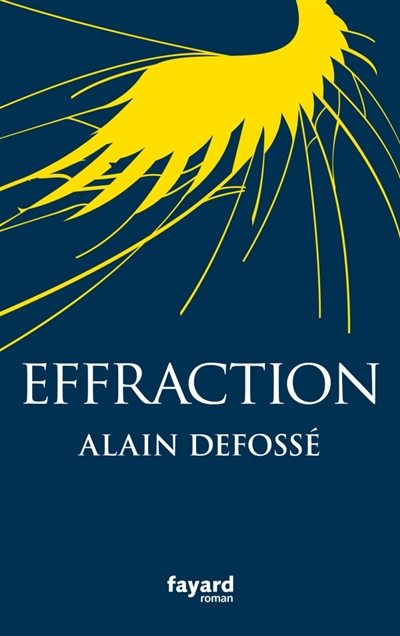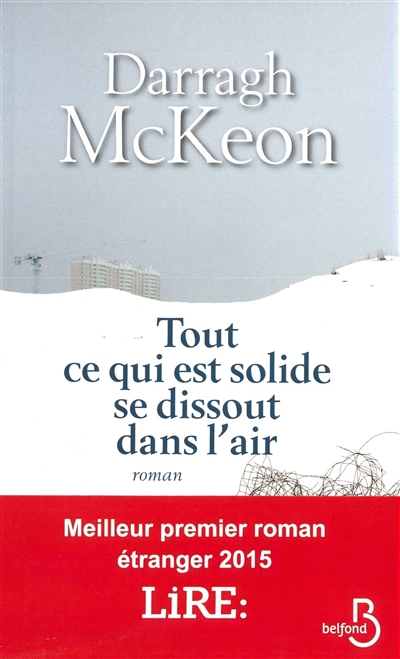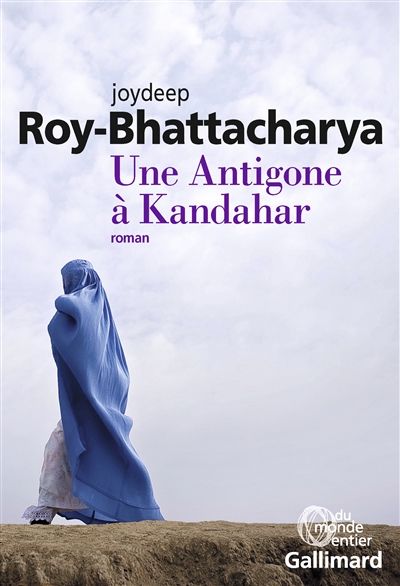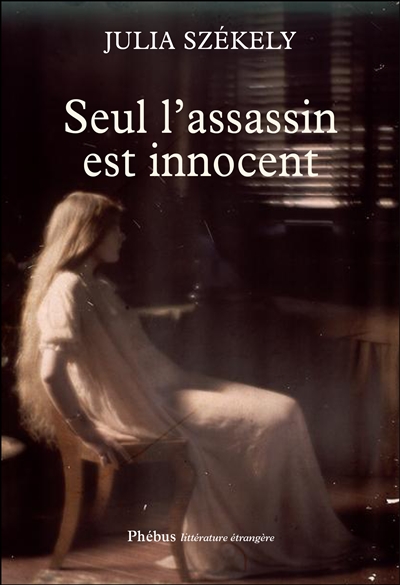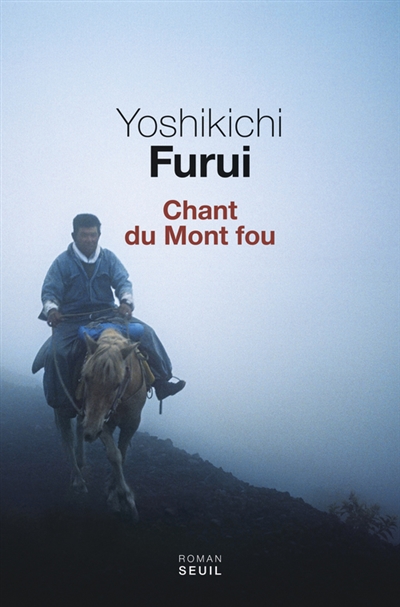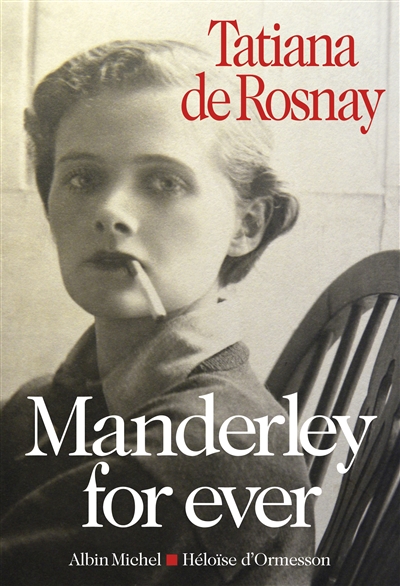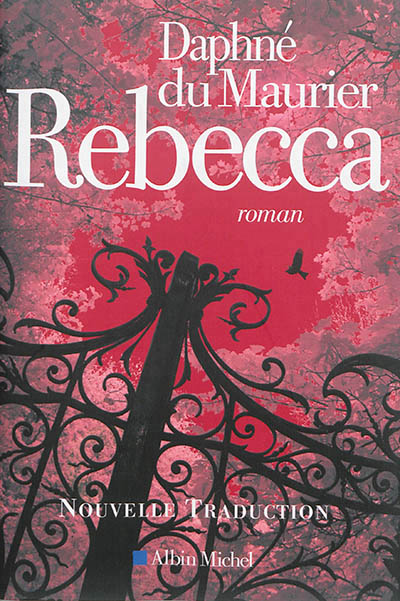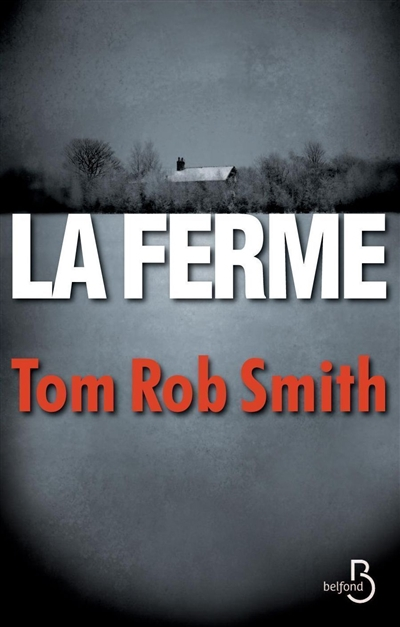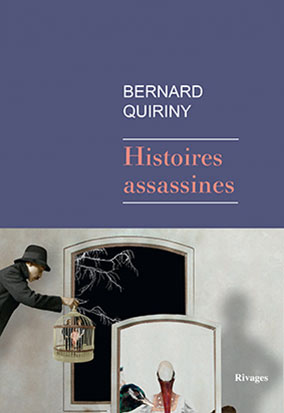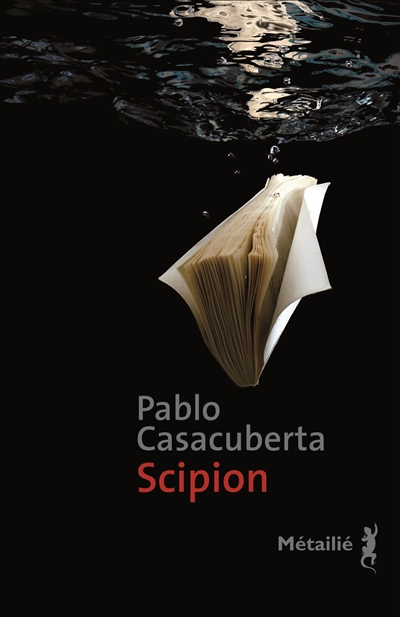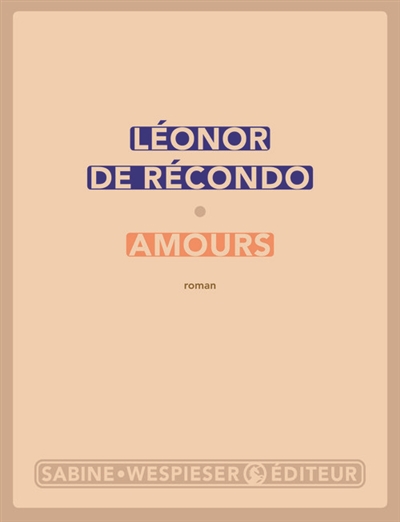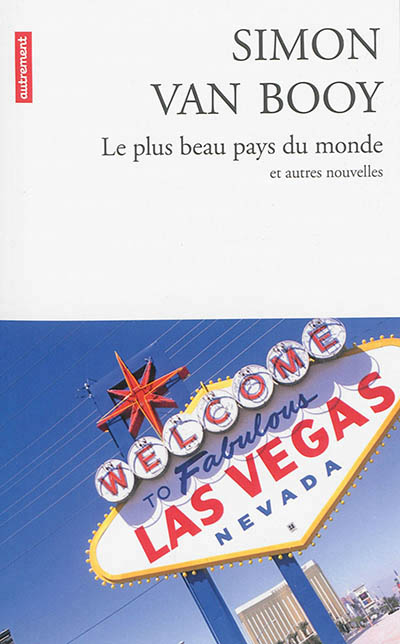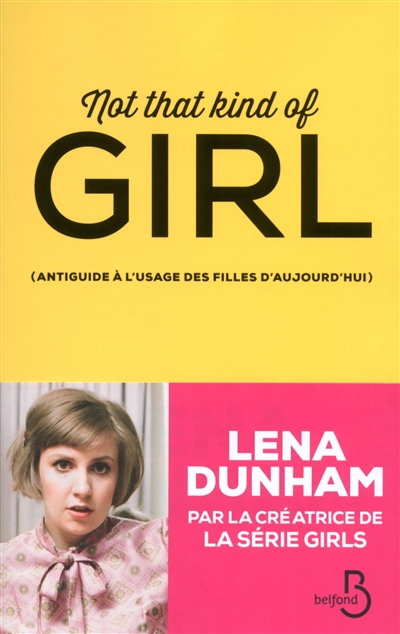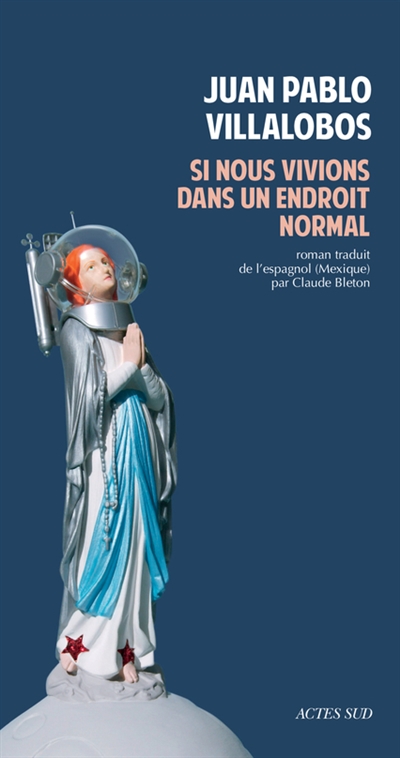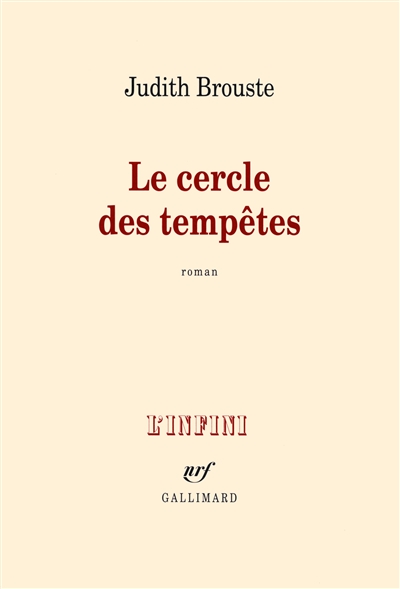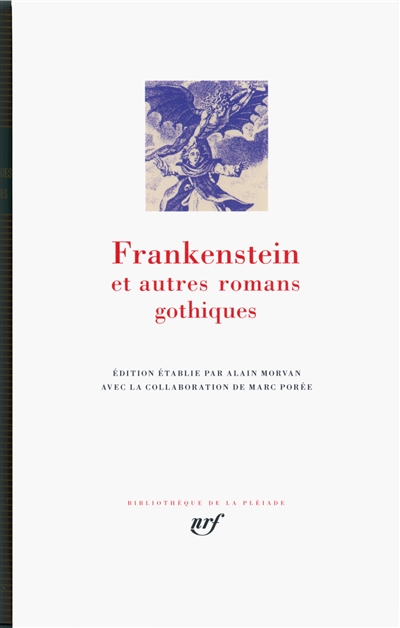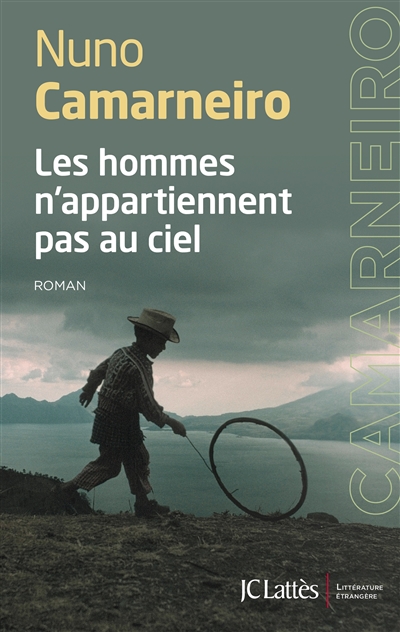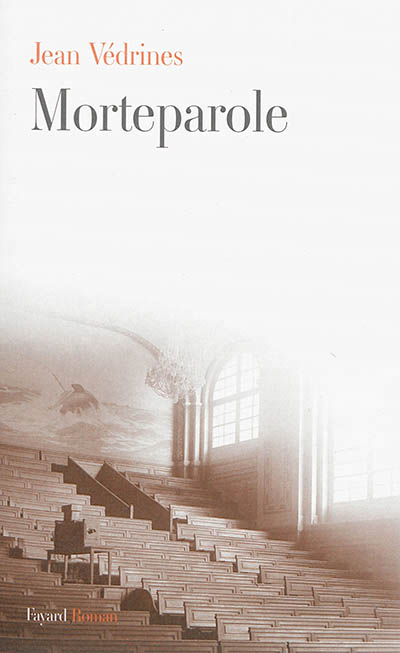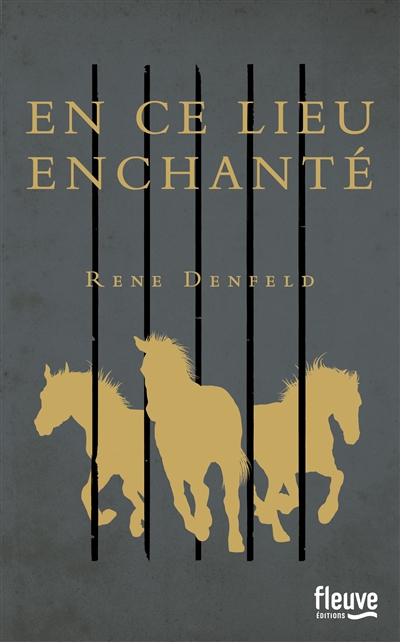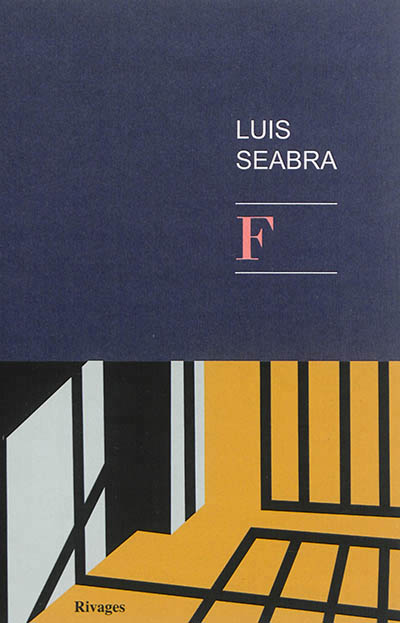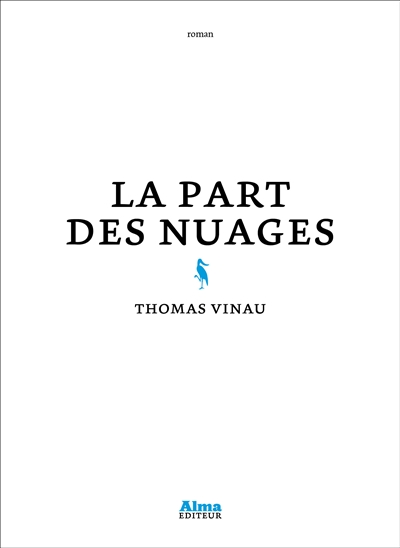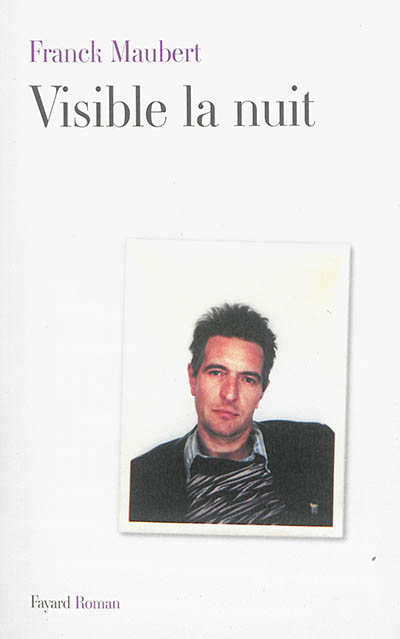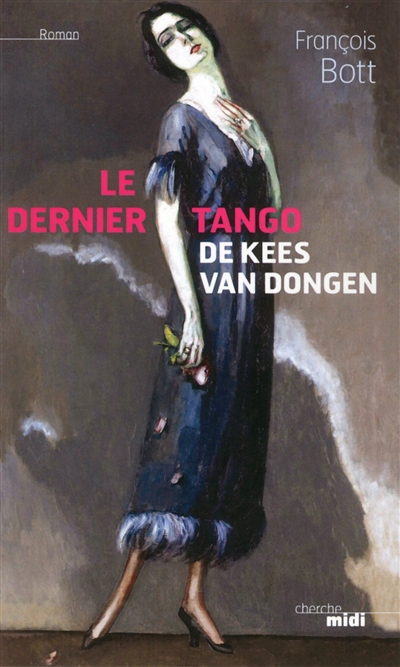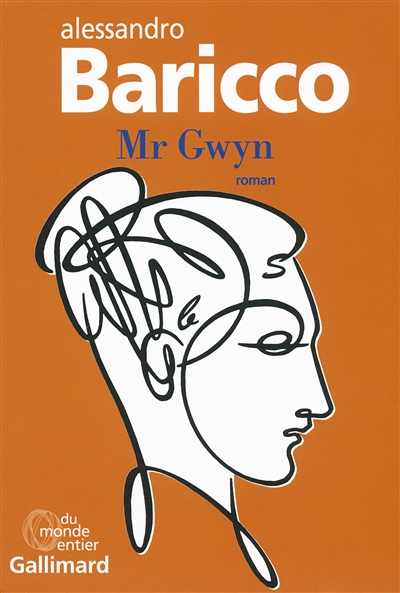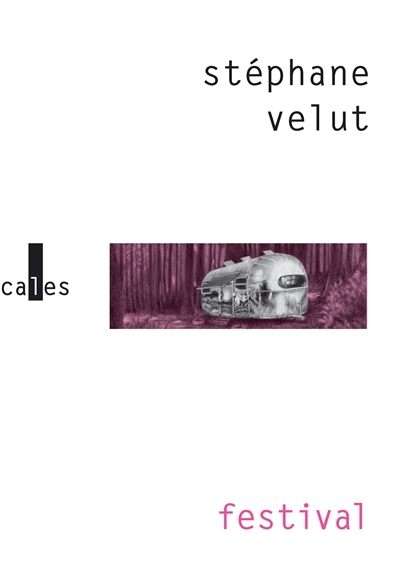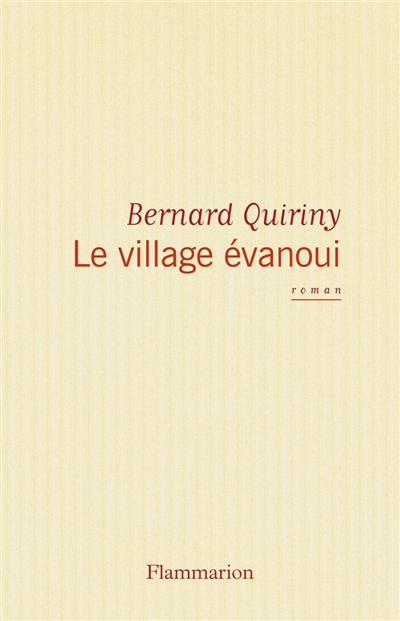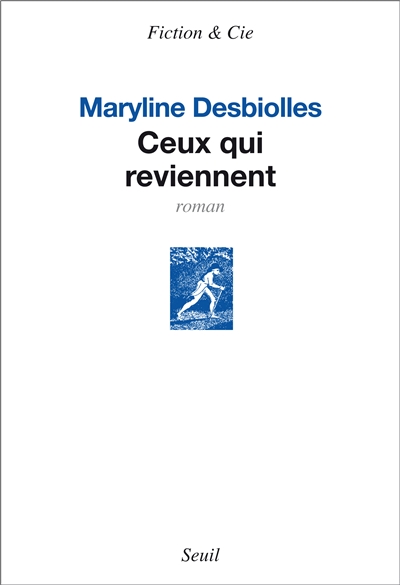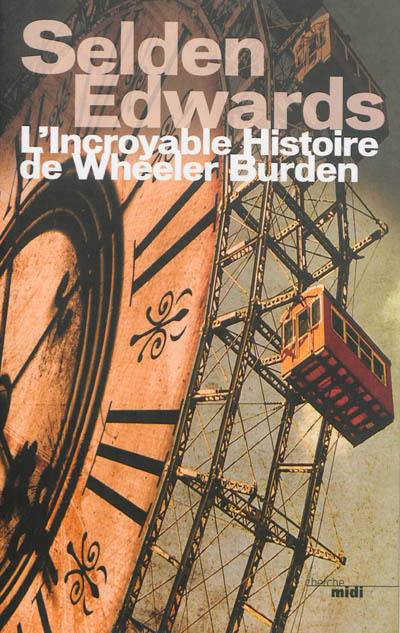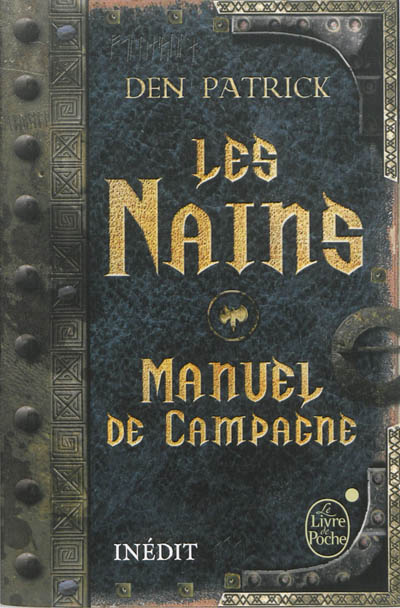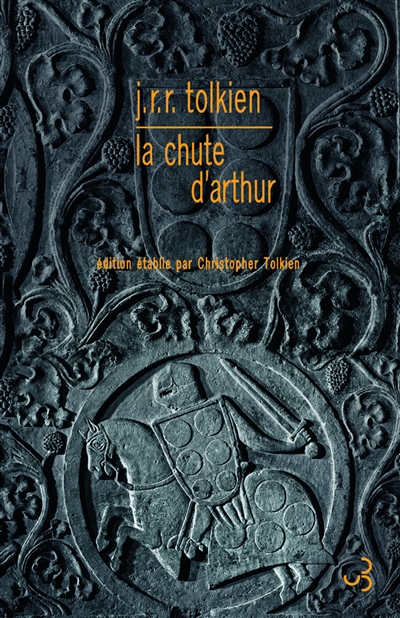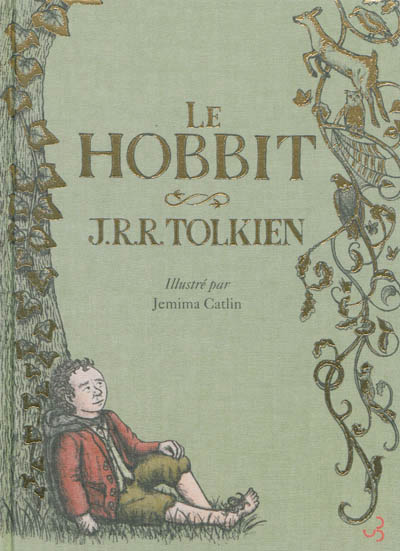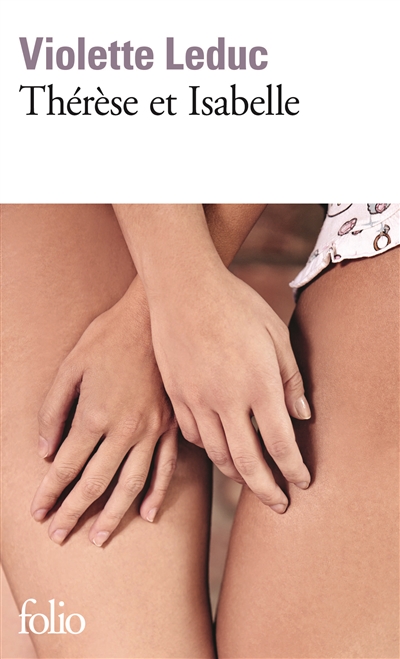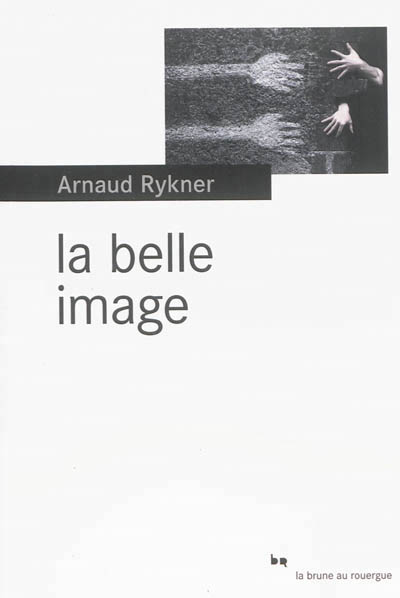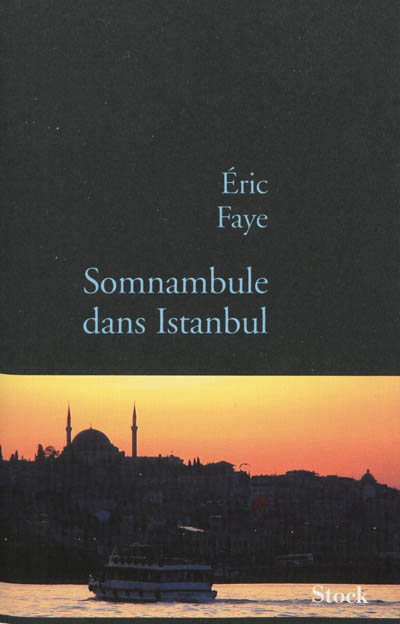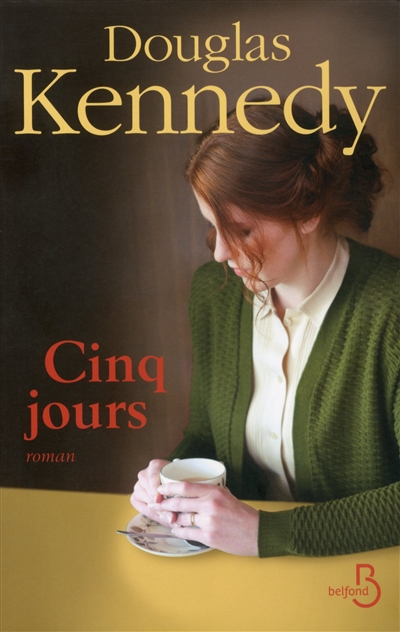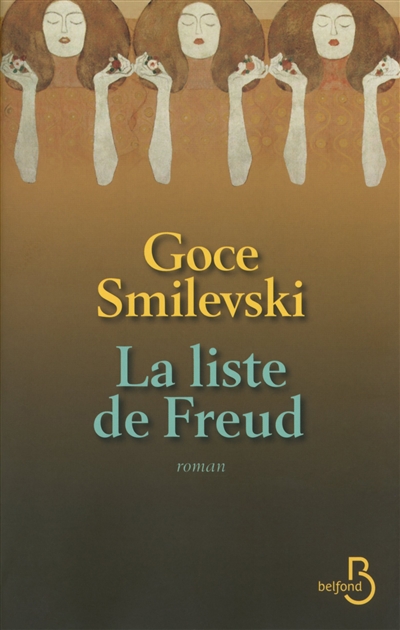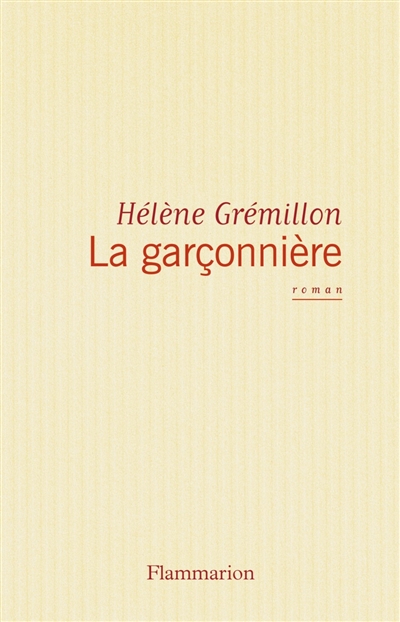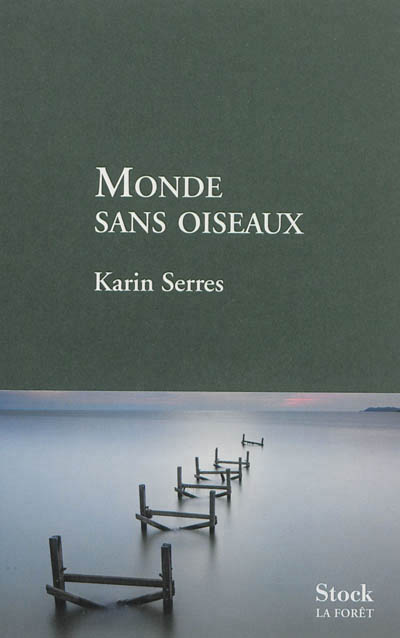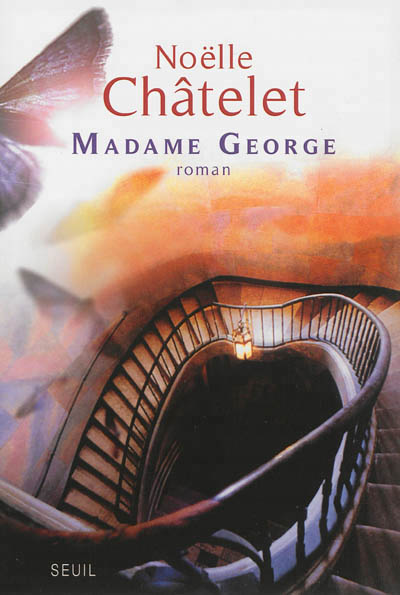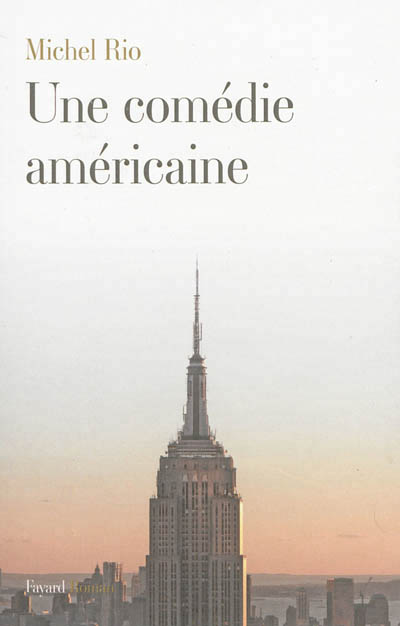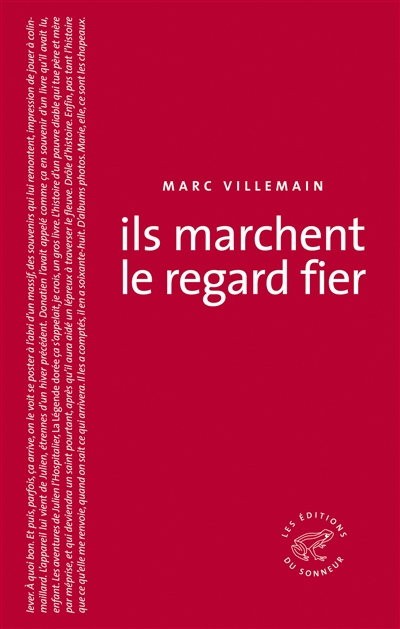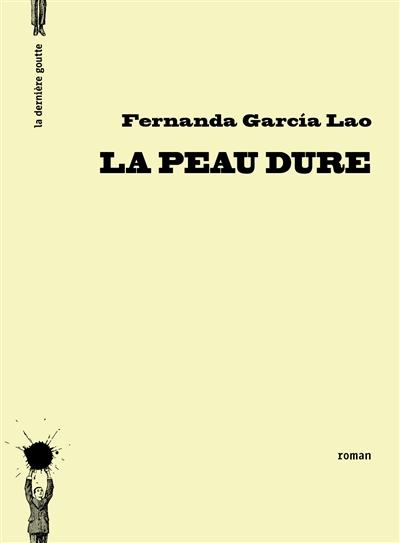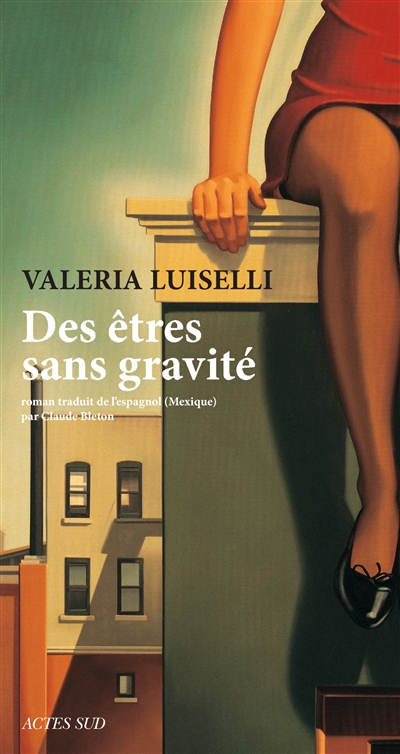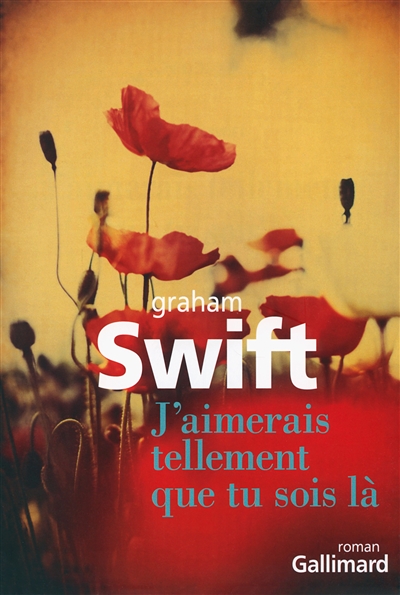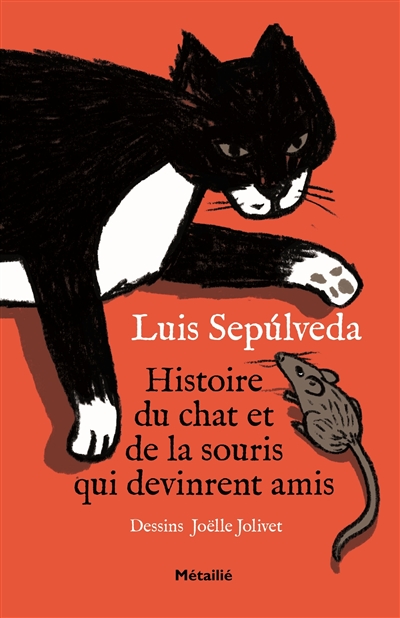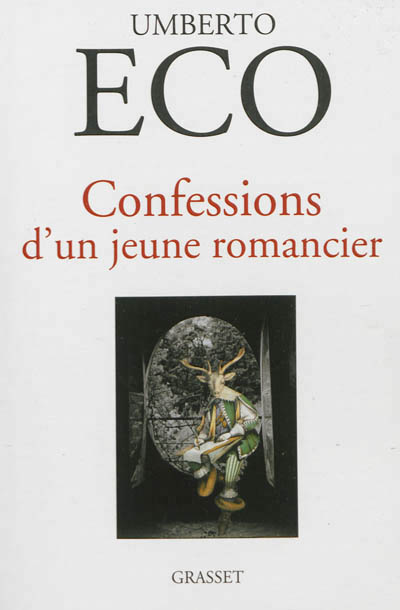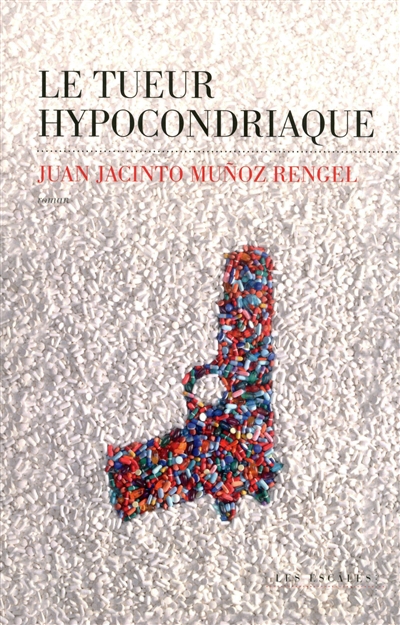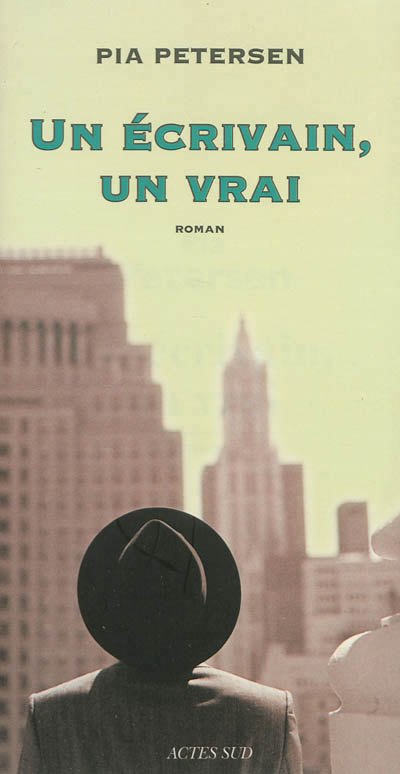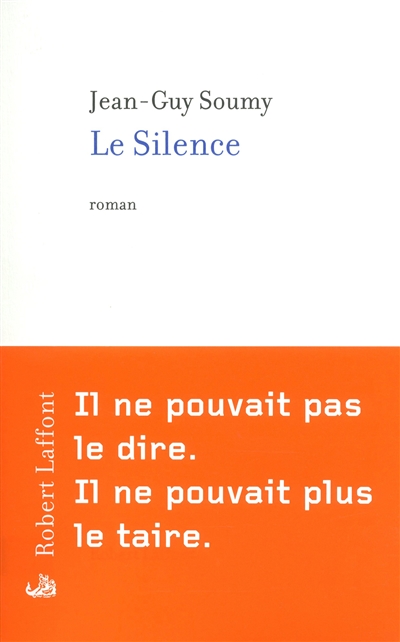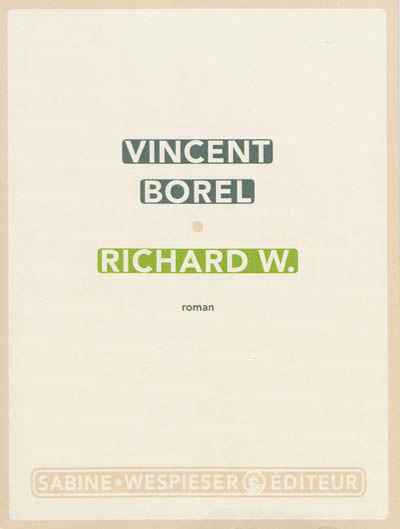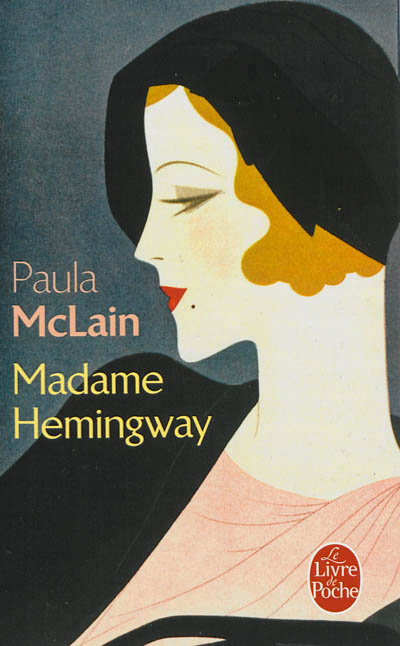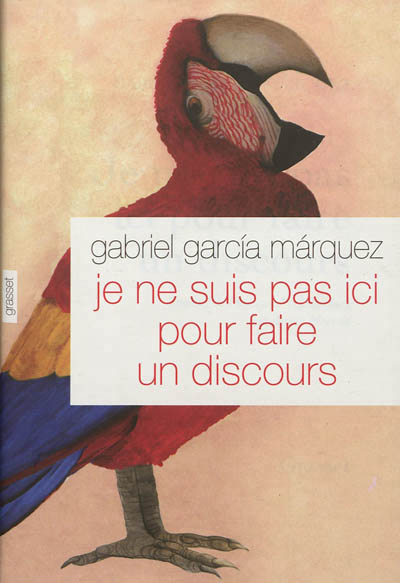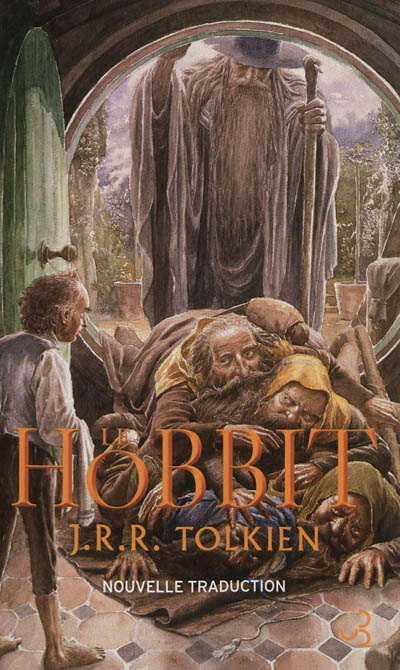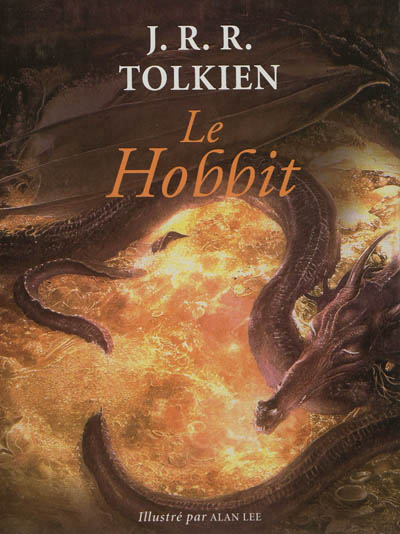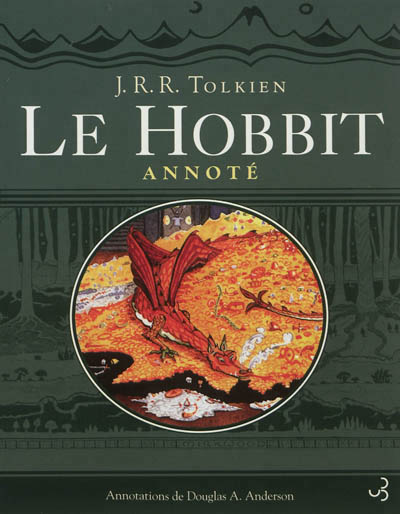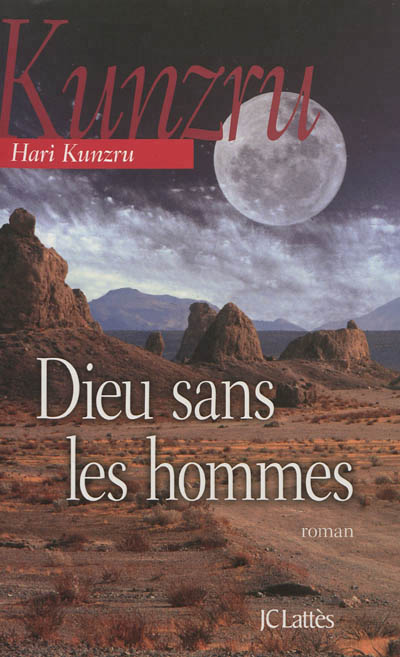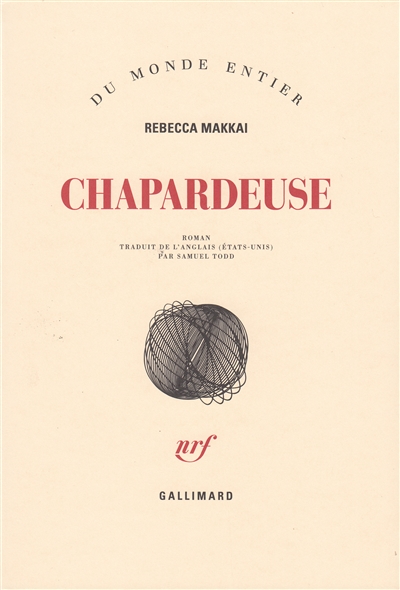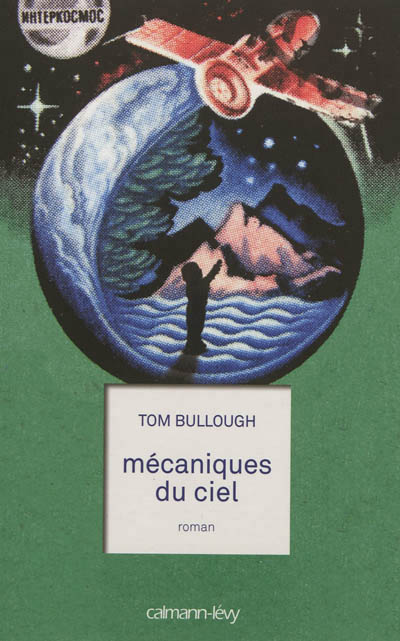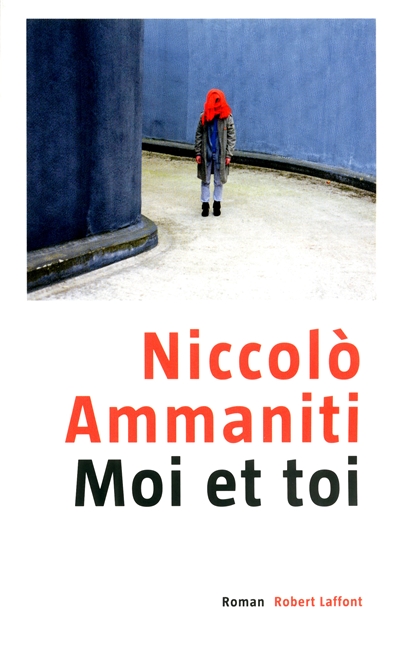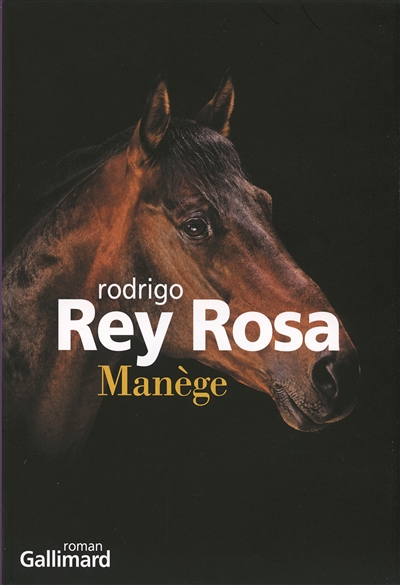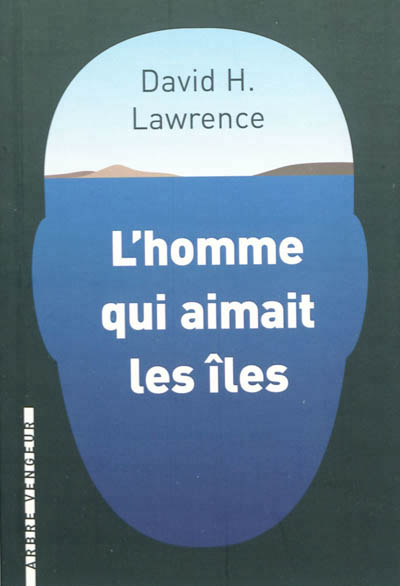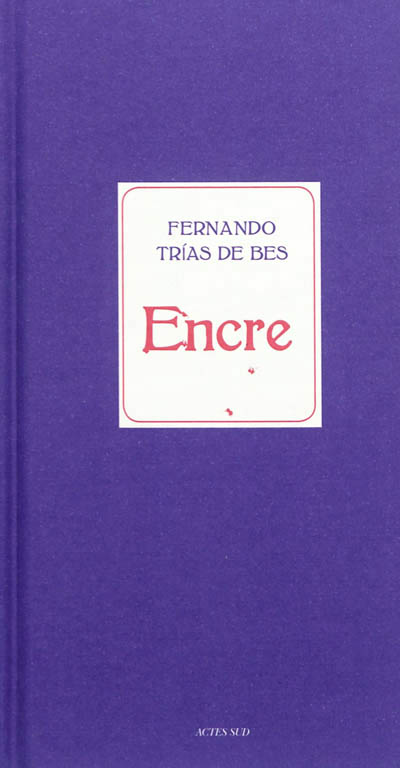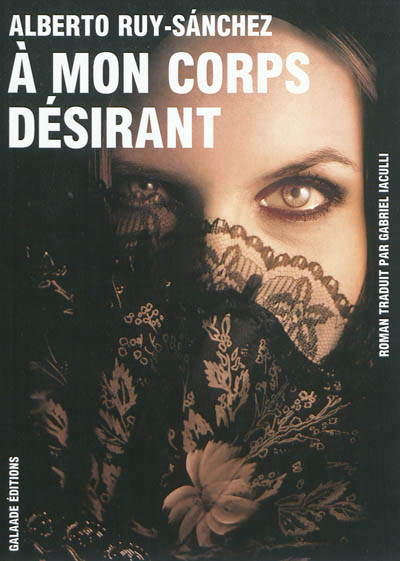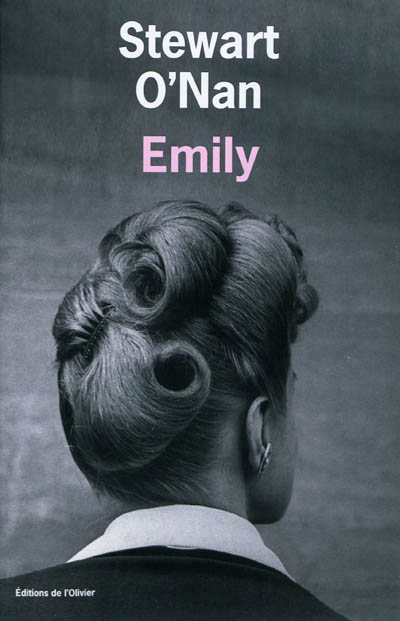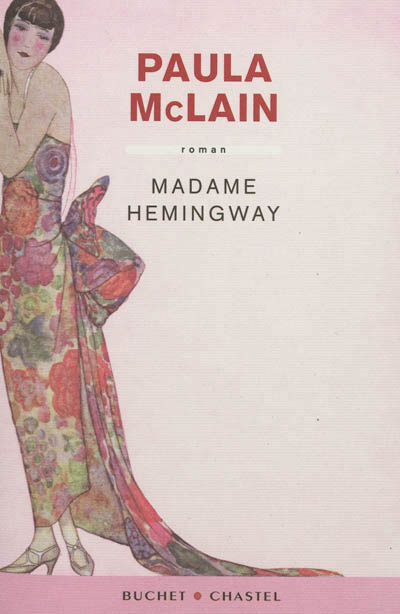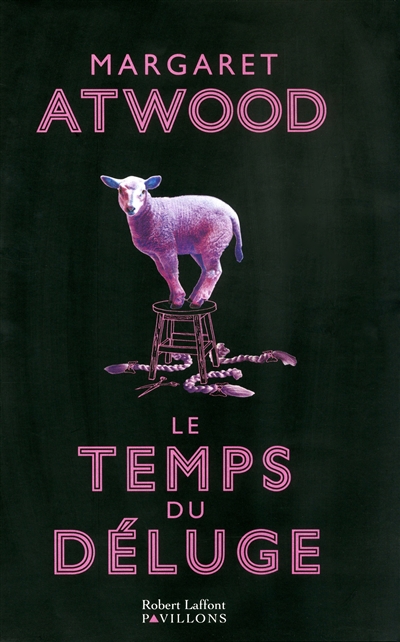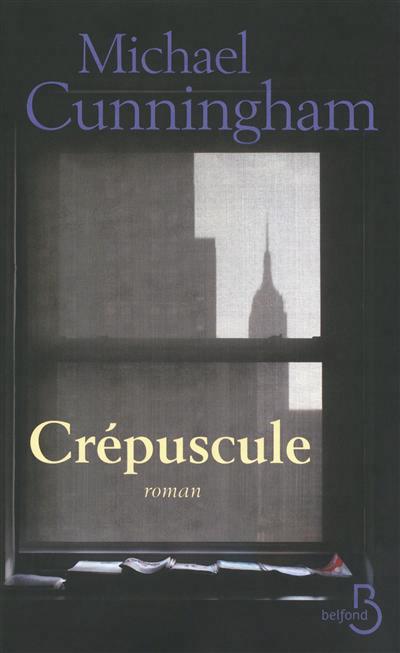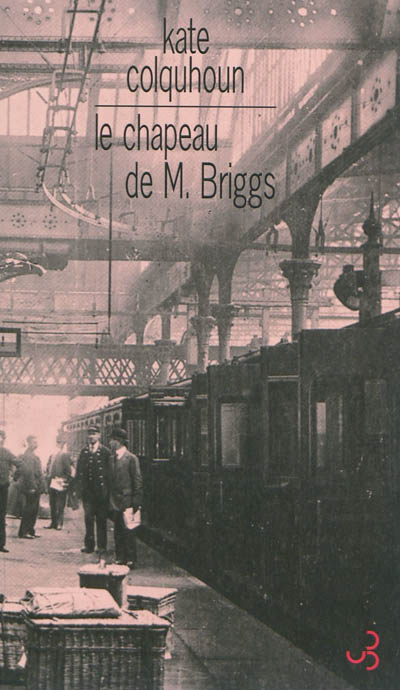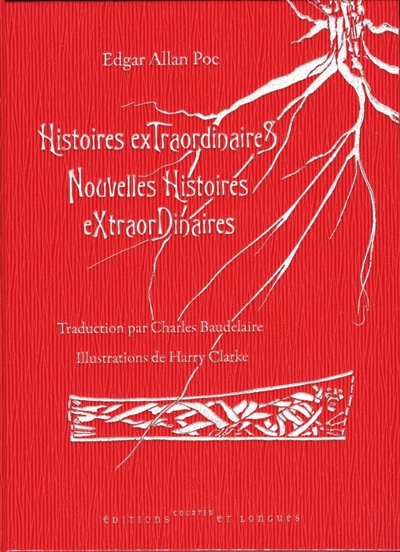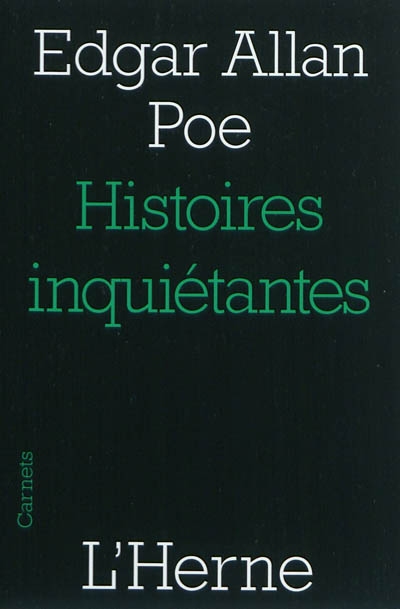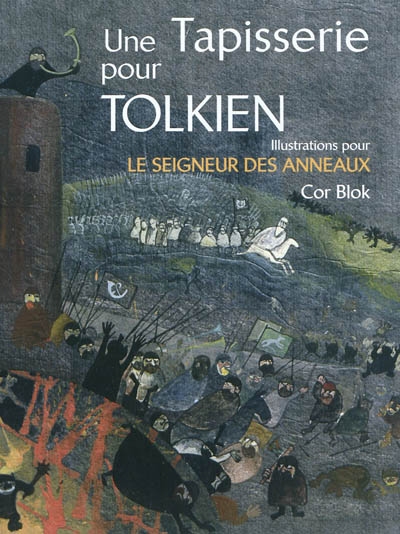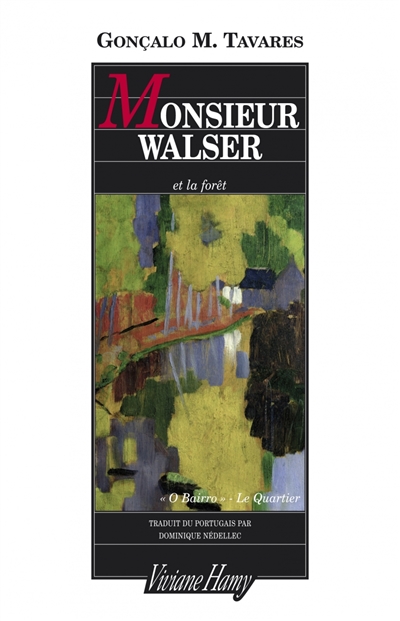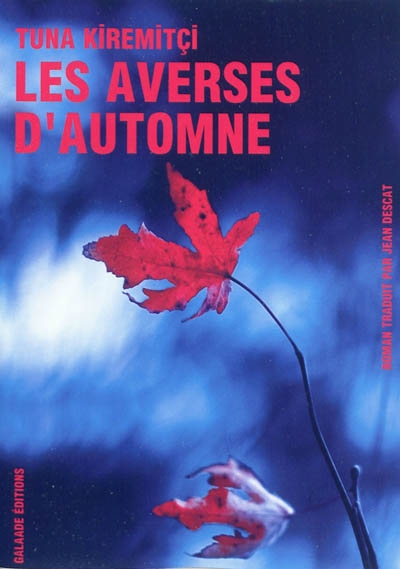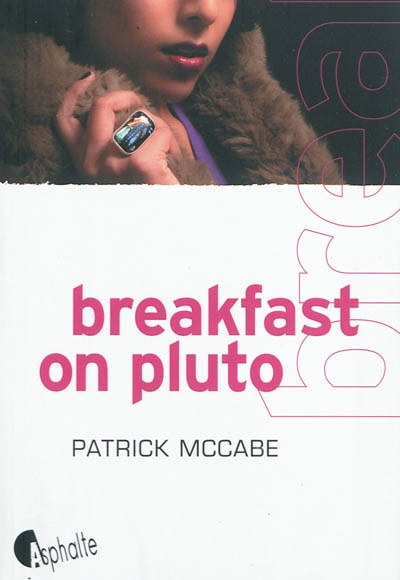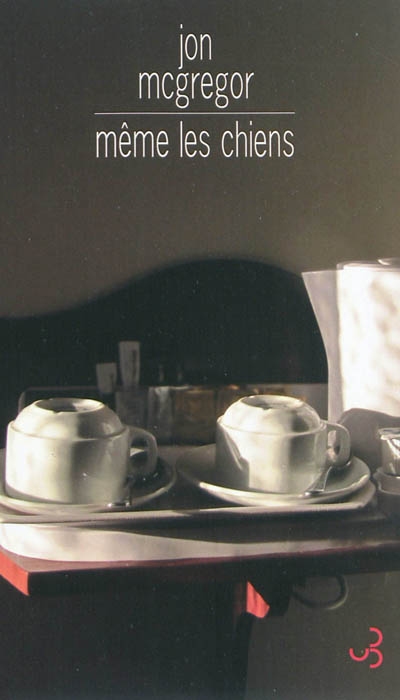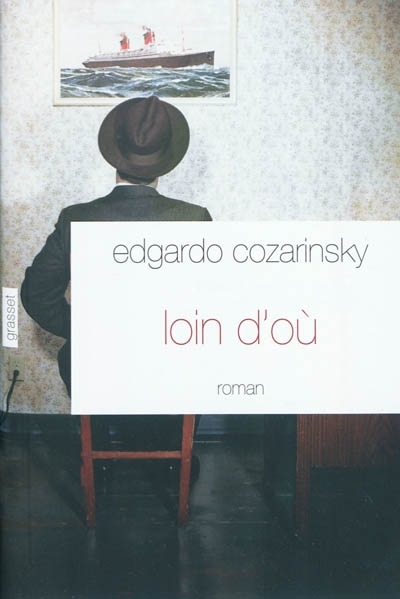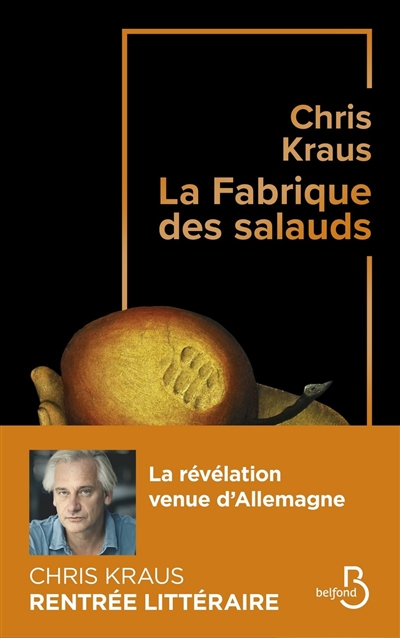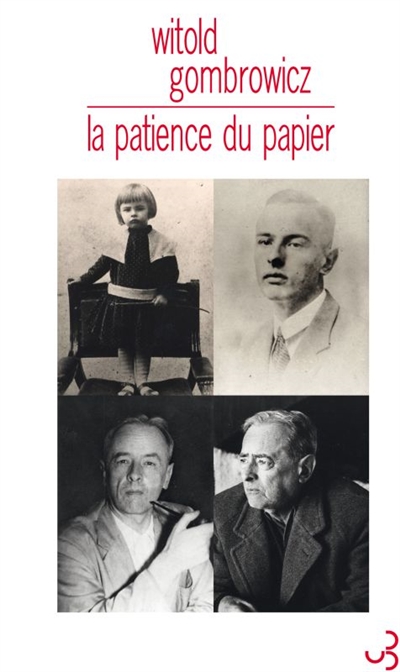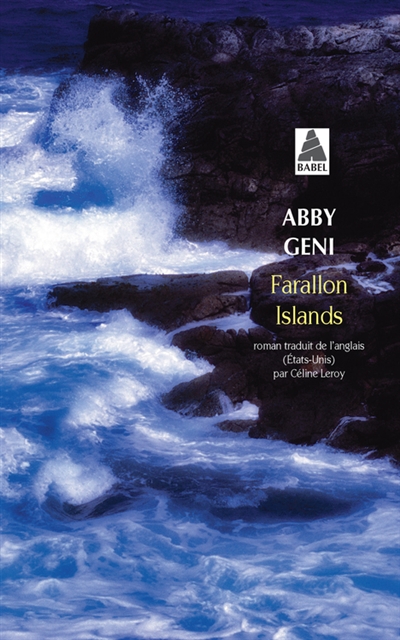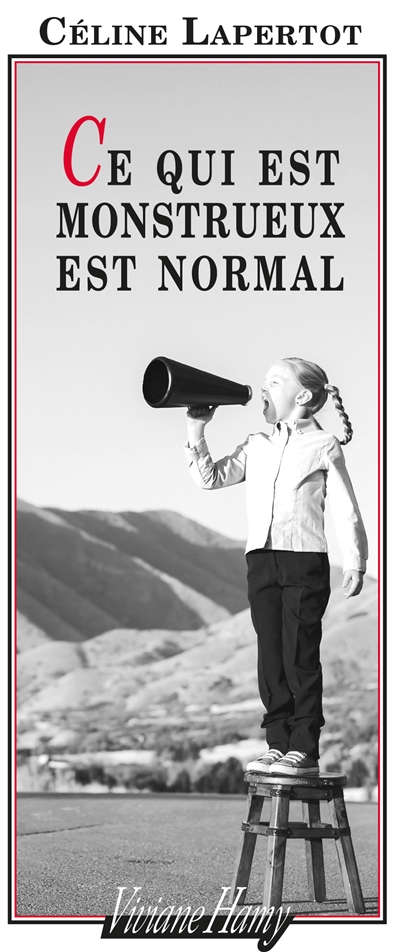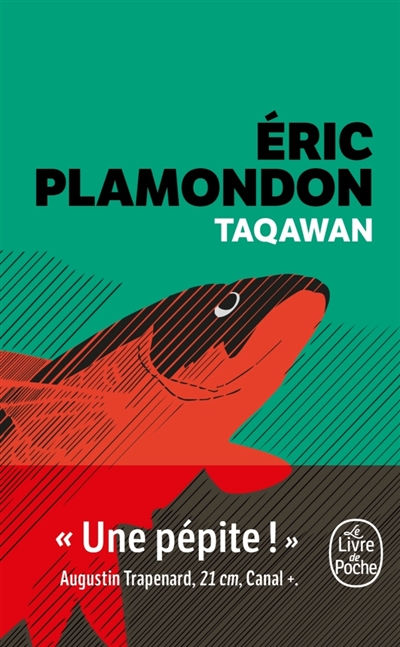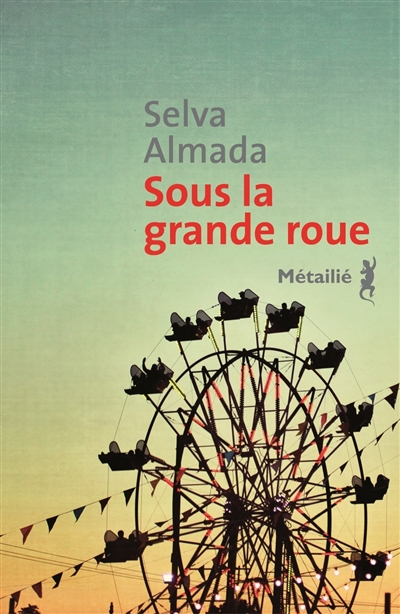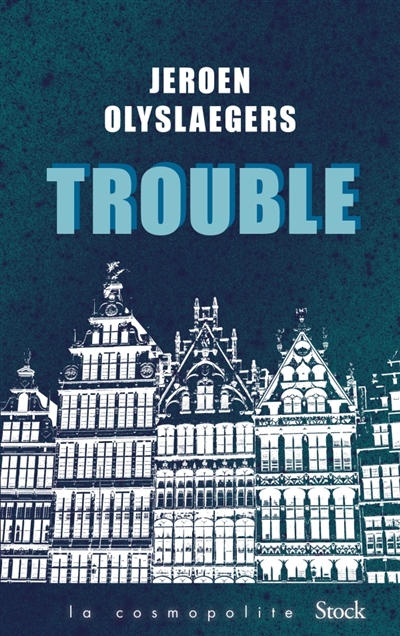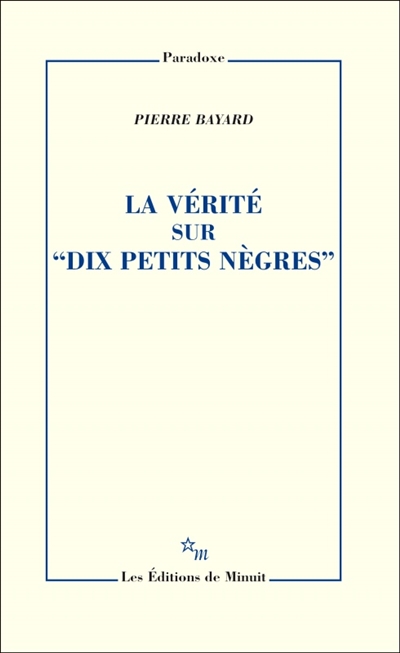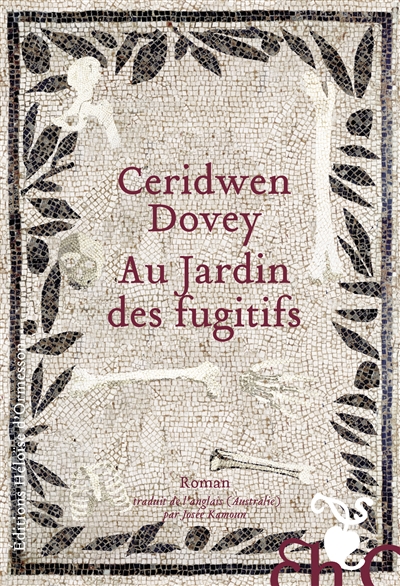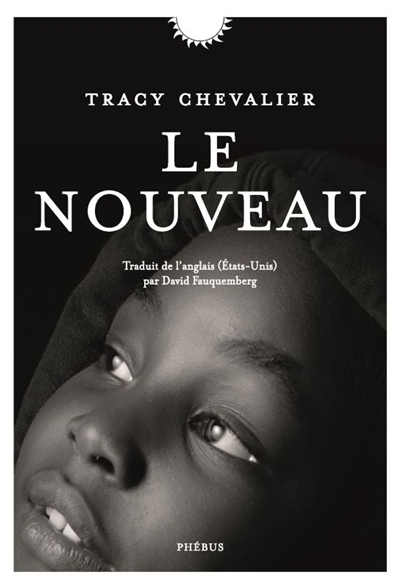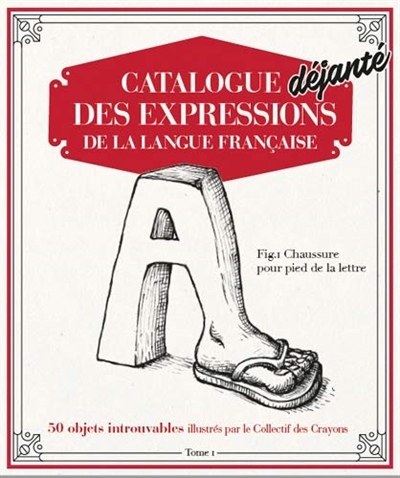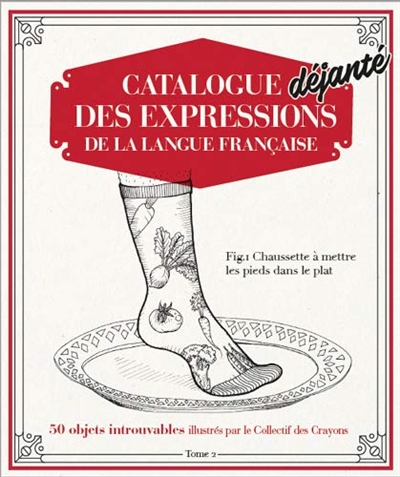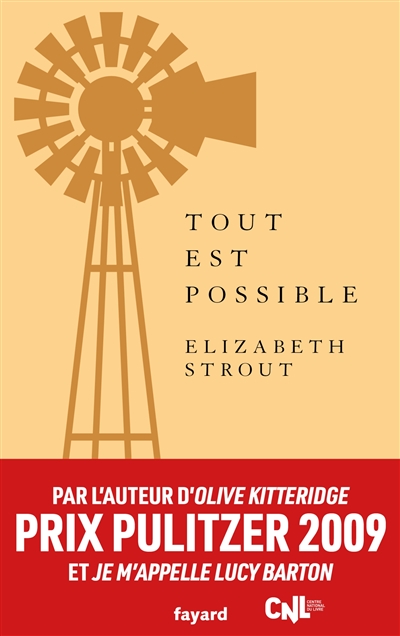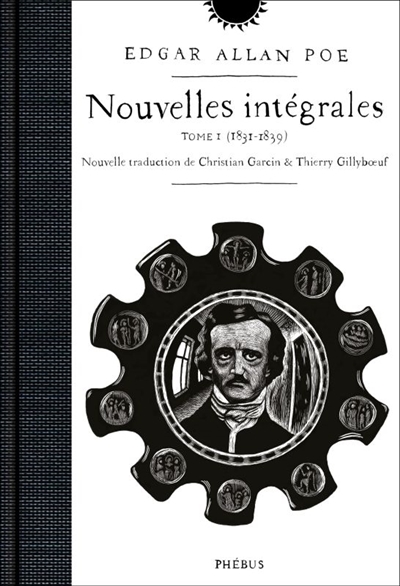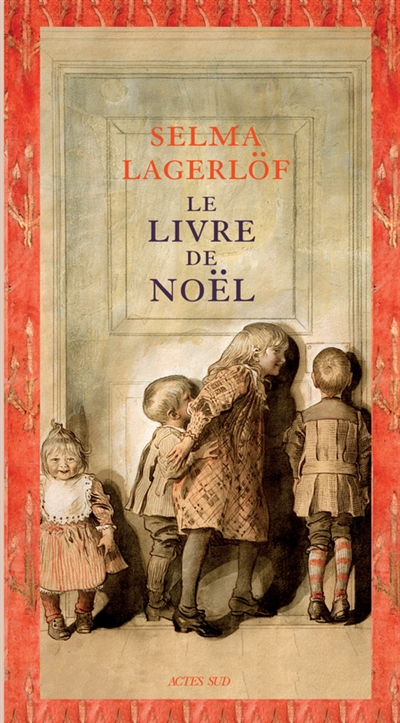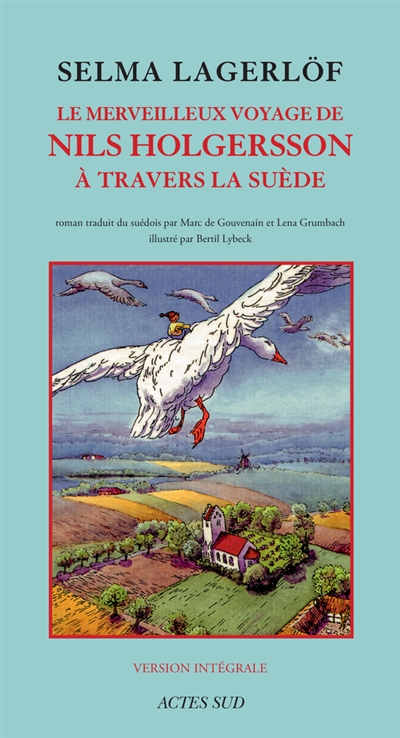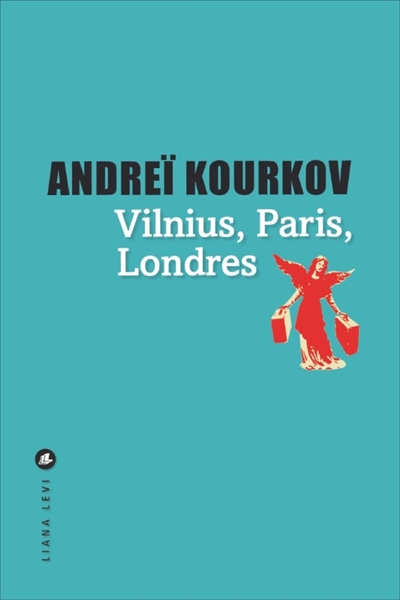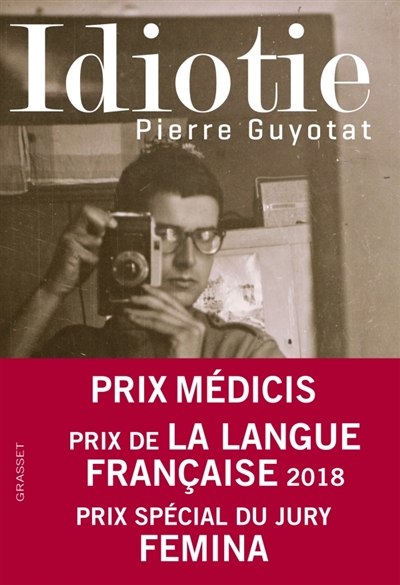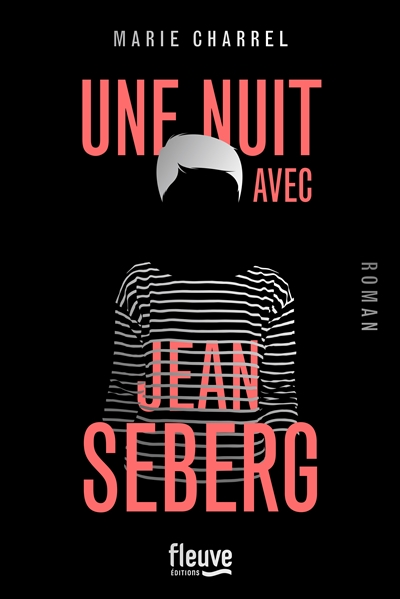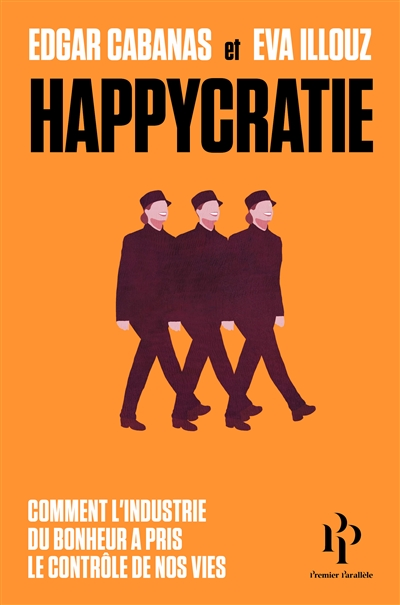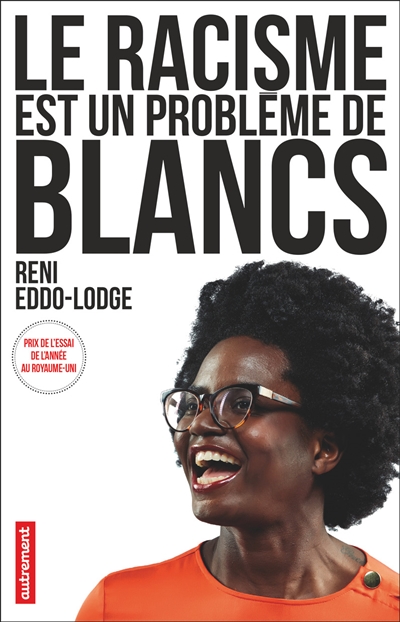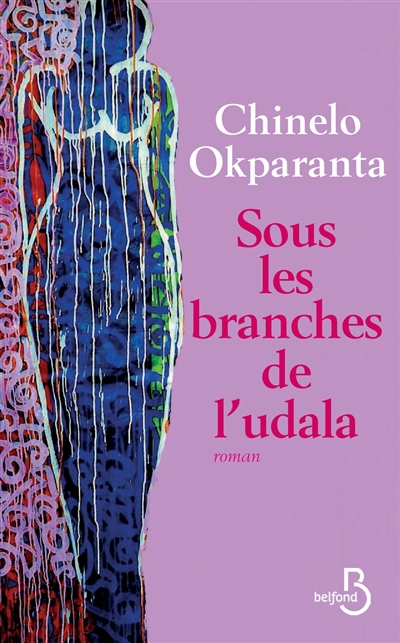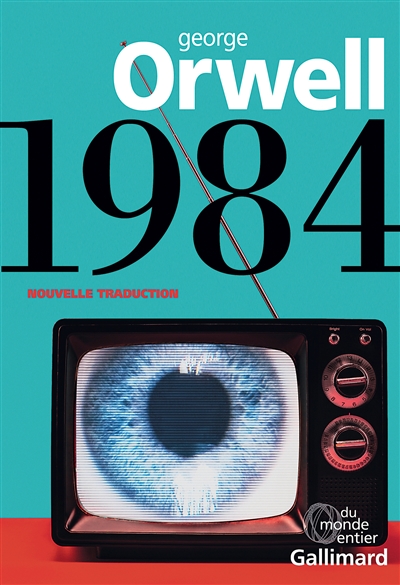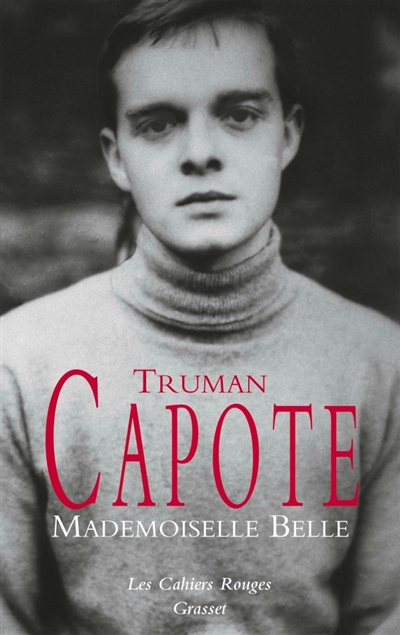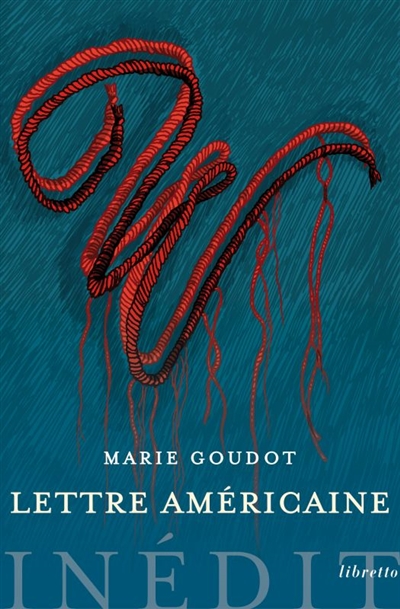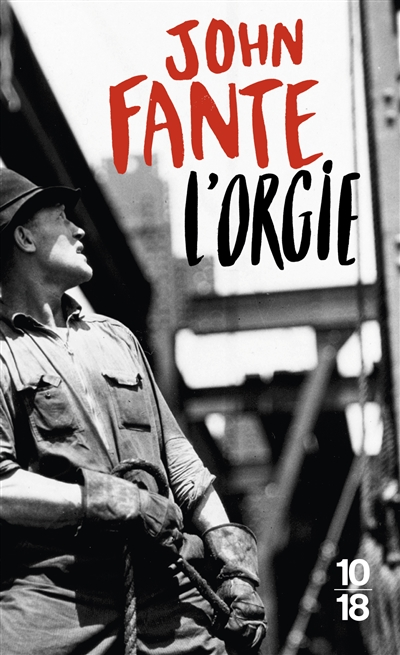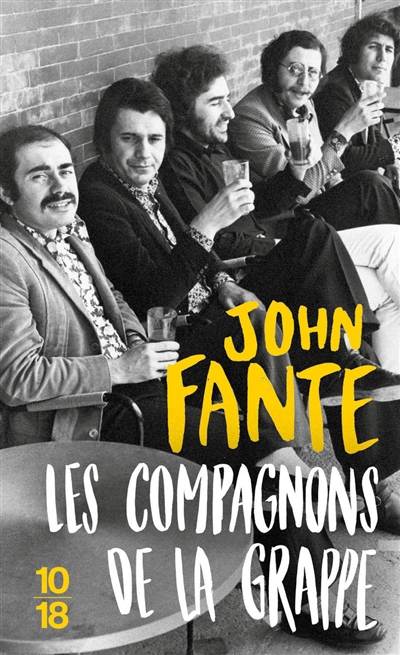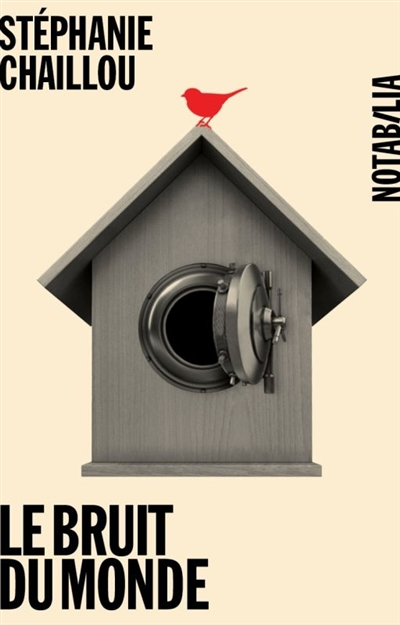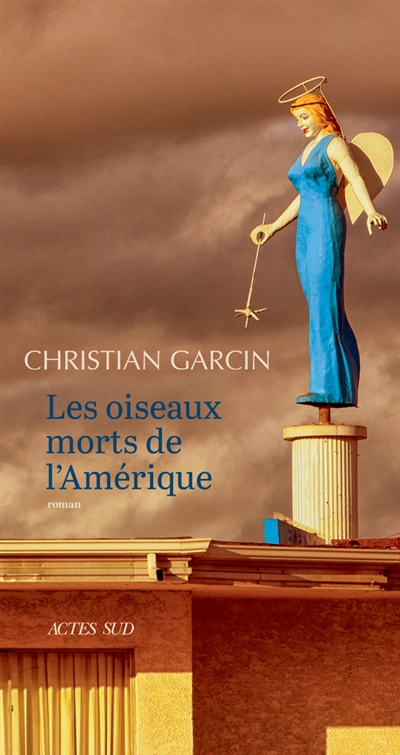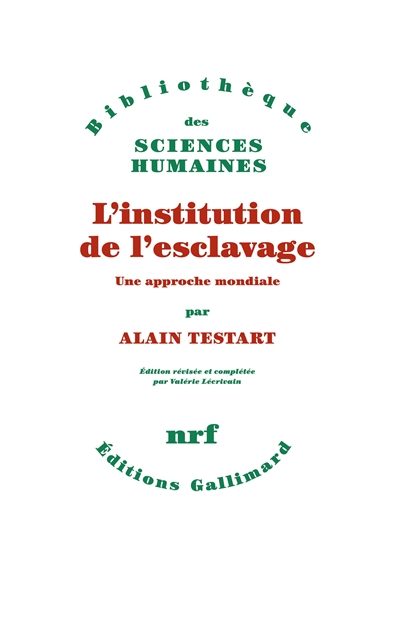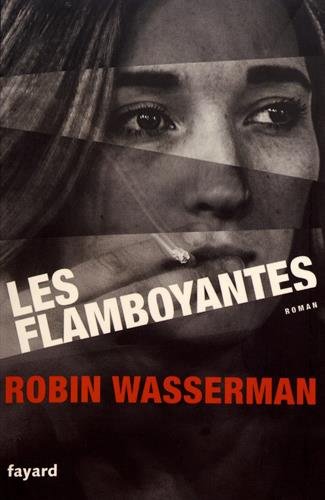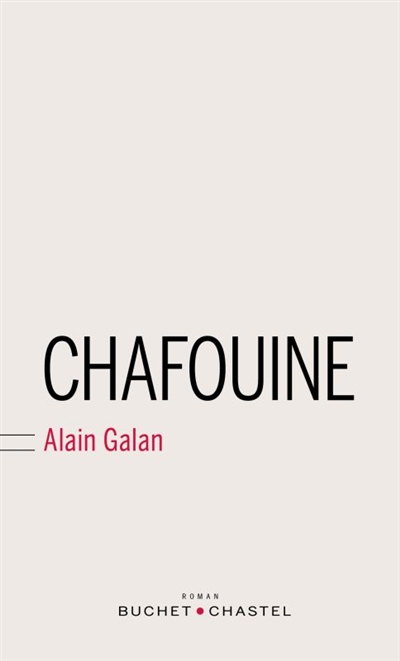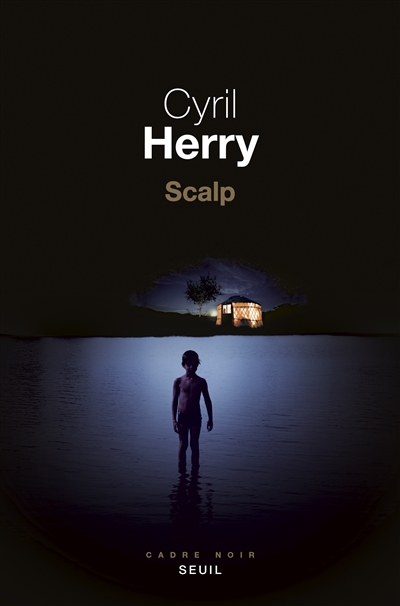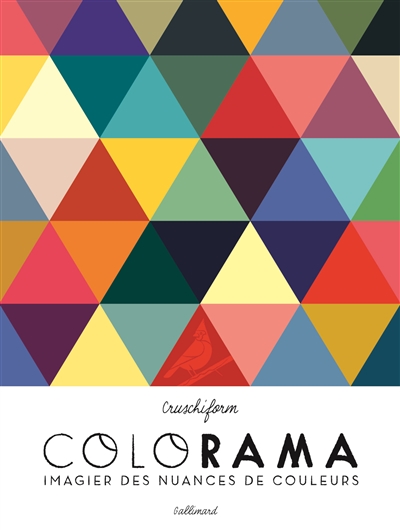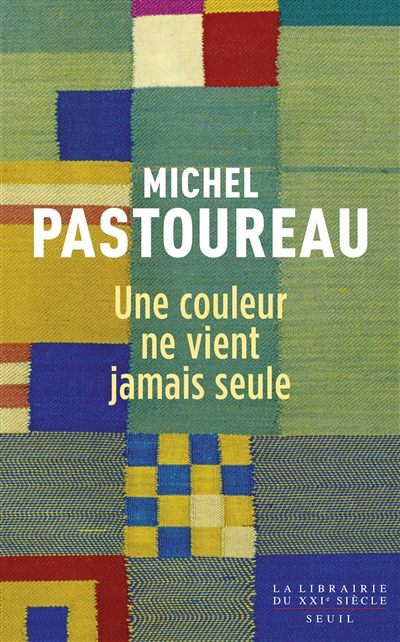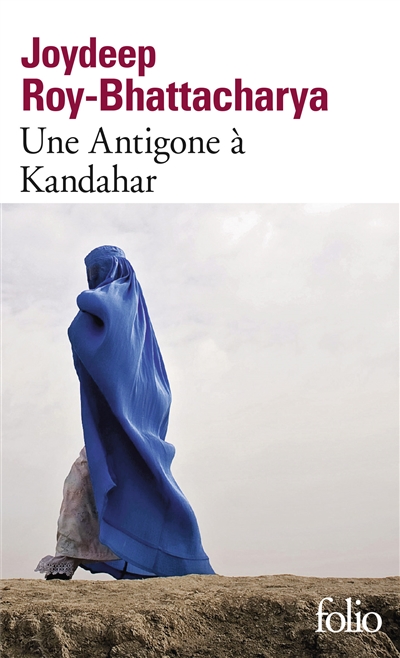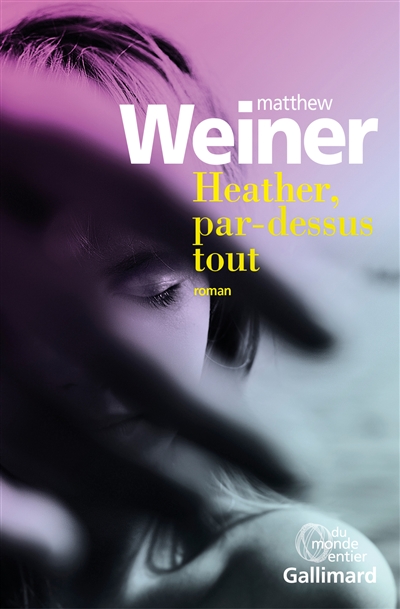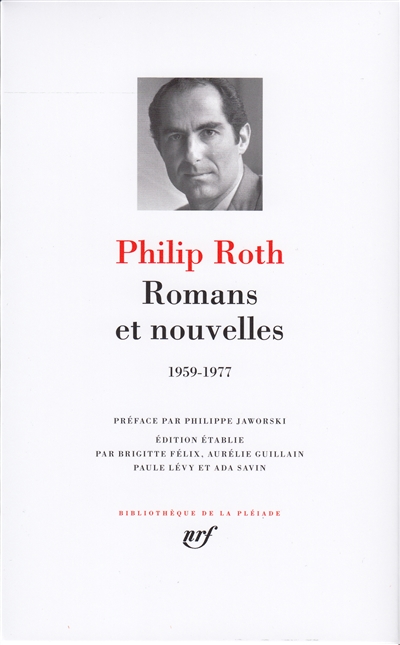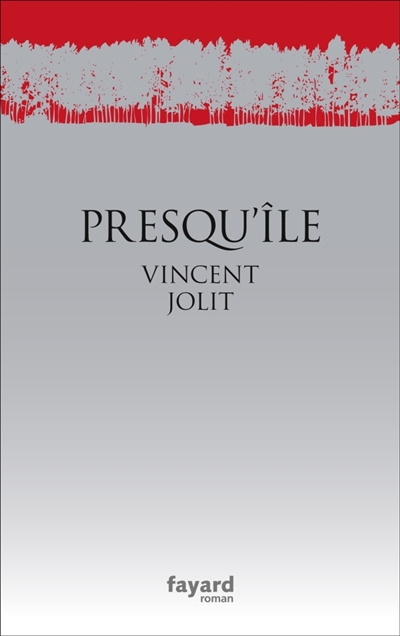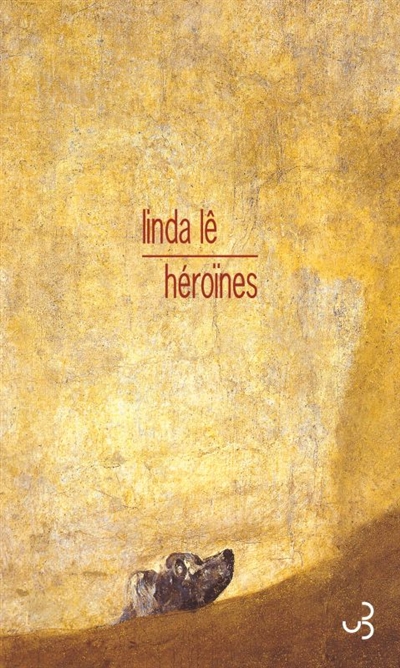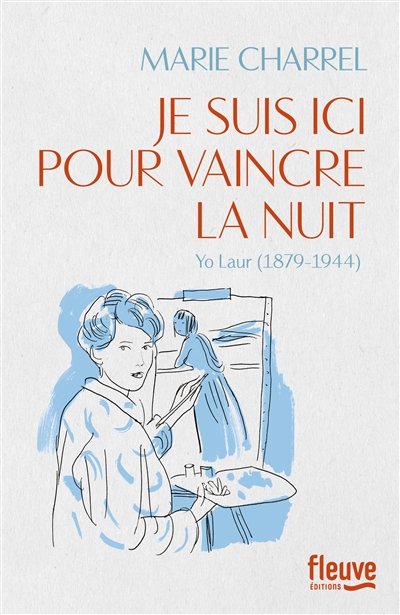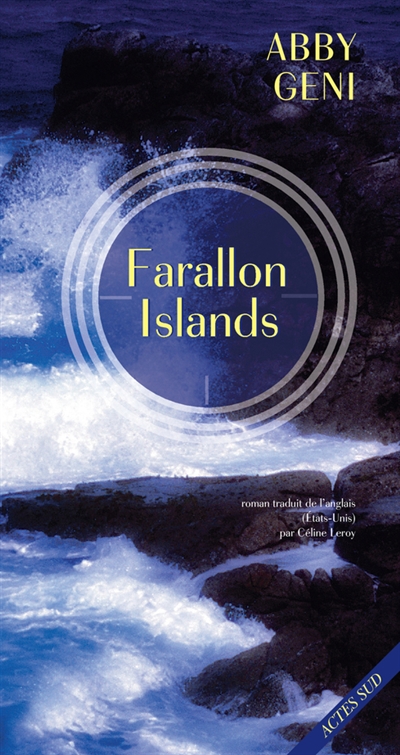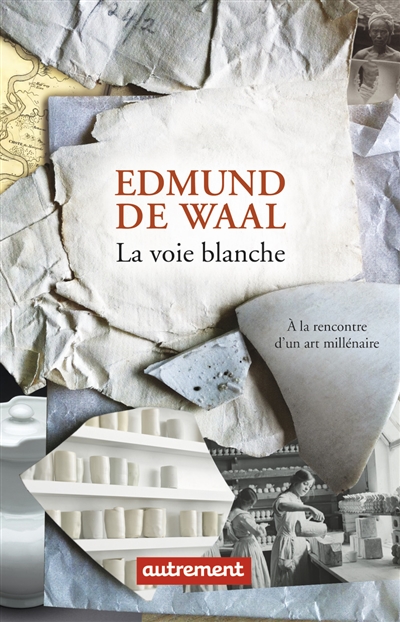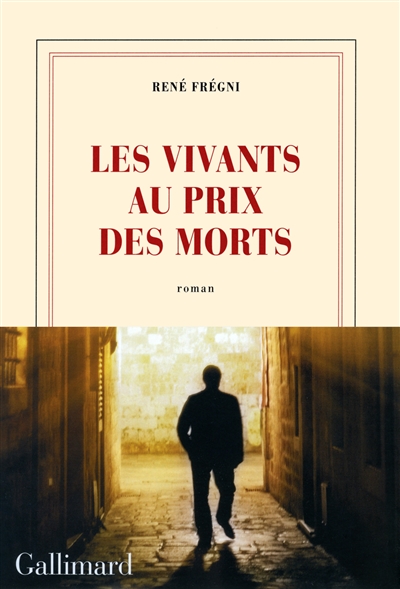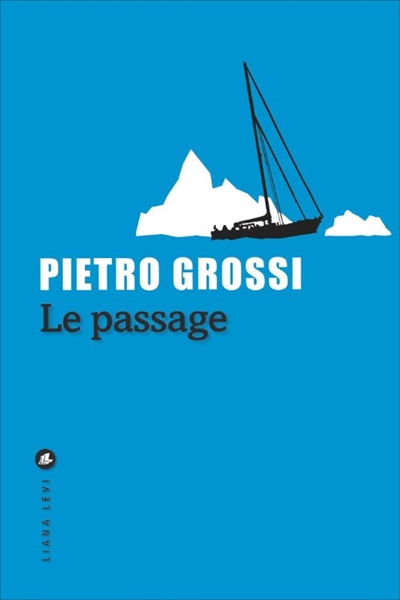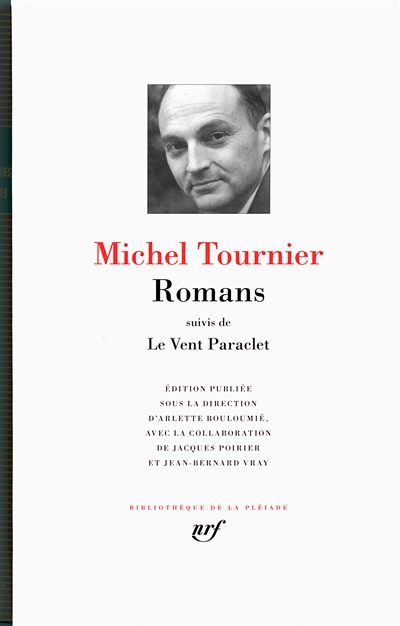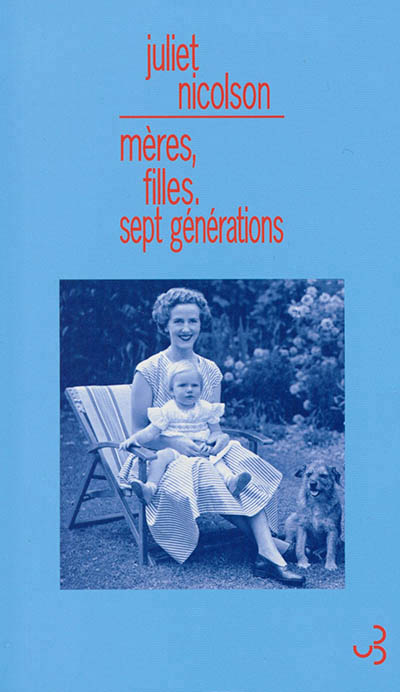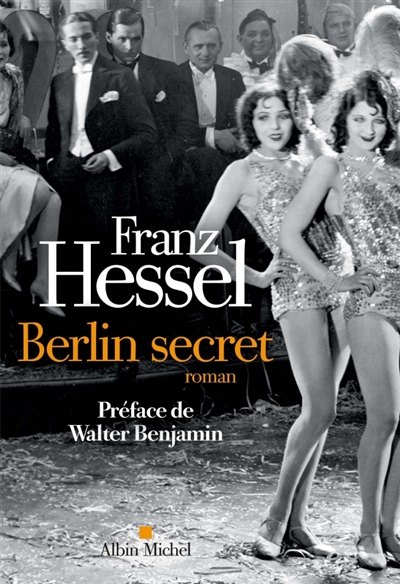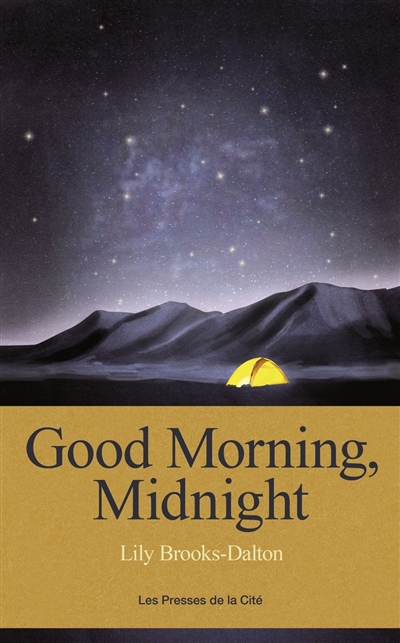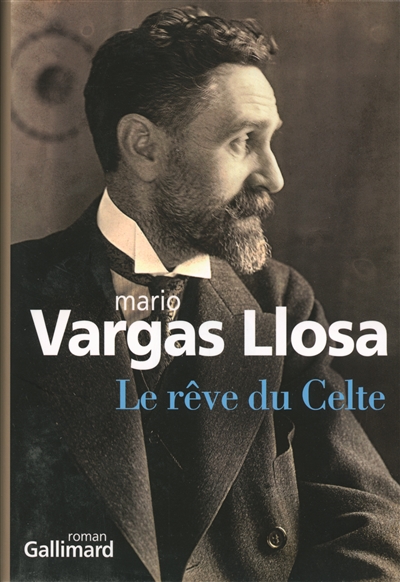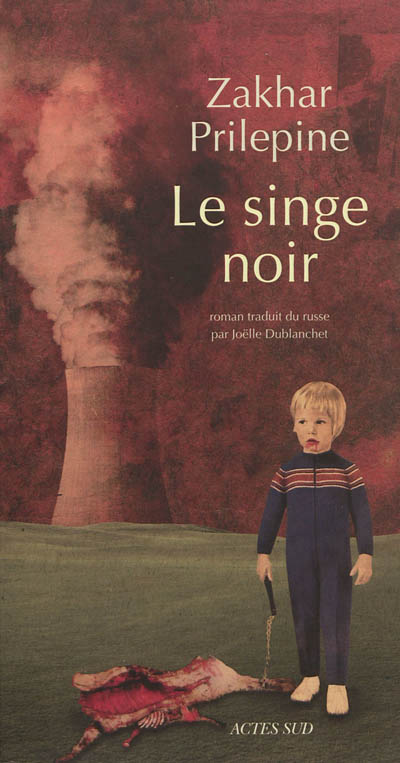Littérature étrangère
Lionel Shriver
Big Brother
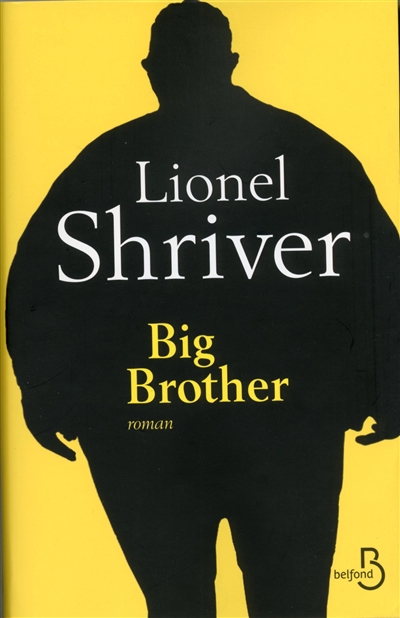
-
Lionel Shriver
Big Brother
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Richard
Belfond
21/08/2014
448 pages, 22,50 €
-
Chronique de
Aurélie Janssens
Librairie Page et Plume (Limoges) -
❤ Lu et conseillé par
7 libraire(s)
- Lydie Zannini de du Théâtre (Bourg-en-Bresse)
- Aurélie Janssens de Page et Plume (Limoges)
- Nathalie Iris de Mots en marge (La Garenne-Colombes)
- Claire Authier de Fontaine Victor Hugo (Paris)
- Marie-Pierre Cambon de L'Oiseau Moqueur (Sucy-en-Brie)
- Brice Vauthier de L'Étagère (Saint-Malo (Paramé))
- Hélène Woodhouse de Le Bateau Livre (Lille)

✒ Aurélie Janssens
(Librairie Page et Plume, Limoges)
Pandora est une femme d’une quarantaine d’années, mariée, deux beaux enfants, patronne d’une entreprise florissante fabriquant des marionnettes qui imitent les tics de langage des personnes à qui elles sont offertes. Sa vie, réussie mais monotone, est chamboulée lorsqu’Edison, son frère, pianiste de jazz, se retrouve à la rue. Elle ne l’a pas vu depuis quatre ans mais accepte de l’héberger quelque temps. À l’aéroport, elle ne le reconnaît pas. Et pour cause ! ce dernier a pris environ cent cinquante kilos. La cohabitation devient dès lors difficile. Fletcher, le mari, extrêmement sévère concernant son hygiène alimentaire, voit d’un mauvais œil cet ogre « fainéant ». Pandora ne sait comment se comporter avec ce frère dont elle devine la souffrance sous les couches adipeuses. Elle qui n’a que peu l’habitude d’aborder les problèmes frontalement va devoir faire des choix et des concessions. Lionel Shriver se penche sur un problème très actuel, celui de notre rapport à la nourriture et la façon dont notre regard sur les autres est empesé de préjugés, y compris malgré nous.
Page — Ce livre est un roman, mais il est inspiré par votre propre expérience puisque vous avez perdu votre frère en 2009, mort des conséquences d’une obésité morbide. Le livre est-il le résultat d’une réflexion que vous avez eue à la suite de cet événement, ou était-ce quelque chose qui vous travaillait déjà depuis un moment ?
Lionel Shriver — Ce que vous dites est bien vu. Oui, en effet, j’ai écrit ce livre aujourd’hui, enfin, il y a quelque temps, parce que j’ai perdu mon frère et que cela m’a donné à réfléchir. Mais comme toutes les Américaines de mon âge, j’ai grandi avec la question du poids. Le livre est donc plutôt le résultat d’une réflexion sur ce sujet qui m’intéresse depuis que je suis adulte. C’est presque un cercle vicieux, parce que plus notre poids nous tracasse, plus la nourriture nous obsède. La place centrale qu’on accorde à la nourriture constitue justement une part importante du problème. Nous partageons de moins en moins de repas en famille et, l’une des raisons pour lesquelles nous mangeons moins lorsque nous partageons un repas – alors que nous passons plus de temps à table – est que nous nous nourrissons d’autres choses à ce moment-là.
Page — Le corps, dans la plupart de vos livres, est une source de souffrance. Pourquoi maltraiter, torturer le corps en particulier ?
L. S. — Je crois que c’est parce que je suis cruelle par nature ! (rires) Je m’intéresse aux rapports très complexes entre l’esprit et le corps, mais aussi à la place écrasante que prend notre corps dans notre esprit et surtout à la confusion que cela engendre lorsqu’il s’agit de définir notre identité et de savoir qui nous sommes. Sommes-nous notre corps ? Non ! Mais la réponse n’est pas si simple. La plupart du temps, nous n’avons pas l’impression d’être uniquement un corps. Mais nous avons tendance à regarder les autres comme s’ils l’étaient. Et je trouve cela incompréhensible. Pourquoi sommes-nous incapables d’assimiler ce qu’être un individu signifie, là, en nous, et de comprendre que l’autre est comme nous quand nous le regardons ?
Page — Vous utilisez des mots justes et parfois durs pour décrire vos personnages, comme le mot « fat » (gros) pour décrire Edison. Les mots ne vous effraient pas, ce qui est plutôt une bonne chose pour un auteur. Pourtant, votre personnage principal, Pandora, a plutôt tendance à utiliser des termes « politiquement corrects » et contourner ainsi la réalité ? Quelle importance ont les mots dans notre rapport à l’autre ?
L. S. — Je ne suis pas sûre qu’on puisse résoudre les problèmes de société à coup d’euphémismes. Si on bannit le mot gros de notre discours, cela ne changera rien à la vie des personnes en surpoids. « Personnes en surpoids », voyez, c’est plus long à dire et pourtant on sait très bien de quoi je parle. Je continue à employer le mot gros. C’est court, descriptif, la sonorité est efficace. J’aime bien ce mot. Et les sentiments entourant ce problème m’intéressent davantage que le mot gros lui-même.
Page — La plupart des personnages de votre roman a tendance à fuir la réalité (Edison fuit ses problèmes de nourriture, Pandora fuit une vie pleine de succès mais ennuyeuse, son mari Fletcher fuit les problèmes du quotidien à coups de kilomètres avalés sur son vélo, Travis fuit sa propre famille pour s’occuper d’une famille virtuelle dans sa série TV, etc.) Qui est le plus sincère avec les autres et avec lui-même ?
L. S. — La petite fille Cody n’est pas dans l’évitement. Elle est en quelque sorte le cœur du livre. Elle accepte son gros oncle et l’aime comme il est. C’est avec elle qu’il aborde les sujets que les autres évitent. Pour en revenir au politiquement correct, celui-ci est aussi une technique d’évitement. Chaque fois que nous sommes confrontés à un sujet qui nous met mal à l’aise ou qui peut nous blesser, notre instinct social nous pousse à le contourner. Mais cela ne fonctionne pas. En réalité, cette stratégie ne fait qu’empirer la situation. Cela revient à dire : « voilà de quoi on ne parle pas ». Et pendant ce temps le problème est plus présent que jamais !
Page — Sans dévoiler la fin du livre, il y a un passage où la narration s’arrête, laissant de grands espaces blancs entre chaque paragraphe. Les espaces vides faisaient-ils partie du projet d’écriture ou est-ce un moment où l’émotion est si forte que des mots ne peuvent la décrire ?
L. S. — Ce blanc est une charnière majeure. C’est un moment de tristesse, d’impuissance. On arrête d’éviter les choses, de se voiler la face, de se réfugier dans un monde alternatif. Ce blanc, c’est de la résignation, du désespoir aussi, du chagrin... Le lecteur ne le comprends qu’en lisant le passage suivant, mais c’est à cet endroit que le roman gagne en profondeur et s’inscrit dans une autre dimension émotionnelle. Et je crois que si je ne m’étais pas aventurée dans ces territoires plus sombres, le livre serait tout autre. Ce serait un livre « plus mince ». Je viens de me rendre compte que l’expression est bien trouvée !
Page — Pour conclure, est-ce que ce livre nous donne une leçon ?
L. S. — L’idée de lire un roman dans lequel on vous donne une leçon est assez rébarbative. En tant que lectrice, je ne suis pas sûre que je choisirais un livre qui me donne une leçon ou me sermonne. En tant qu’écrivain, je préfère qu’on explore des problèmes qui font partie de notre quotidien et que l’on pose les bonnes questions, que l’on aille plus loin que celles posées dans les magazines qui proposent dix nouvelles recettes pour maigrir ! C’est donc plus une exploration qu’une leçon.
<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https://www.youtube.com/embed/UJN5GzkGOxA\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>