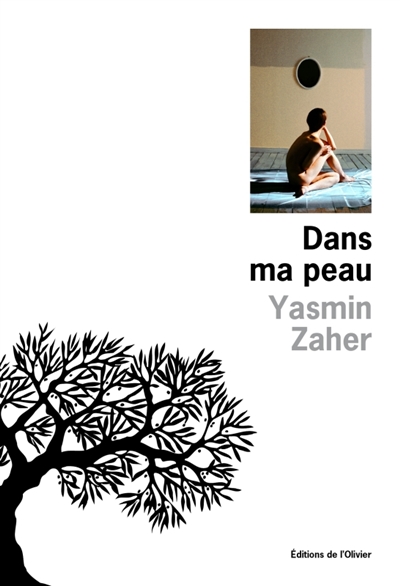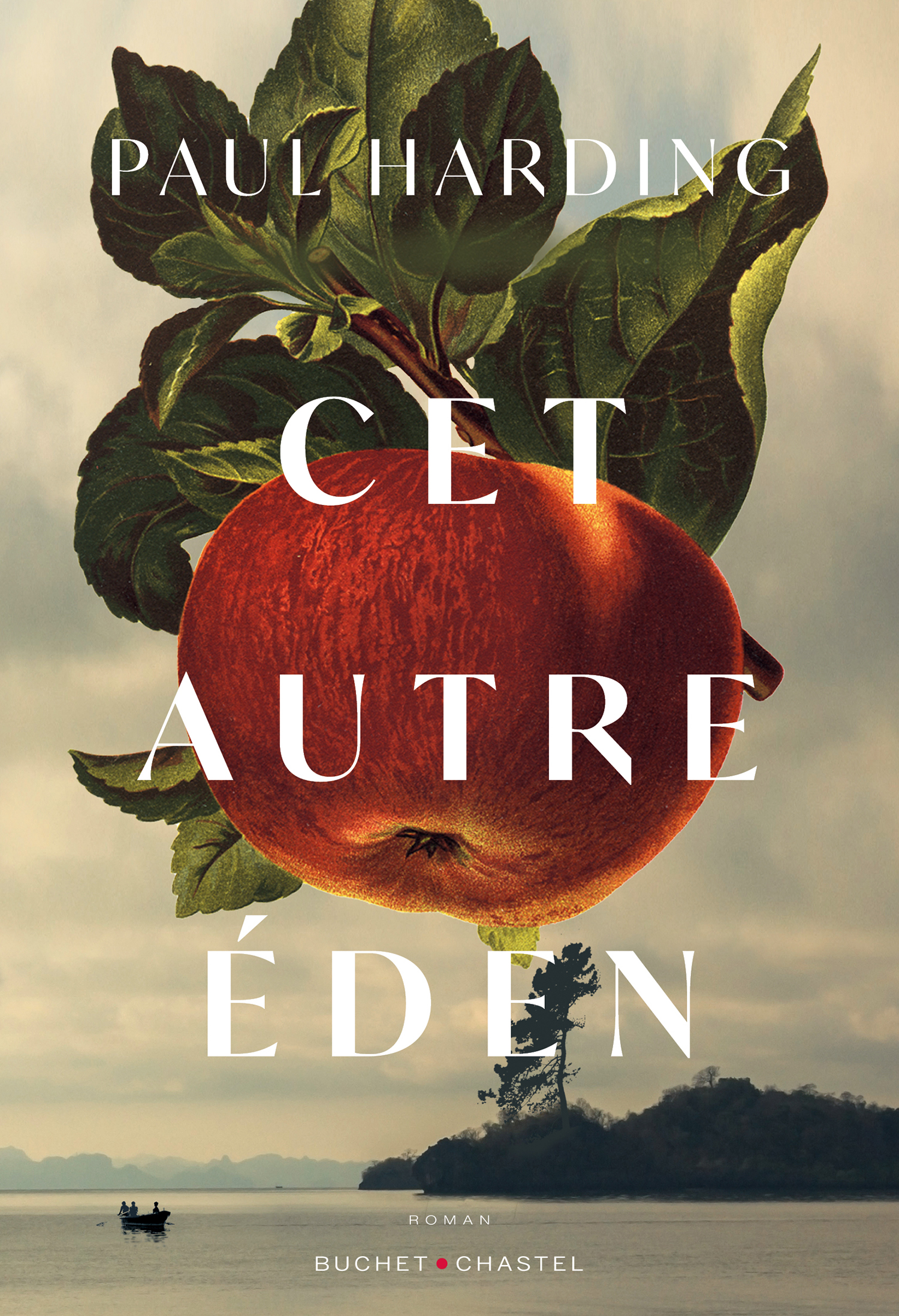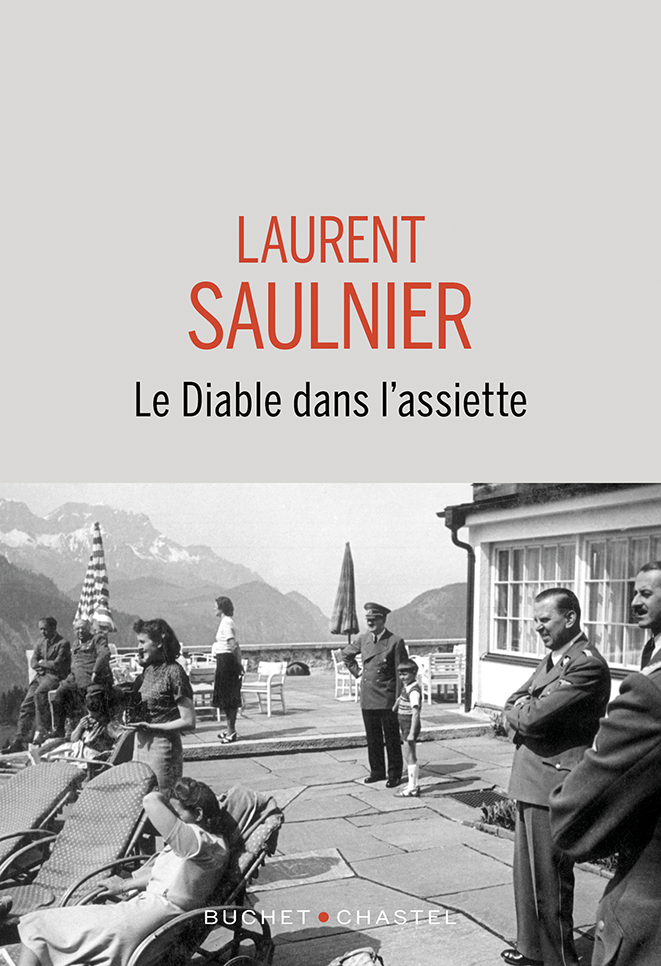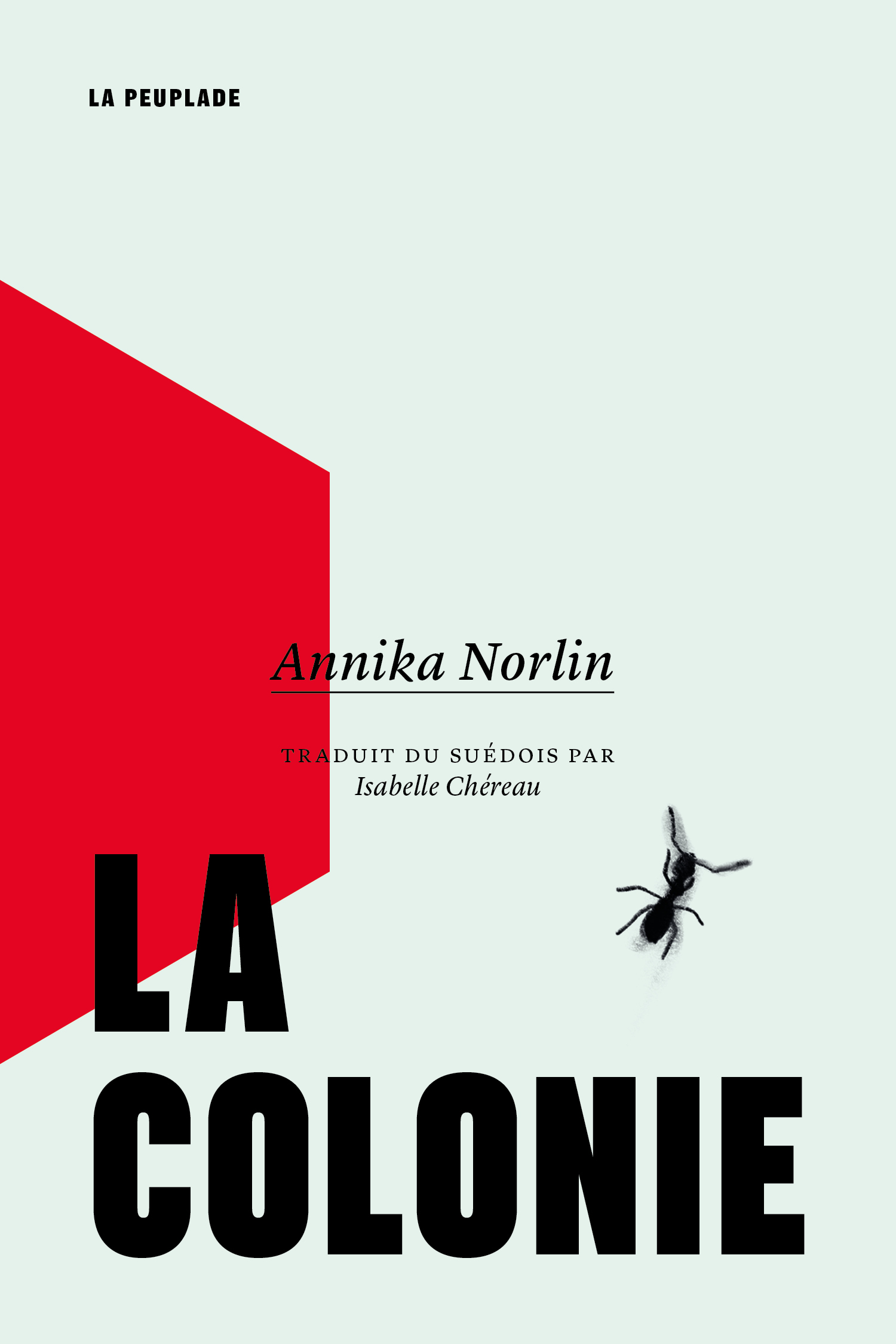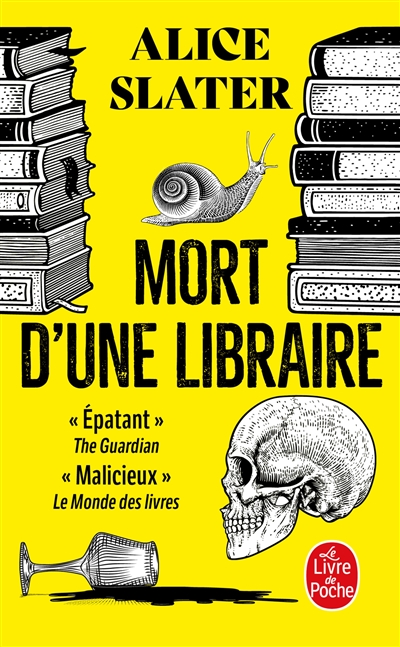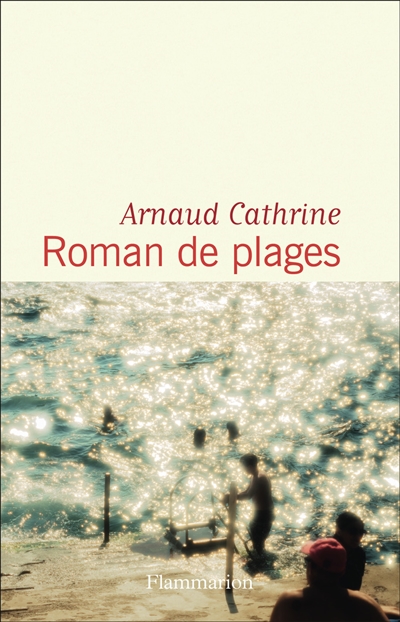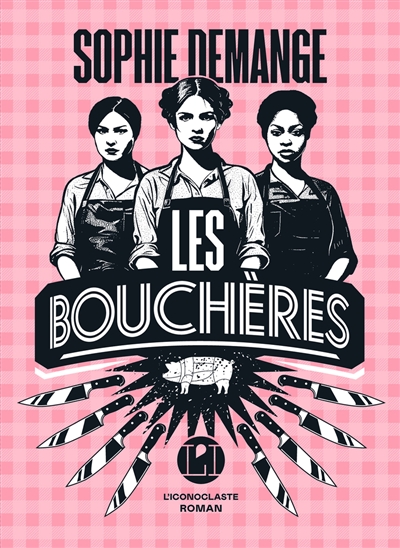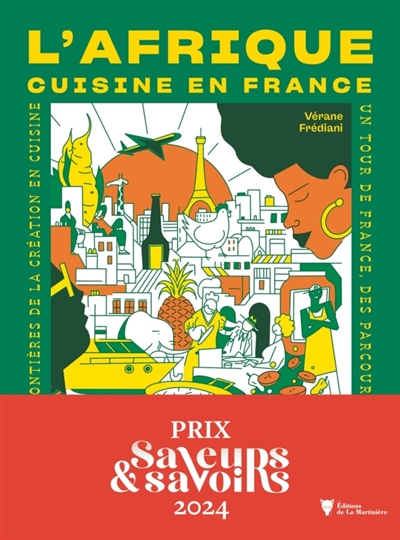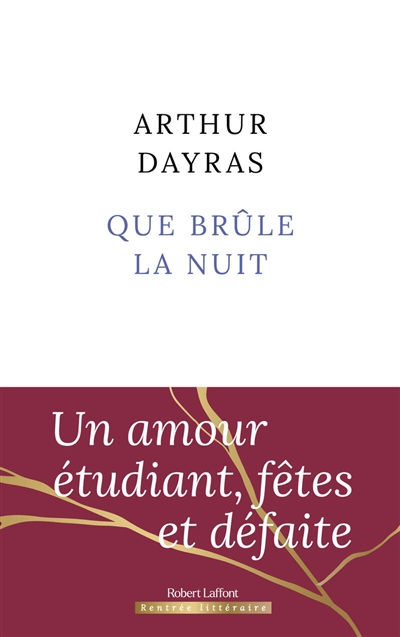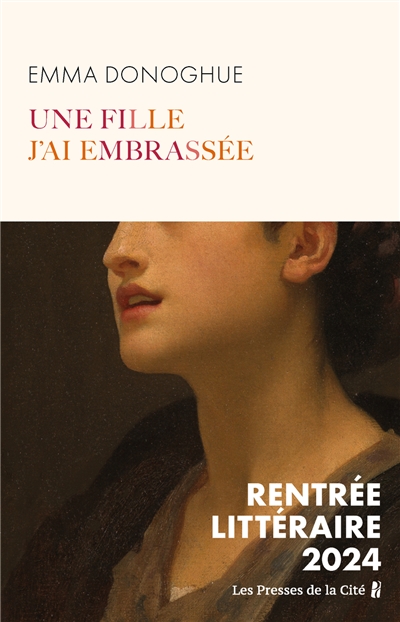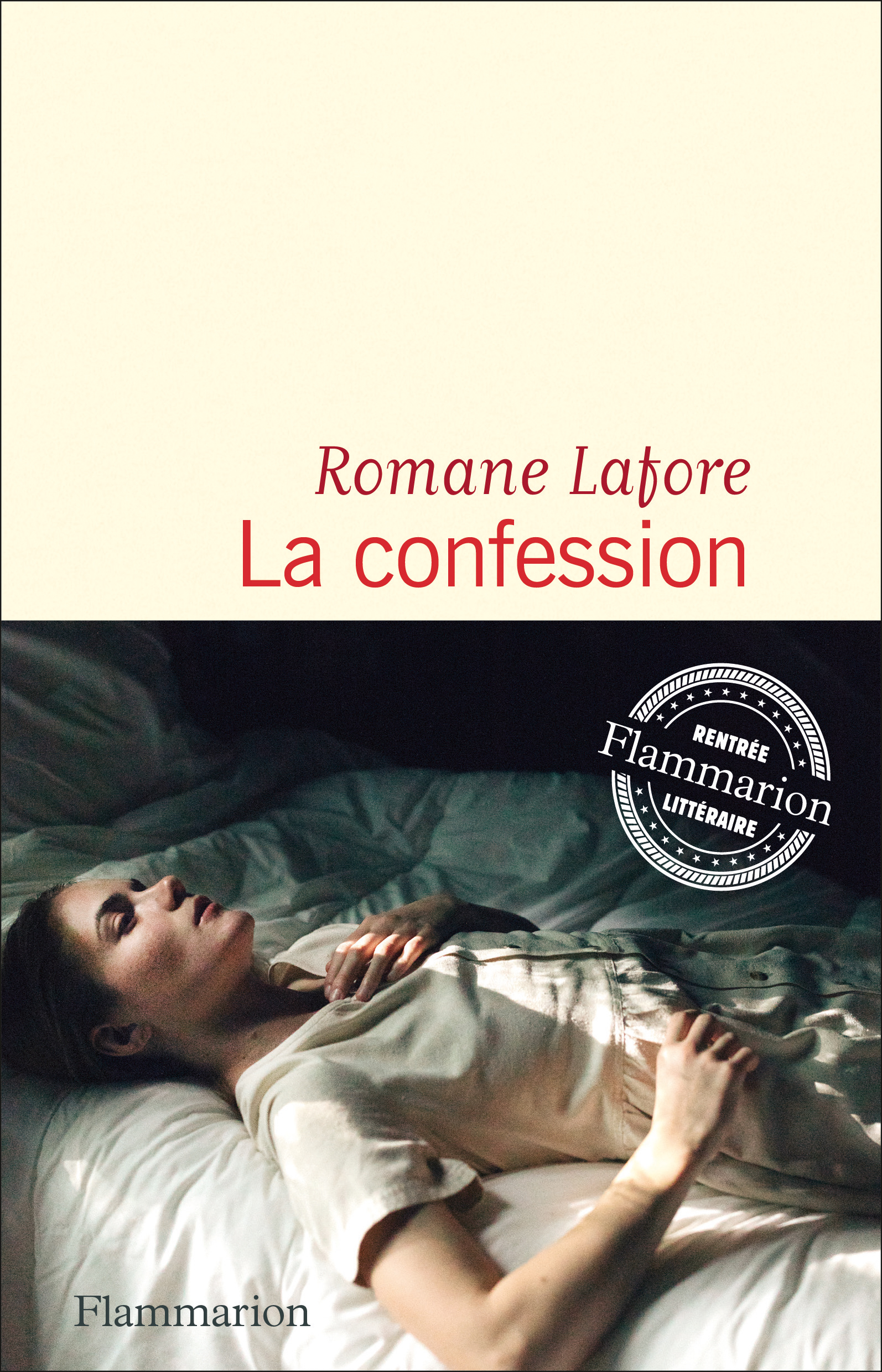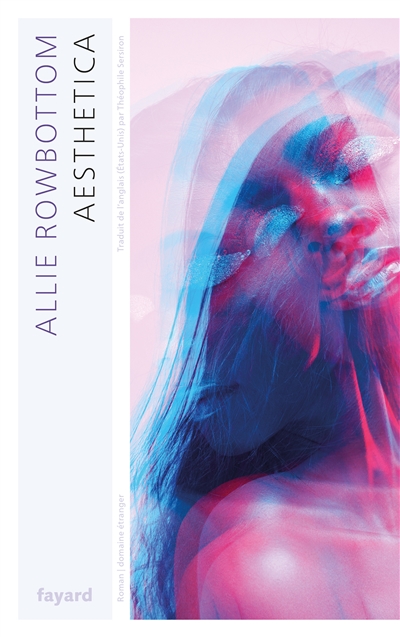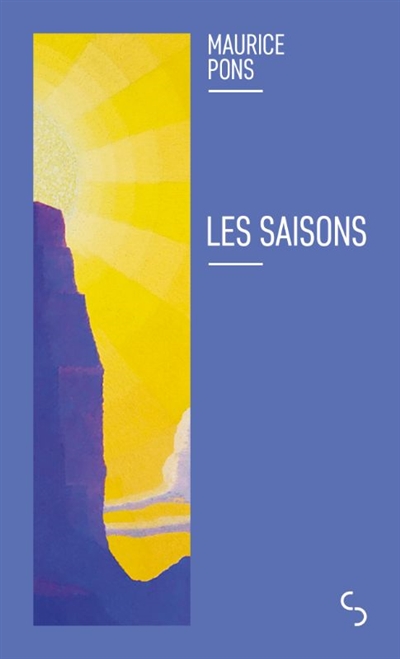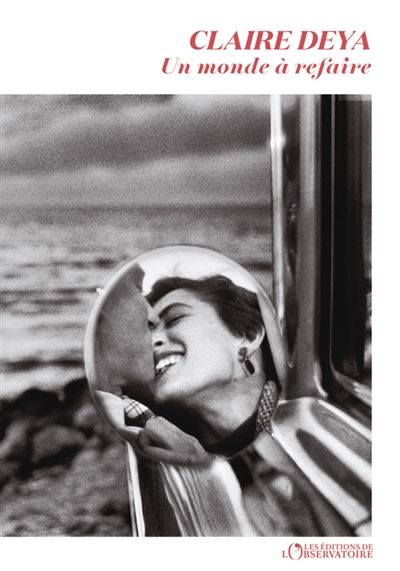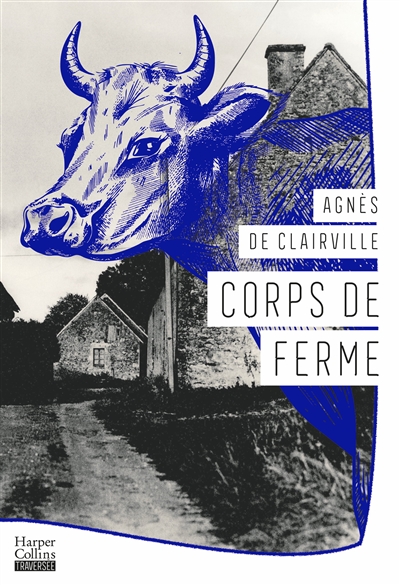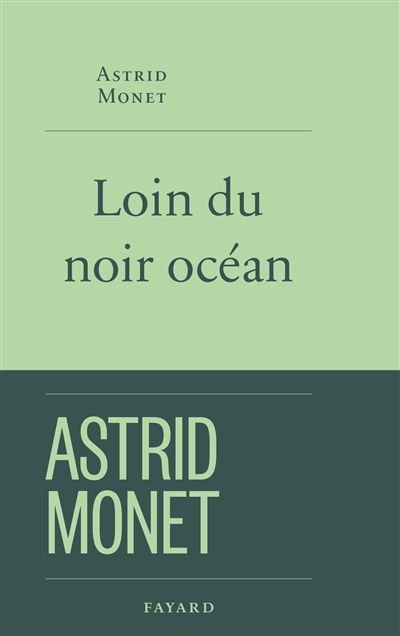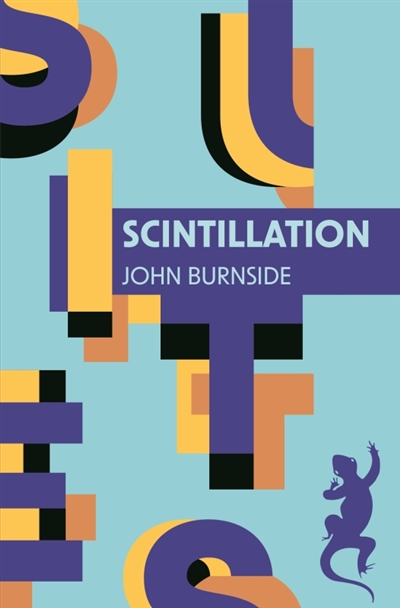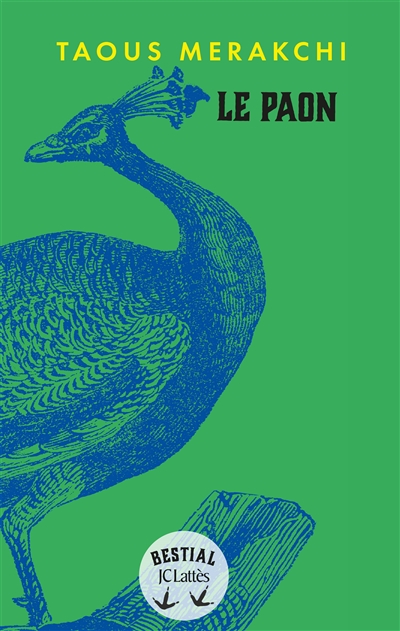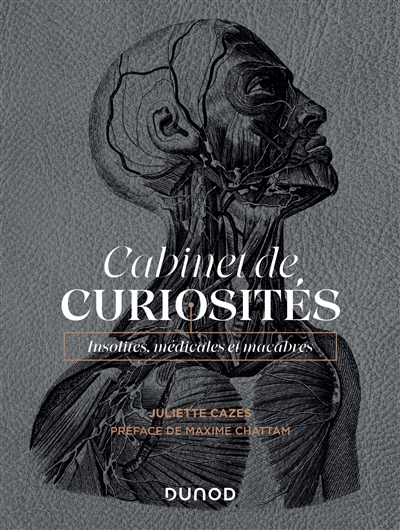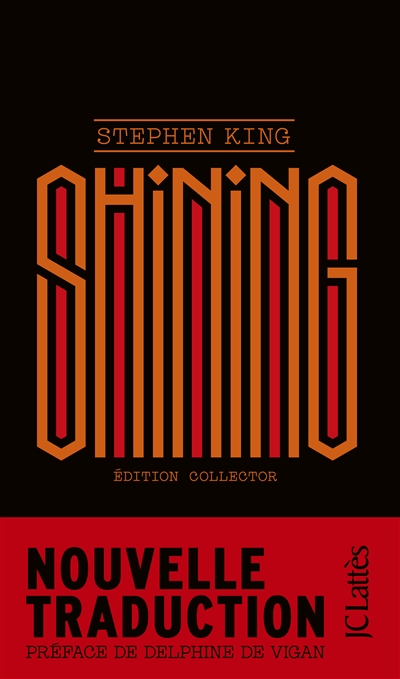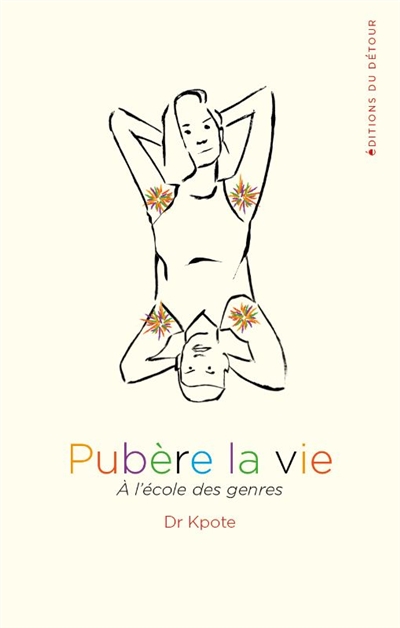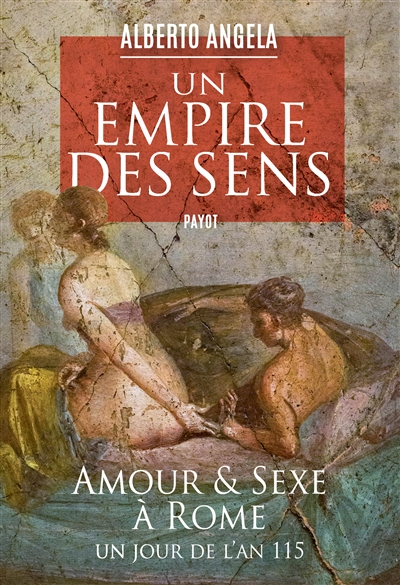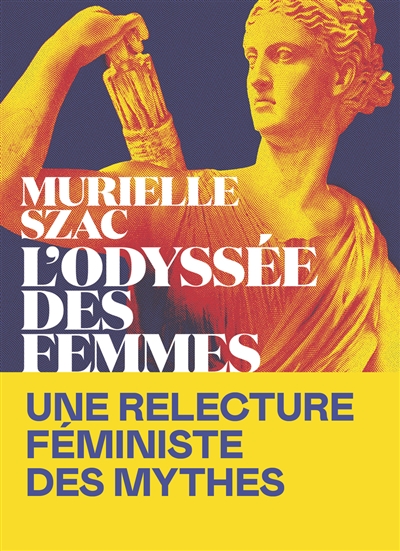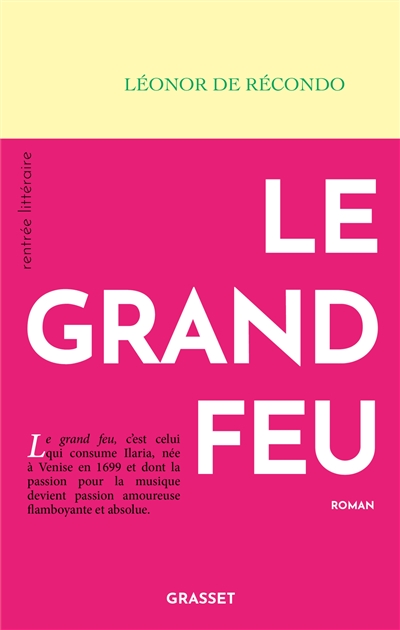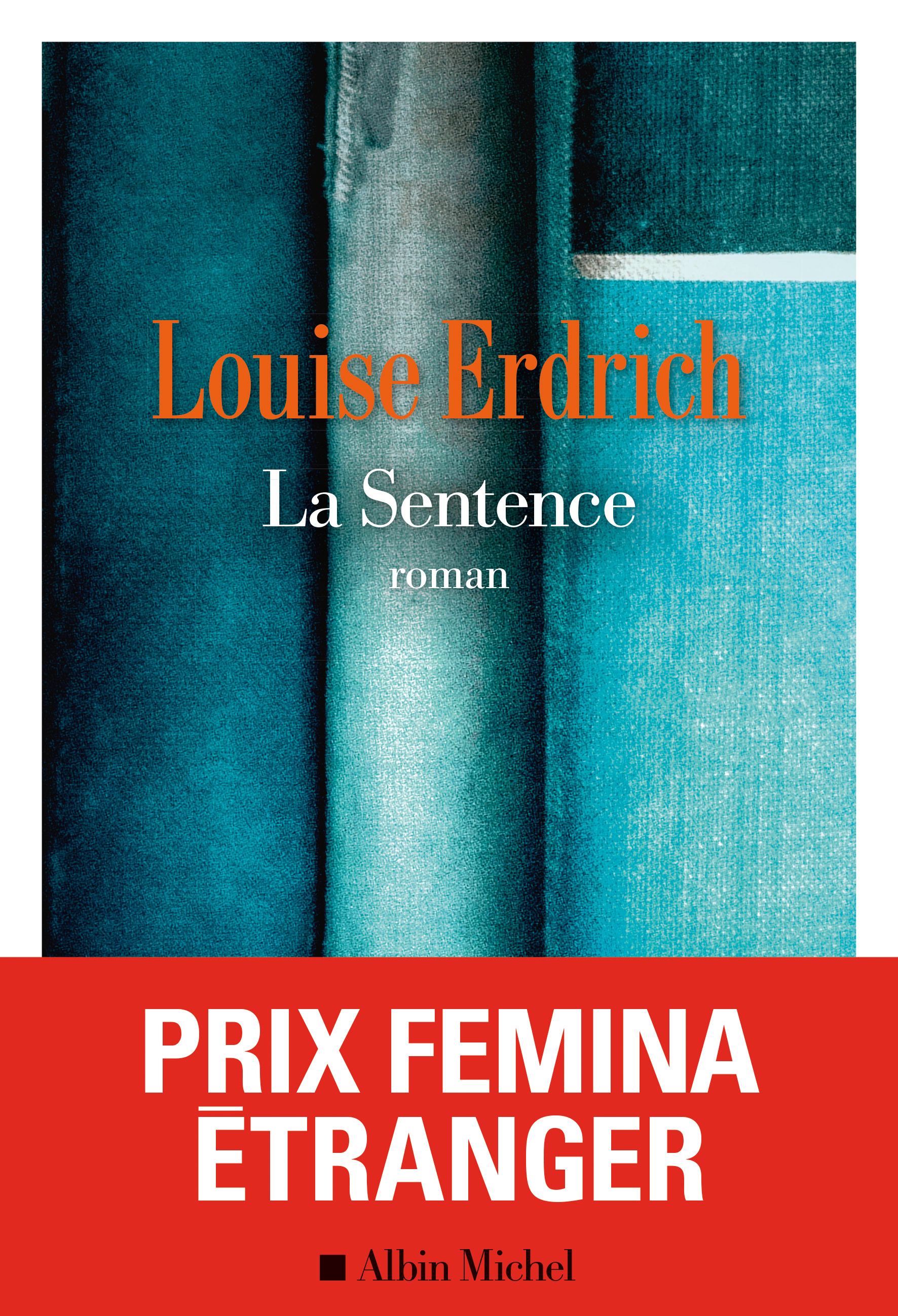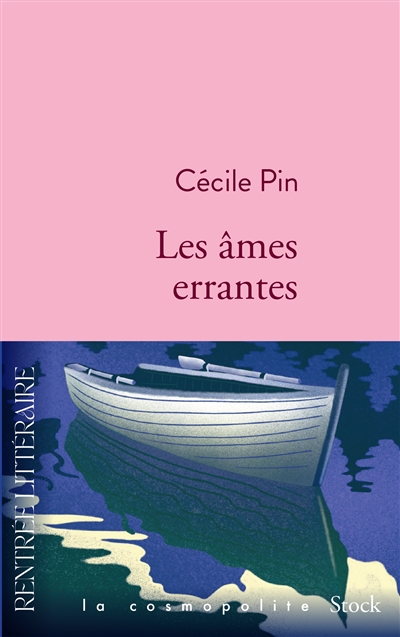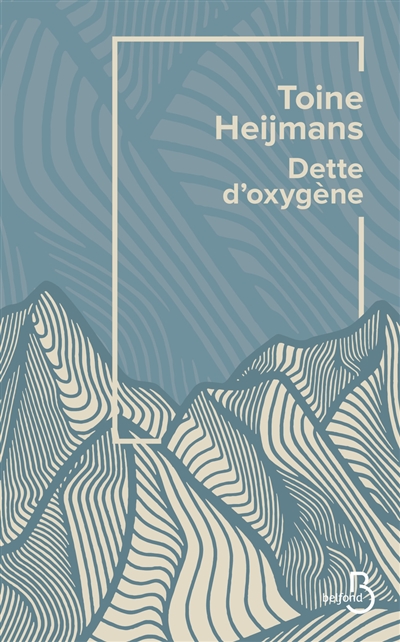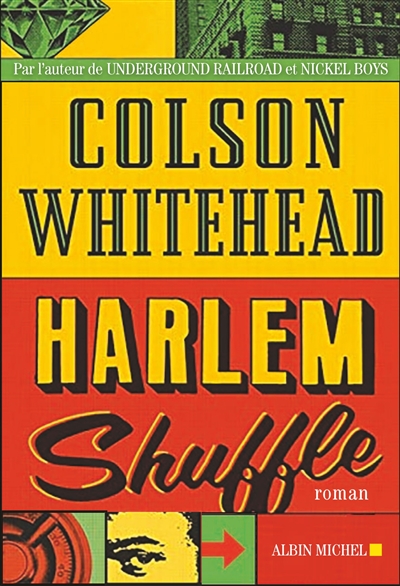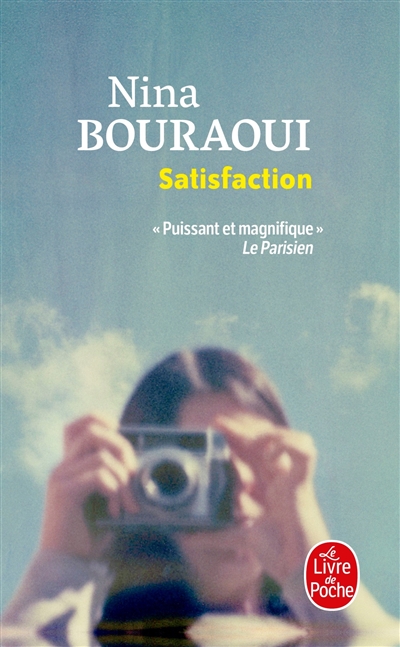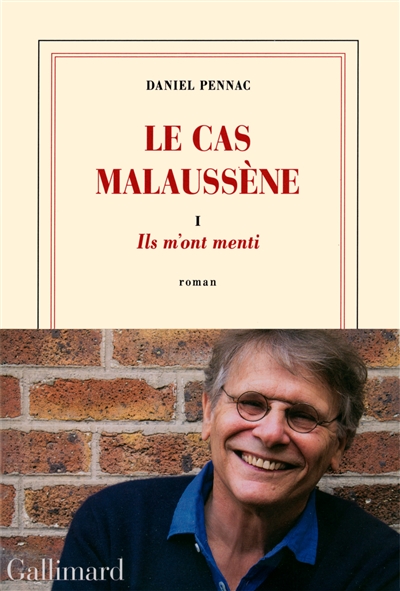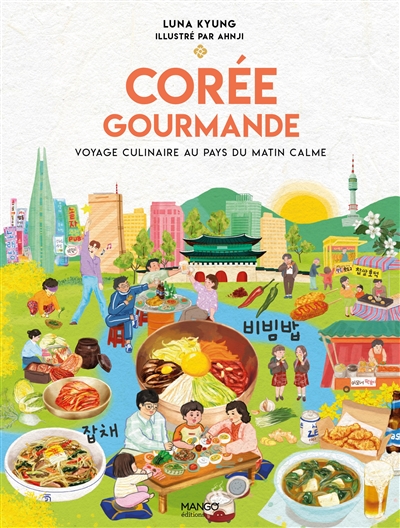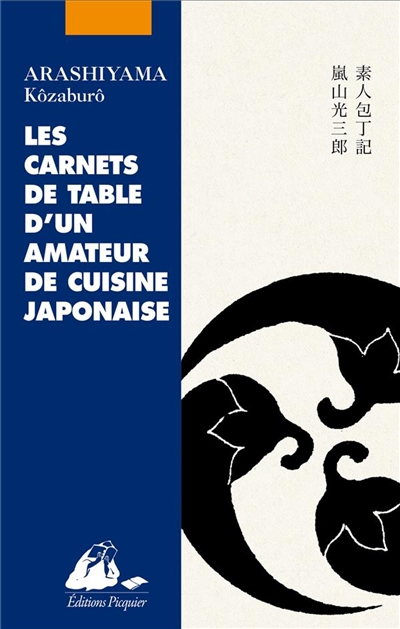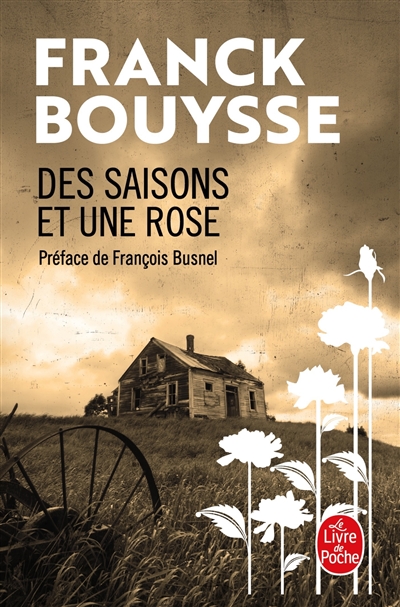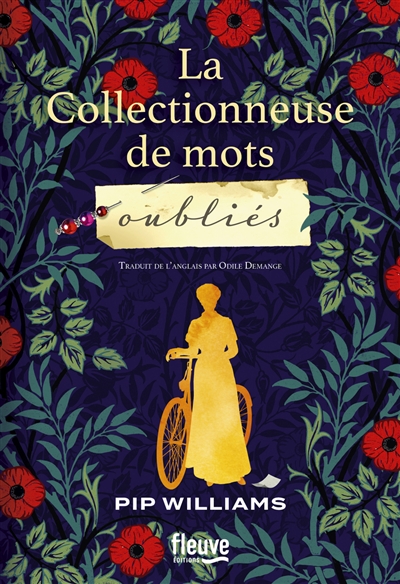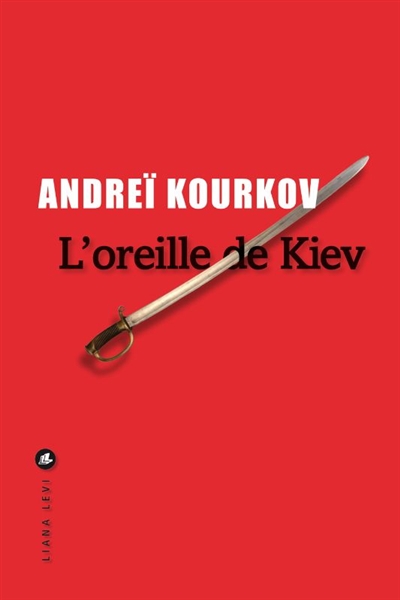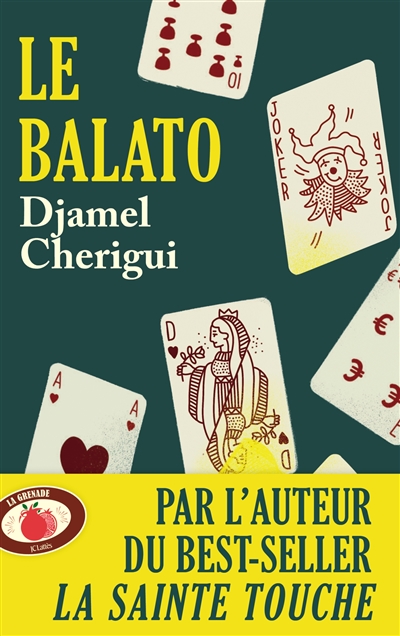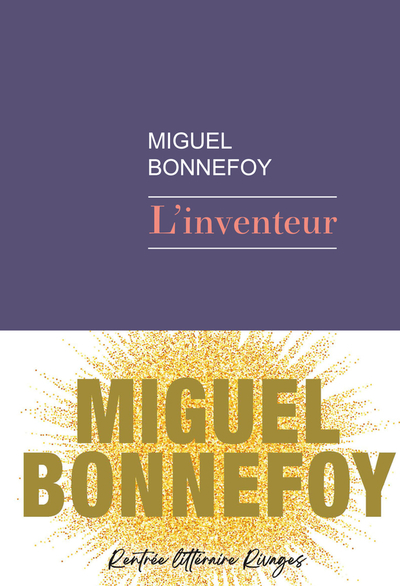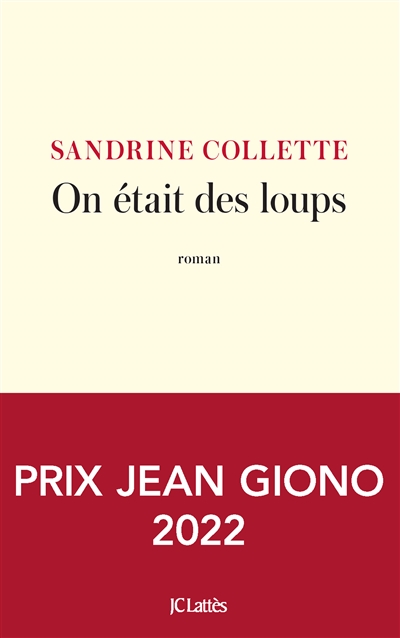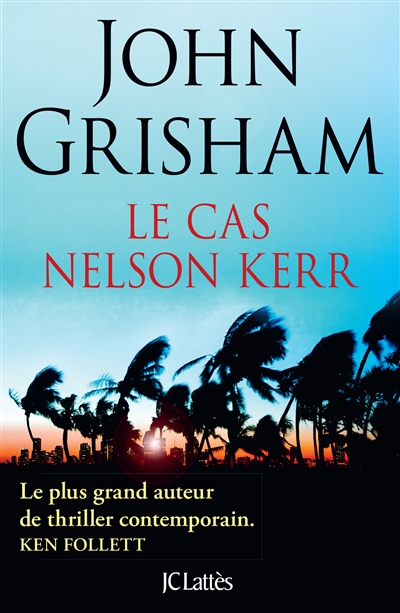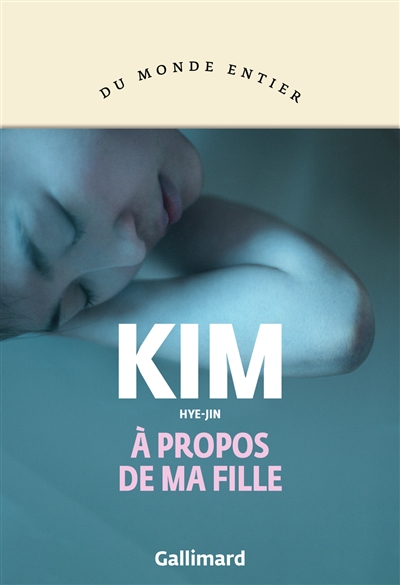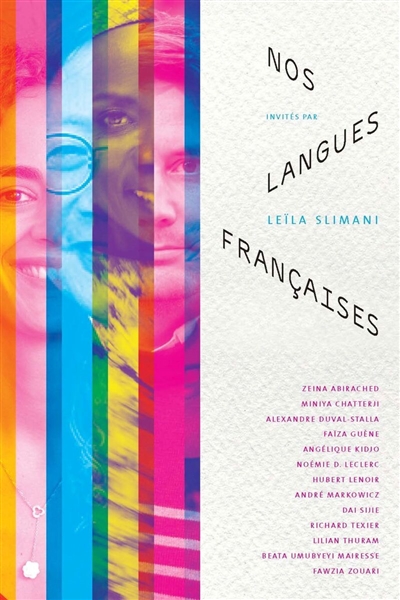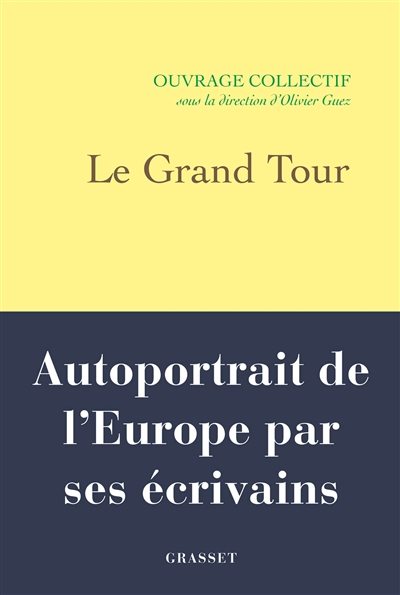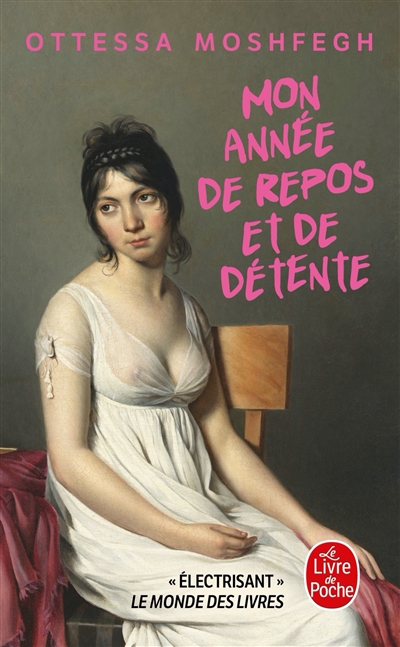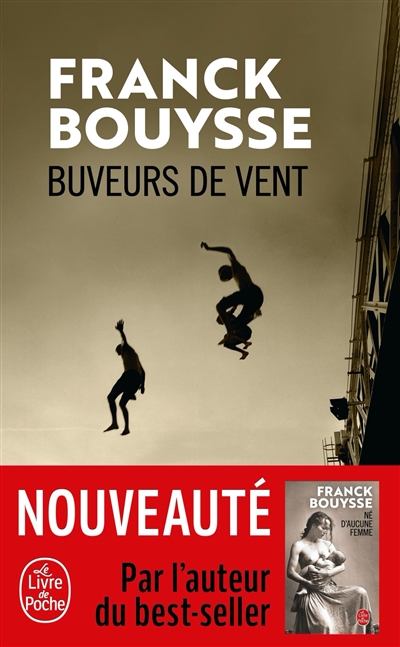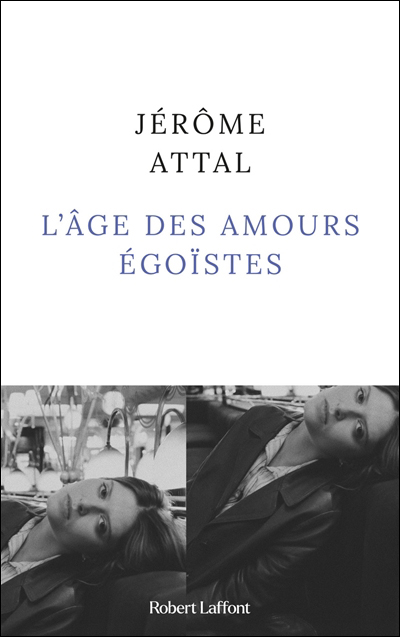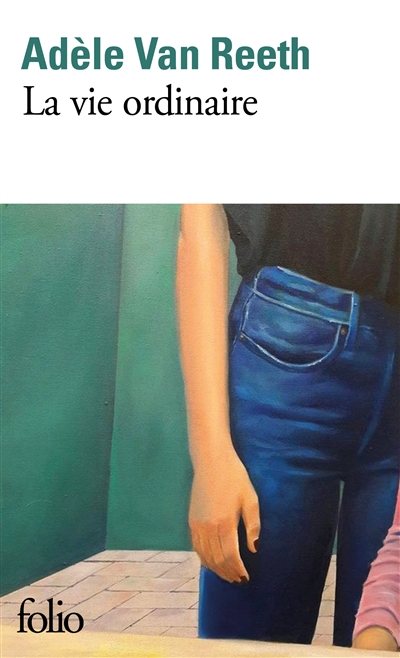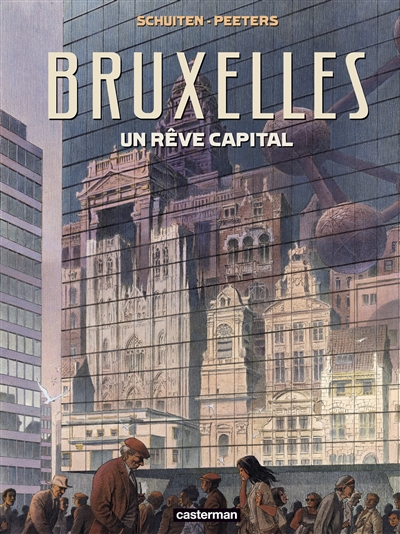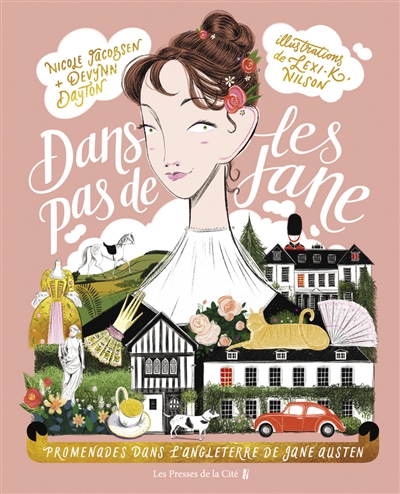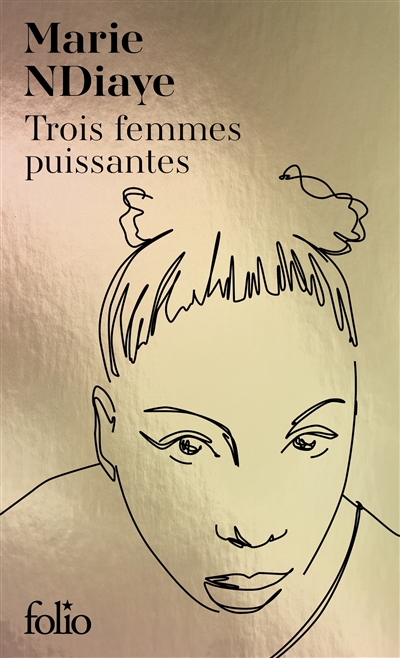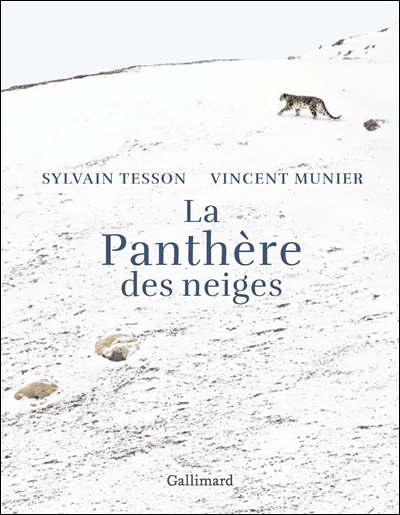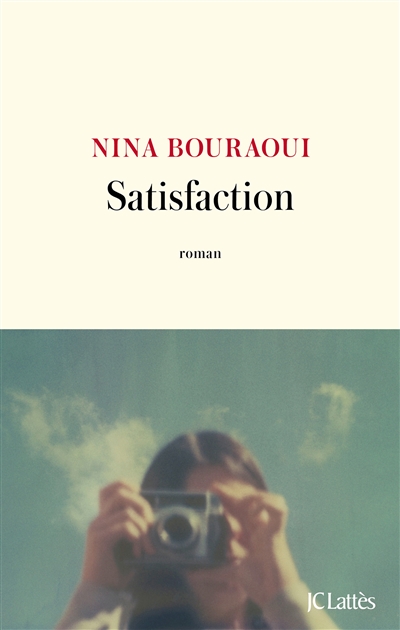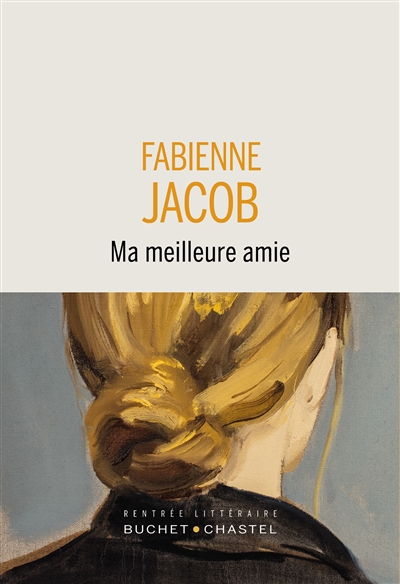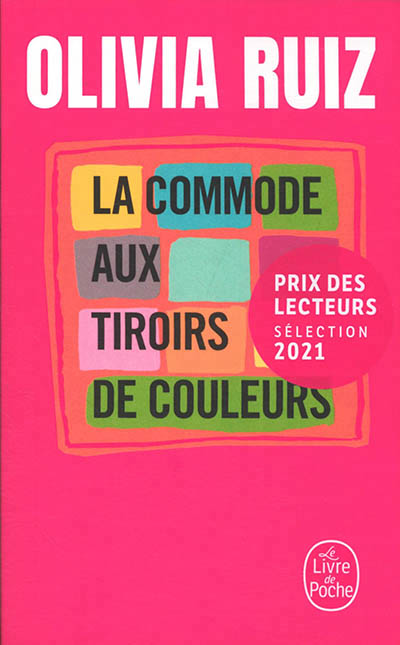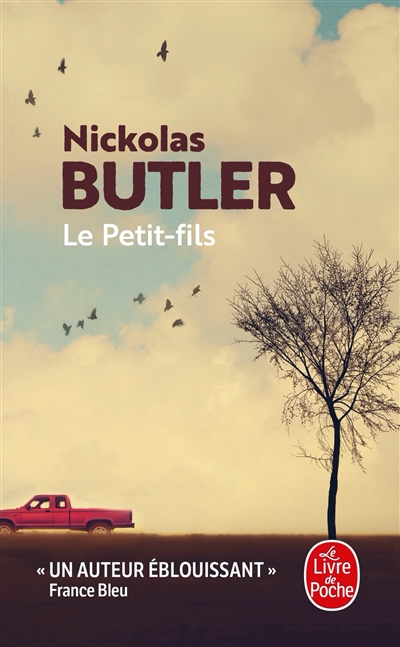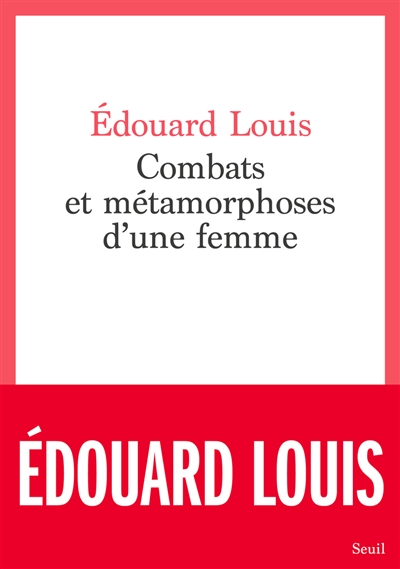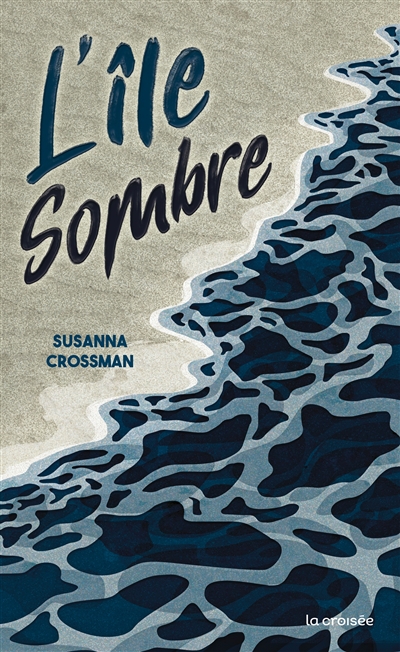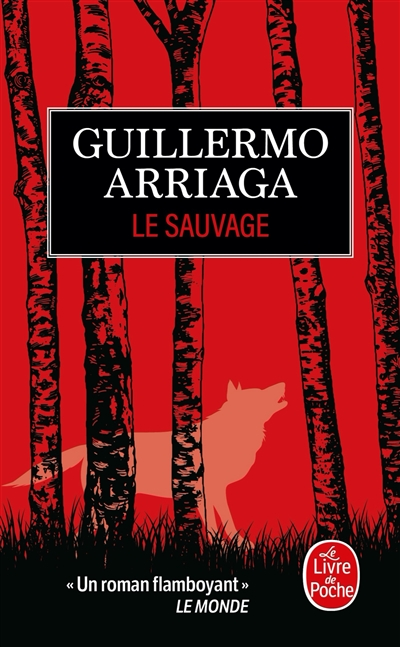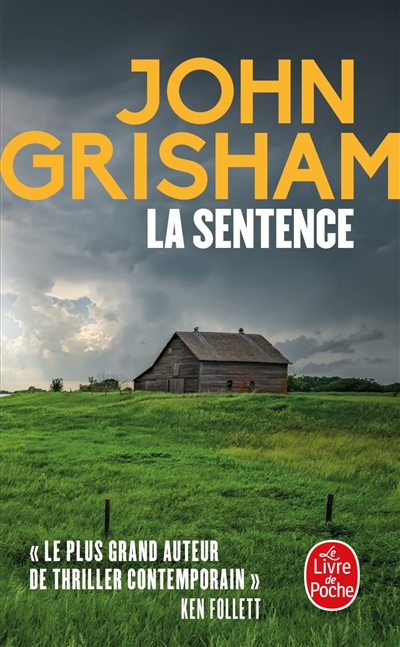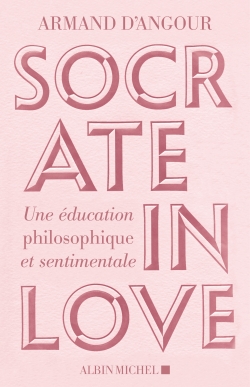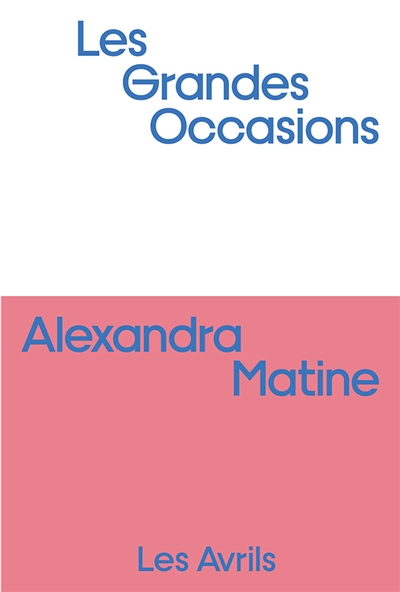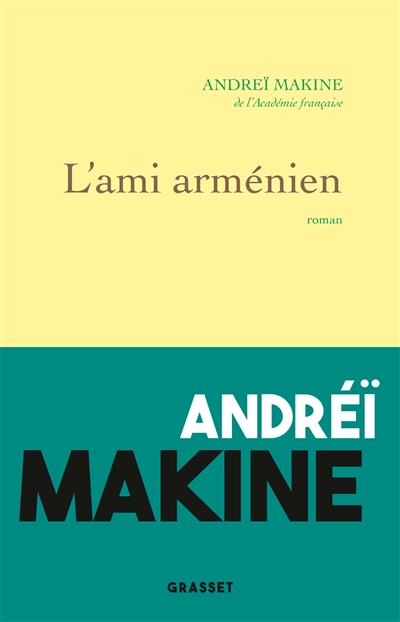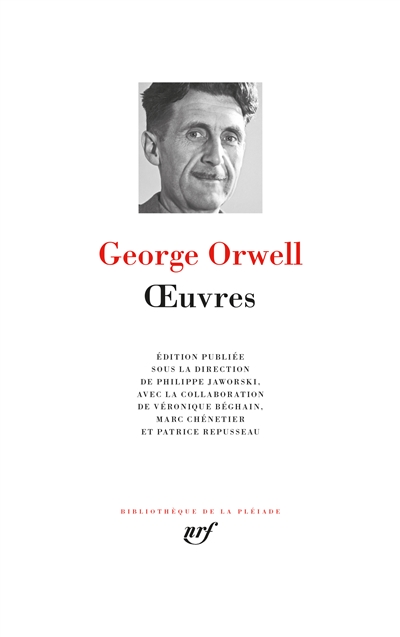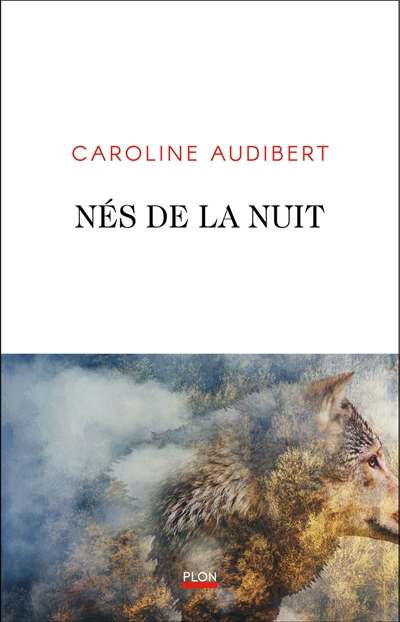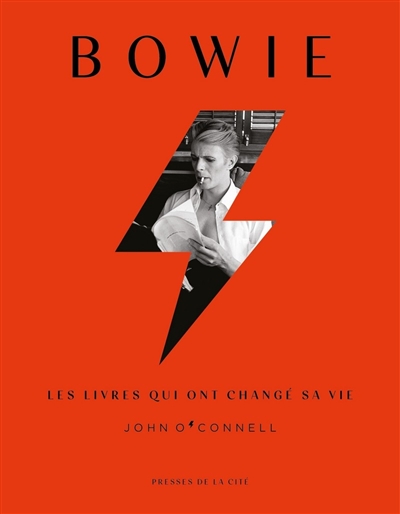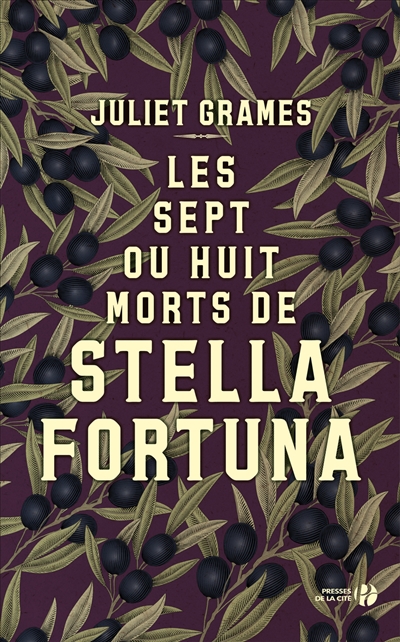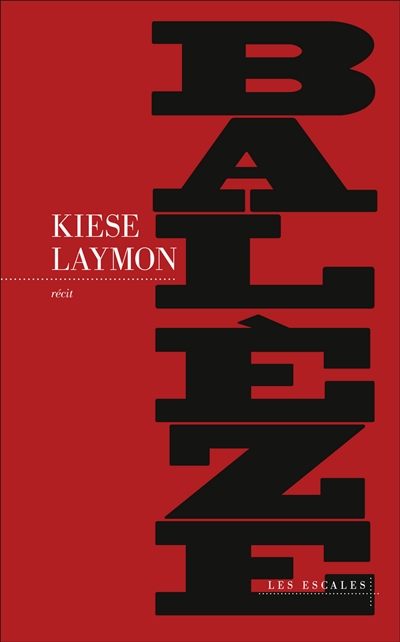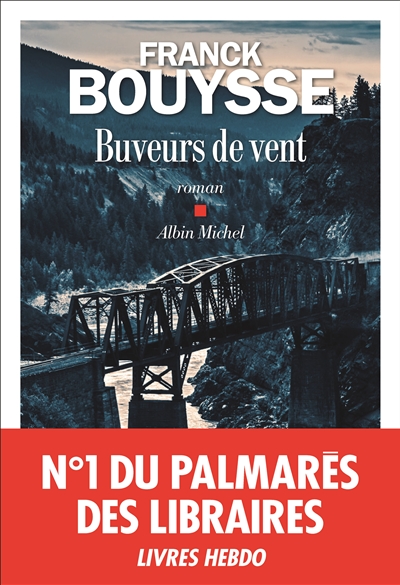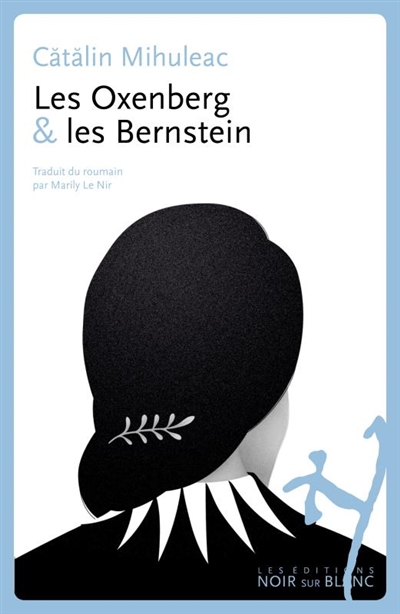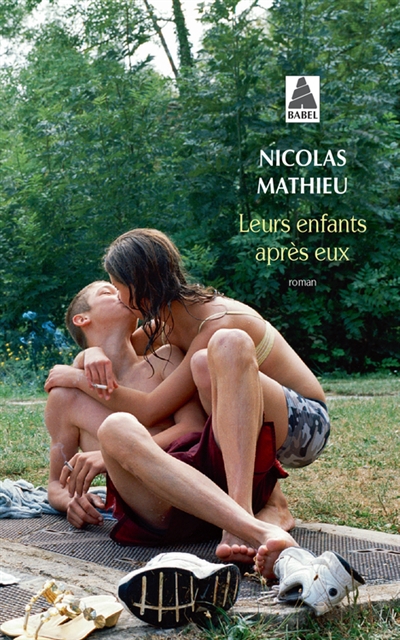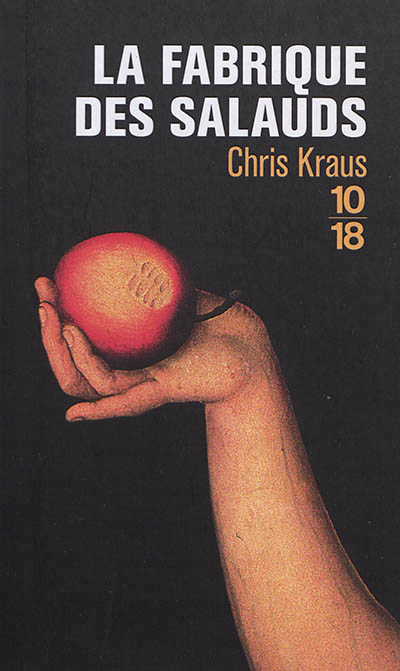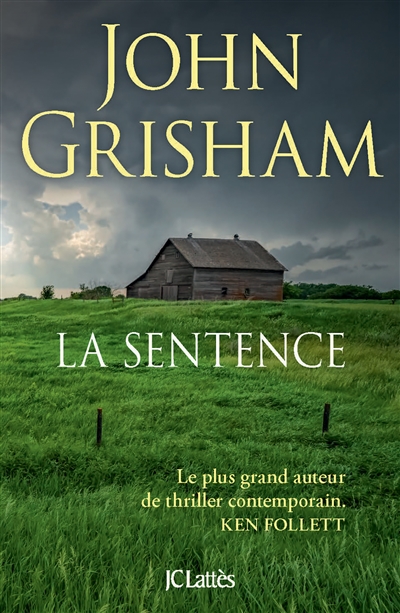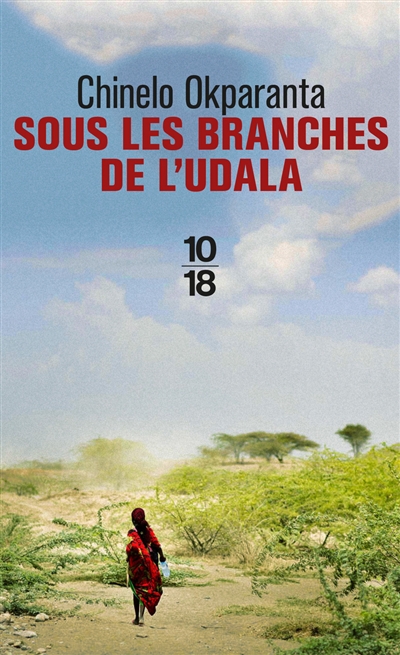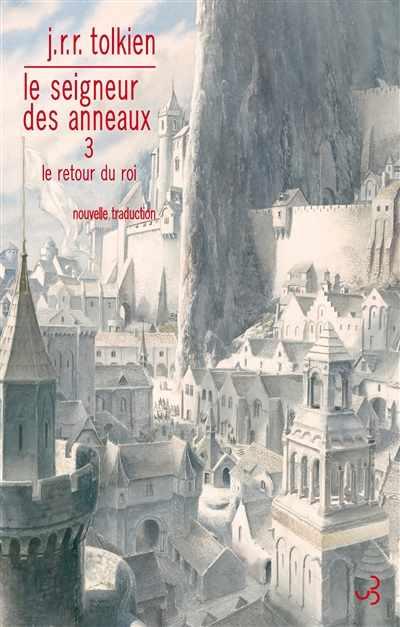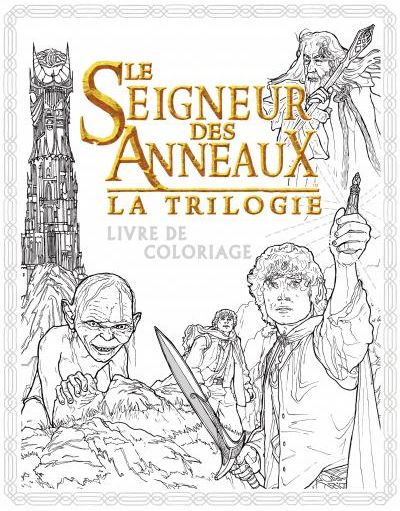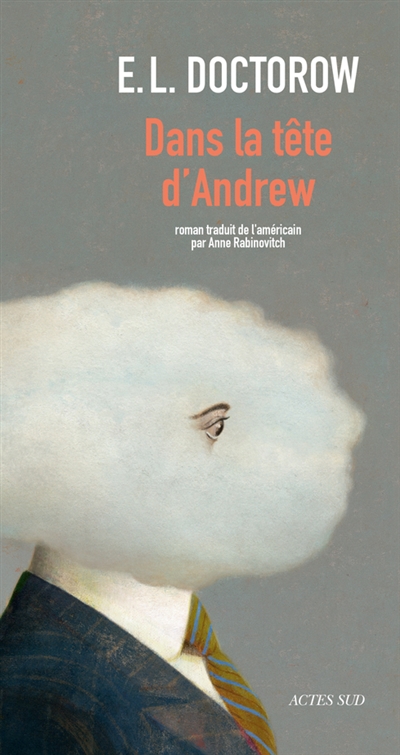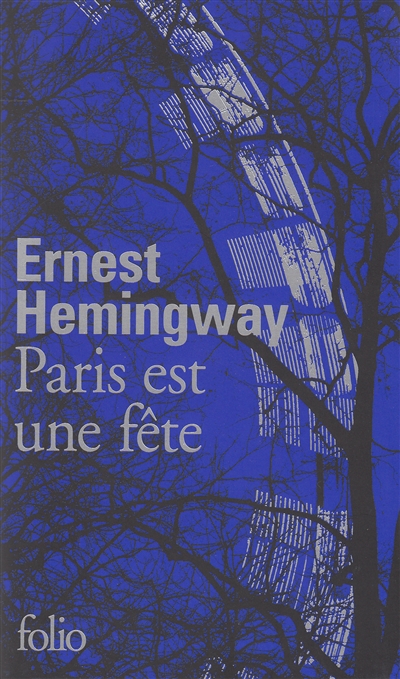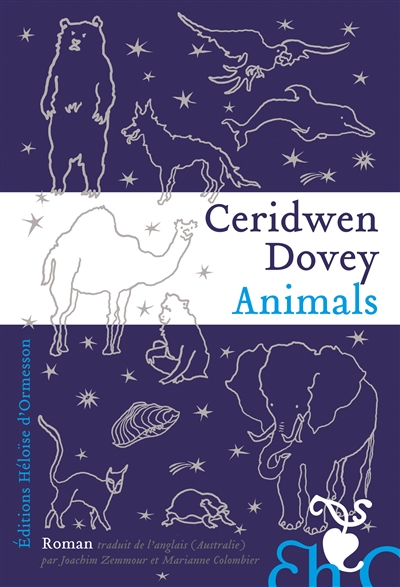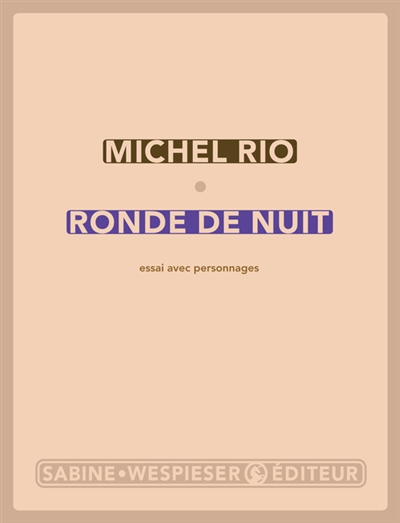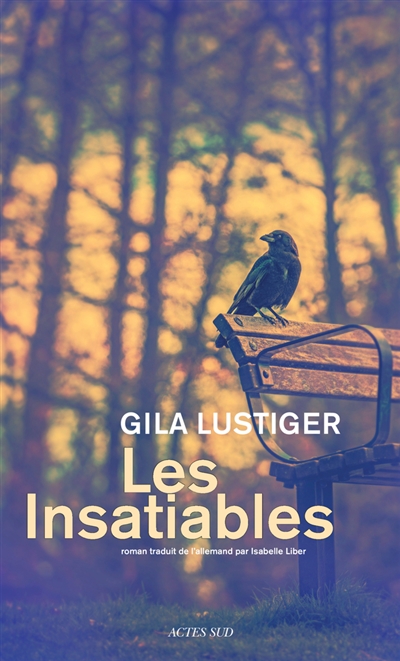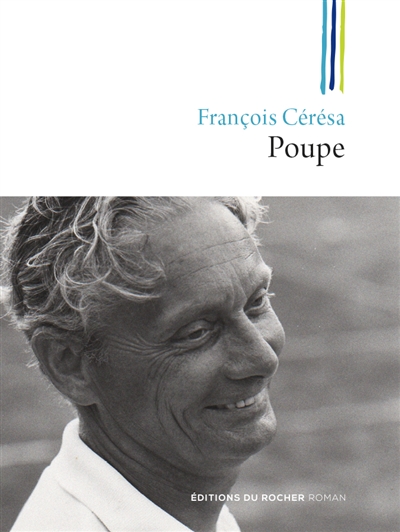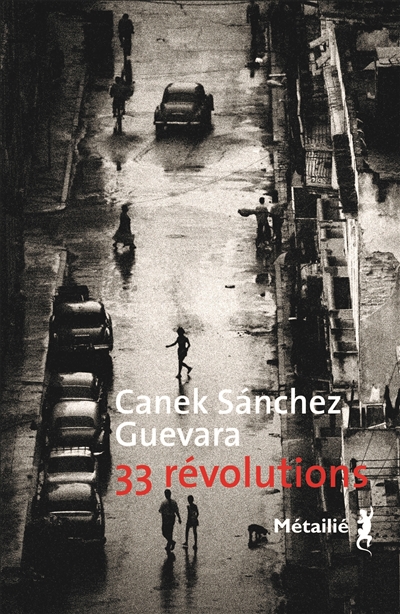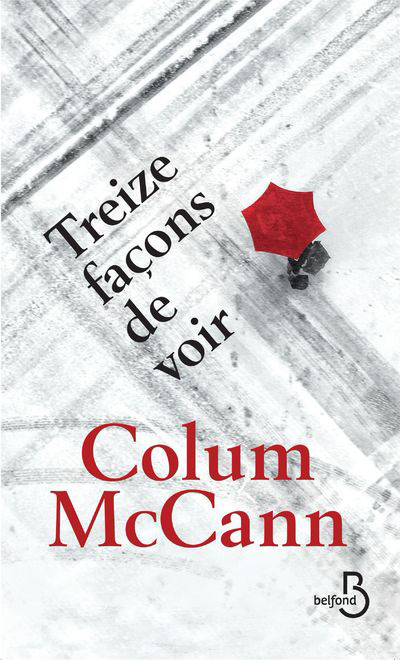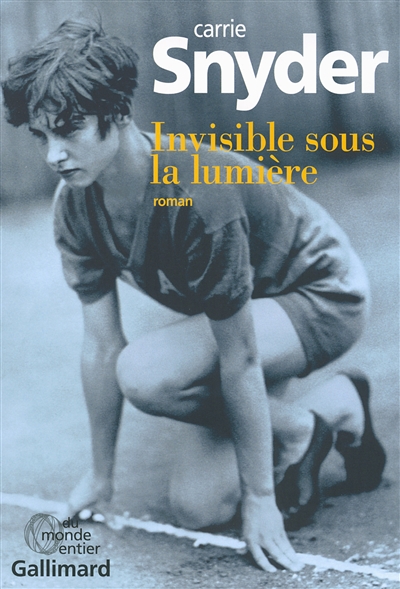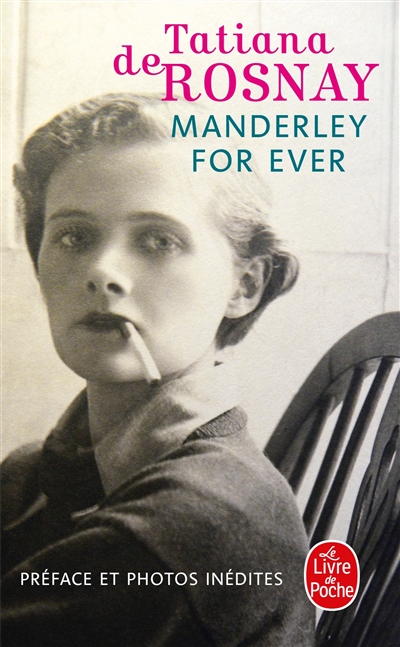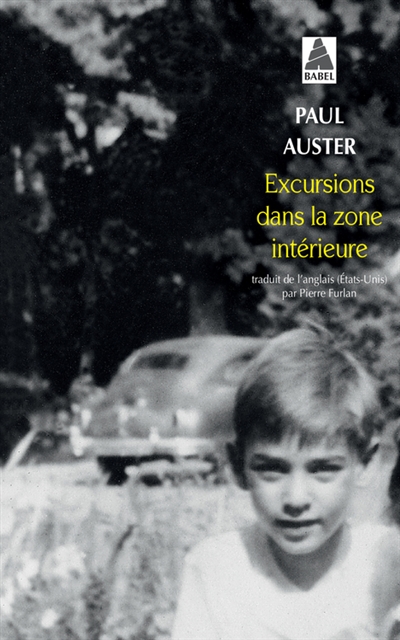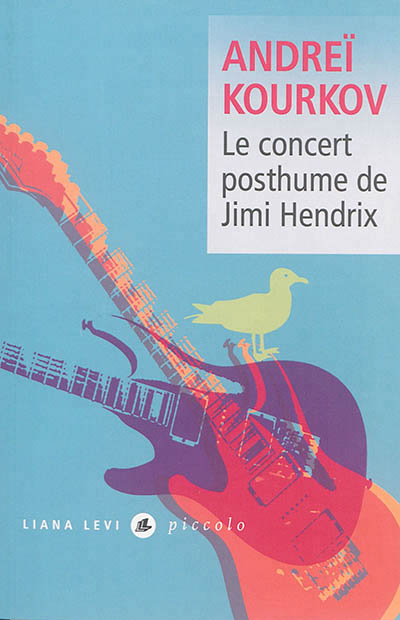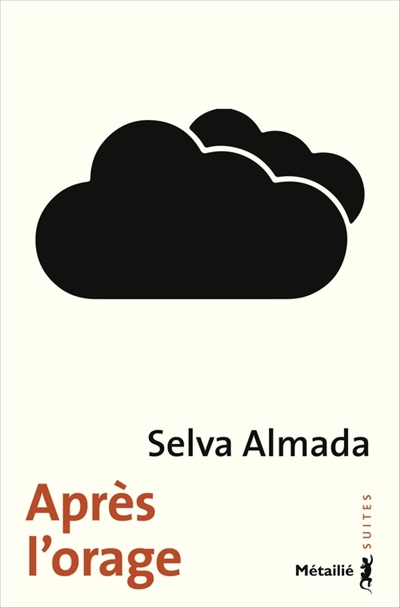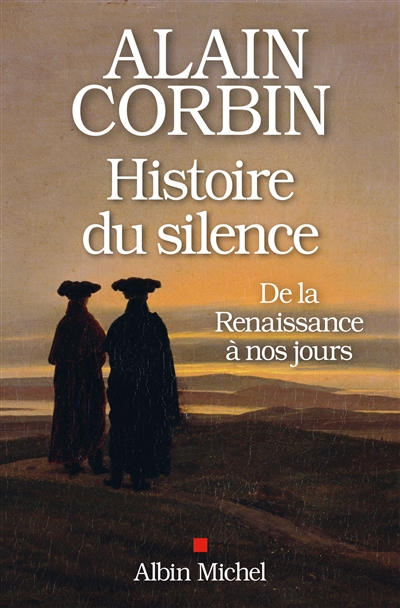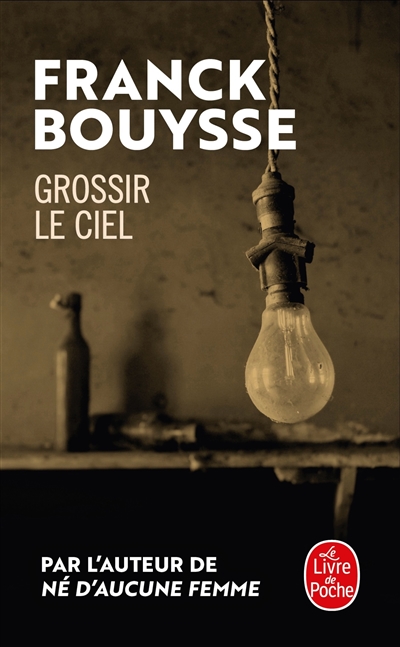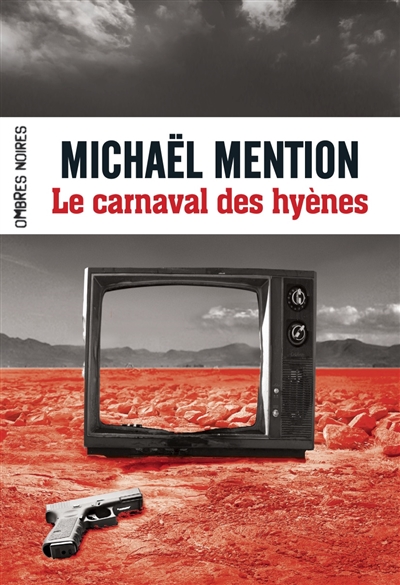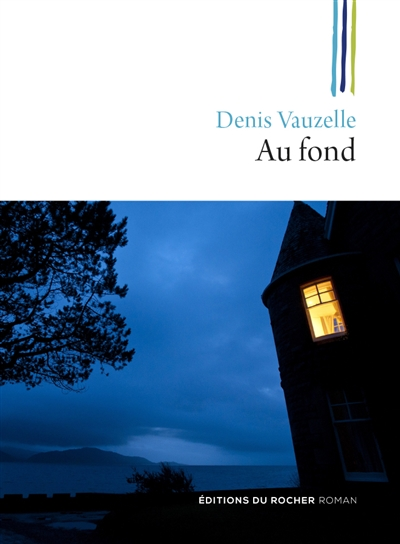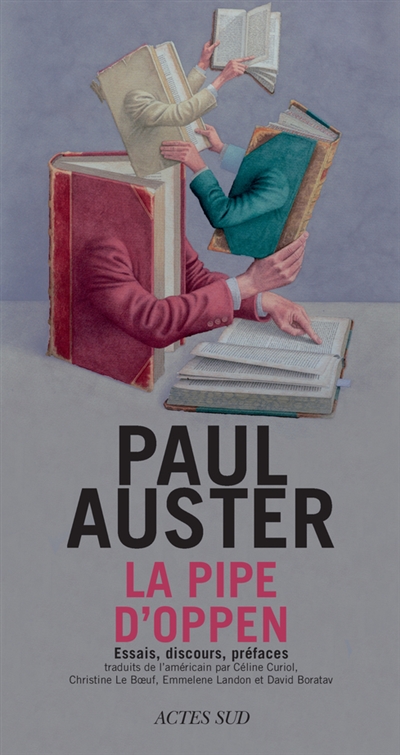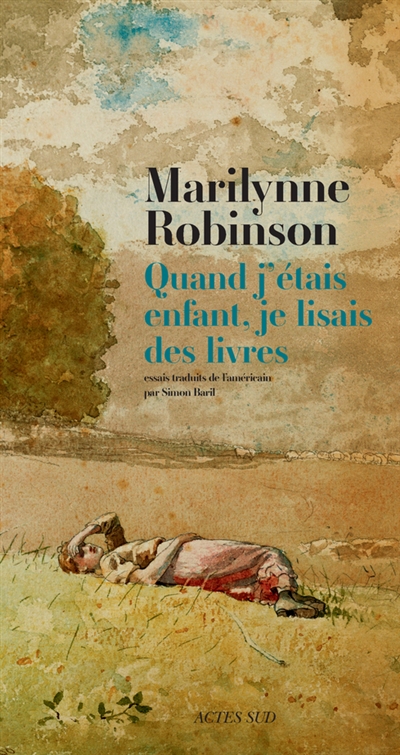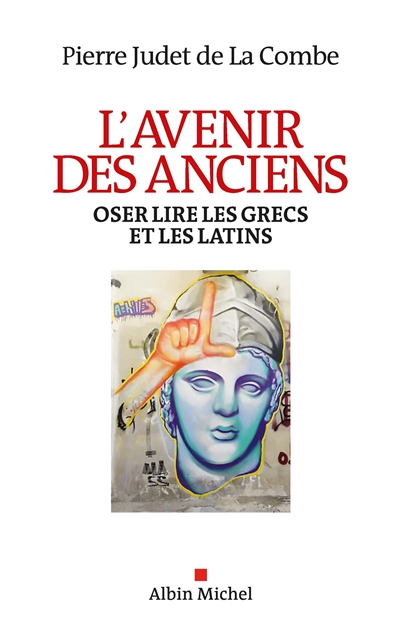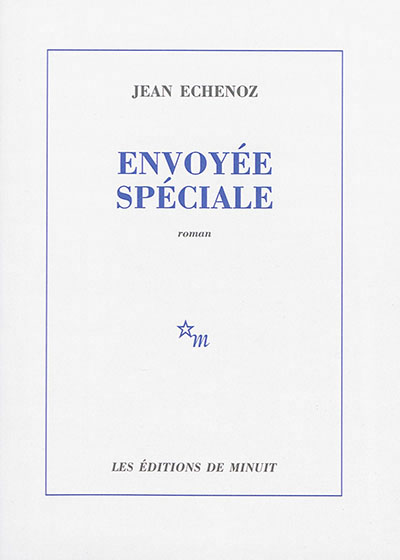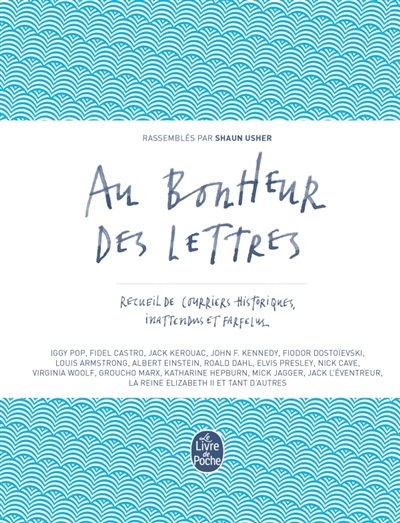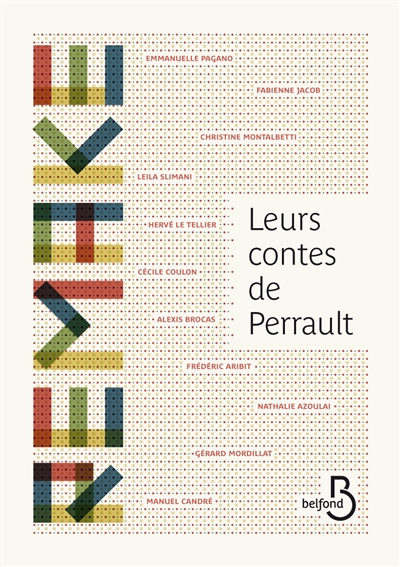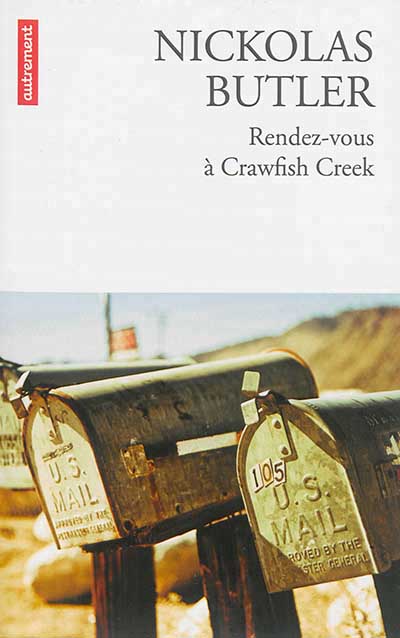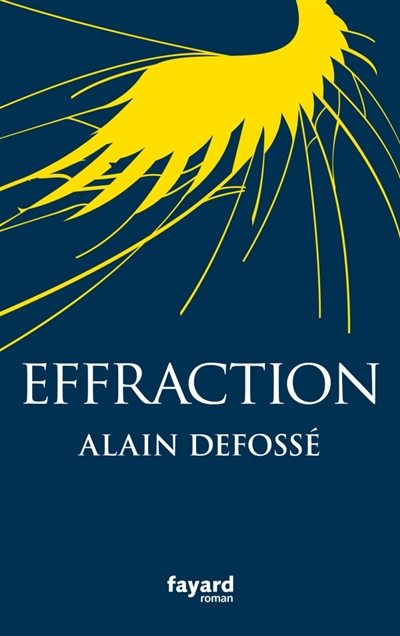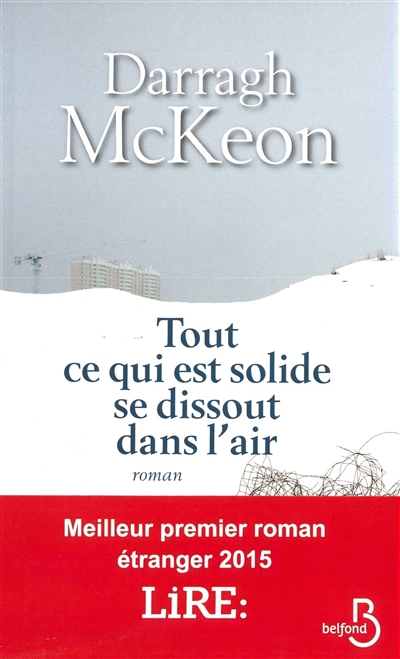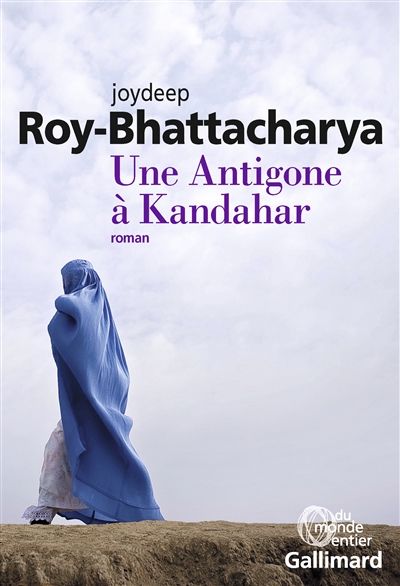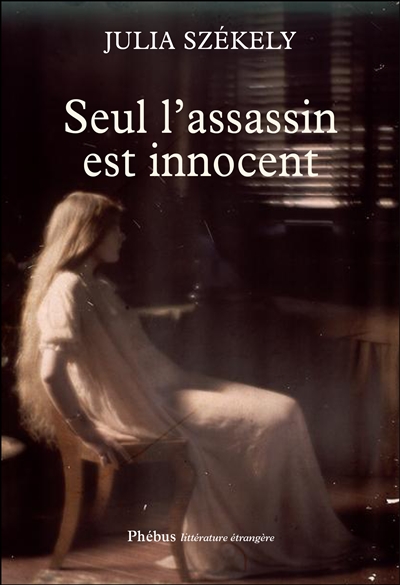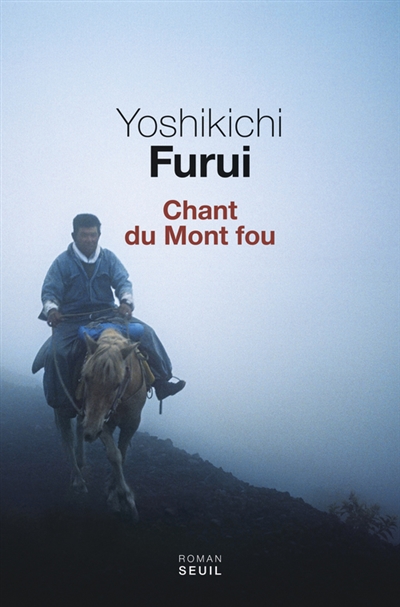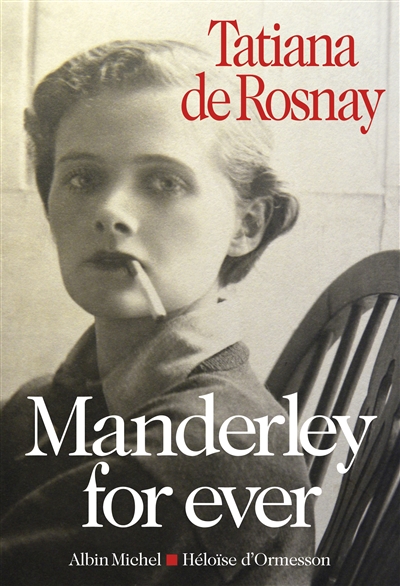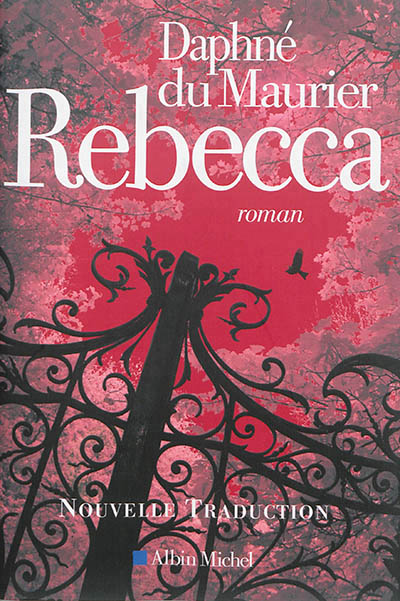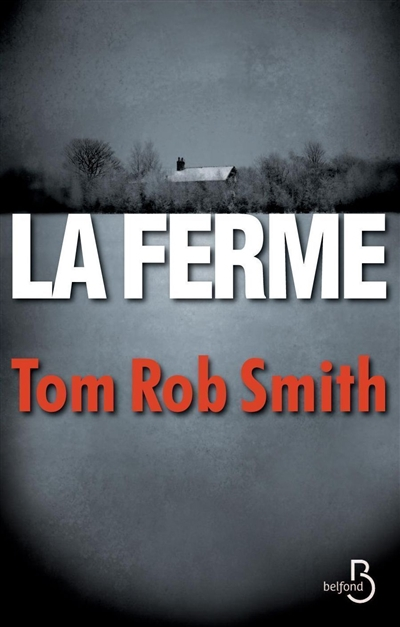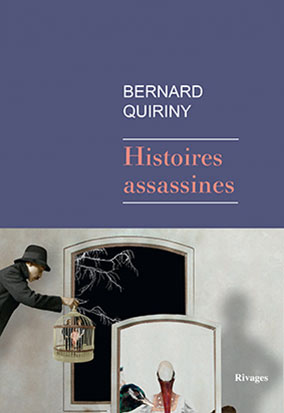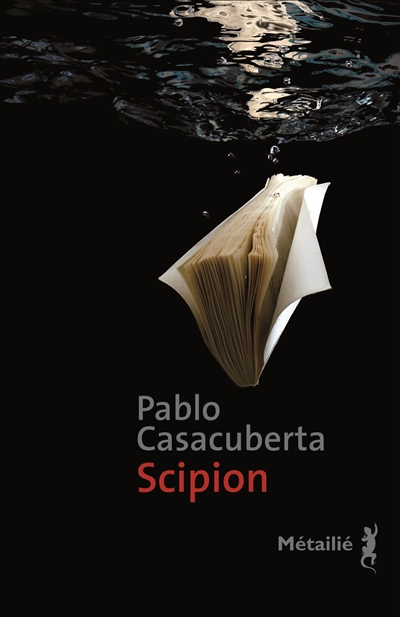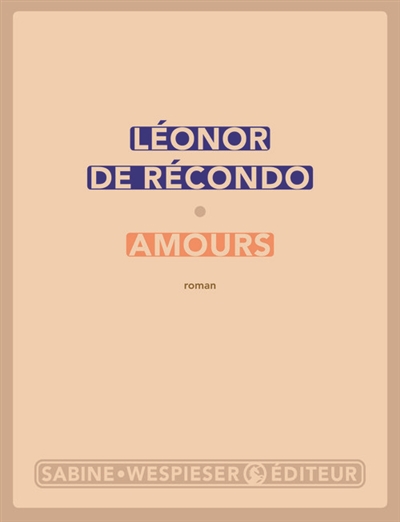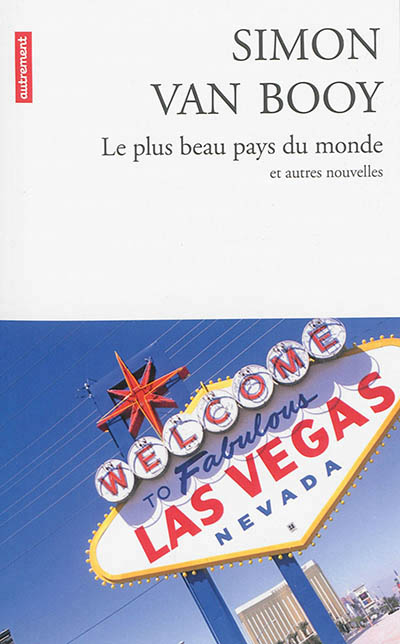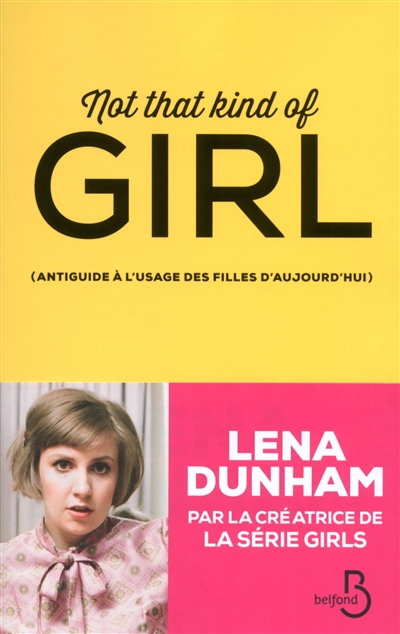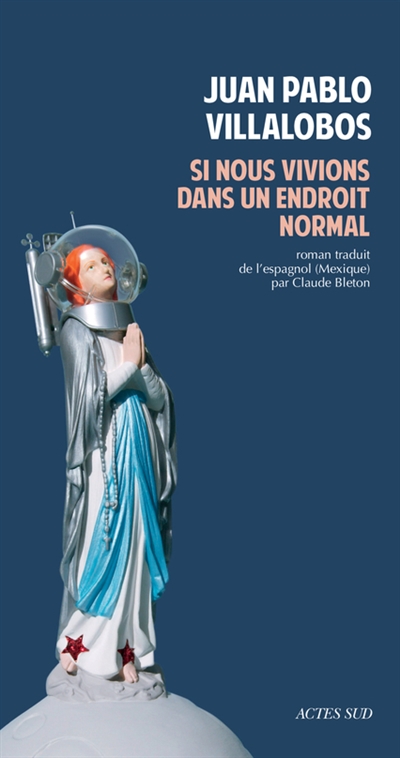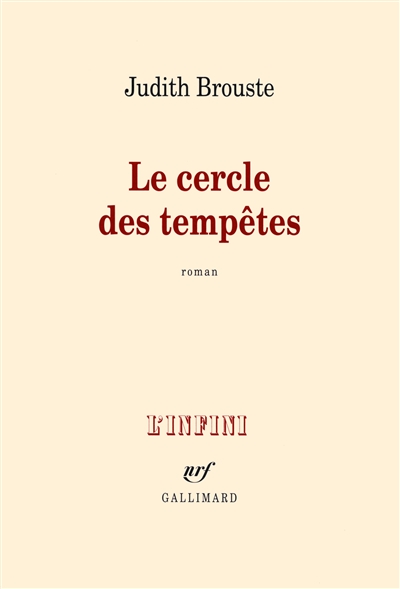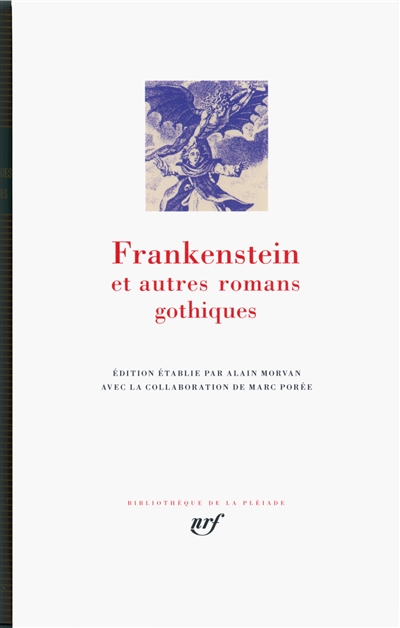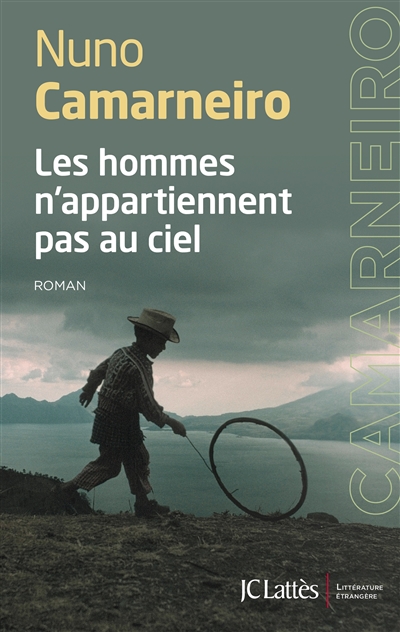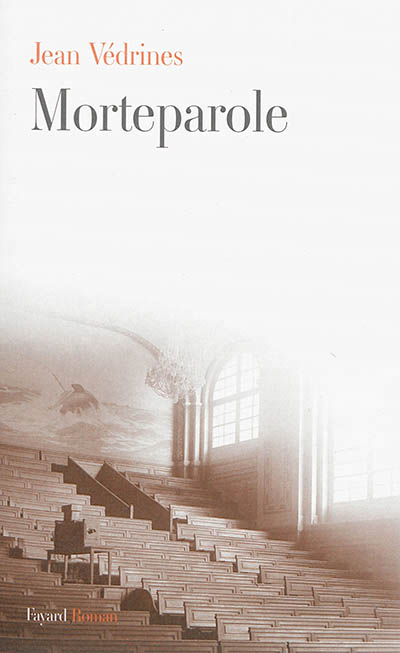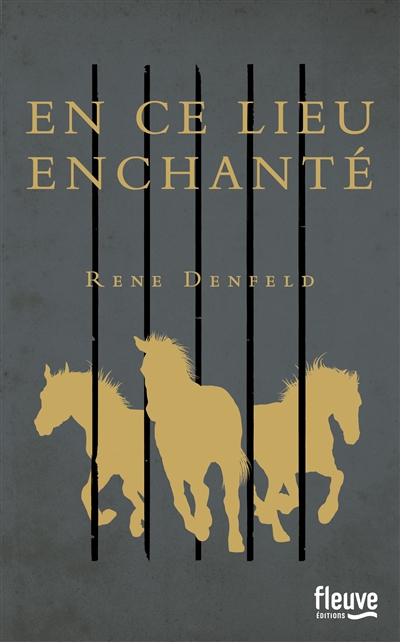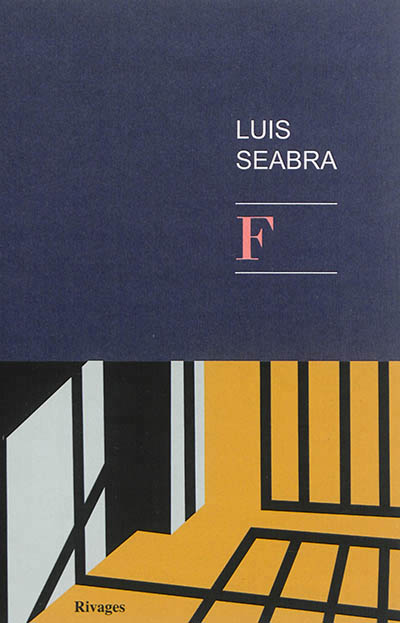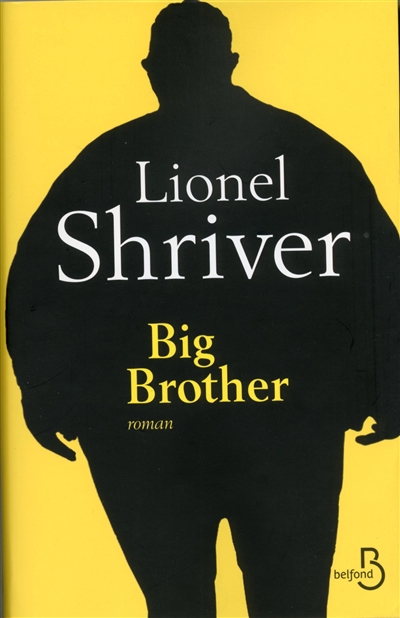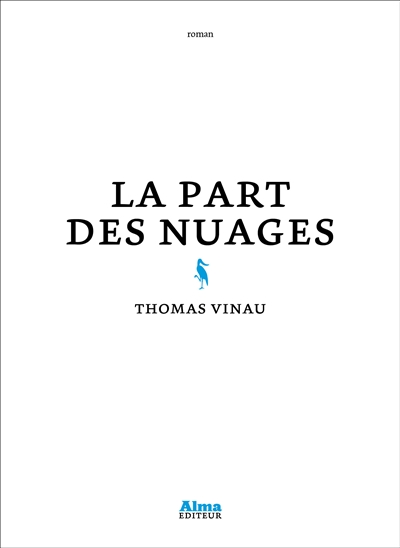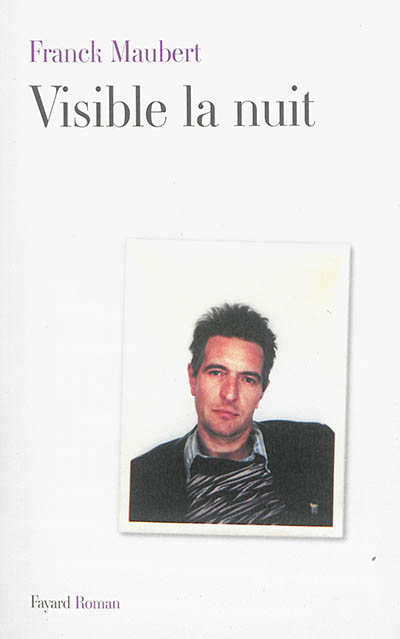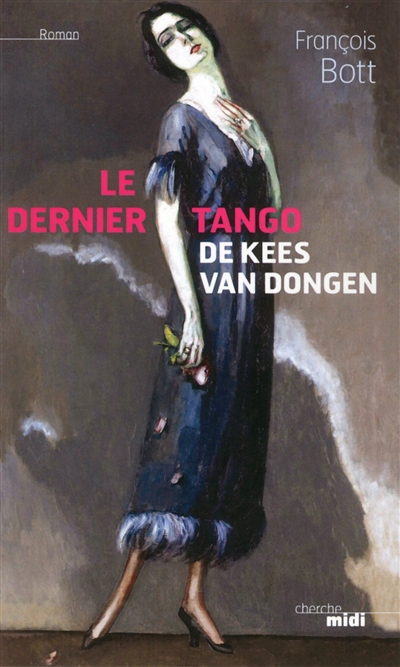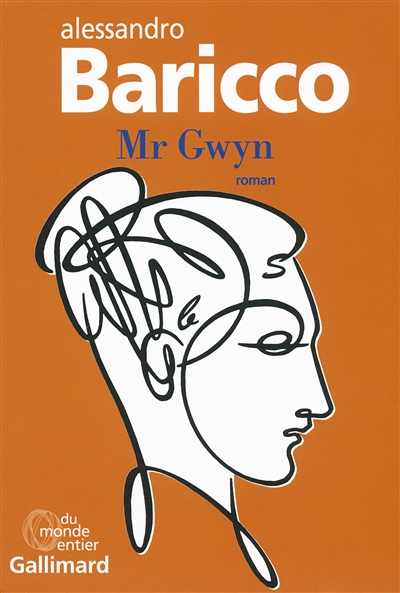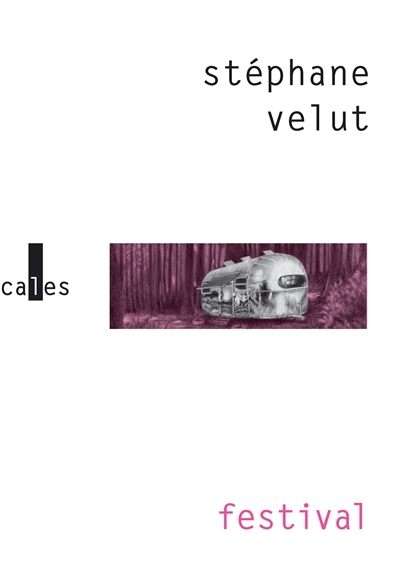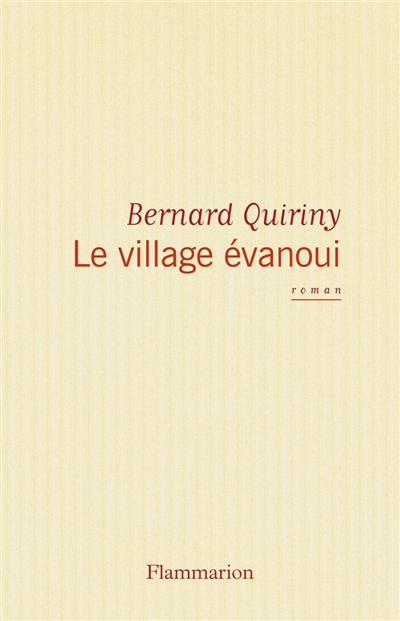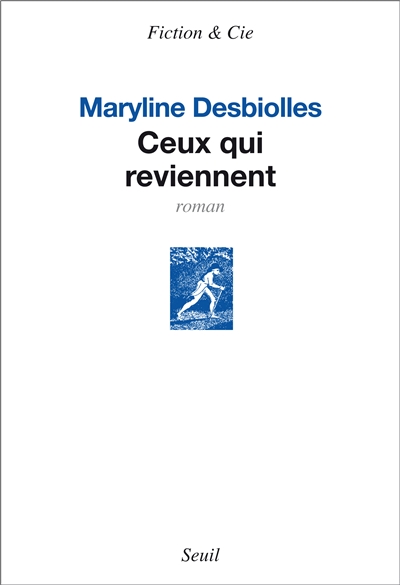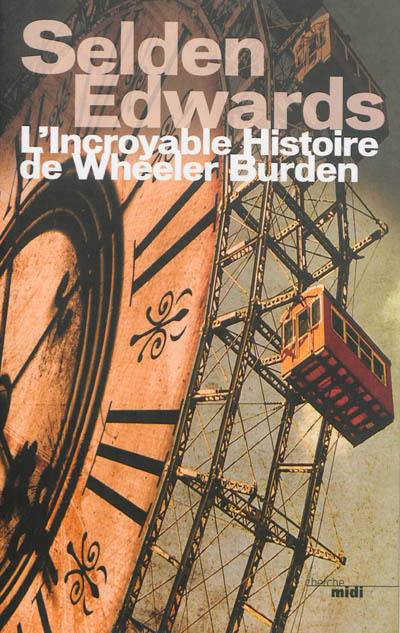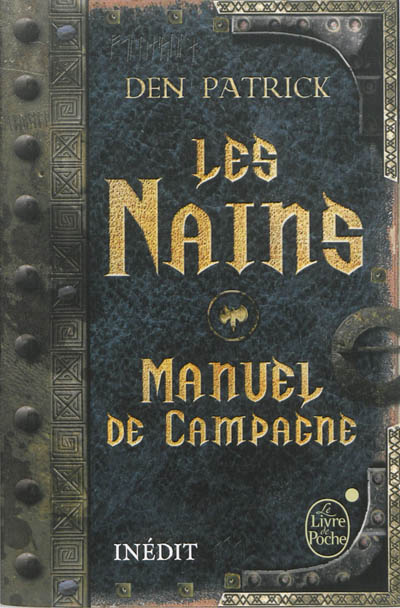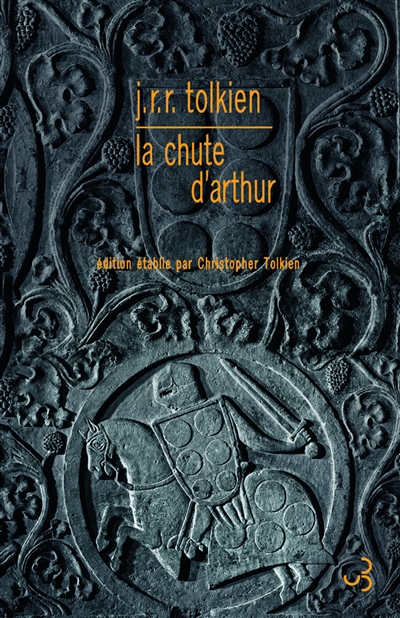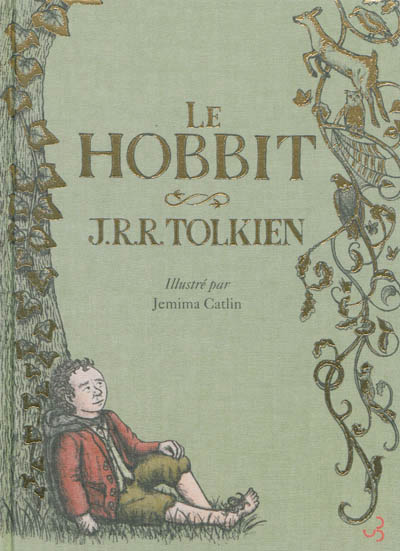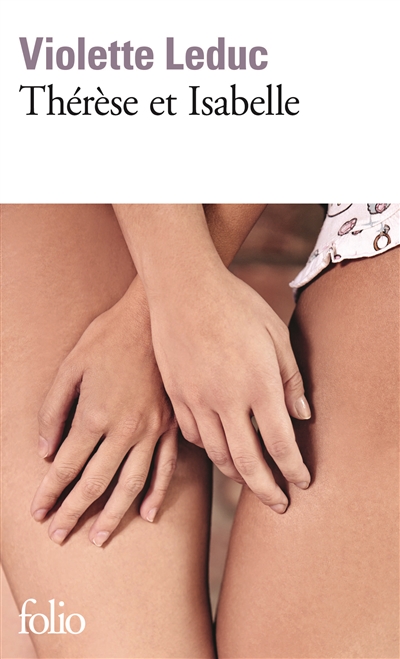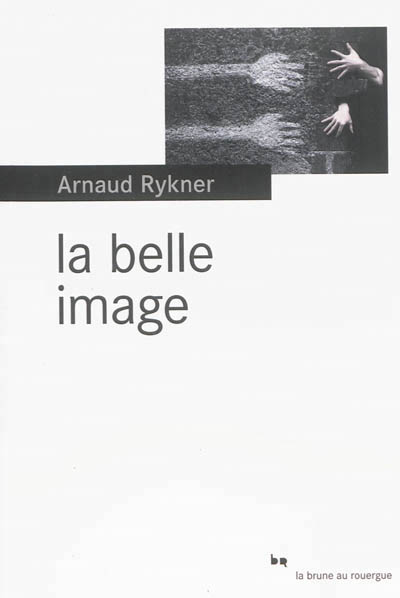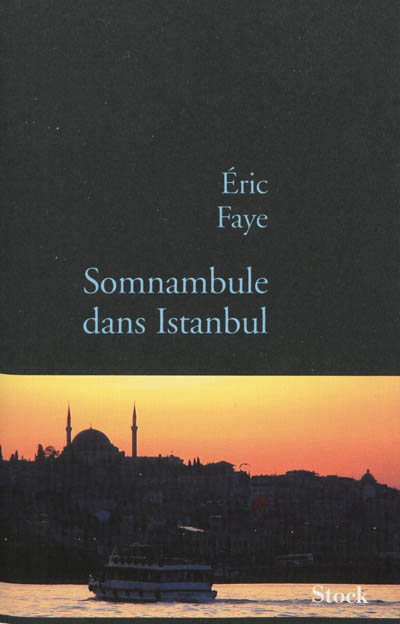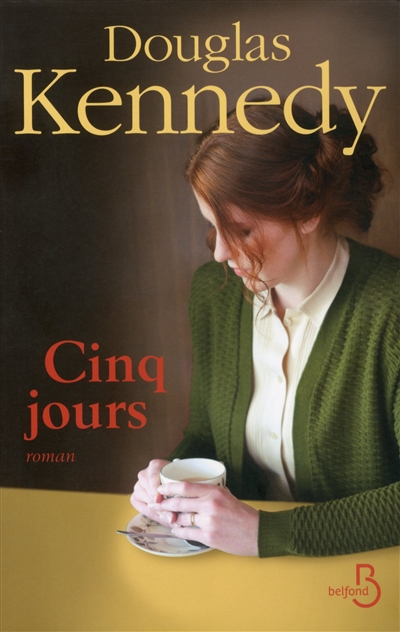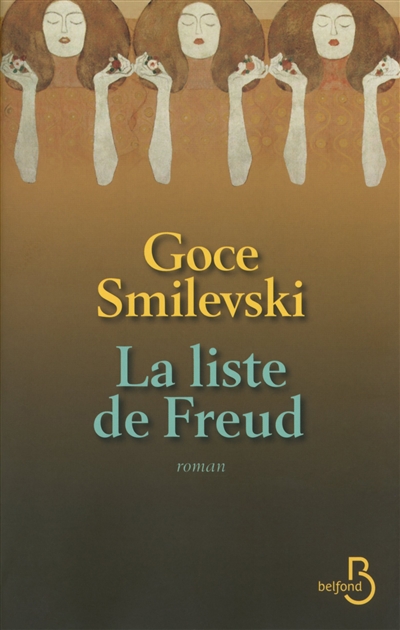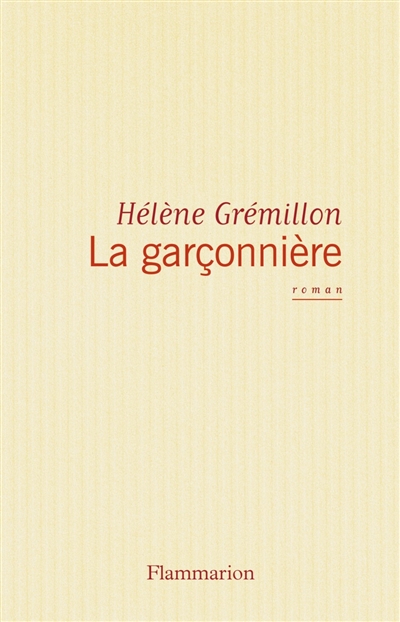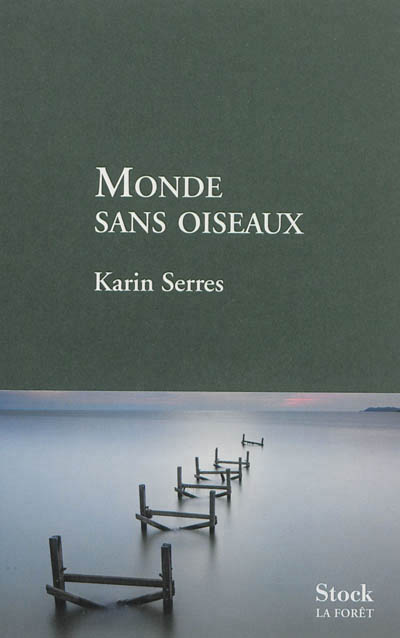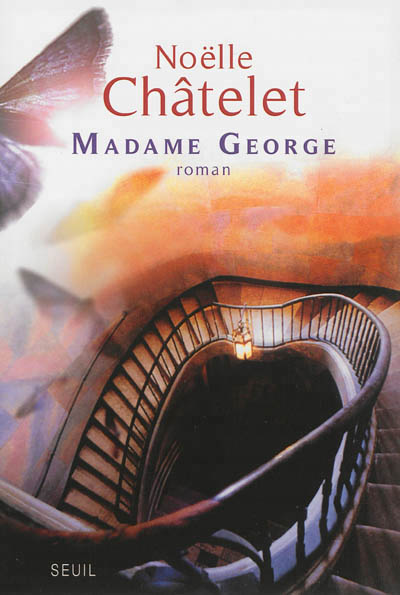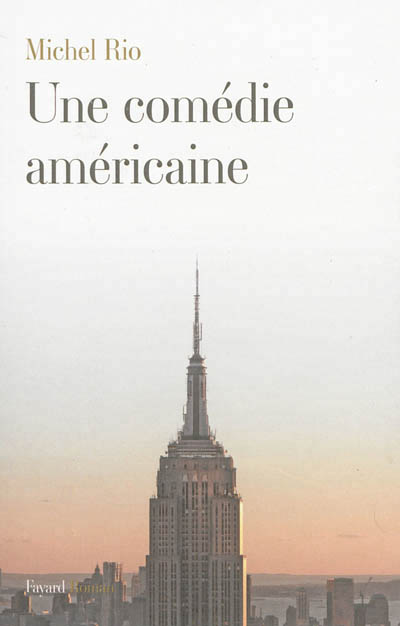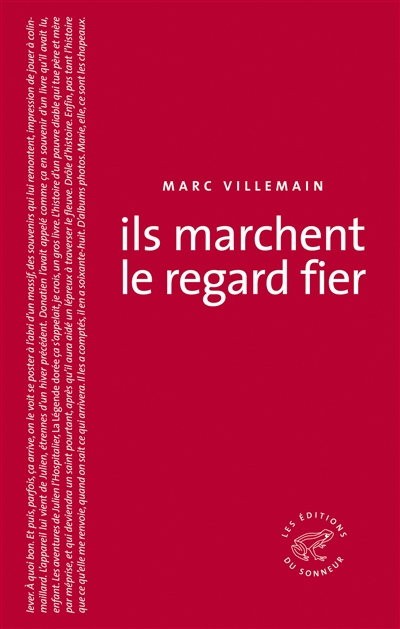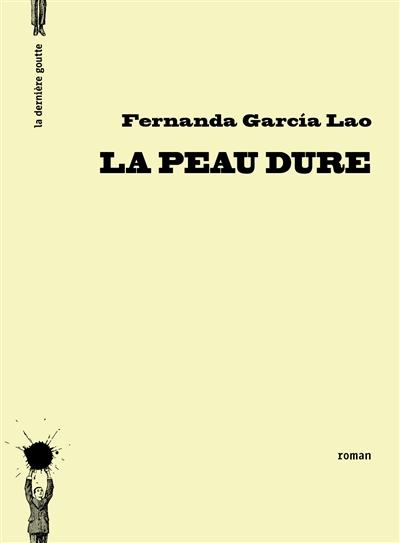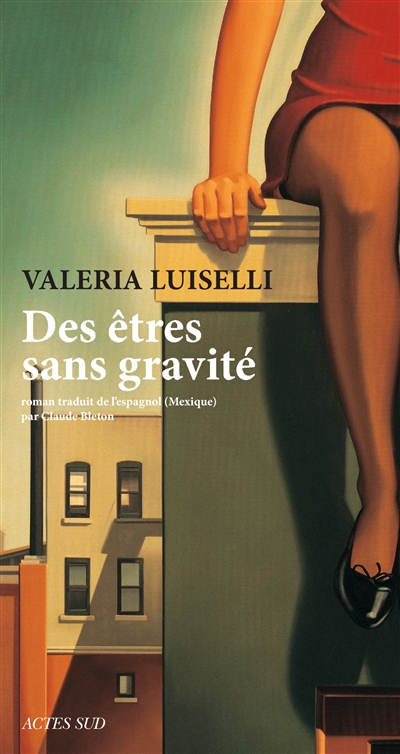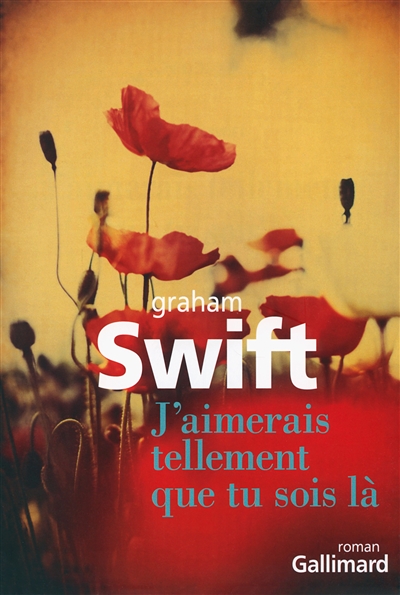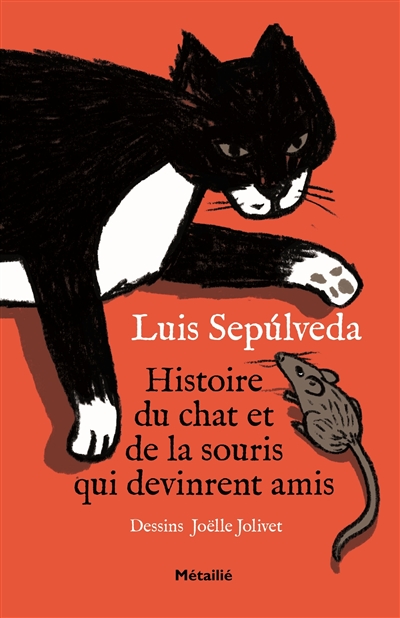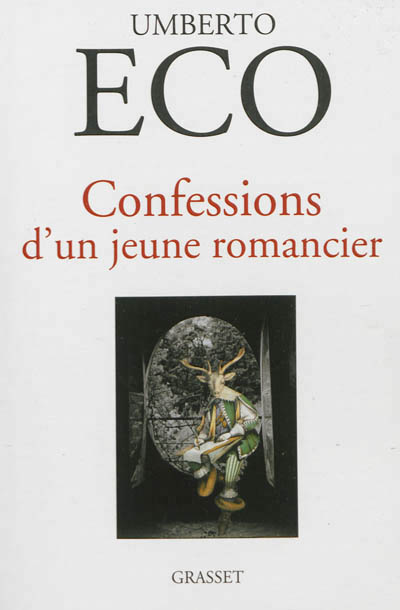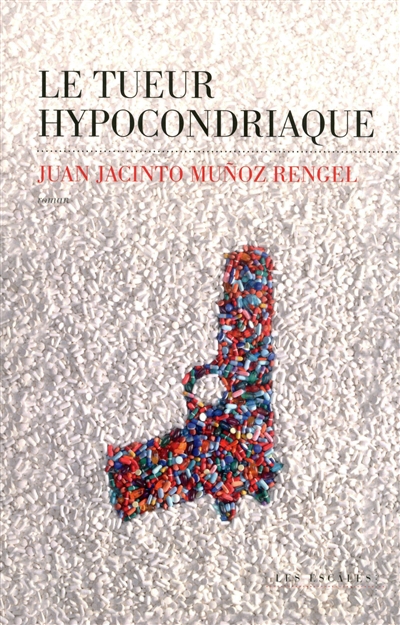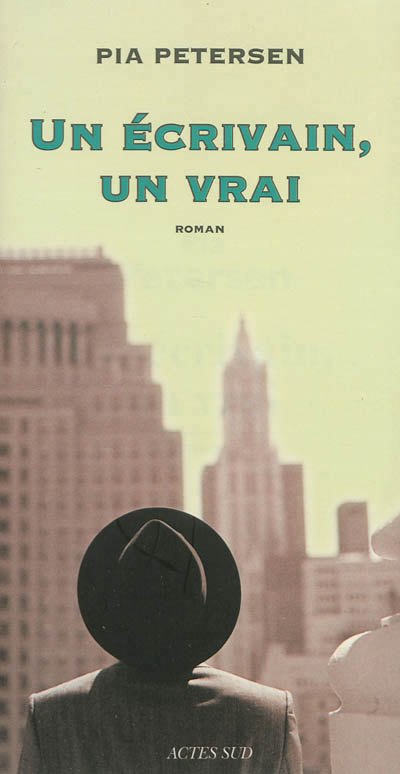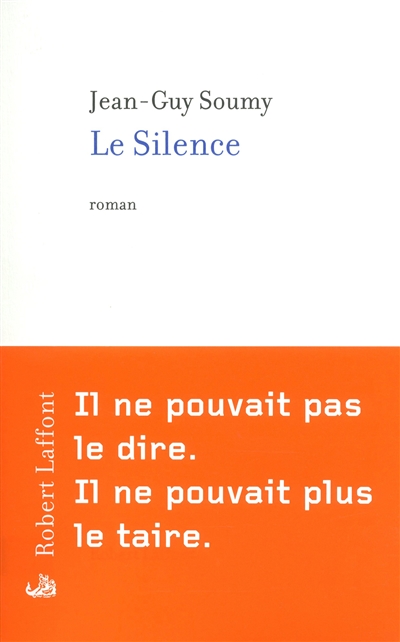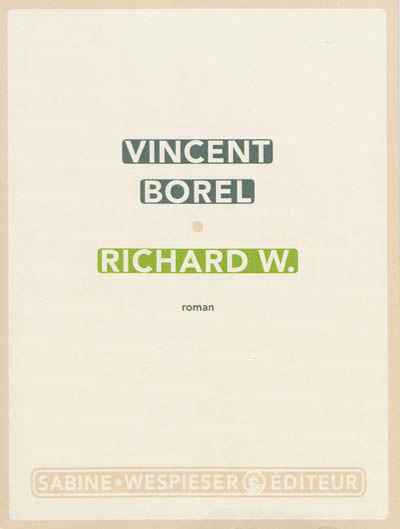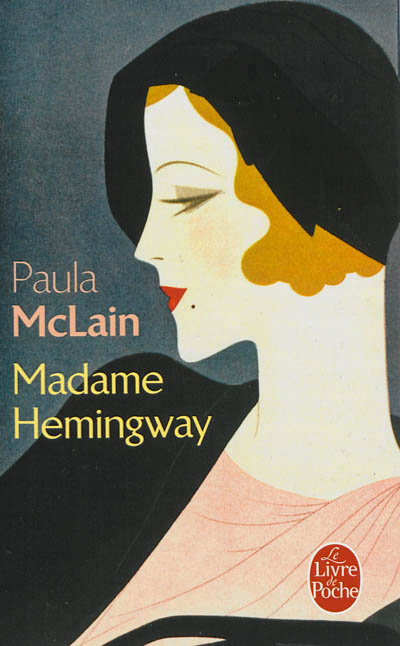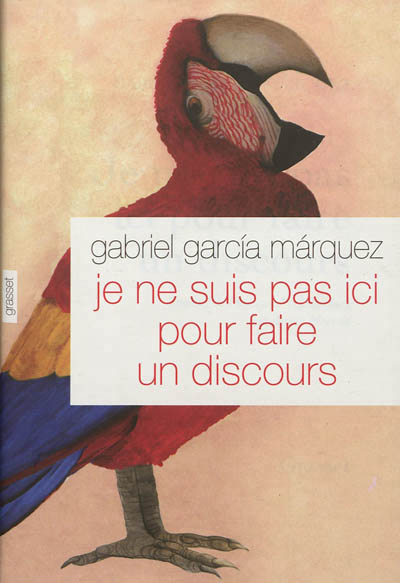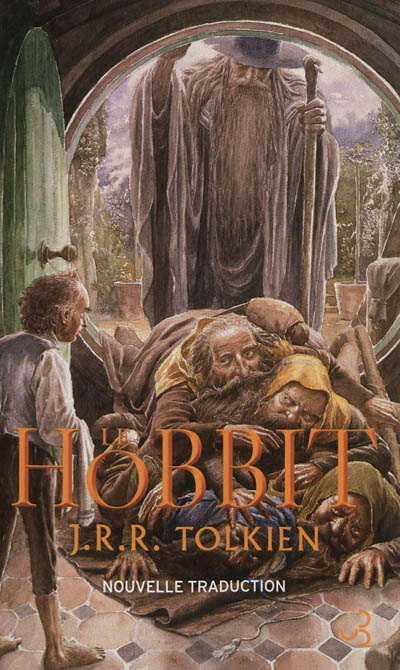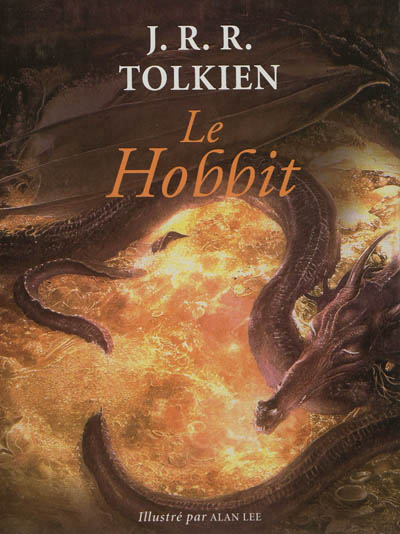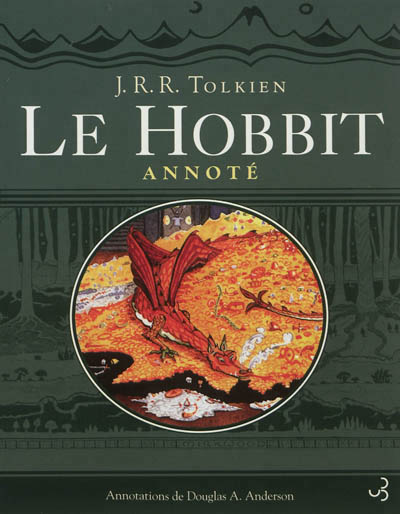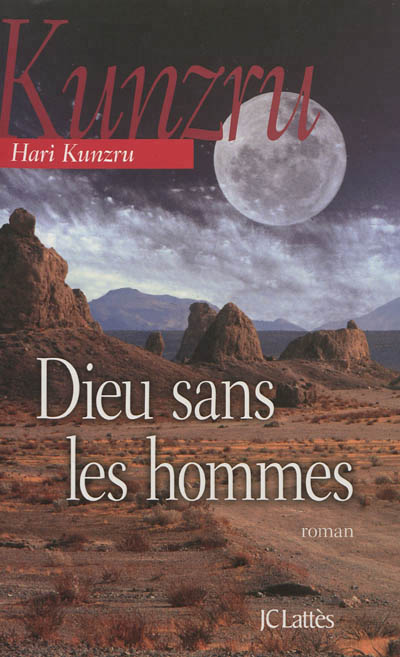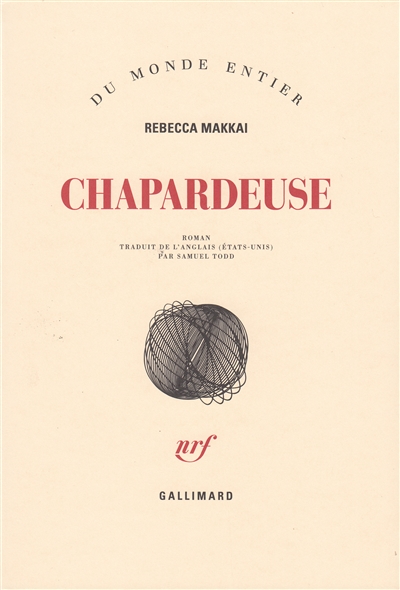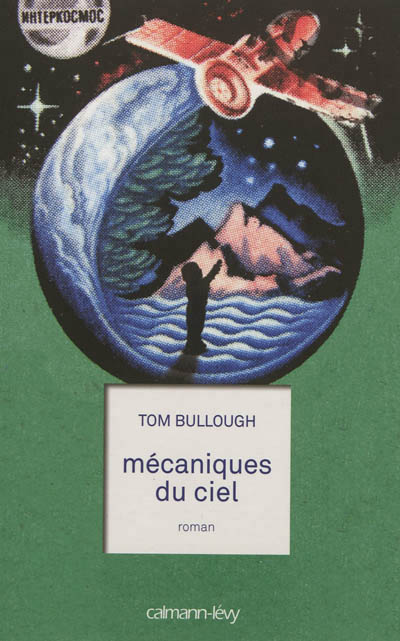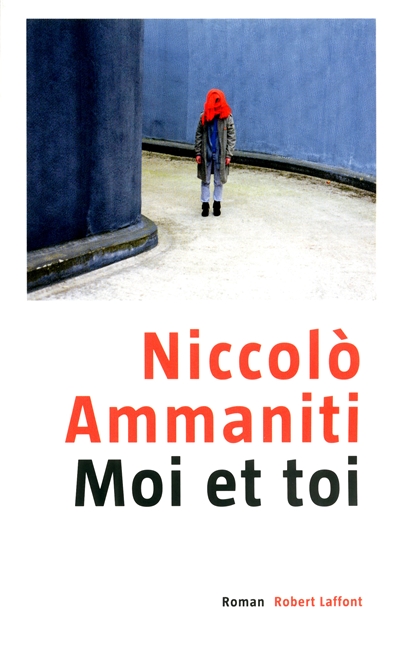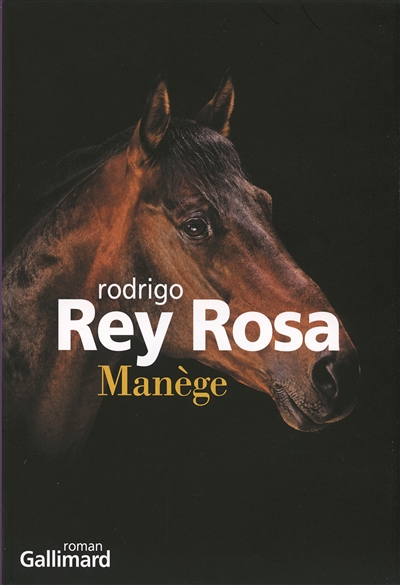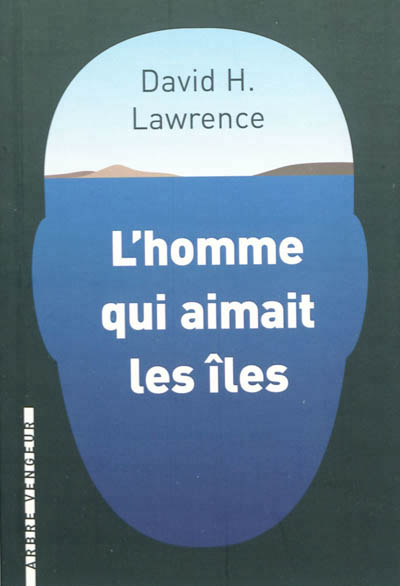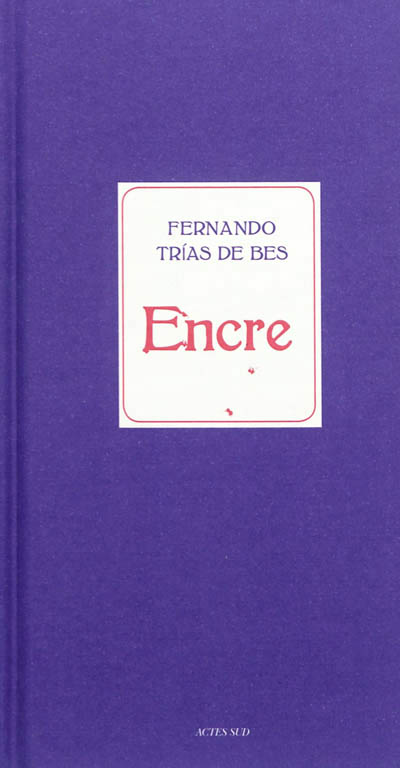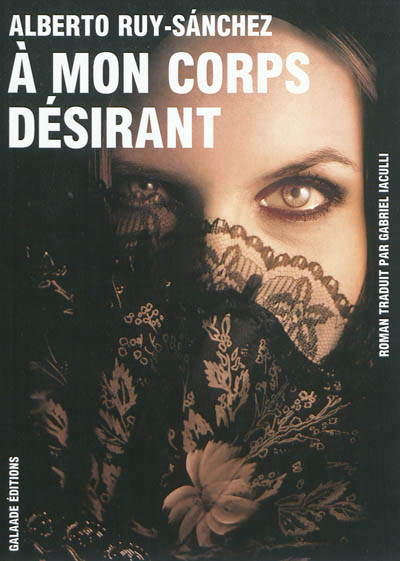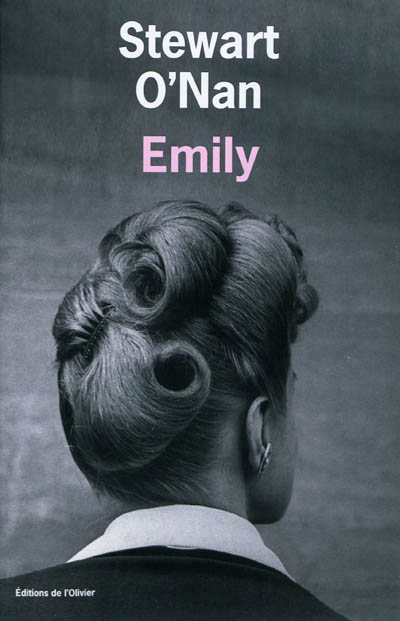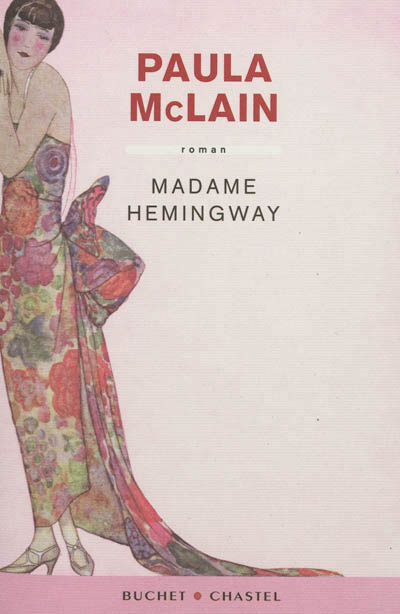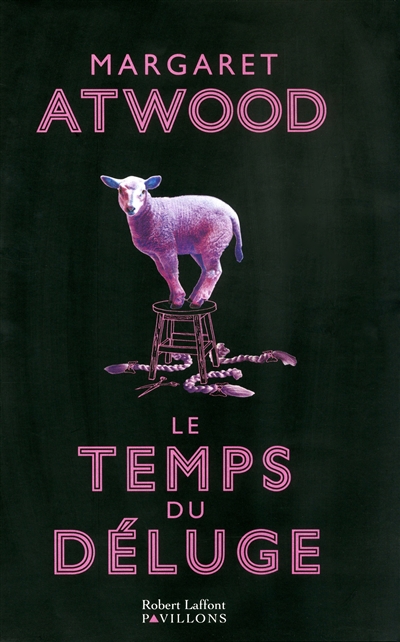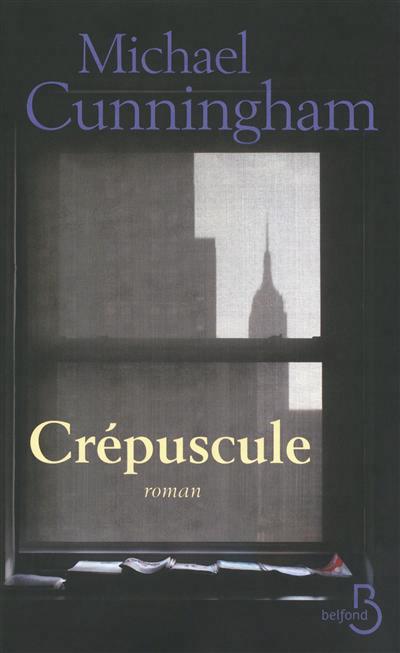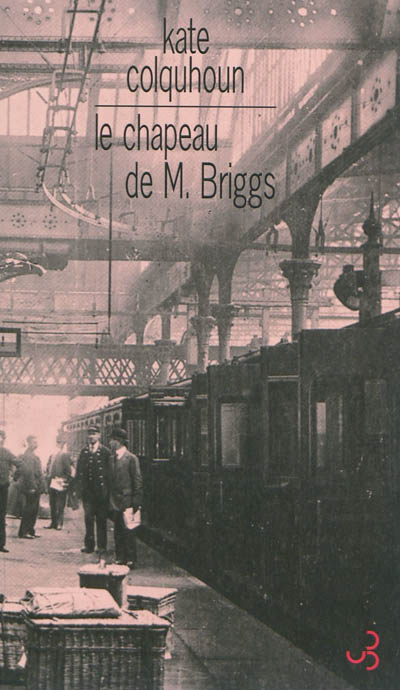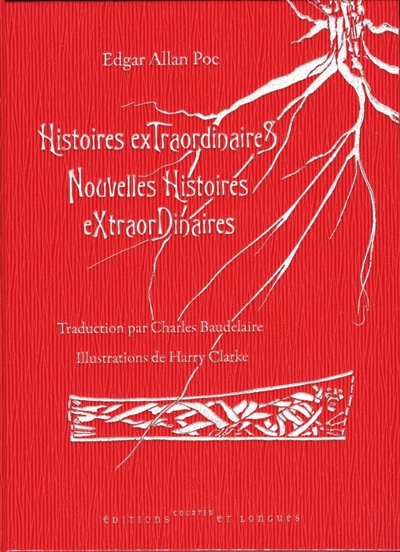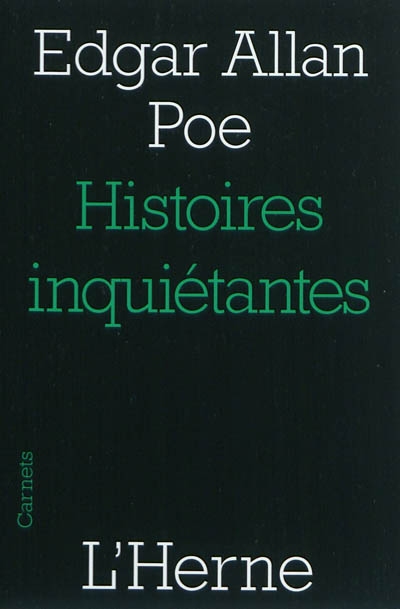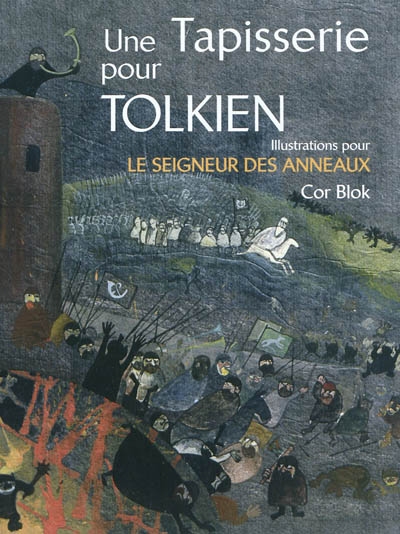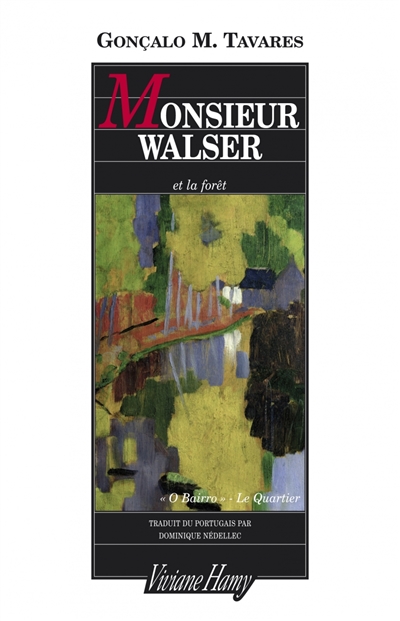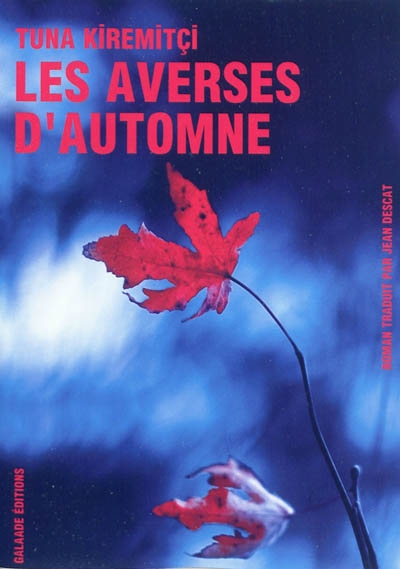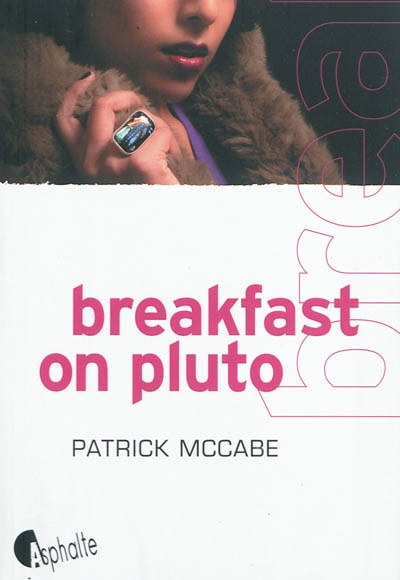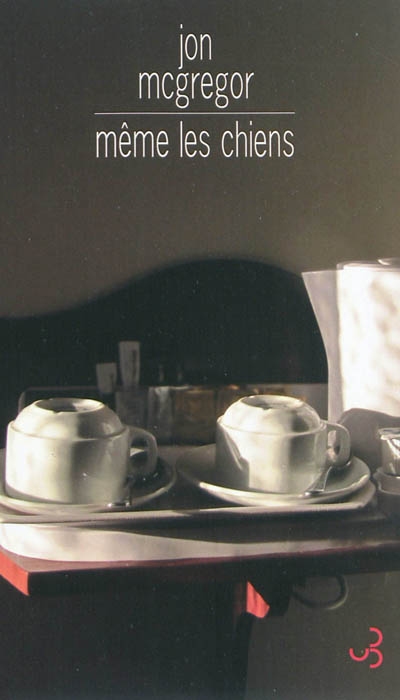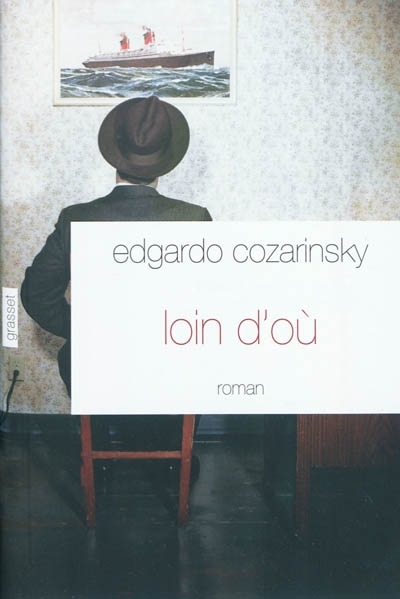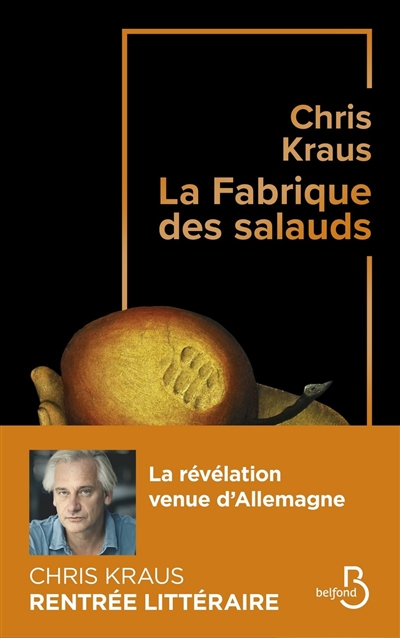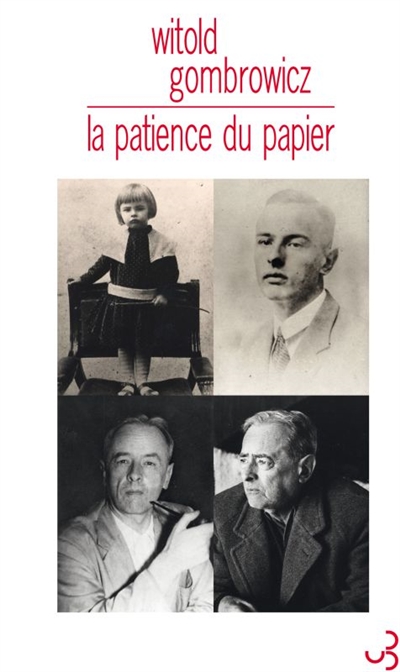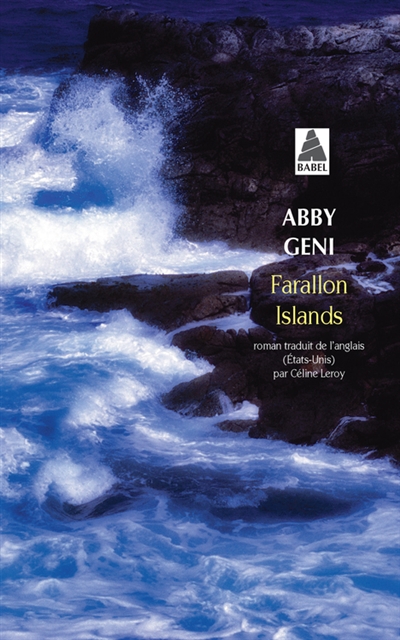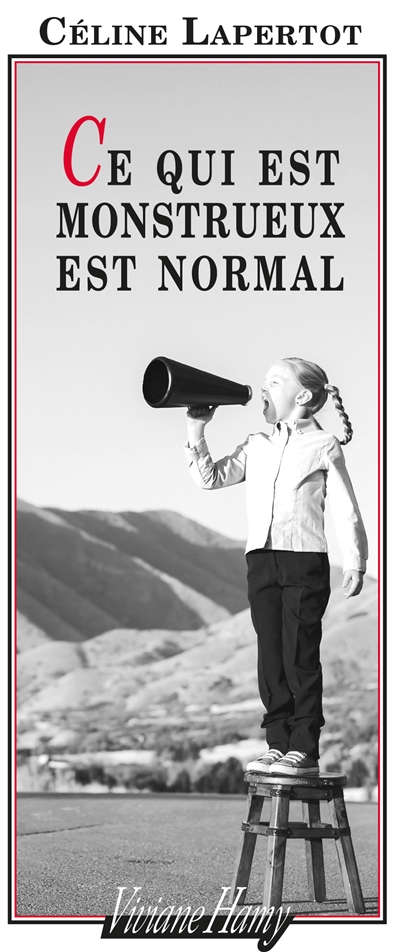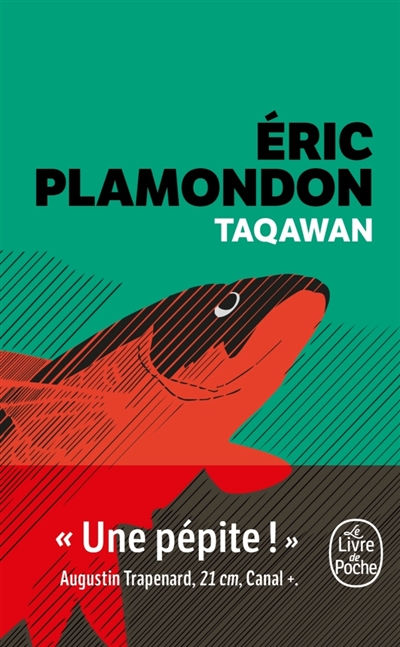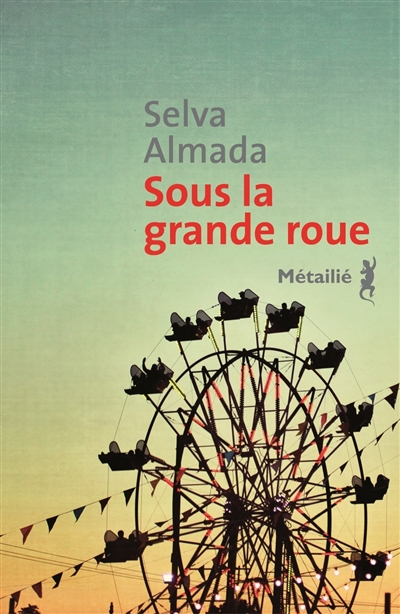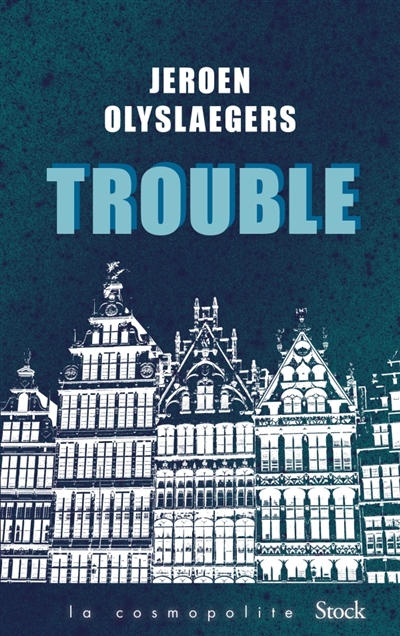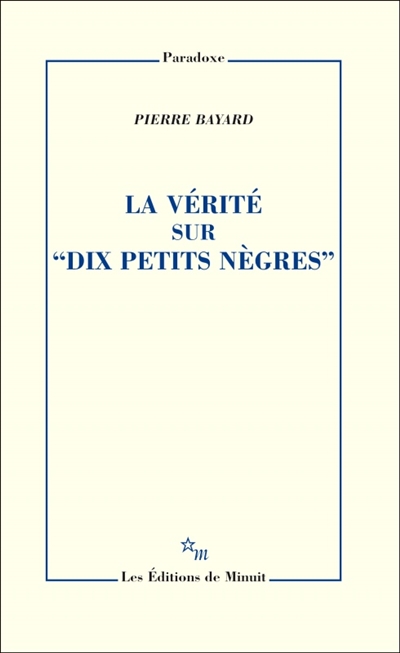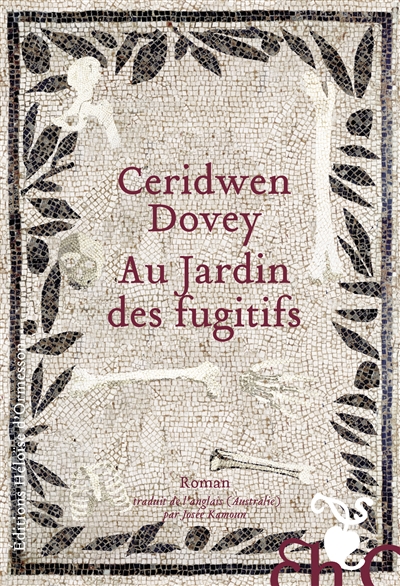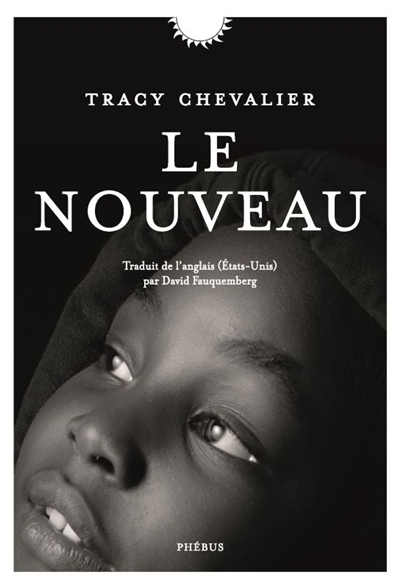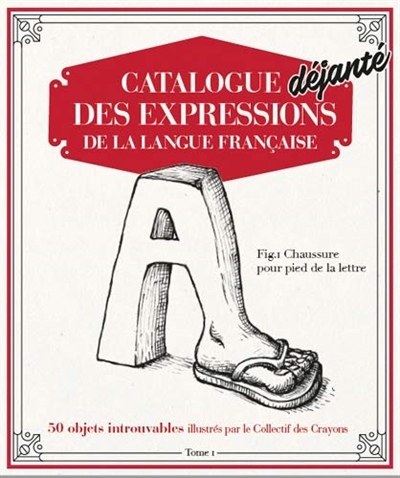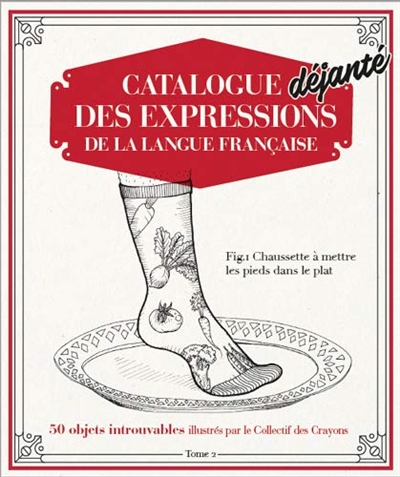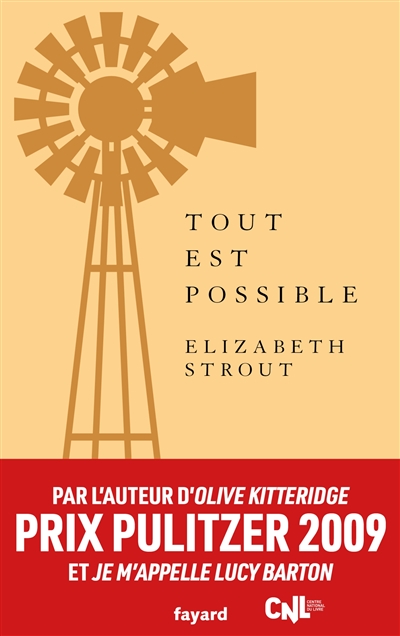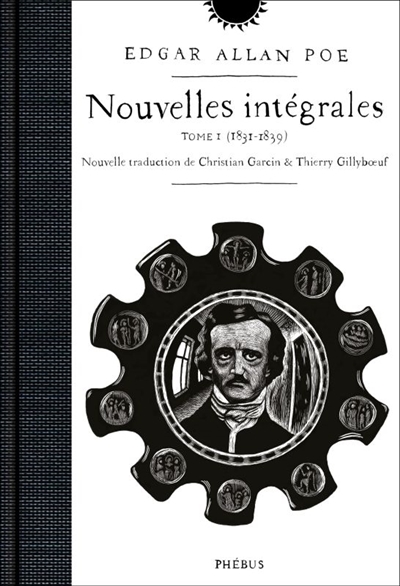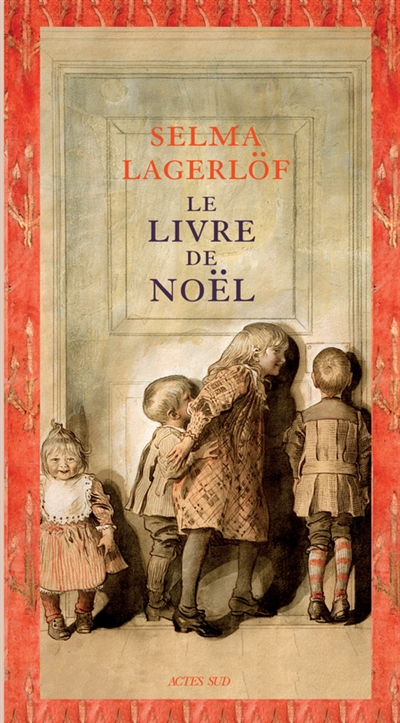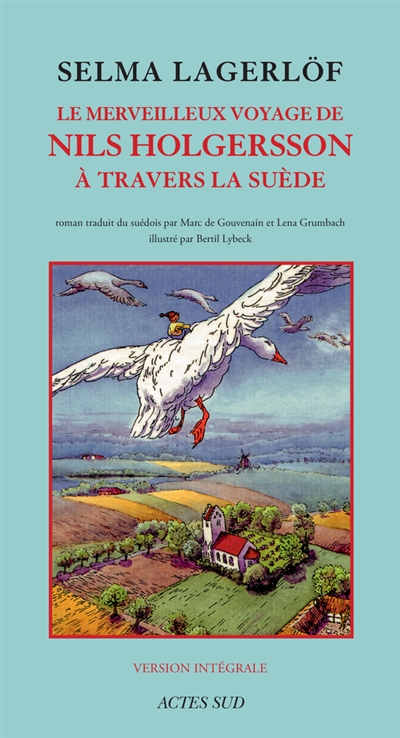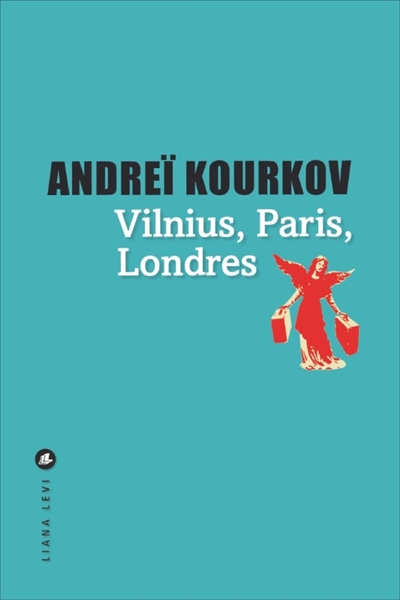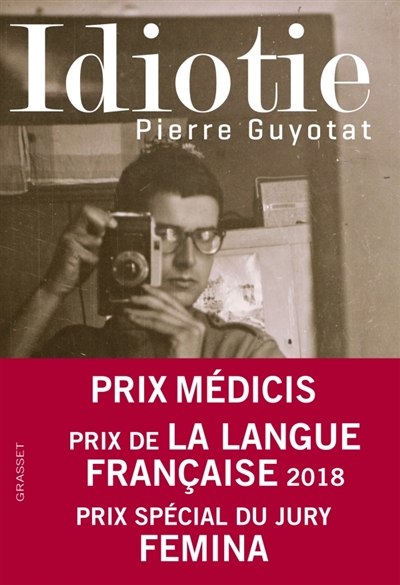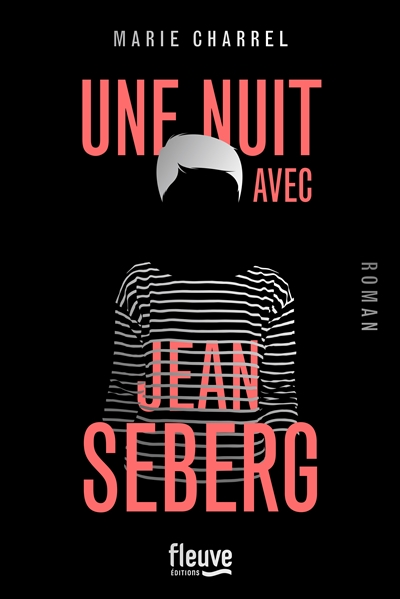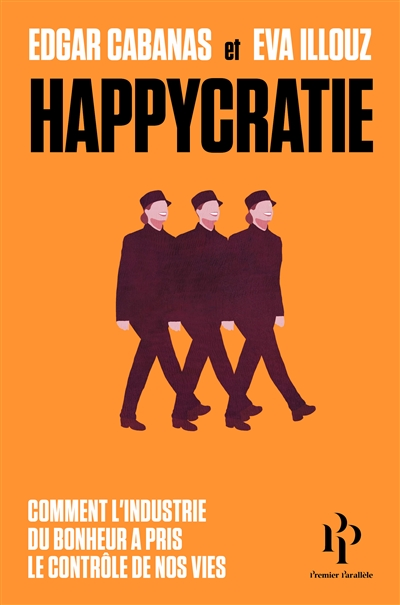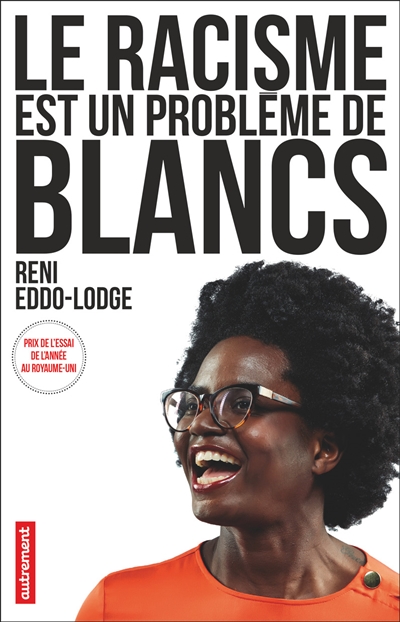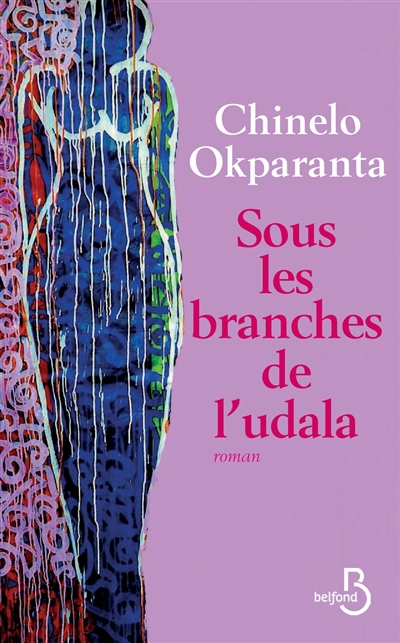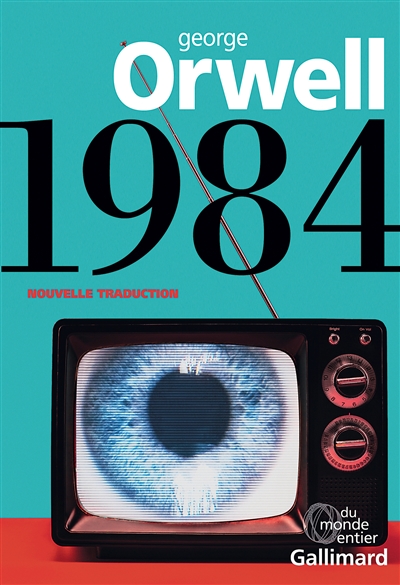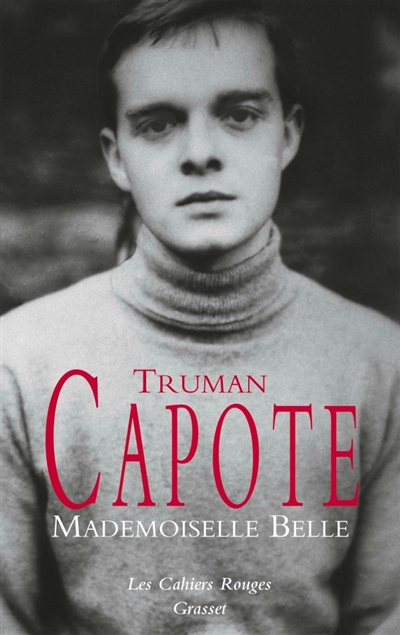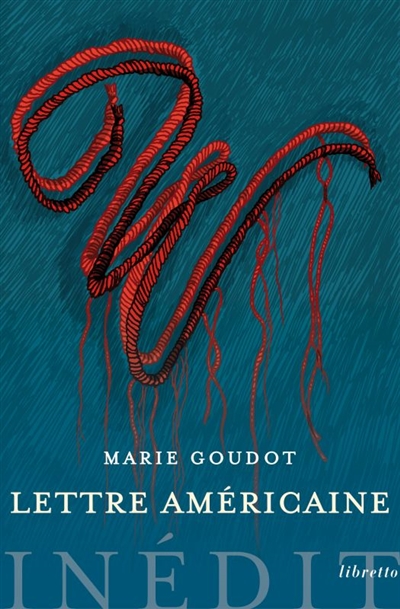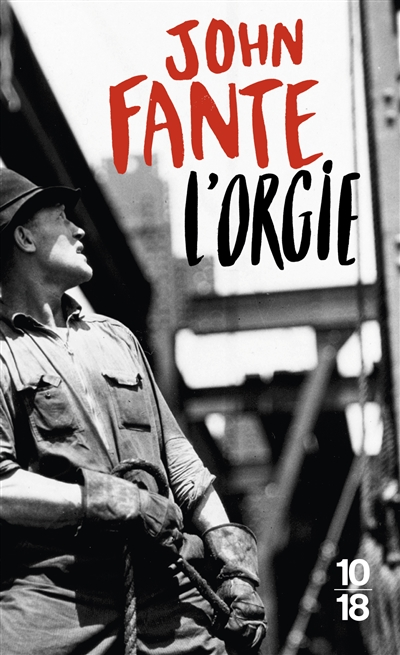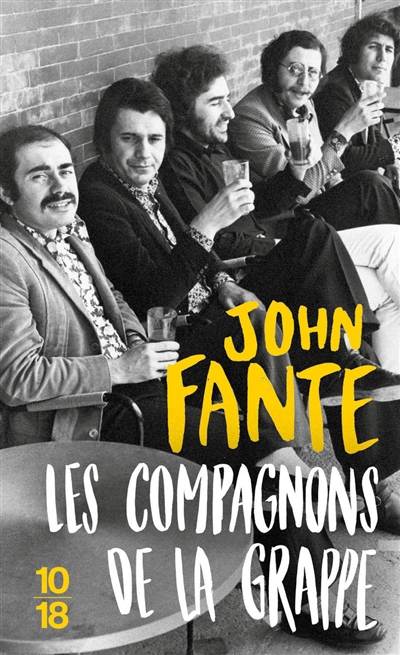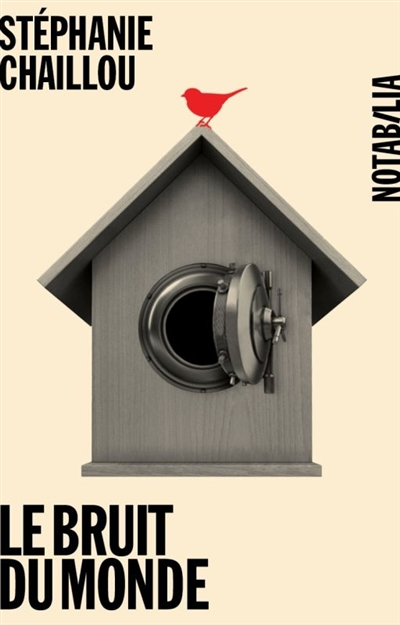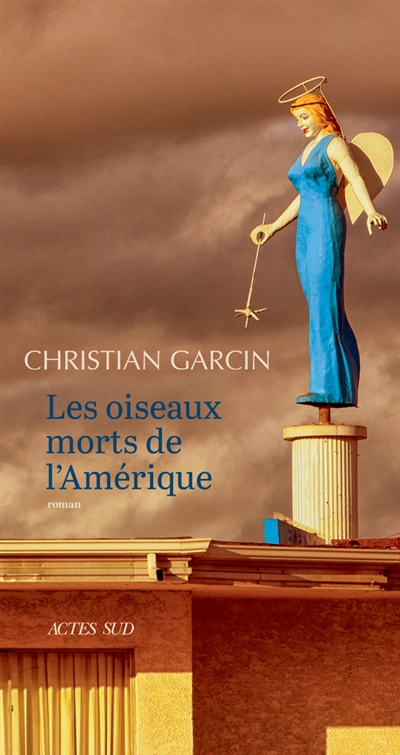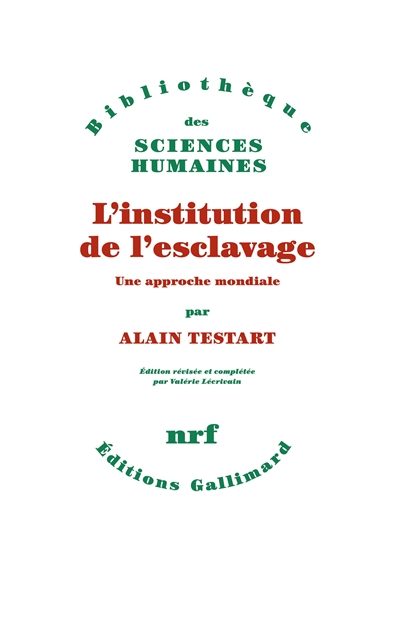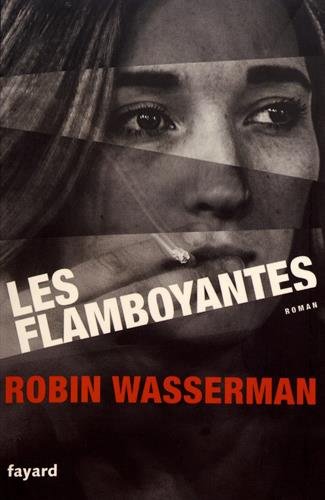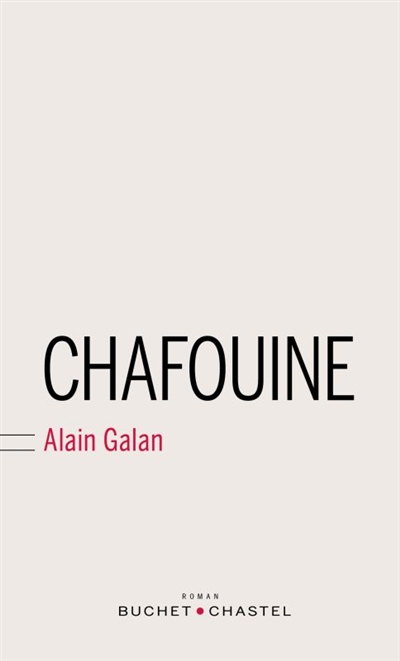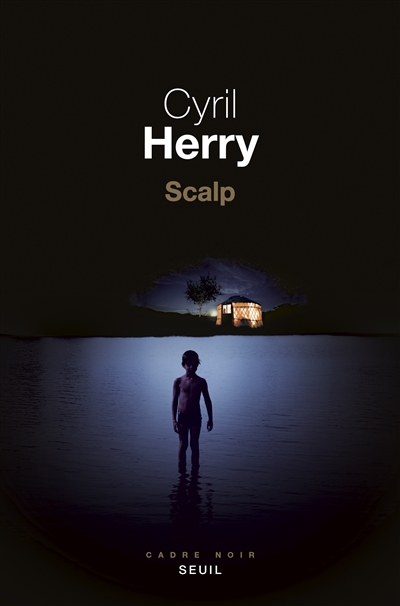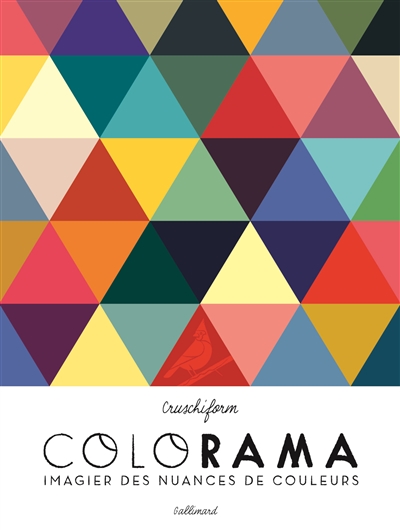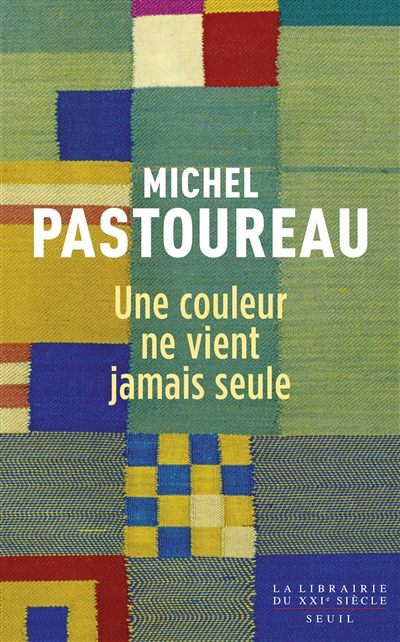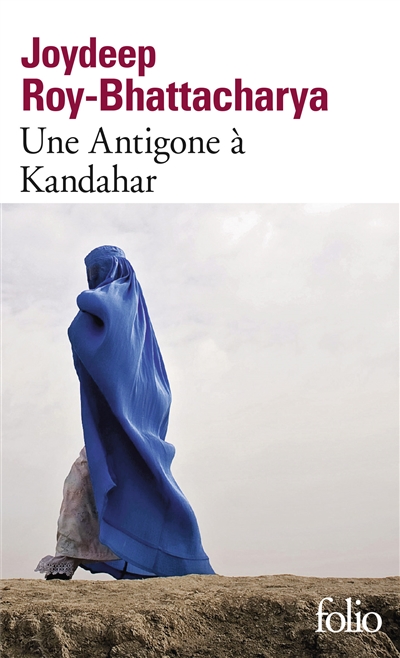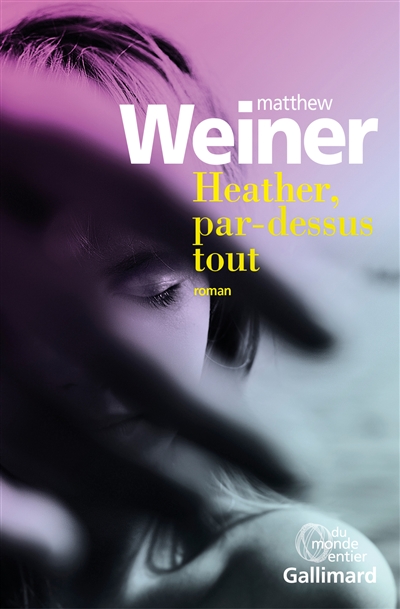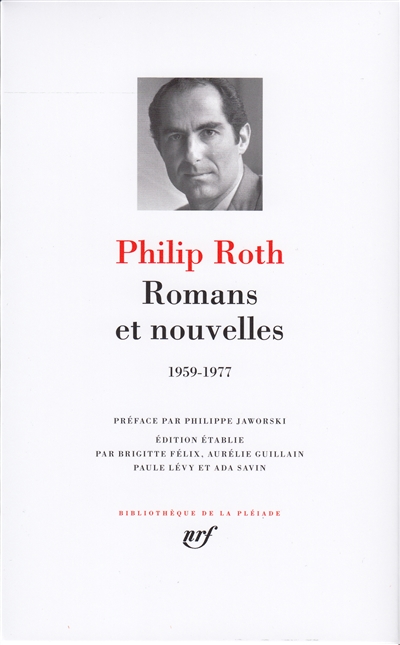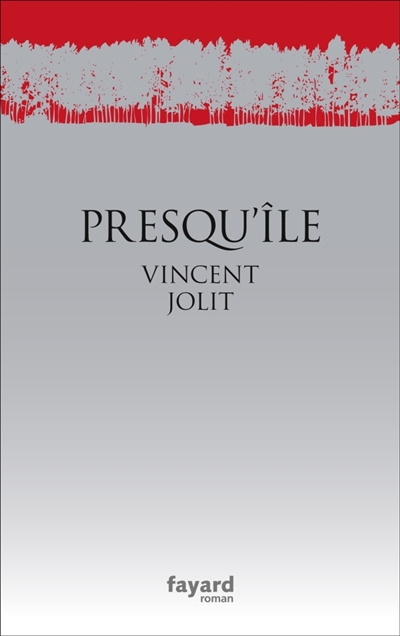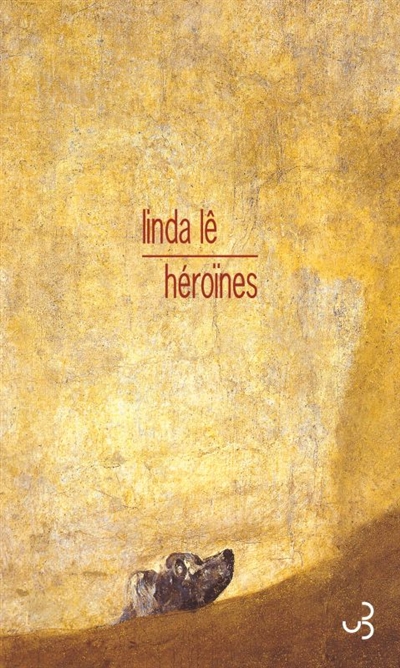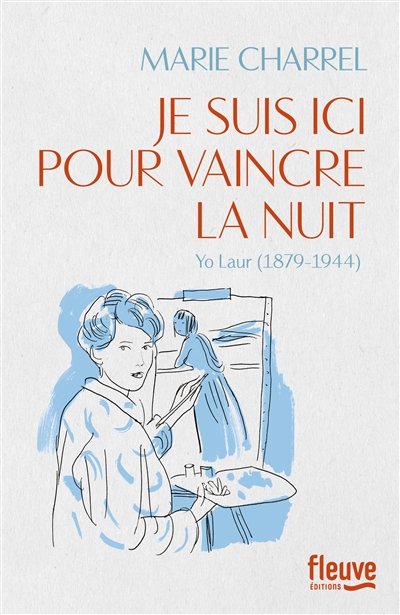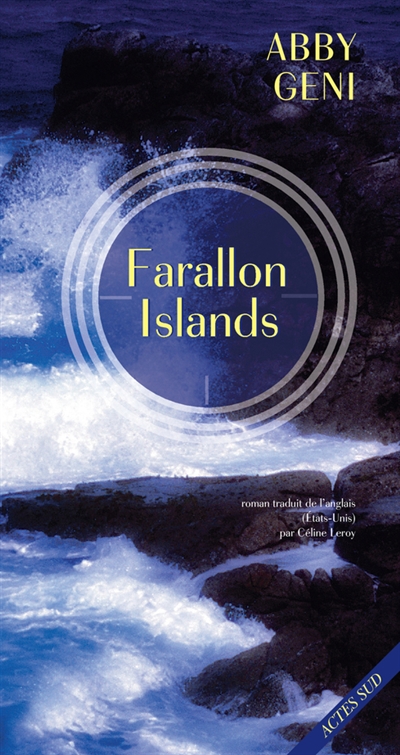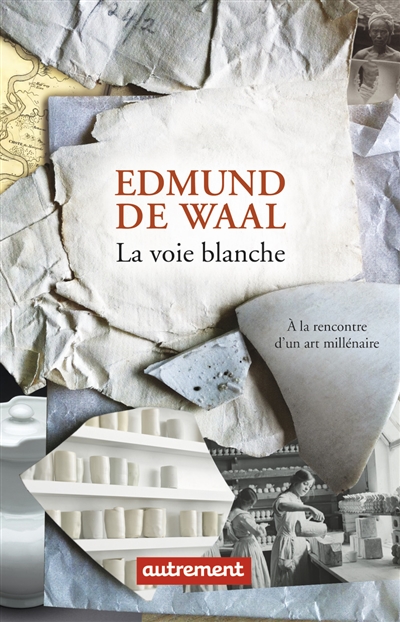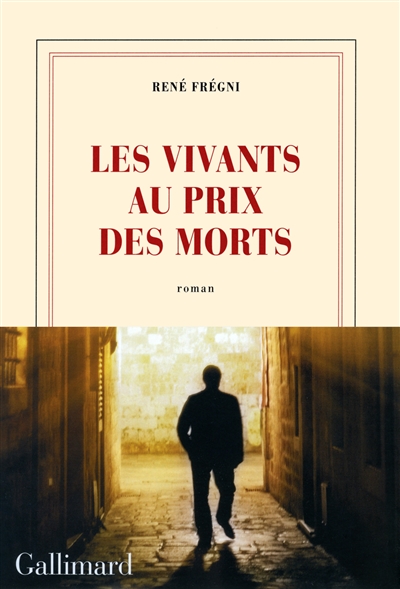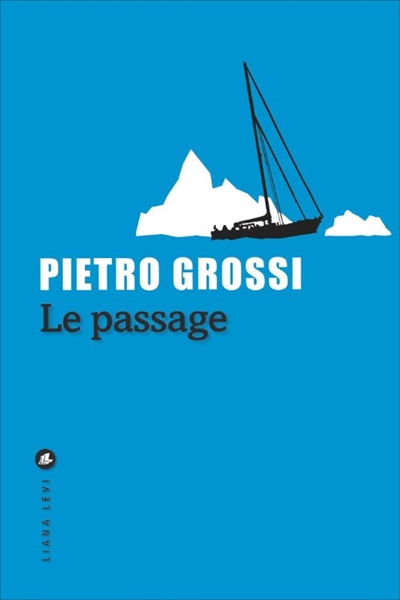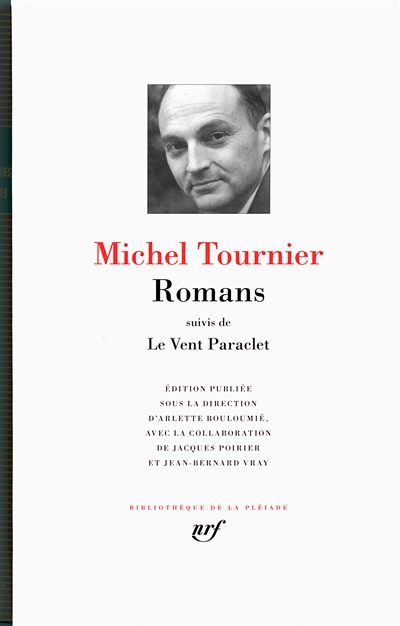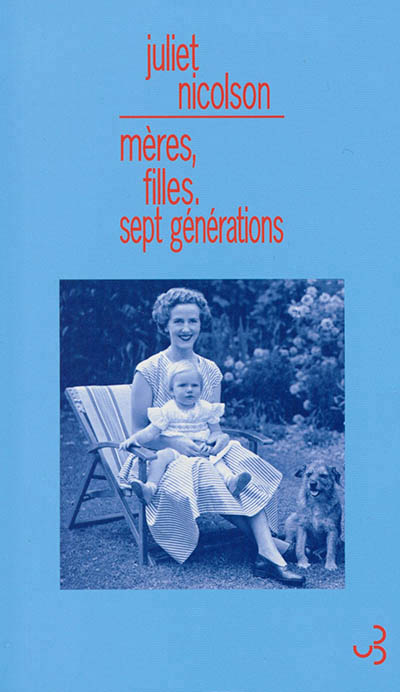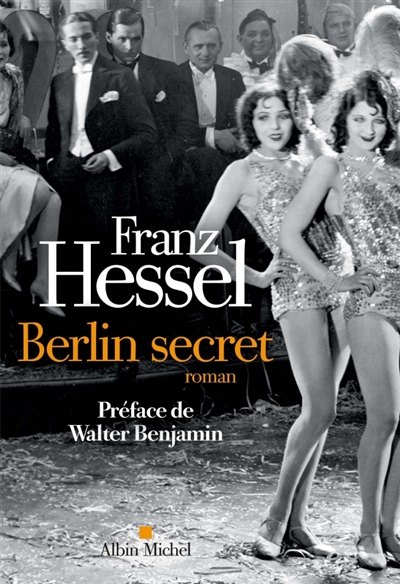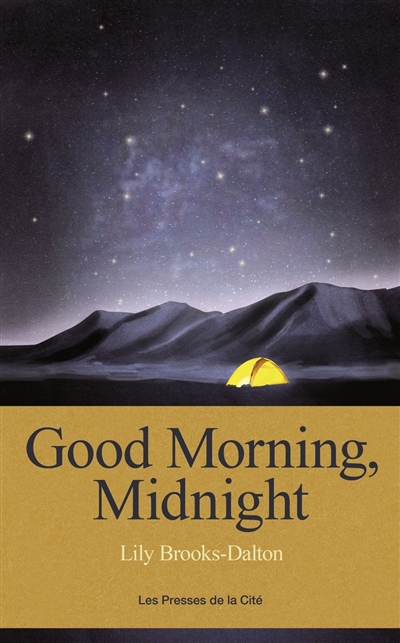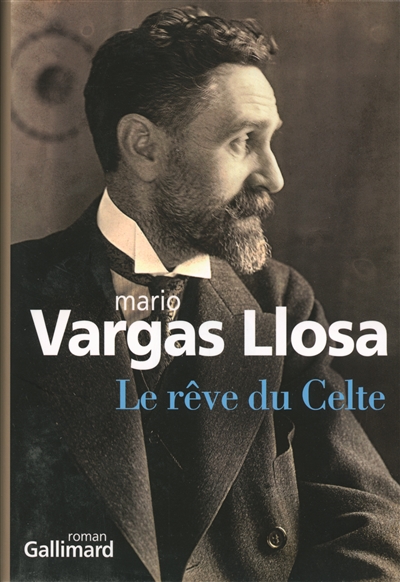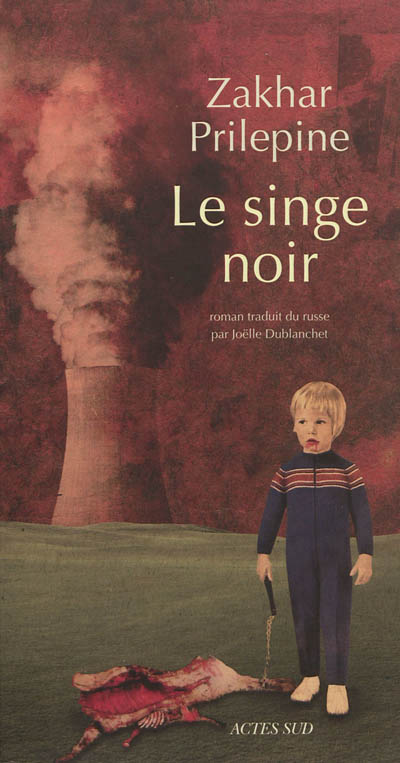Sciences humaines
Hélène Merlin-Kajman
Lire dans la gueule du loup
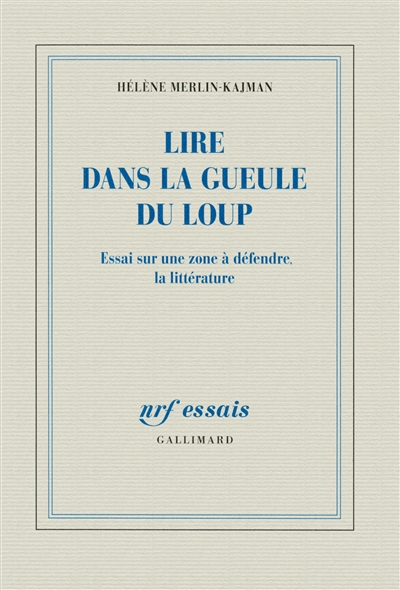
-
Hélène Merlin-Kajman
Lire dans la gueule du loup
Gallimard
14/01/2016
336 pages, 23,50 €
-
Chronique de
Aurélie Janssens
Librairie Page et Plume (Limoges) -
❤ Lu et conseillé par
5 libraire(s)
- Geneviève Binet de Lire en Majuscule (Sarlat-la-Canéda)
- Nathalie Claudel de La Compagnie des livres (Vernon)
- Delphine Bouillo de M'Lire (Laval)
- Aurélie Janssens de Page et Plume (Limoges)
- Catherine Béchet de Spicilège (Lagny-sur-Marne)

✒ Aurélie Janssens
(Librairie Page et Plume, Limoges)
C’est un refrain, plus que nécessaire, qui revient régulièrement : l’inquiétude face au nombre décroissant de lecteurs. Au-delà du lecteur, c’est avant tout la lecture et son apprentissage qui inquiètent les intellectuels et le corps enseignant. Qu’est-ce qui se joue ? Pourquoi est-ce si important ? Du « trauma » à « l’amour », petite variation sur les émotions du lecteur.
Ils seraient environ 7 à 9 %, selon les statistiques, à ne pouvoir lire cet article, un courrier, un panneau, à ne pouvoir déchiffrer le monde qui les entoure. C’est le cas de Léo, personnage principal du roman de Cécile Ladjali, Illettré. Au moment où, comme tous les enfants de 6 ans, Léo apprend à lire, ses parents, endettés, fuient le Fisc et l’abandonnent à sa grand-mère analphabète. Ce traumatisme se mêle intrinsèquement à l’apprentissage, qui devient dès lors un exercice douloureux. Laissant « des continents entiers hors du sens, hors de lui », il tente de faire illusion jusqu’au moment de quitter l’école pour l’usine. Il ruse, s’adapte à un monde où les mots sont autant de « fauves » qu’il lui faut dompter. Cependant, l’illusion ne peut rien face à la notice d’une machine, qui, indéchiffrable, lui fait perdre deux doigts. Cet accident et sa rencontre avec sa voisine infirmière déclenchent chez Léo une envie de ne plus simplement « flotter parmi les signes ». Par l’apprentissage de la lecture, il espère avoir accès à ces « mondes contre-factuels, futurs et conditionnels », mais aussi au cœur de Sibylle. Lire les mots pour mieux dire ses sentiments. Le terme de « traumatisme » n’est pas anodin. Dans Lire dans la gueule du loup, essai sur une zone à défendre, Hélène Merlin-Kajman, enseignante à la Sorbonne et créatrice de l’Observatoire de l’Éducation, constate que l’apprentissage de la lecture n’est pas qu’une méthode purement formelle, dont la maîtrise dépendrait essentiellement d’éléments textuels. Elle souhaite redéfinir la littérature « dans la perspective de son partage, c’est-à-dire, de sa transmission, donc de son avenir. » Partant de situations concrètes, elle tente de saisir ce qui se joue lors de la lecture. Elle constate que les sentiments y ont une grande part. Dès lors, la transmission d’un savoir doit se repenser en prenant en compte les affects de l’apprenant. Le but étant, in fine, que cela se fasse avec le moins de heurts possible afin que les individus ayant acquis la « lecture littéraire » puisse « se frayer un chemin, […] s’établir dans le langage, dans la société. » Dans L’Avenir des Anciens : oser lire les Grecs et les Latins, Pierre Judet de La Combe, helléniste et directeur d’études à l’EHESS, revient lui aussi sur l’importance de la lecture. « La connaissance approfondie, historique et inventive de sa propre langue est centrale, car elle est la possibilité de comprendre et de faire siens, à son niveau, l’ensemble des langages qui dominent la société, qui contribuent à ce qu’il y ait une société et à ce que d’une société à l’autre s’établissent des échanges. » Son essai a été écrit en réaction à la réforme du Collège qui part du principe que l’apprentissage des langues anciennes est devenu trop élitiste et souhaite que chacun y soit désormais initié. L’accès à ces langues ne se fait désormais plus tel qu’on le connaît, mais à travers une sorte de parcours de découverte, mêlant plusieurs matières, s’appuyant sur des faits de civilisations plus que sur la langue elle-même. Comment demander alors à un élève de comprendre ce qu’est la démocratie, par exemple, sans lui dire d’où vient ce mot, comment il a été formé, à quelle langue il appartient ? L’auteur explique qu’il y aura toujours des formes d’élitisme, qui se déplaceront désormais sur d’autres apprentissages, et qu’il y avait peut-être d’autres manières d’attirer les élèves vers ces langues, plutôt que d’imposer à tous une initiation maladroite. Plus encore que la lecture des textes anciens, c’est la lecture qui, selon lui, est importante. Apprendre à lire une langue, c’est apprendre à former un raisonnement qui permet de se situer par rapport à l’Autre, par rapport au monde. Deux auteurs publiés chez Actes Sud livrent à travers deux recueils d’essais leur cheminement d’intellectuel et de citoyen, le trajet de la lecture à la pensée qu’ils ont effectué dans le cadre professionnel et privé. Marilynne Robinson revient dans Quand j’étais enfant, je lisais des livres, sur les textes qui ont formé sa pensée et son regard sur son pays, les États-Unis, mais aussi sur le reste du monde : les Saintes Écritures et les fresques historiques. « Les livres m’ont appris l’essentiel de ce que je sais, et ils ont exercé mon attention et mon imagination ». Par le détail, elle explique comment ces livres lui permettent aujourd’hui d’écrire, de penser, de communiquer. Paul Auster reste quant à lui plus littéraire dans ses références. La Pipe d’Oppen regroupe des textes hommages à Oppen, Hawthorne, Melville, Poe, Perec, Beckett, ou encore Robbe-Grillet. Il y explique les rapports qu’il a entretenus avec chacun, soit directement, soit à travers leurs livres. Ces textes et ces auteurs sont autant de socles sur lesquels se fondent ses romans et sa pensée. On ne répétera donc jamais assez l’importance de l’apprentissage de la lecture. Plus qu’une évidence, une simple formalité. Il faut prendre conscience de ce qui se joue lorsqu’on transmet ce savoir, pour comprendre ce qu’on peut en faire. Être mobilisé pour qu’il y ait moins d’illettrés et plus de grands écrivains.