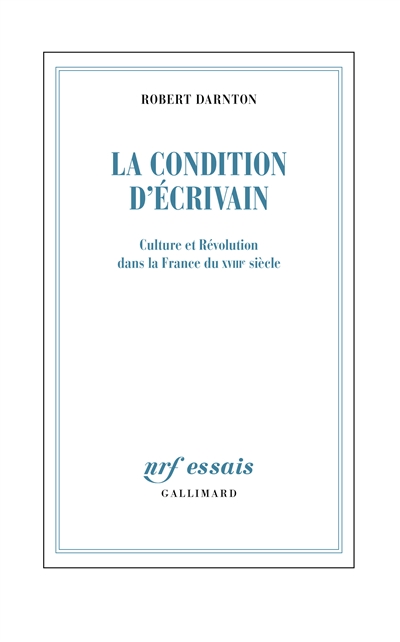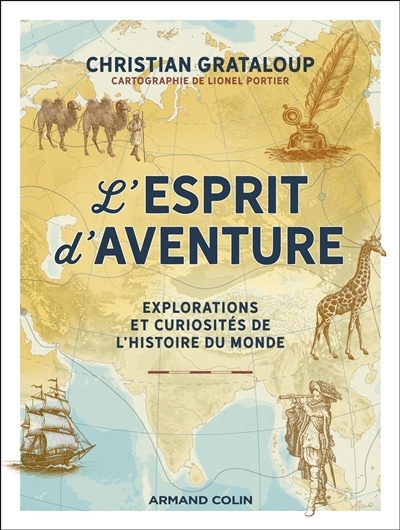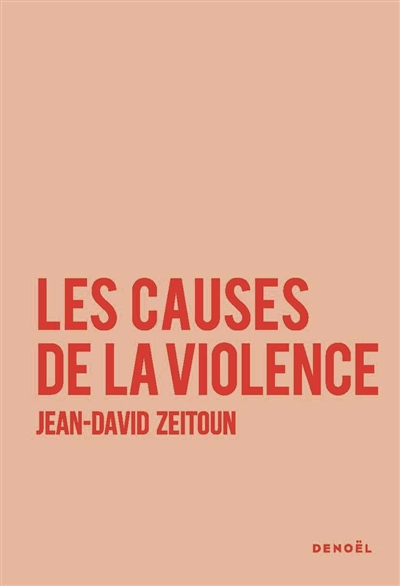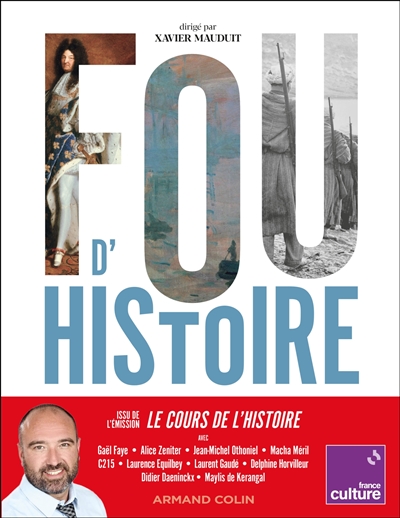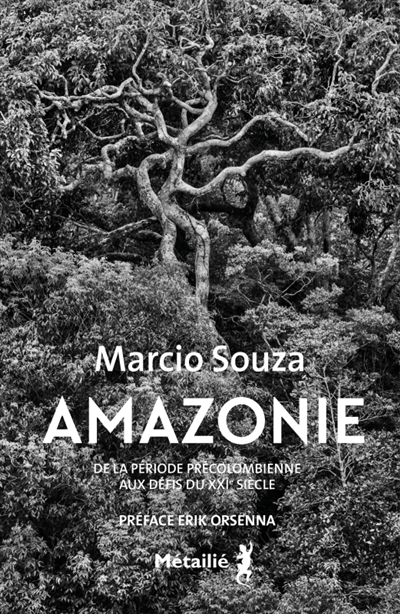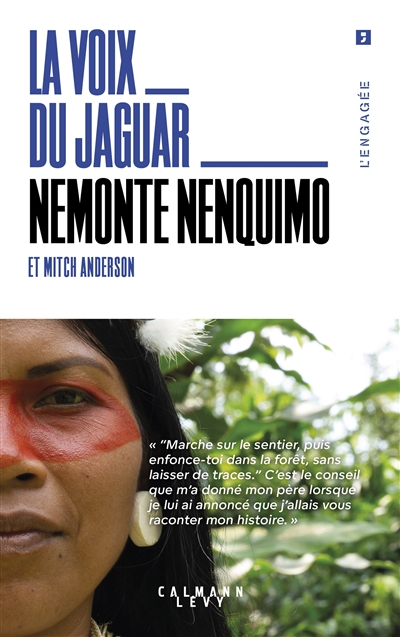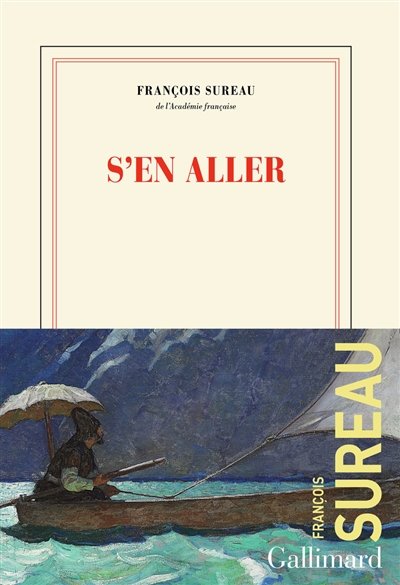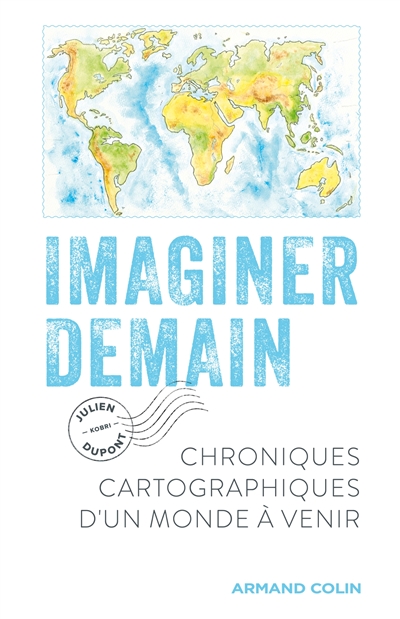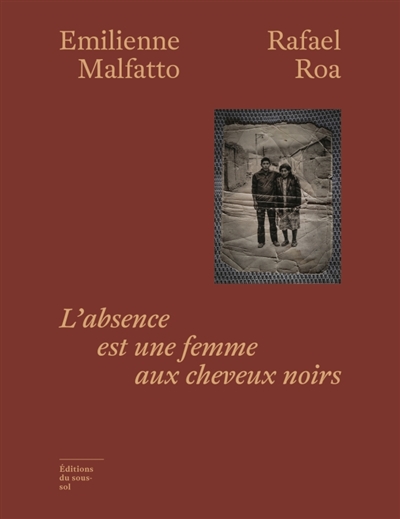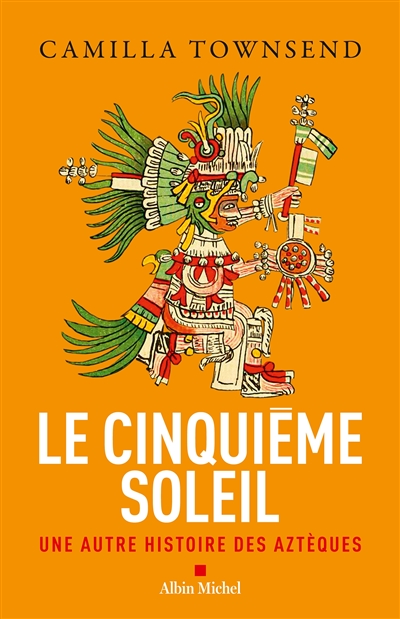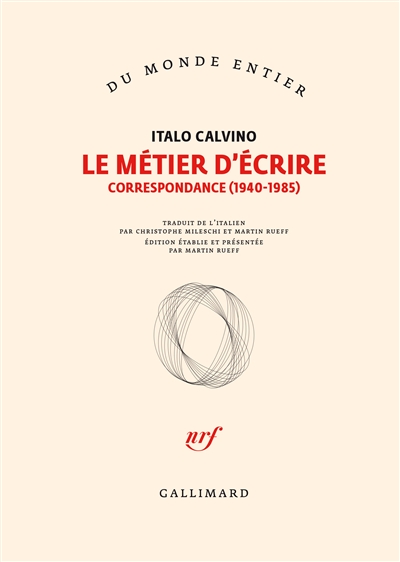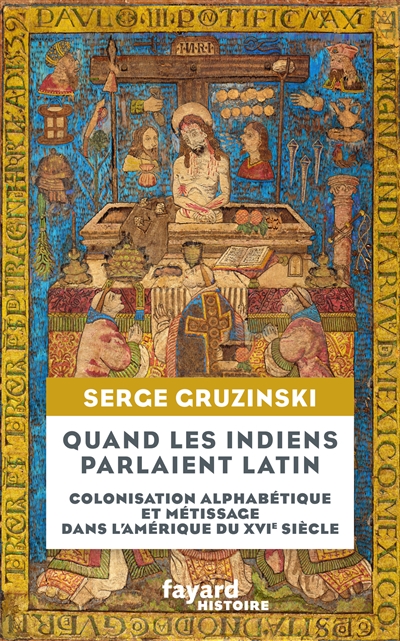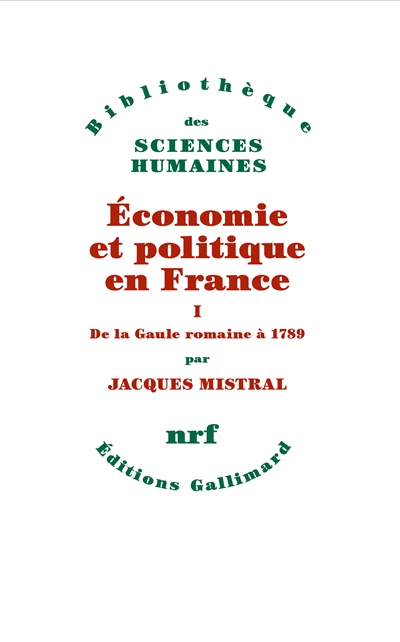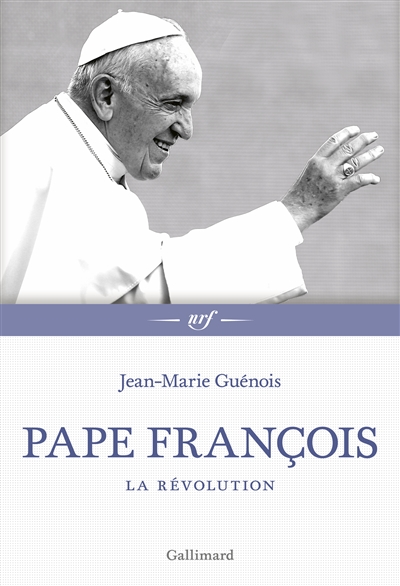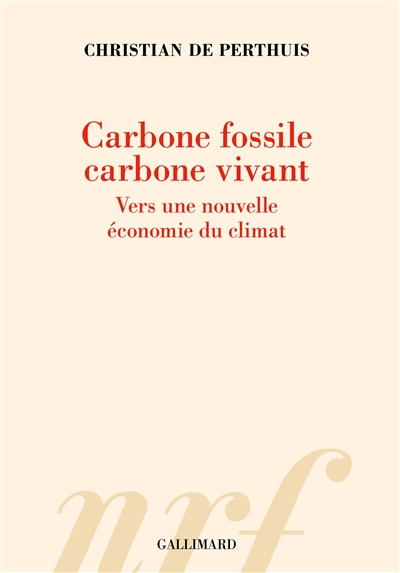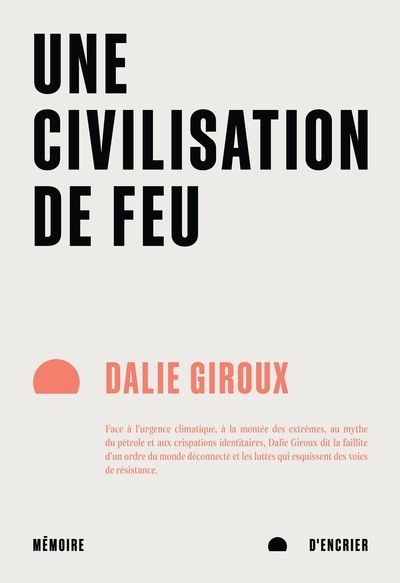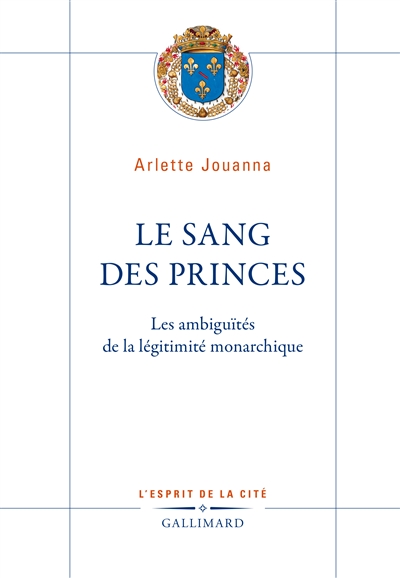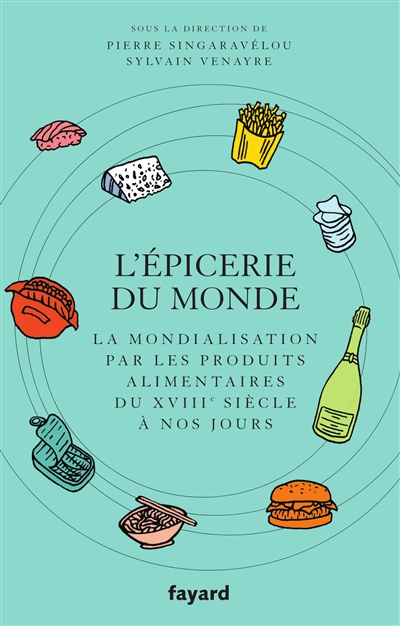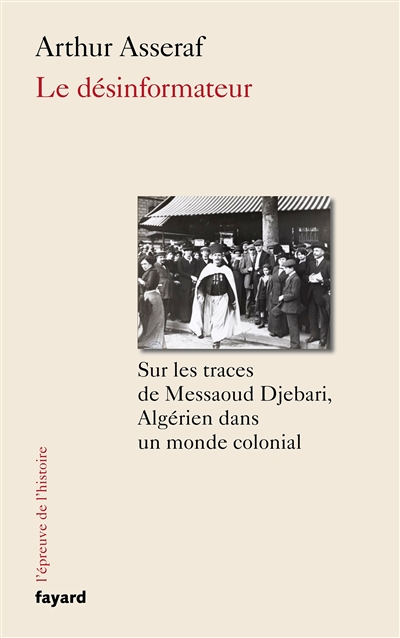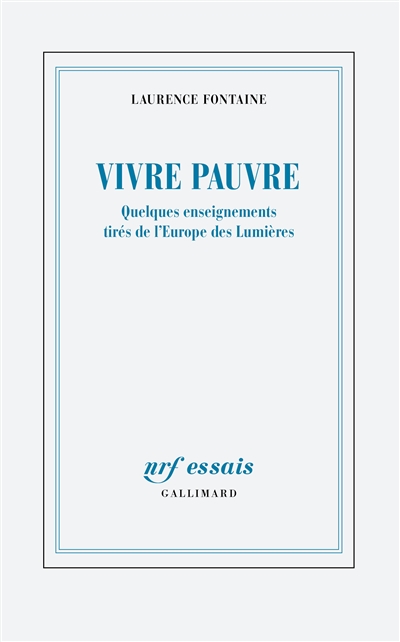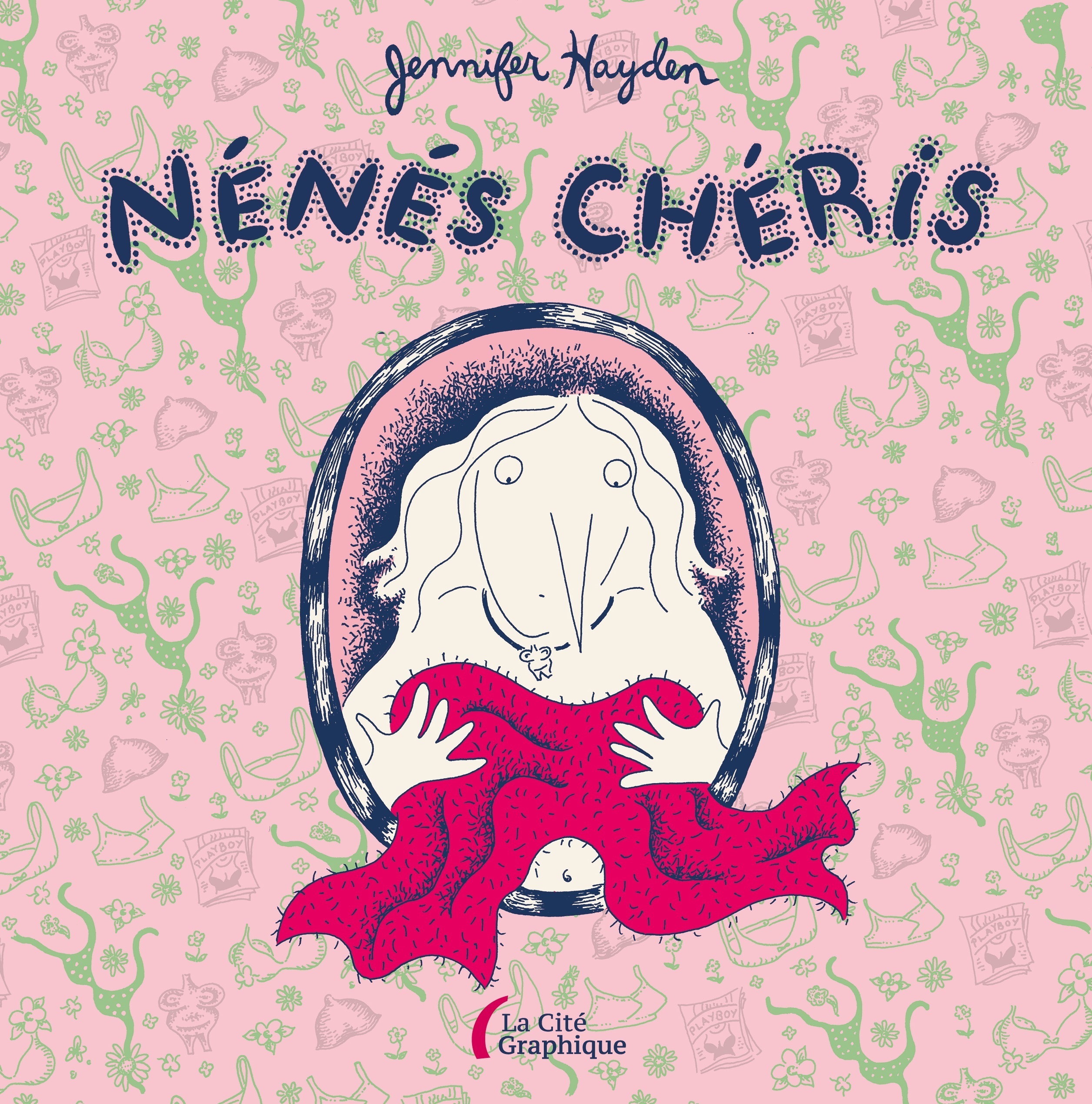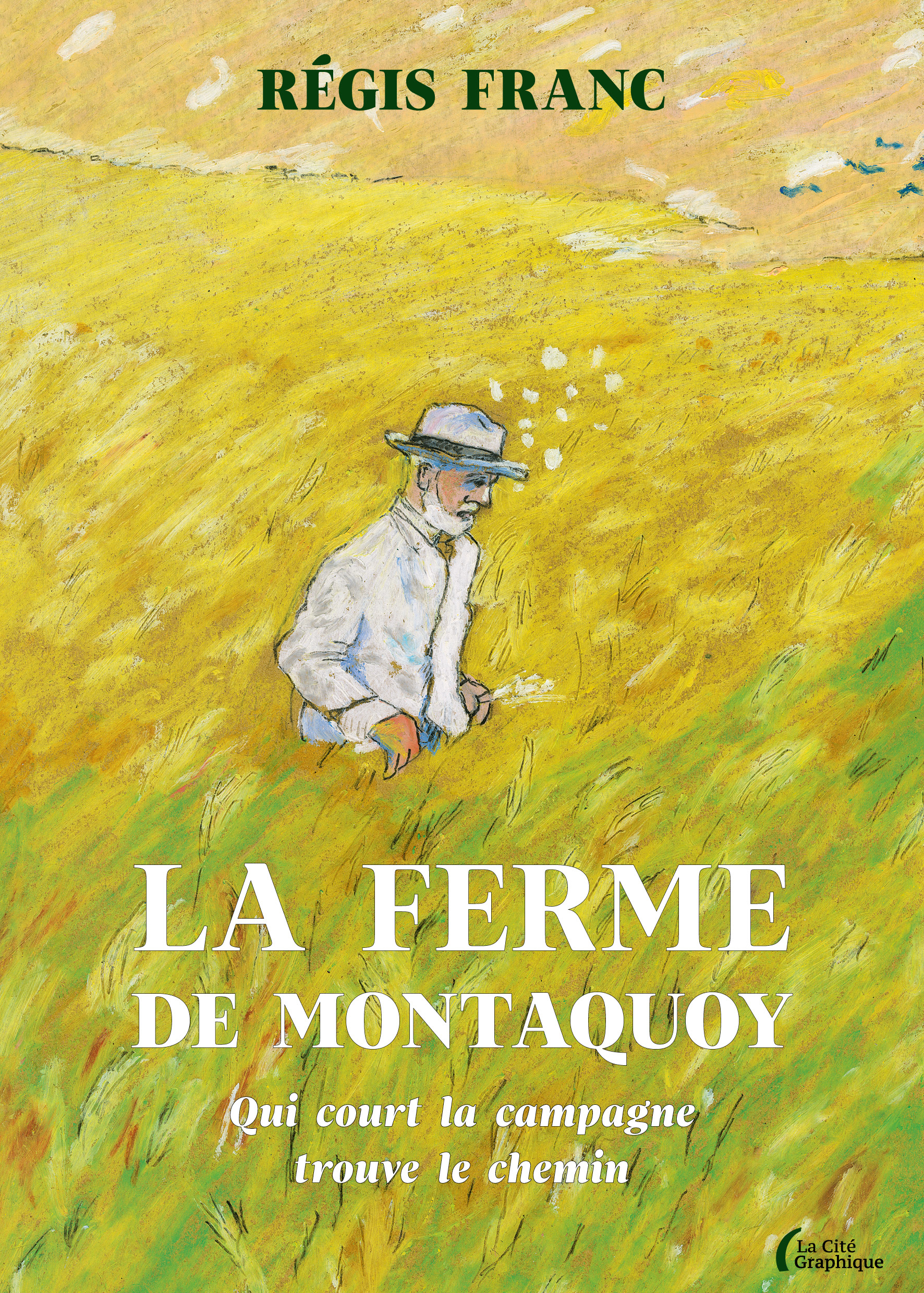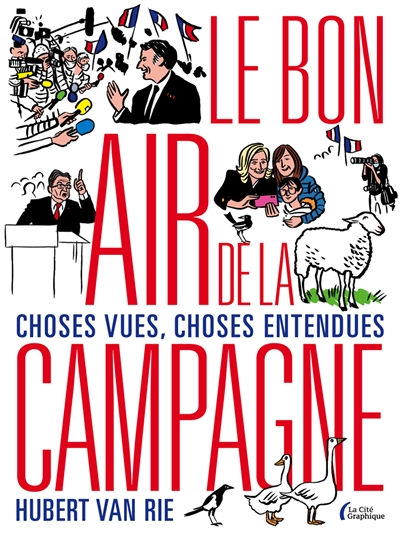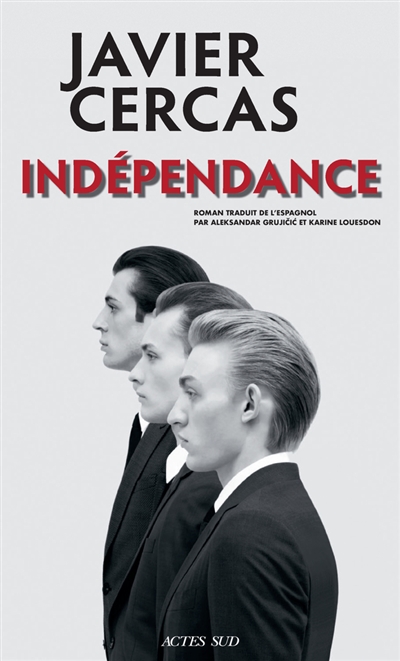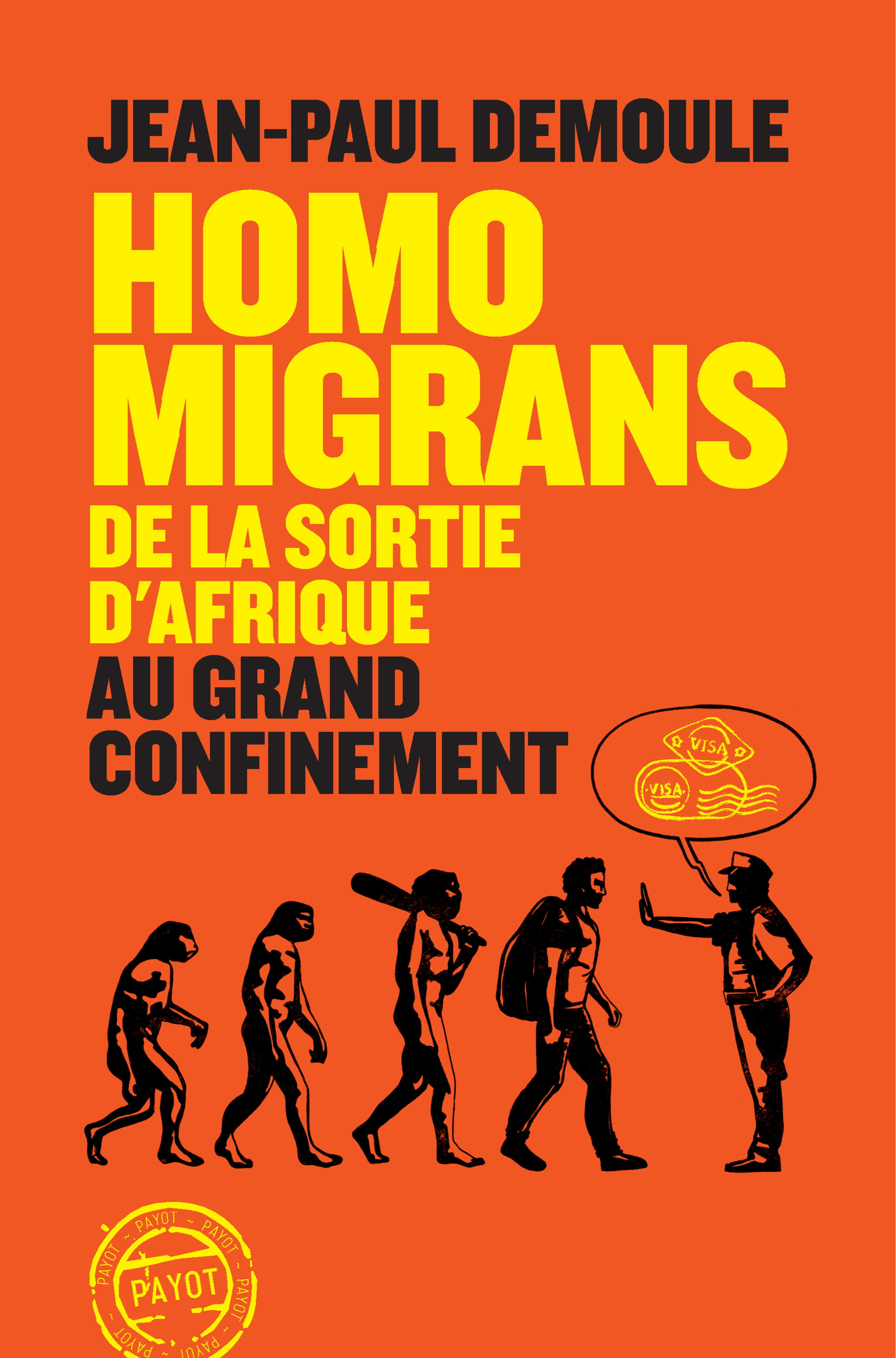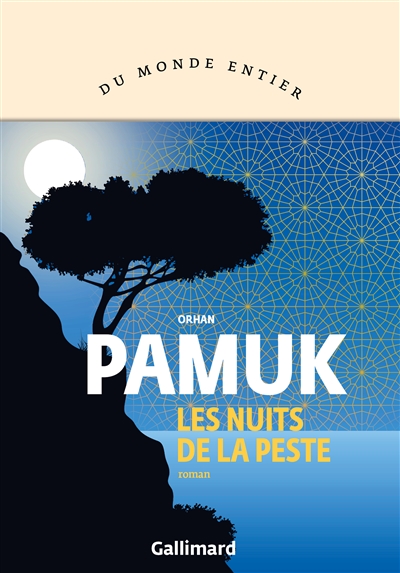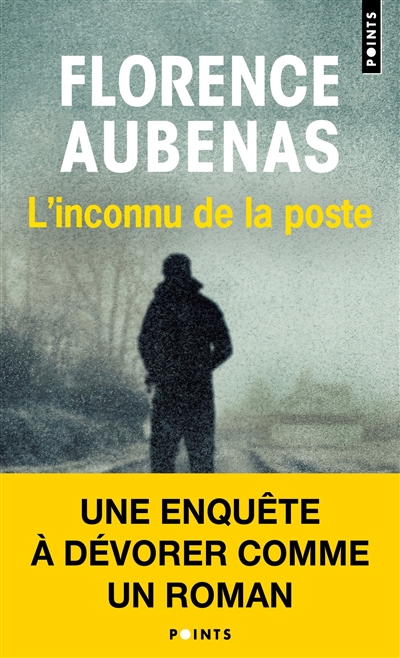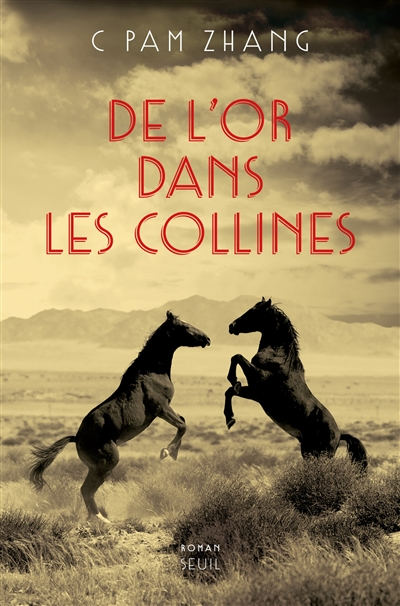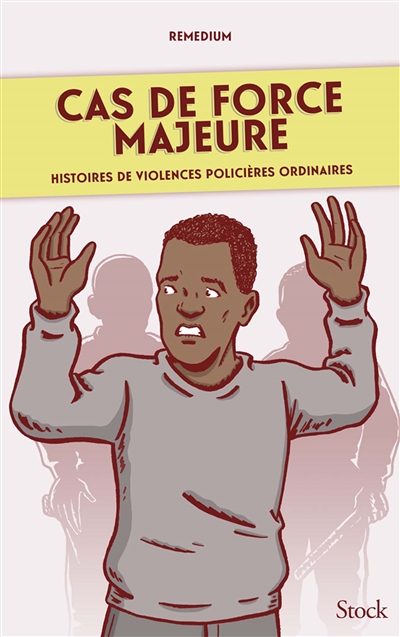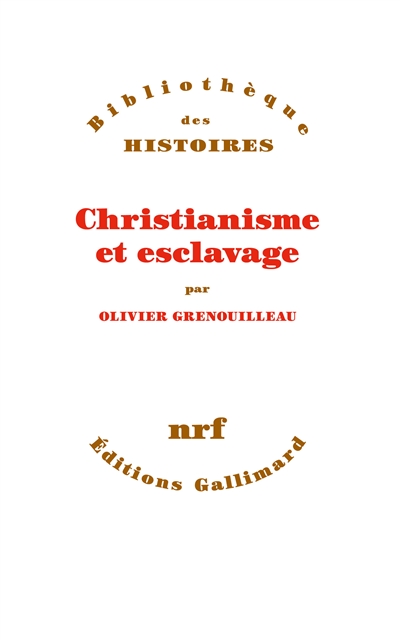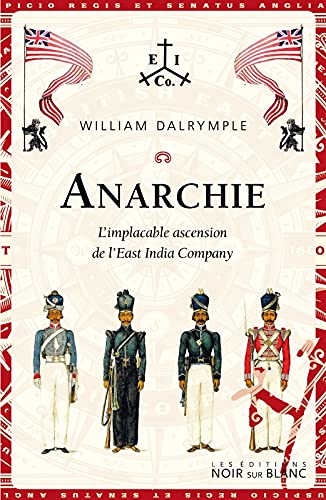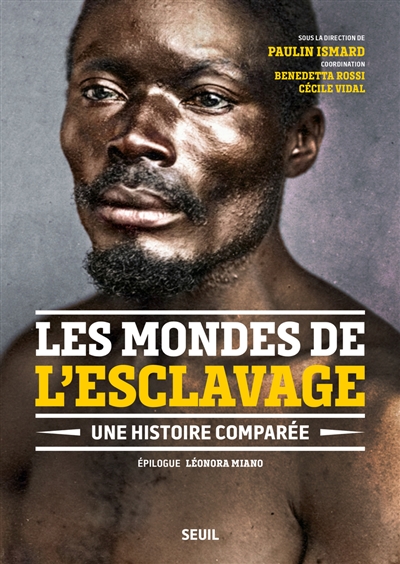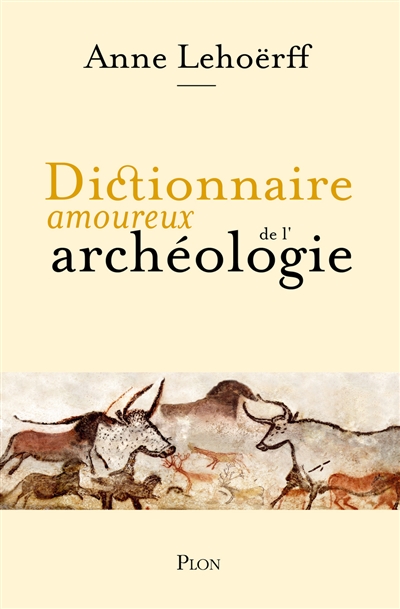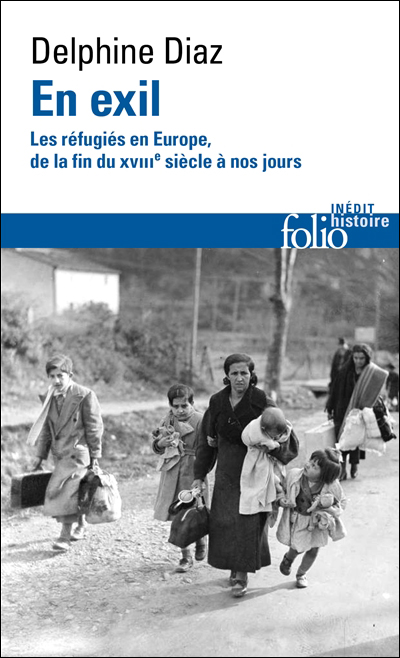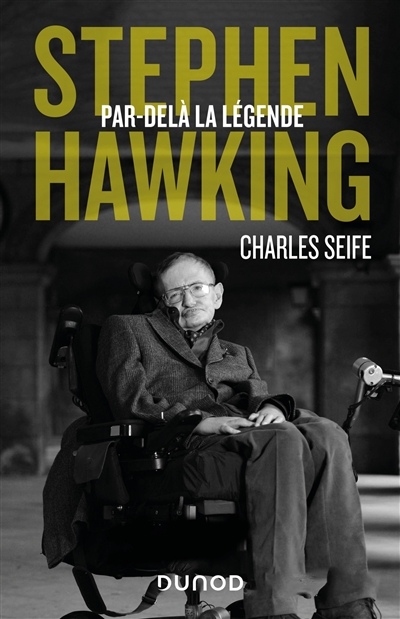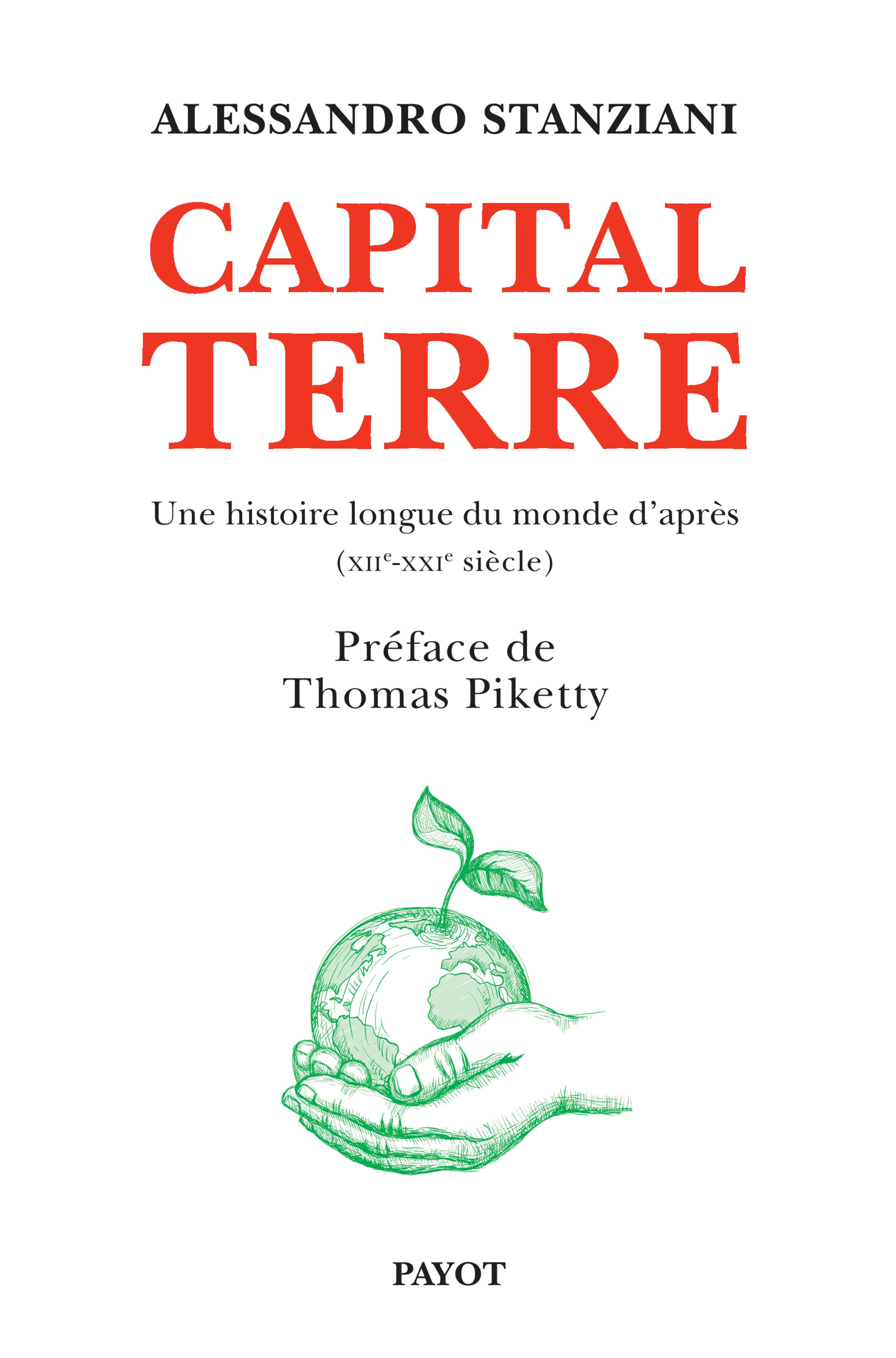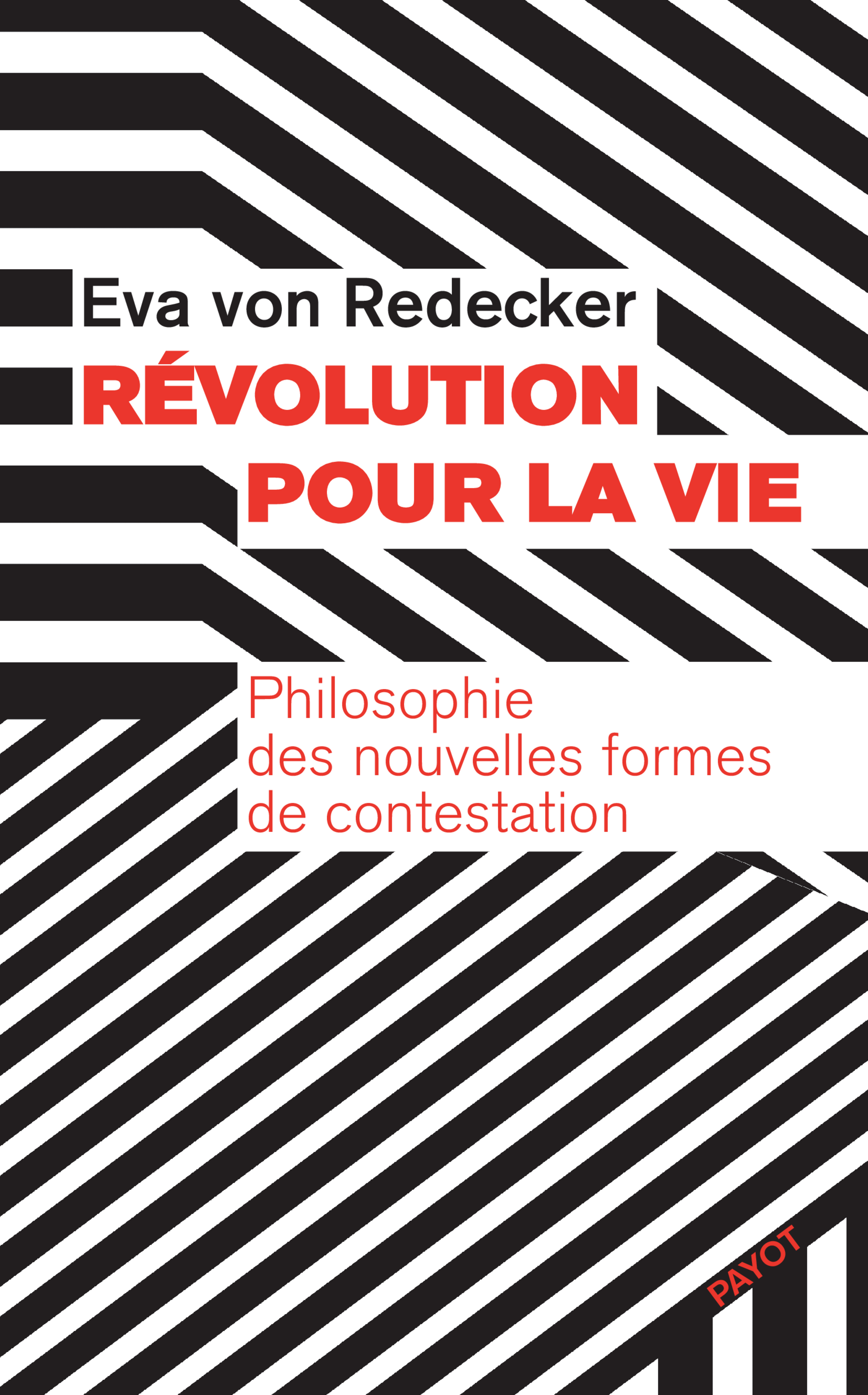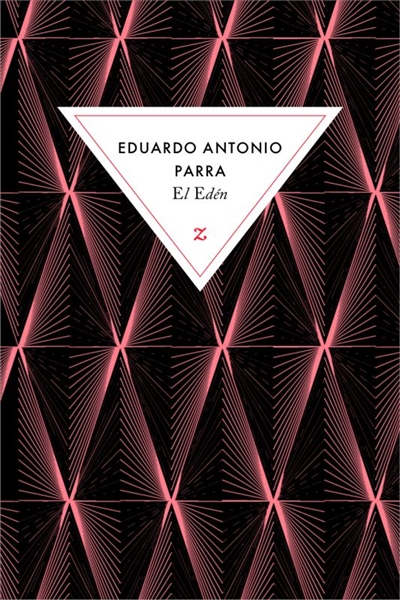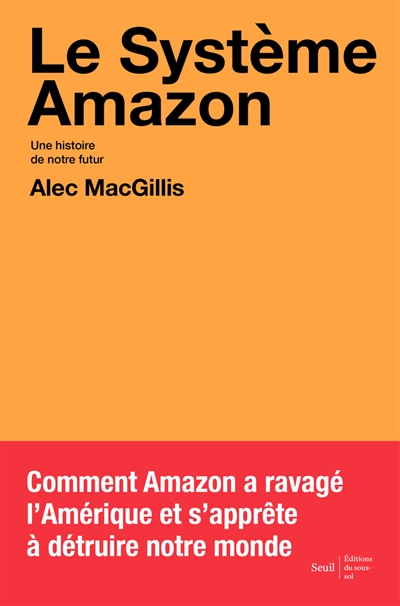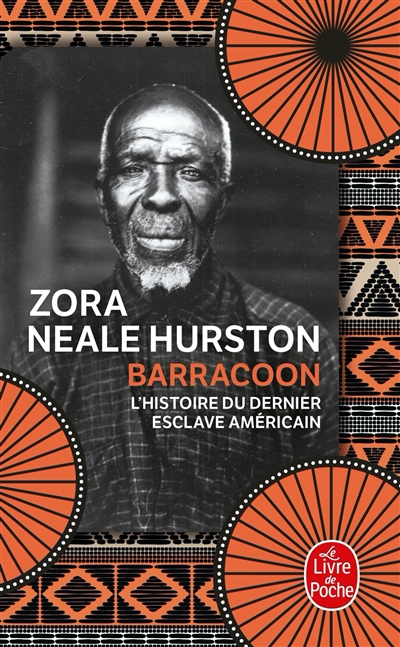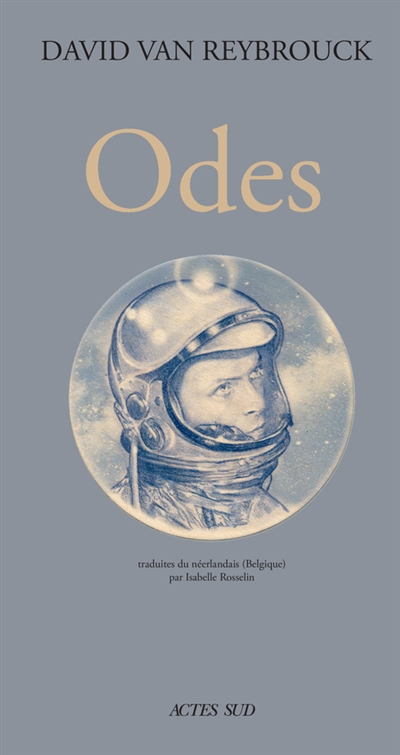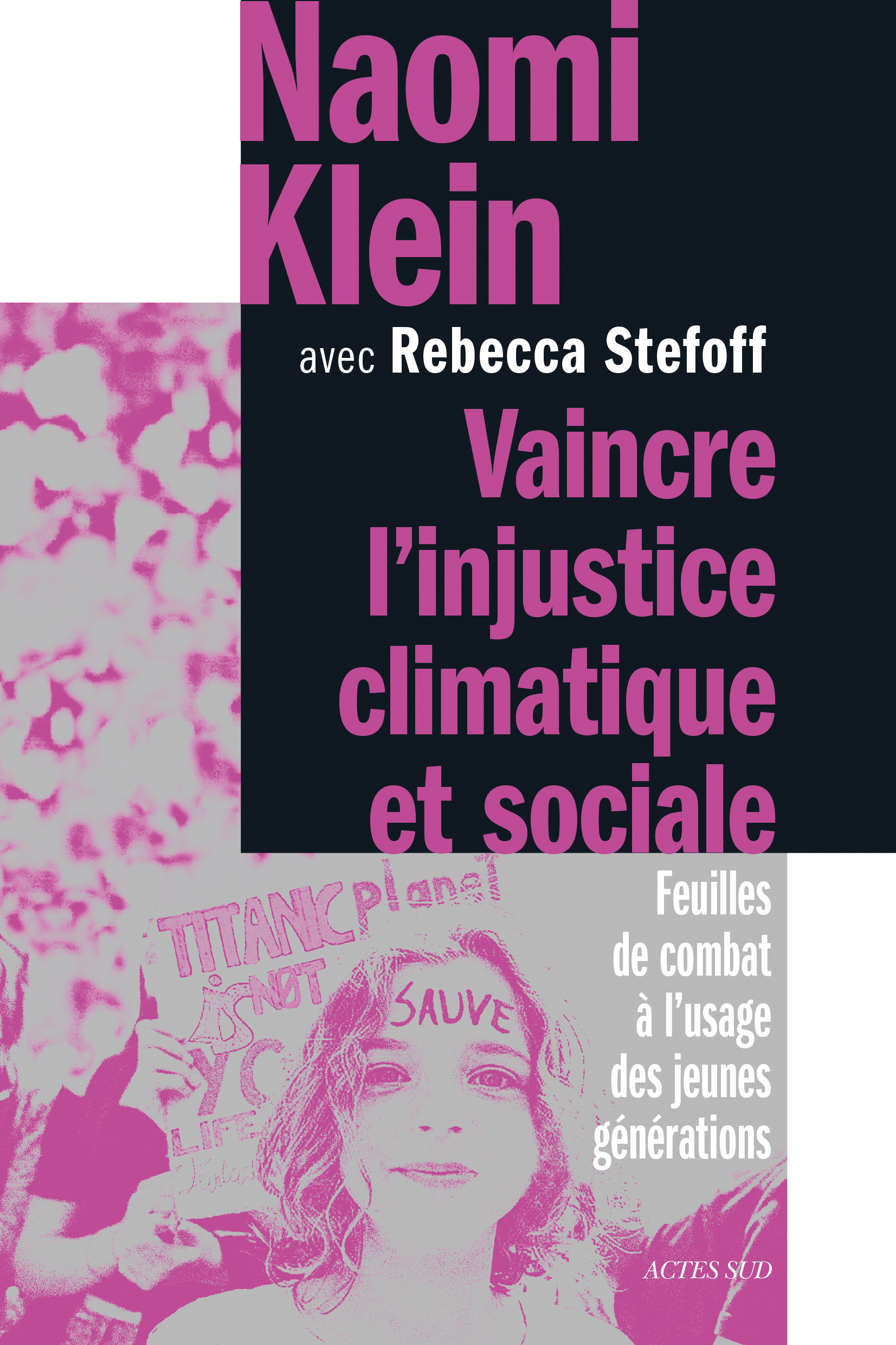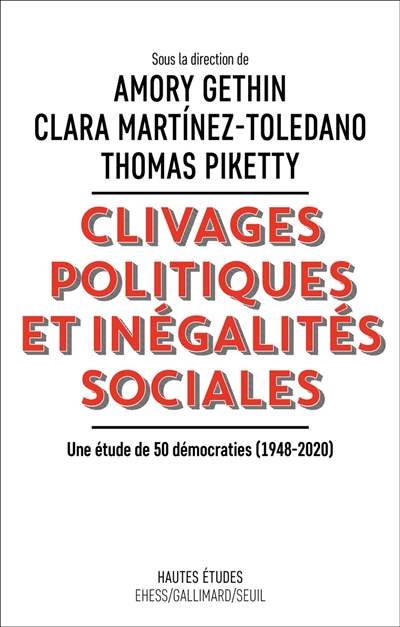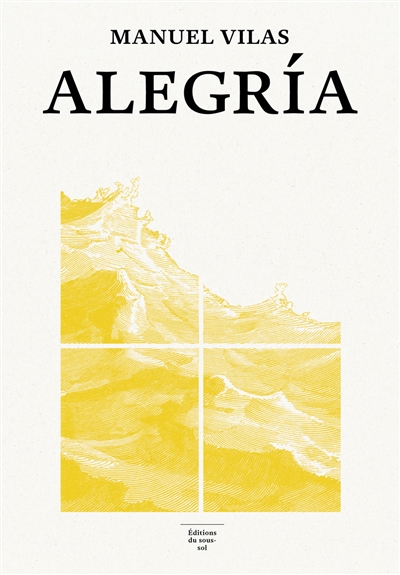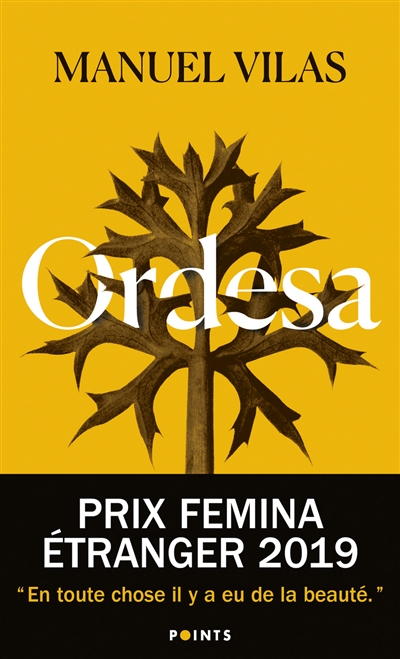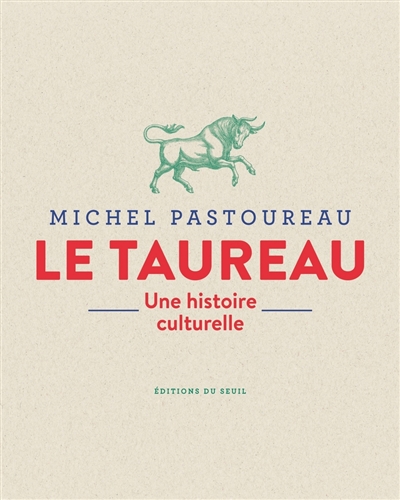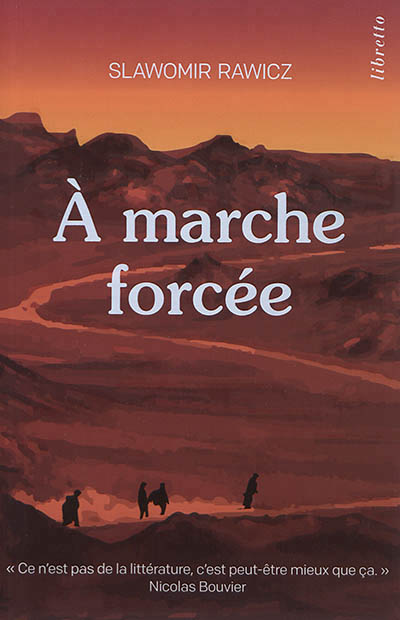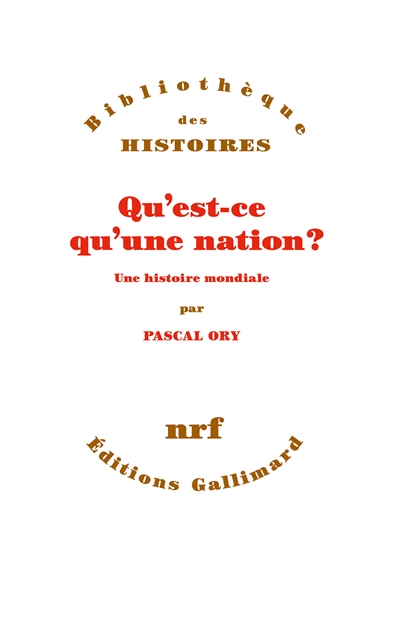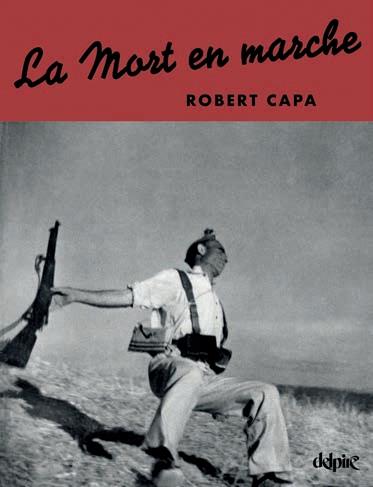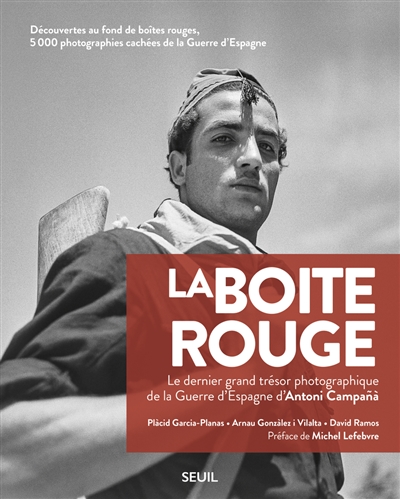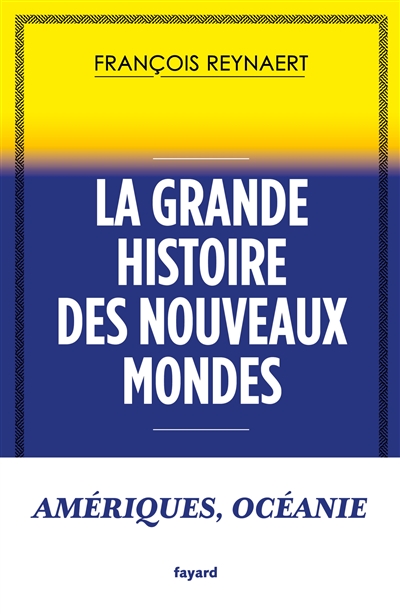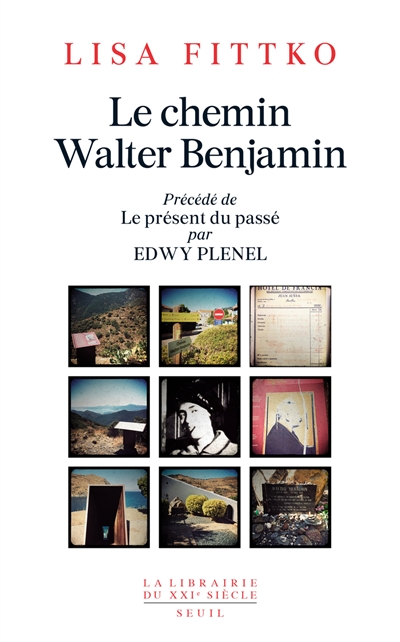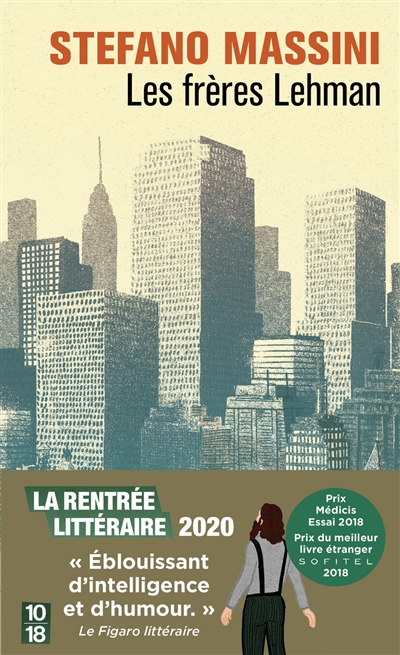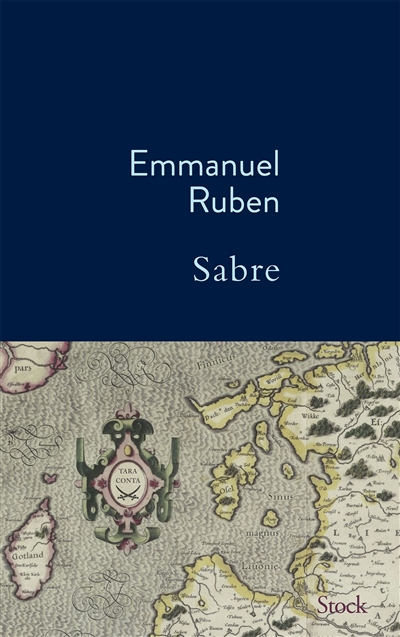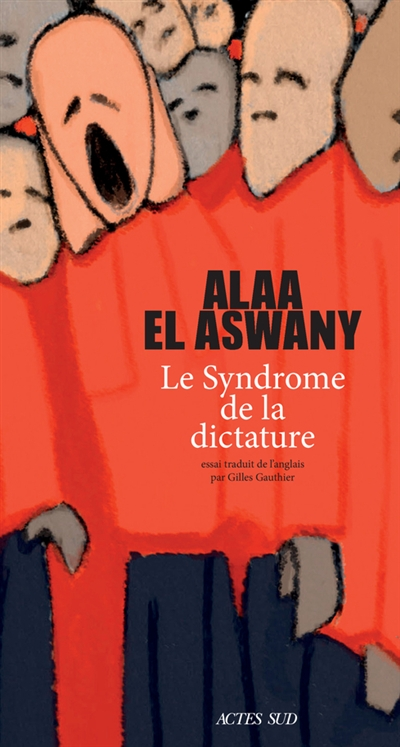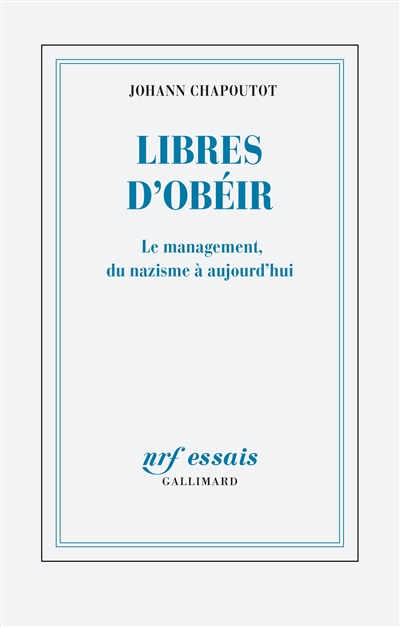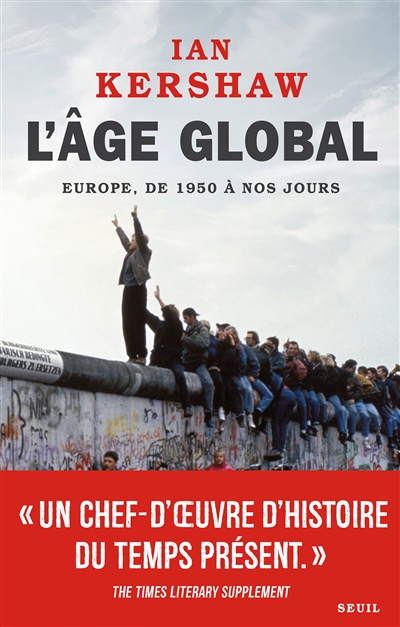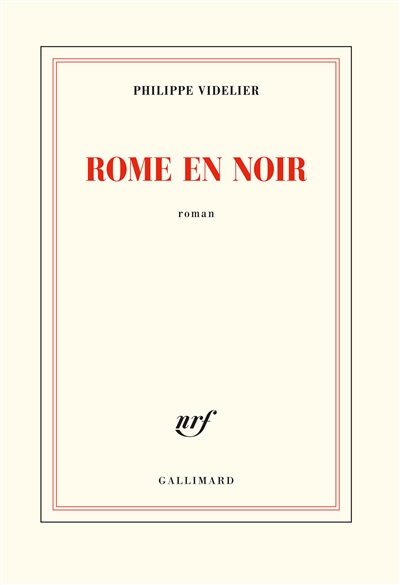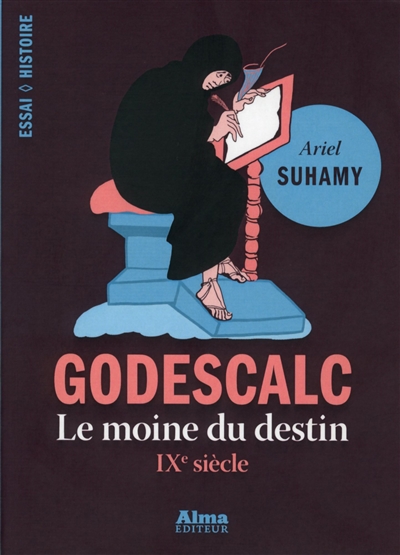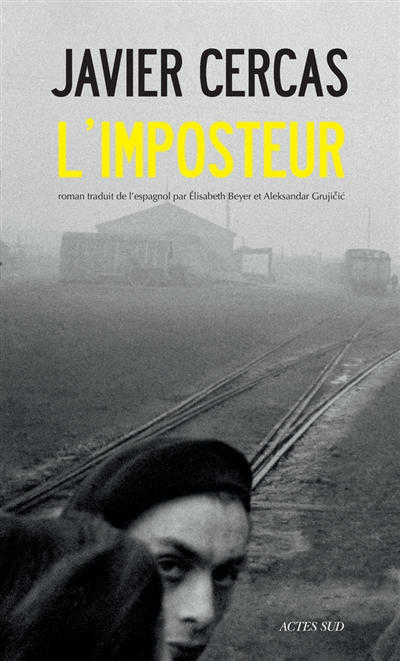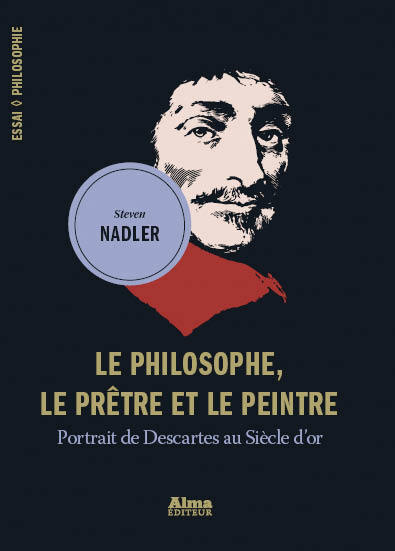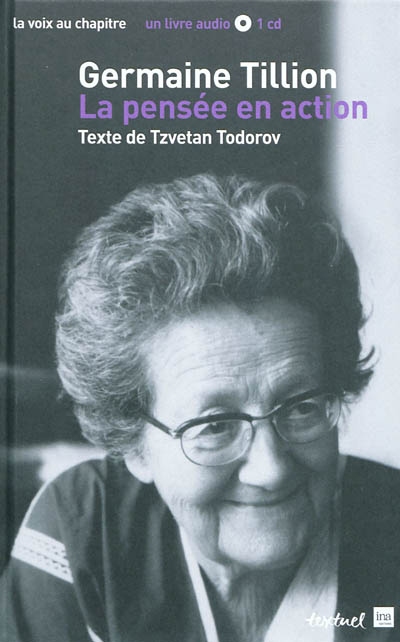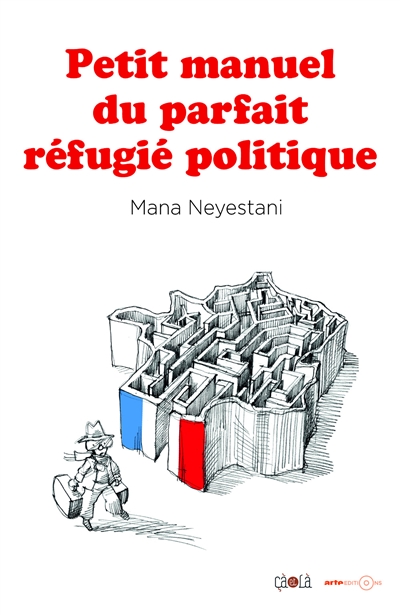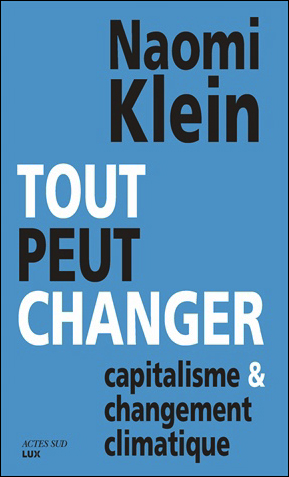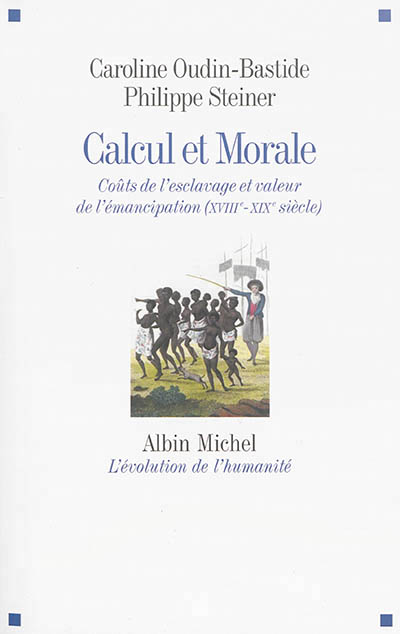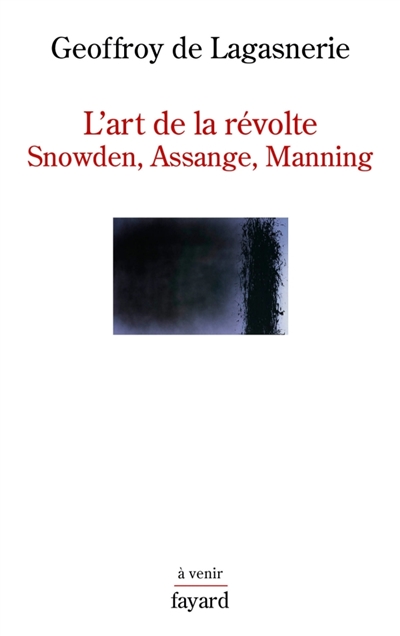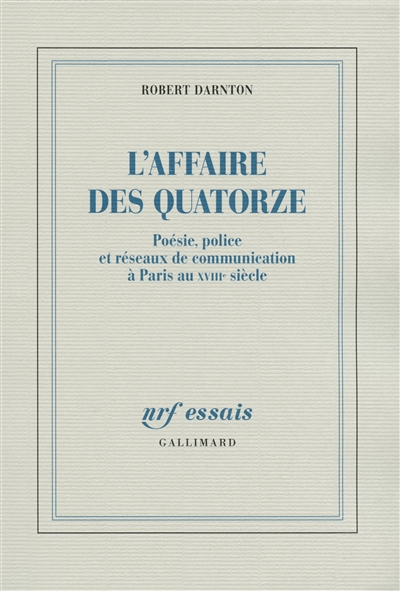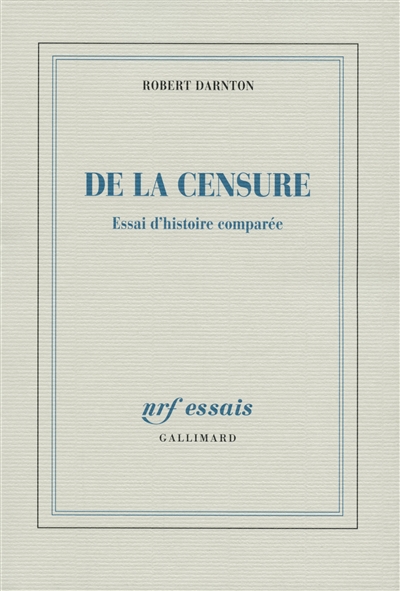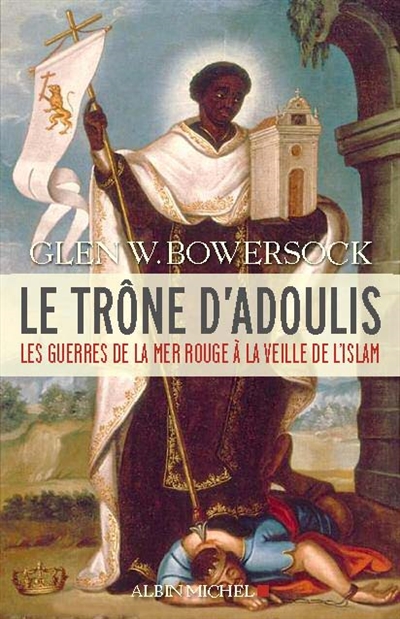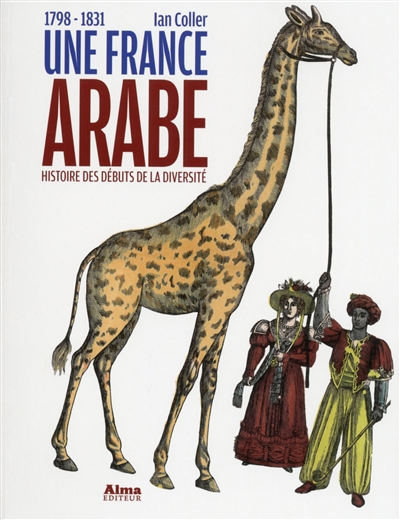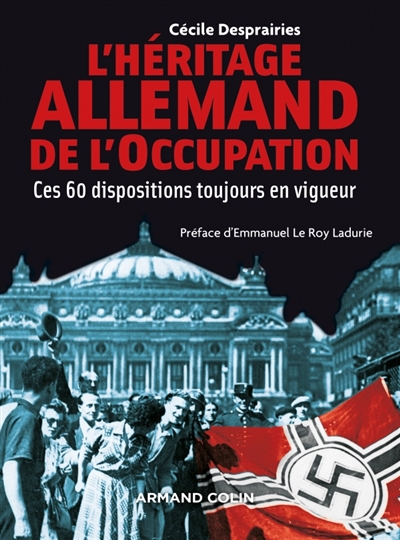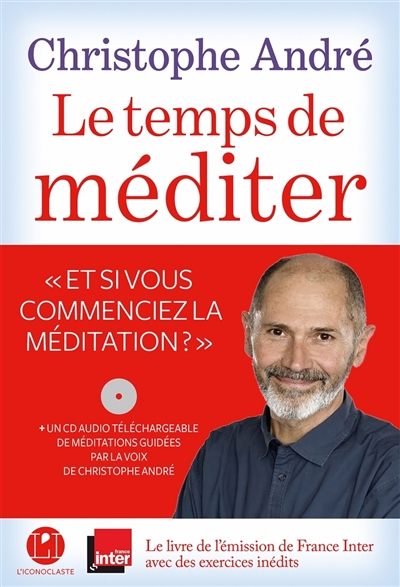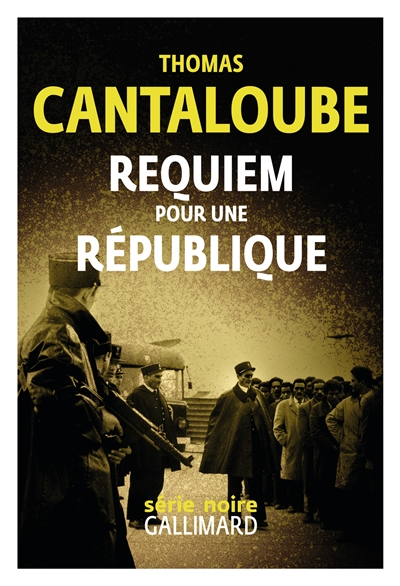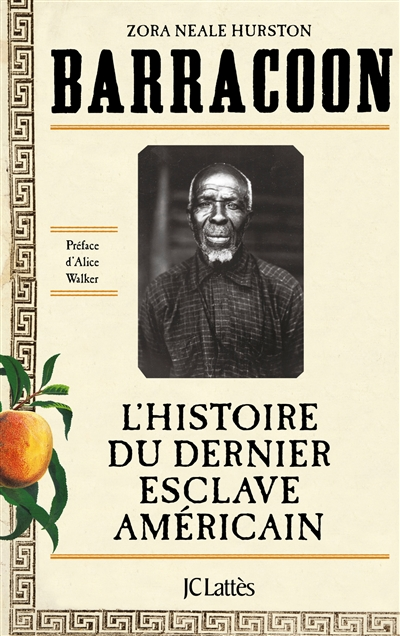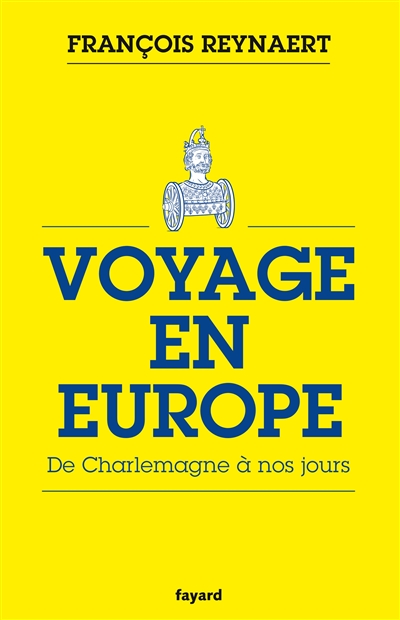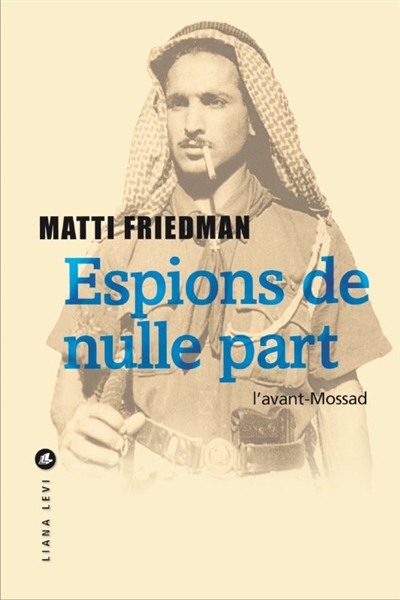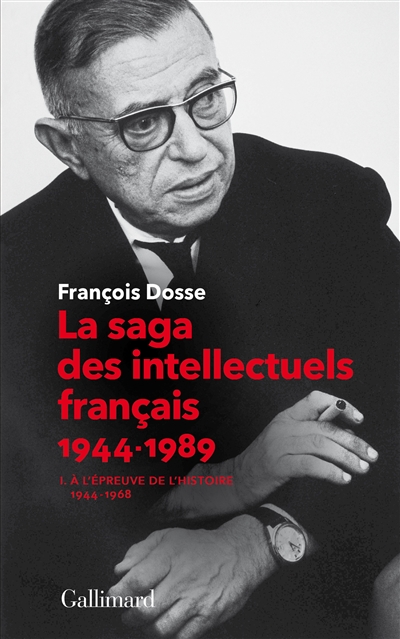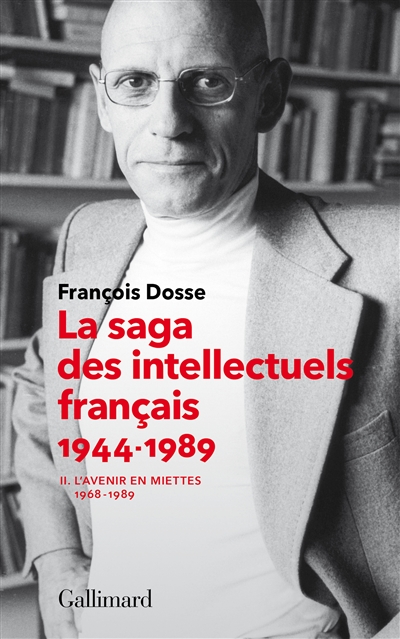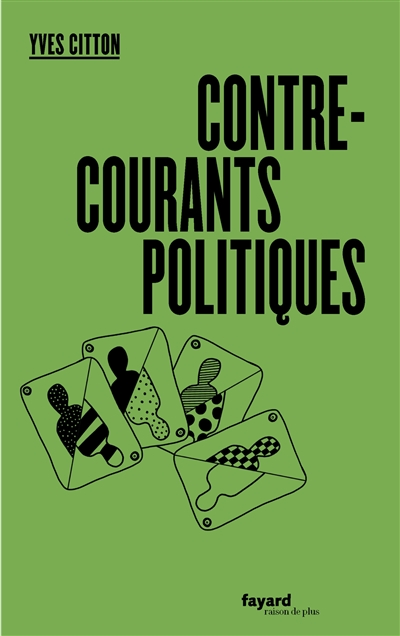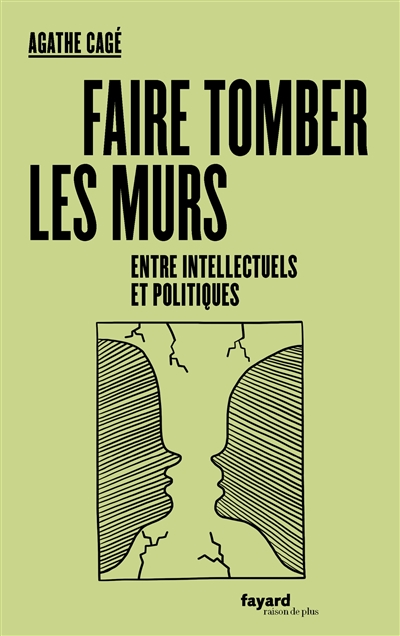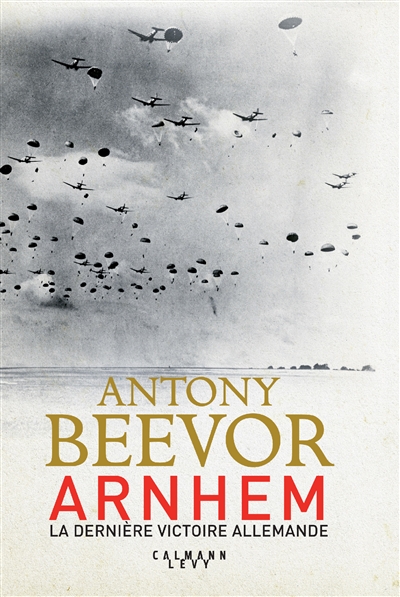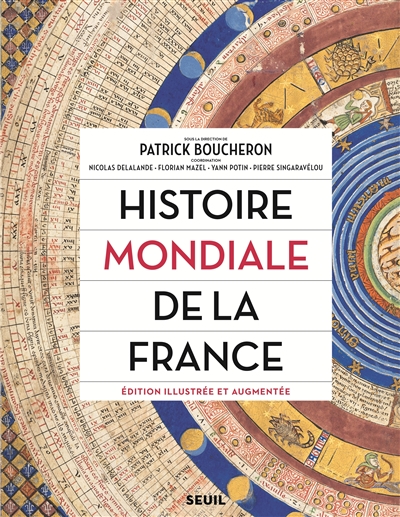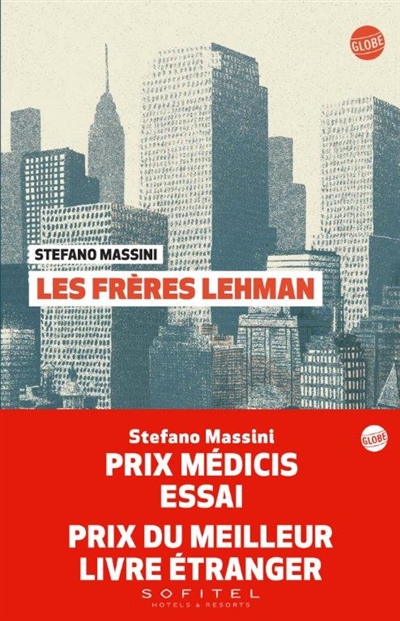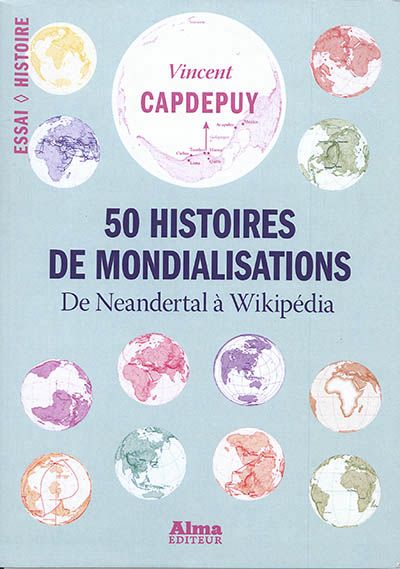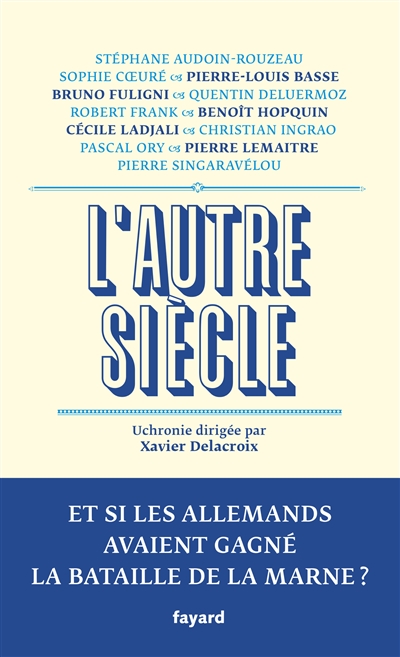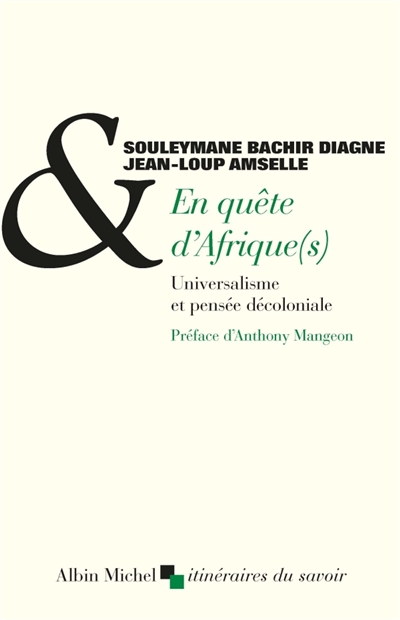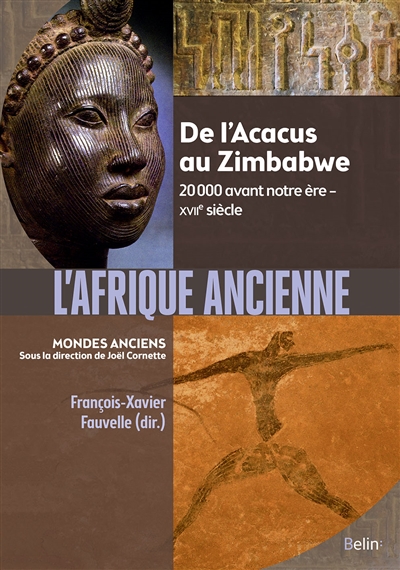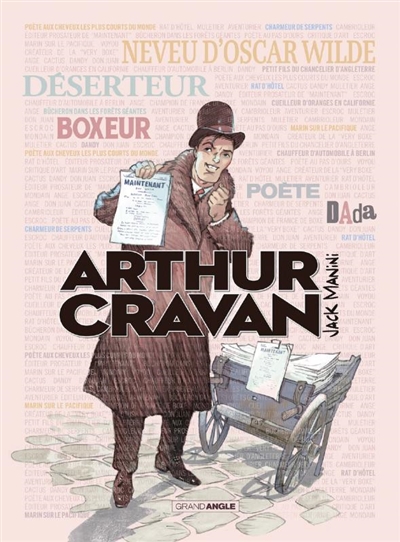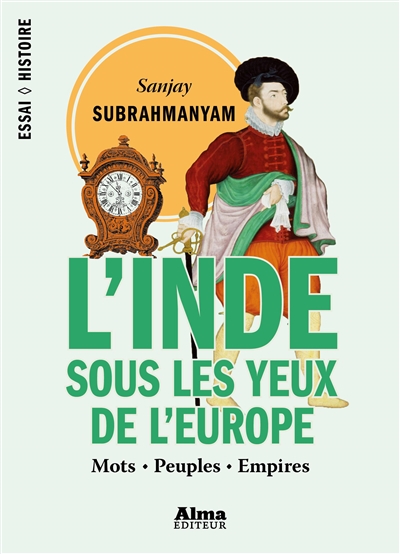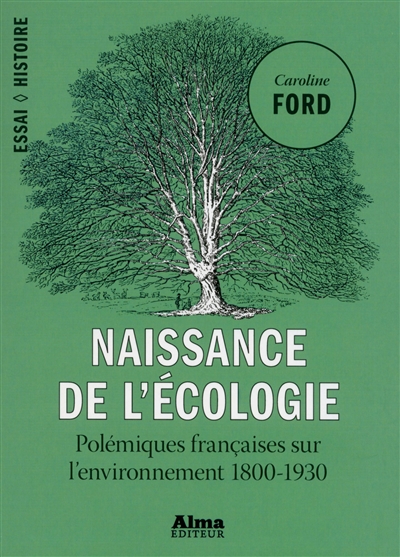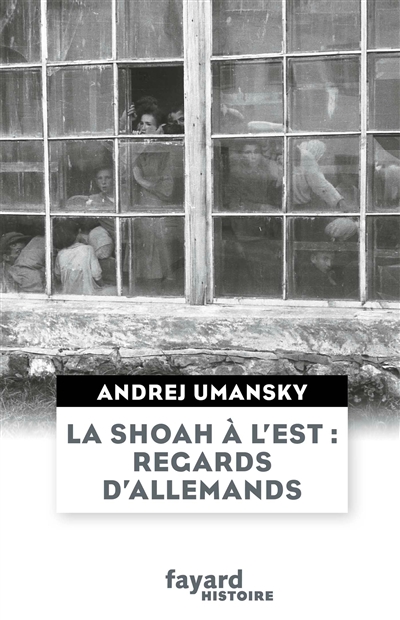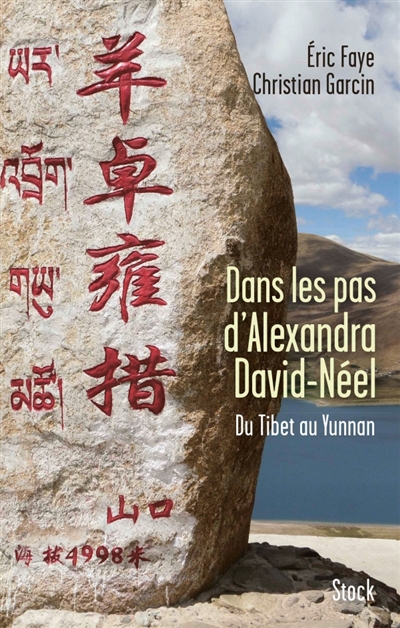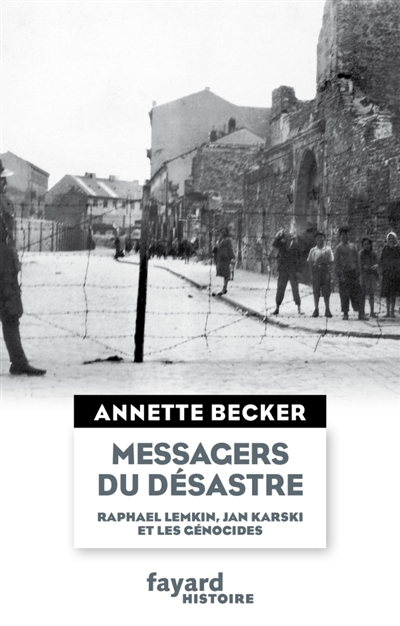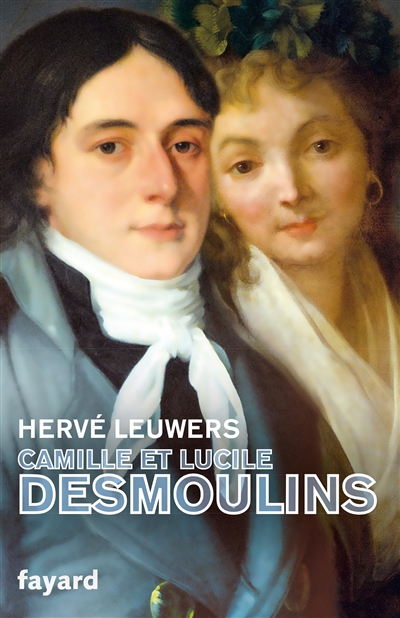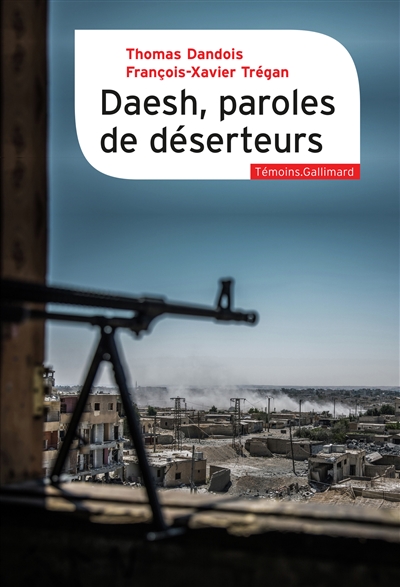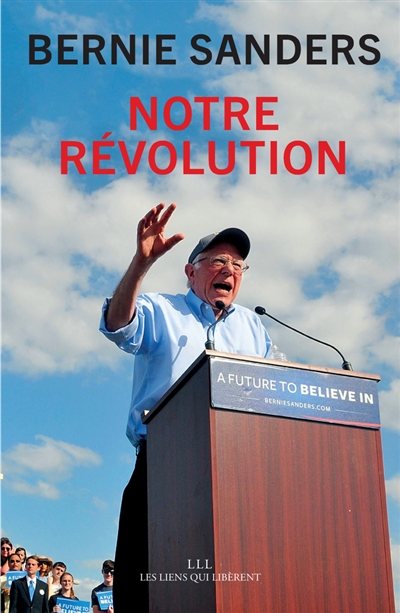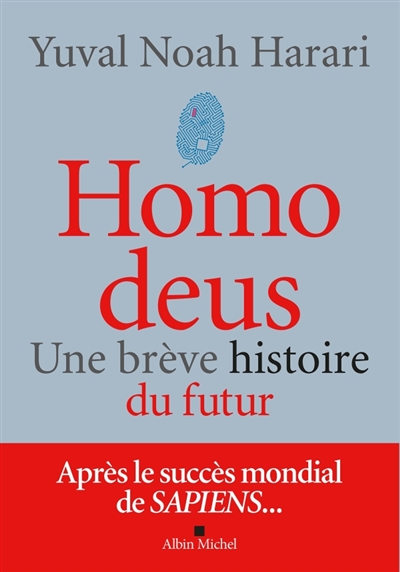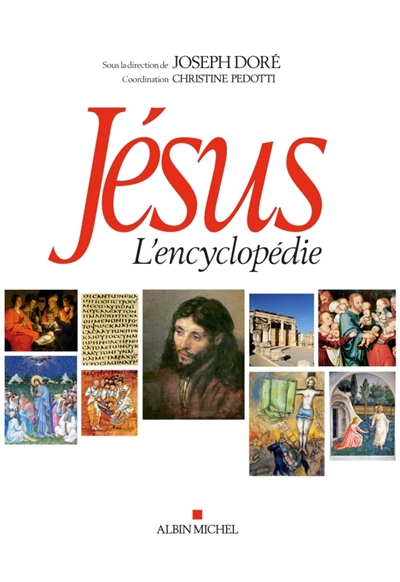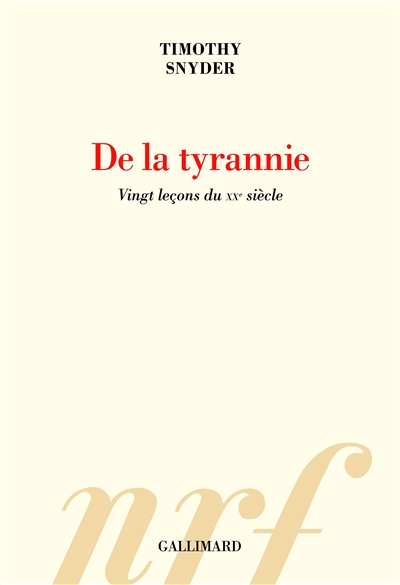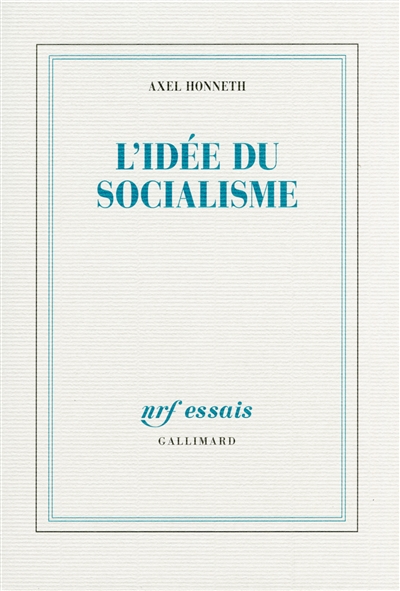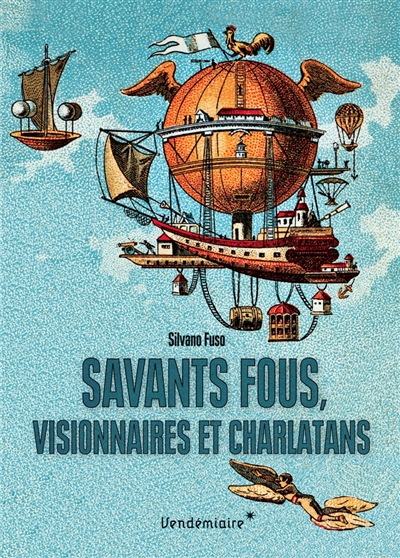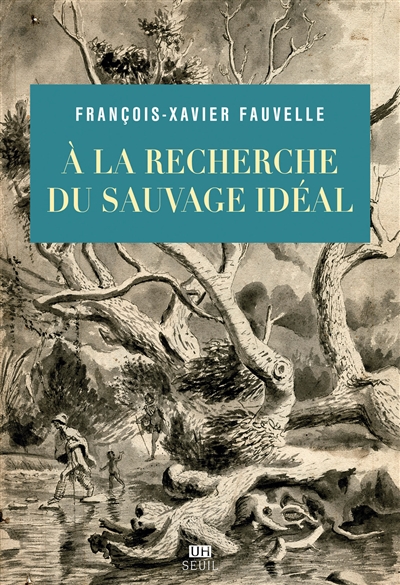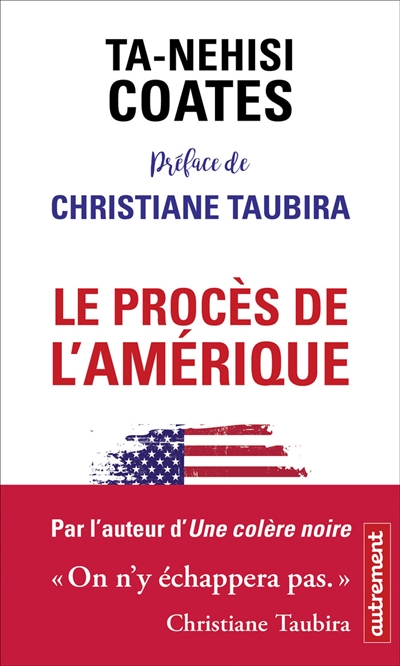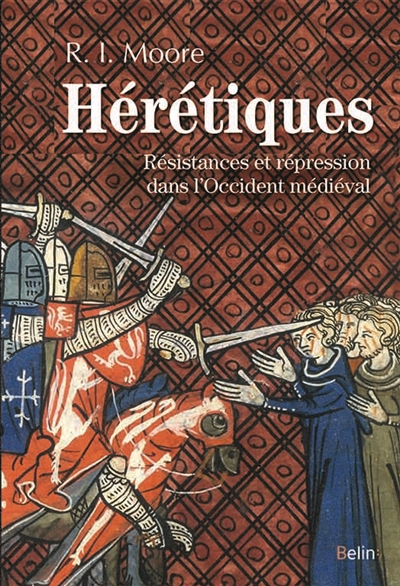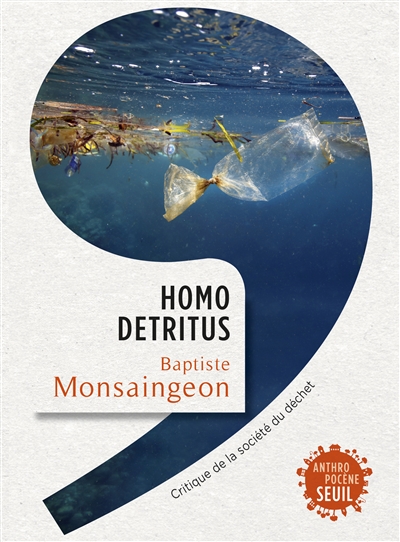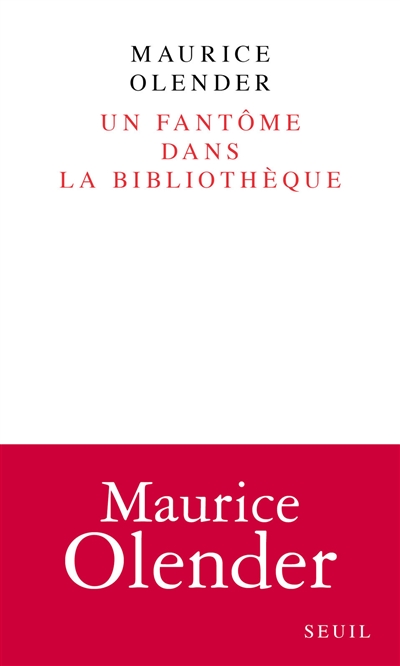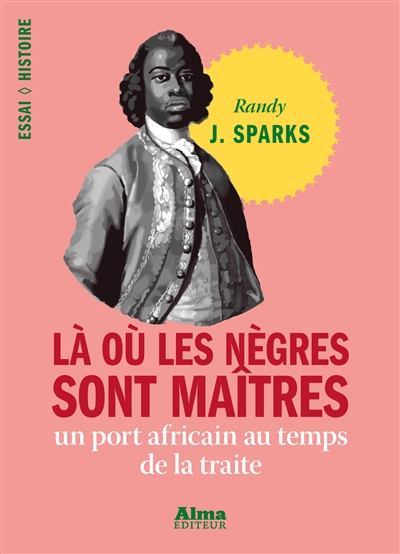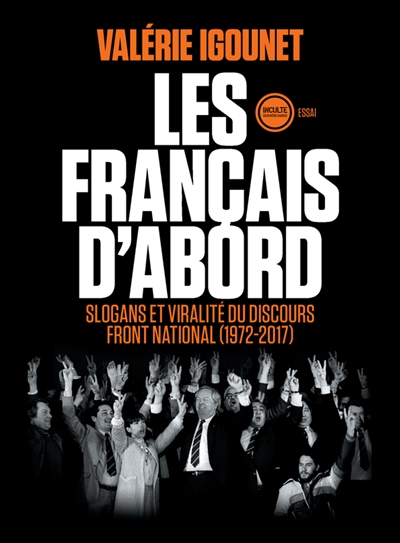Sciences humaines
Martín Caparrós
La Faim

-
Martín Caparrós
La Faim
Traduit de l’espagnol par Alexandra Carrasco
Buchet Chastel
01/10/2015
880 pages, 26 €
-
Chronique de
Jérémie Banel
Librairie du Contretemps (Bègles) -
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Maïté Blatz de Le Roi livre (Paris)
- Charlène Busalli

✒ Jérémie Banel
(Librairie du Contretemps, Bègles)
Que sait-on de la faim ? Rien. Des images qui reviennent épisodiquement sur nos écrans de télé, la sensation diffuse et culpabilisante qu’on pourrait sûrement faire mieux, ou plus… Face à cette urgence souvent délaissée, Martin Caparros a enquêté pour faire le point et dénoncer une situation qu’il n’est plus possible d’ignorer.
Page — Tout d’abord, pouvez-vous nous présenter la genèse de cette œuvre, qui est un projet au long cours, et son lien éventuel avec le roman J’ai mangé, que les lecteurs français découvriront en 2016 ?
Martin Caparros — J’ai passé un certain nombre d’années à travailler – dans le cadre de reportages, de livres – sur des situations de conflits – guerres, migrations, mouvements divers – dans les pays les plus difficiles, et je me retrouvais toujours face à un problème dont on parlait peu : la faim était toujours présente, une sorte de bruit de fond continu, à la base de toutes ces situations. Alors j’ai commencé à me demander comment je pourrais faire pour en parler : « la faim dans le monde » est devenue une espèce de cliché, un lieu commun qui exigeait une approche différente. À un moment donné, j’ai décidé d’essayer une construction à trois pattes : les histoires de ceux qui la subissent – car il n’y a pas de « faim » mais des affamés –, les chiffres, données et aperçus historiques qui permettent de la mettre en contexte, les tentatives d’analyses qui nous offriraient d’en comprendre les mécanismes… et donc de penser des solutions. Et je suis parti : plusieurs années de travail, une dizaine de pays, des centaines de conversations, de l’écriture. Il n’y a pas d’autre lien avec J’ai mangé que les plus superficiels : ce sont des livres, c’est moi qui les ai écrits, la bouffe y tient une place. Mais l’un est un roman plutôt intimiste, l’autre un essai qui s’efforce de travailler sur le global.
P. — Par quels moyens avez-vous rencontré les nombreuses personnes qui témoignent dans votre livre, et comment avez-vous réussi à tisser ce lien de confiance qui semble si fort ?
M. C. — C’est surtout Médecins Sans Frontières qui m’a aidé à me mettre en contact avec des personnes qui m’ont prêté leur témoignage pour le livre. J’ai passé d’assez longs moments dans quelques-unes de leurs missions, au Soudan du Sud, au Niger, au Bangladesh, en Inde. Et ce lien de confiance se bâtit, je crois, à force de savoir écouter. Les gens ont des histoires, sont pleins d’histoires que personne n’écoute. Ils sont donc très sensibles à l’attrait d’une oreille bien disposée. C’est heureux, parce qu’il y a peu de choses qui me plaisent et m’émeuvent aussi fortement que ces moments un peu magiques où quelqu’un que tu connais à peine te confie sa vie.
P. — Comment réussissez-vous, sur un sujet aussi sensible, à atteindre un juste équilibre entre la colère, l’empathie, et un travail plus documentaire ?
M. C. — Je suis content que vous pensiez que j’y ai réussi. En fait, c’était un des défis principaux de ce travail : comment se servir de la colère – justement suscitée par beaucoup des histoires et des situations que j’ai eu à connaître – tout en évitant d’être asservi par elle. Et comment intégrer histoires, données et analyses, de façon à ce qu’elles s’interrogent et s’expliquent les unes les autres. Parce qu’un pur travail de récit documentaire court le risque de devenir une sorte de pornographie de la misère, et un travail pur d’analyse perd, dans sa froideur, sa capacité d’interpeller.
P. — Comment expliquez-vous que, bien que dramatique et bien connue, la question de la faim dans le monde reste presque marginale, en dépit de grandes déclarations ?
M. C. — C’est très simple : parce que ceux qui en souffrent sont ceux que nous considérons comme « des marginaux ». Quelle autre définition de la marginalité, si ce n’est : « ceux qui ne mangent pas à leur faim » ? Le fait que 800 ou 900 millions de personnes ne mangent pas à leur faim, dans un monde qui produit assez de nourriture pour une humanité et demie, est le problème le moins démocratique, le moins égalitaire qui soit. En cela il est exactement l’opposé de la menace écologique – représentée surtout par le changement climatique –, dont la visibilité a tellement progressé ces derniers temps. Tandis que la faim, non, elle n’arrive qu’aux autres. Et alors, on peut s’en tirer avec quelques déclarations aimables, bien tournées. Et ne pas relever que la faim n’est pas une conséquence de la pauvreté mais de la richesse, de notre richesse, qui est le résultat de ce processus de concentration par lequel nous consommons ce que tous ces autres n’arrivent pas à manger. Par conséquent, il n’existe pas de solutions techniques mais des solutions politiques. Et les solutions que l’on devrait appliquer sont à l’opposé de celles qui dominent nos pays.
P. — Au-delà de l’indignation et du cri de colère, votre but serait donc de favoriser une prise de conscience sur notre responsabilité « occidentale » ?
M. C. — Au-delà ou en deçà, si j’ai écrit ce livre, c’est pour dire cette douleur, que j’ai essayé de résumer dans cette phrase qui parcourt le livre : « Comment, bordel, parvenons-nous à vivre en sachant que ces choses-là arrivent ? » Parce que je suis convaincu que cette conscience est la condition indispensable – bien qu’insuffisante – pour que tout ça commence à changer : pour que nous commencions à le changer.