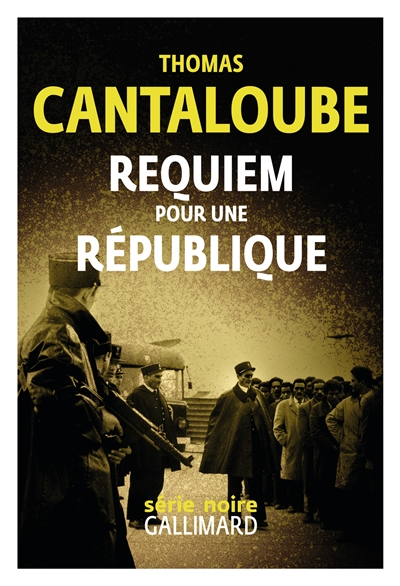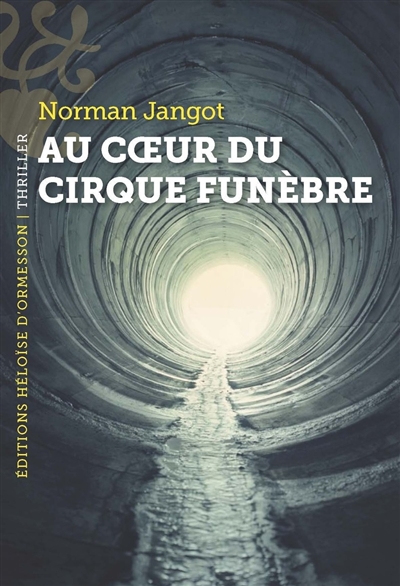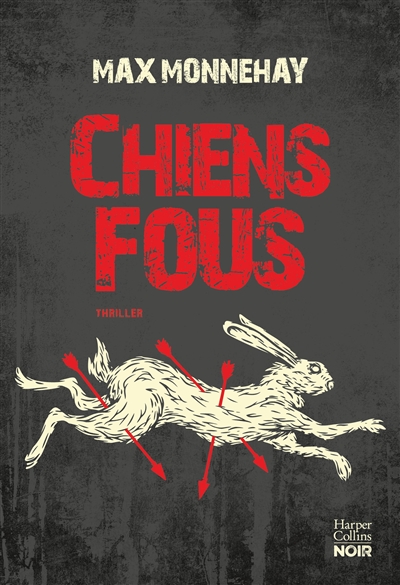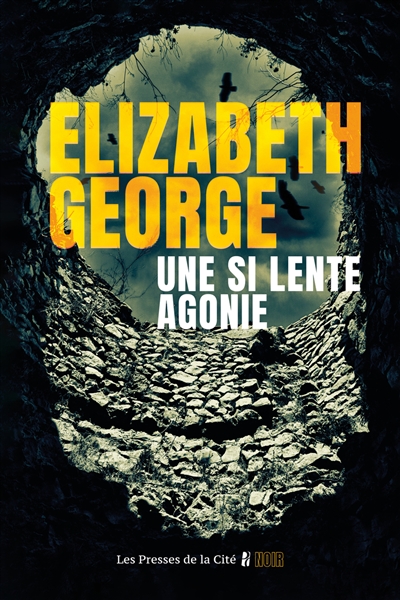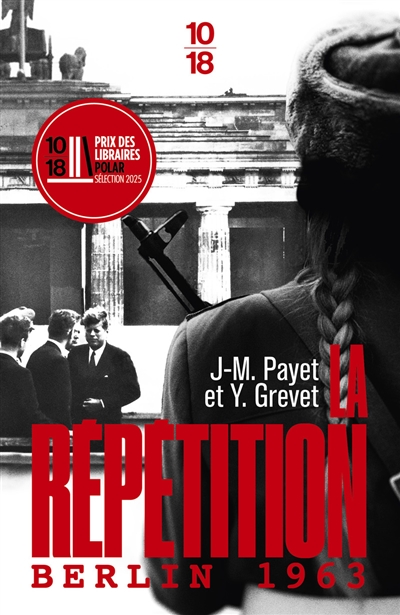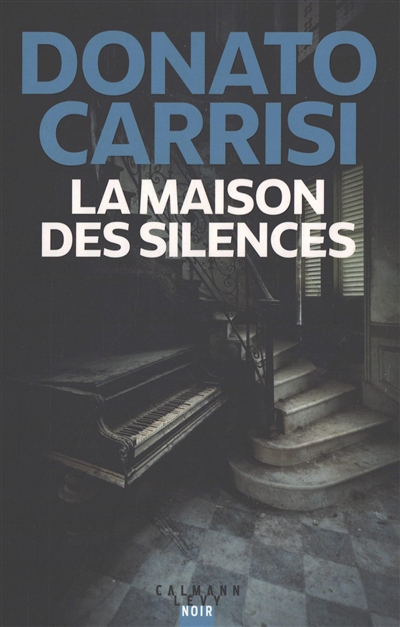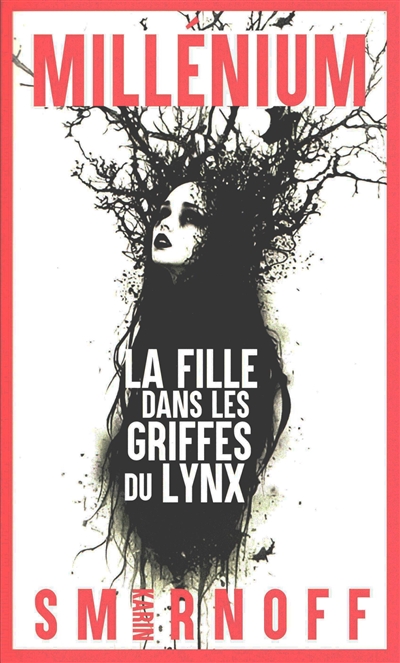Comme dans tout bon roman policier, on trouve dans Requiem pour une République un meurtre, un meurtrier, un enquêteur, et mille personnages gravitant autour de cette intrigue principale. À ceci près qu’ici, certains de ces personnages s’appellent François Mitterrand, Charles Pasqua ou encore Maurice Papon. Ajoutons par ailleurs que la victime est un avocat proche des indépendantistes du FLN et que tout ce petit monde évolue entre souvenirs de Résistance, réseaux gaullistes louches et vrais voyous. Le tout compose un cocktail détonnant, où la vérité a toutes les peines du monde à émerger, tant ceux qui souhaitent réellement la faire apparaître sont peu nombreux. Bien évidemment, l’irruption de la politique au cœur de l’enquête et le recours par certains à la raison d’État ne sont pas non plus propices à un travail efficace. Voici donc un roman policier à l’intelligence rare, jouant avec un fond historique et politique trop méconnu, le tout sans jamais céder ni sur le sens du rythme, ni sur le sens de l’intrigue.
PAGE — Votre roman est un mélange particulièrement habile de moments historiques réels et de fiction, comment avez-vous réussi à mêler les deux et à quels obstacles vous êtes-vous heurté ?
Thomas Cantaloube — Mon principal souci était la vraisemblance. En injectant de la fiction dans des événements réels (certains bien documentés, d’autres moins), il fallait faire attention à ne pas transformer les faits historiques. Par exemple, pour la nuit du 17 octobre 1961, je me contente de positionner mes personnages en tant qu’observateurs de ce qui se déroule autour d’eux. Par contre, s’agissant de l’attentat contre le train Strasbourg-Paris, dont on connaît peu de détails, j’ai pris une plus grande liberté en faisant d’un des personnages l’auteur du déraillement.
P. — Vous êtes journaliste et les membres de votre profession sont, à l’instar des truands ou des forces de l’ordre, au cœur du roman. Ils oscillent aussi entre lâcheté et idéaux. Est-ce un hommage, une dénonciation ? Quels liens peut-on établir avec la pratique contemporaine du journalisme ?
T. C. — Dans toutes les périodes, il y a des journalistes courageux et d’autres qui se couchent. Parfois, durant une même carrière, certains oscillent des deux côtés (je ne citerai pas de noms !). Par contre, ce qui est vrai, c’est qu’il était sans doute plus difficile d’être un journaliste indépendant en France dans les années 1950-1960 qu’aujourd’hui. L’audiovisuel était contrôlé par l’État, il n’y avait donc que la presse écrite qui pouvait être frondeuse. Mais c’était encore une époque où l’on pratiquait plus le journalisme de validation et de narration que celui d’investigation. Cela viendra plus tard, après le Watergate aux états-Unis, après les révélations du Canard enchaîné et du Monde sur les diamants de Bokassa ou l’affaire Greenpeace.
P. — Au final, la République pour laquelle vous écrivez ce requiem est toujours la nôtre, plus de 50 ans après. La guerre d’Algérie, qui agit encore trop comme un point aveugle de notre histoire récente, serait donc un fardeau de naissance indépassable pour celle-ci ?
T. C. — Je crois en effet que le refus de se confronter honnêtement aux circonstances du début de notre République pèse sur elle, et sur nous, comme un fardeau. Qu’il s’agisse des institutions taillées pour un homme providentiel, militaire de surcroît ; qu’il s’agisse de la répression sauvage menée contre les Algériens qui voulaient être indépendants ou simplement acceptés dans leurs différences, attitude qui nourrit toujours le racisme ; qu’il s’agisse des accommodements du pouvoir avec des truands ou d’anciens collabos ; tout cela a été balayé et mis sous le tapis et nous revient aujourd’hui à la figure.