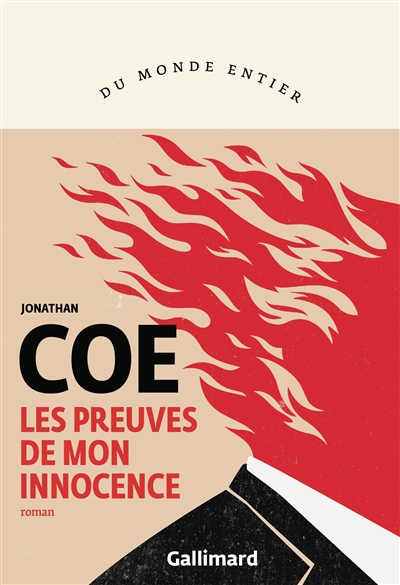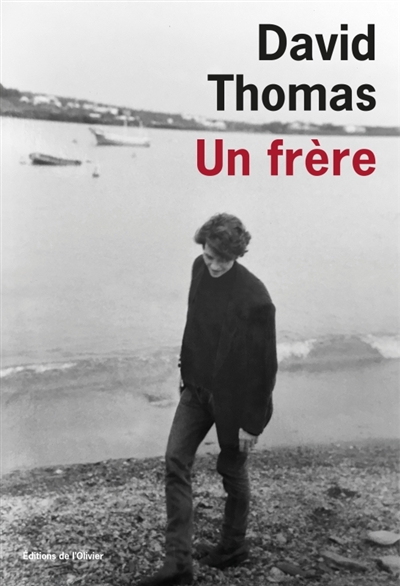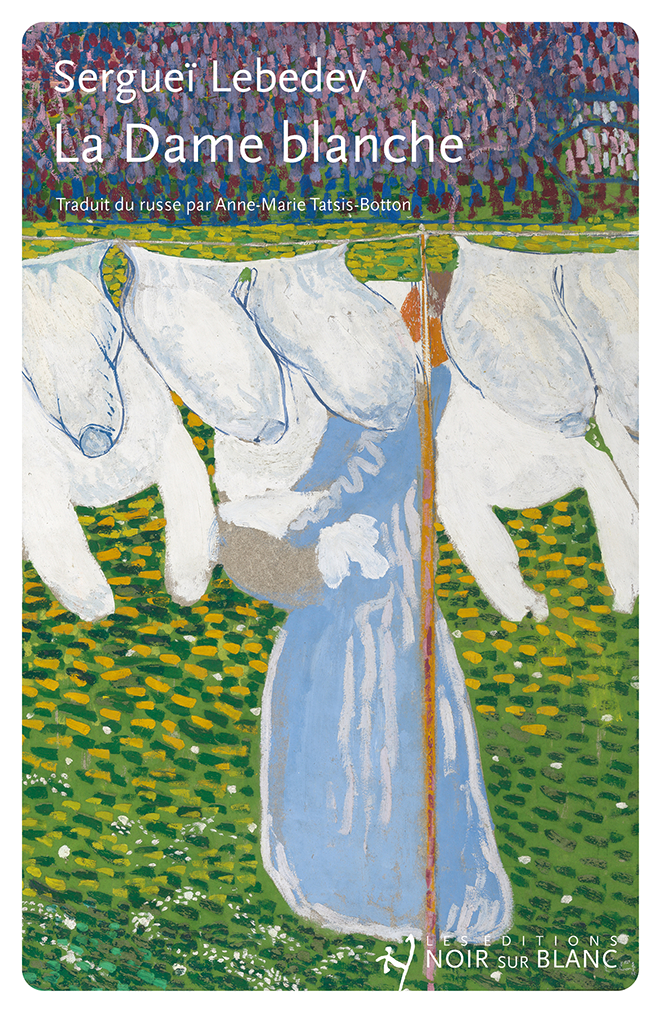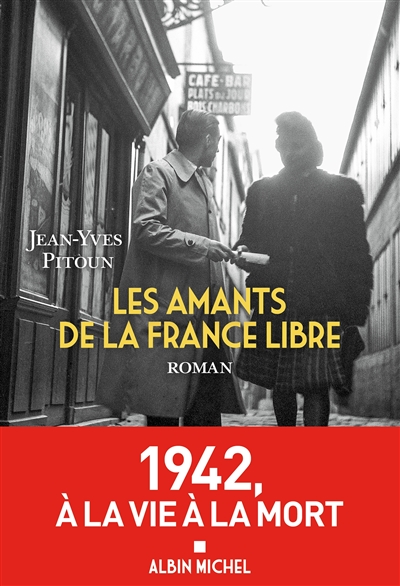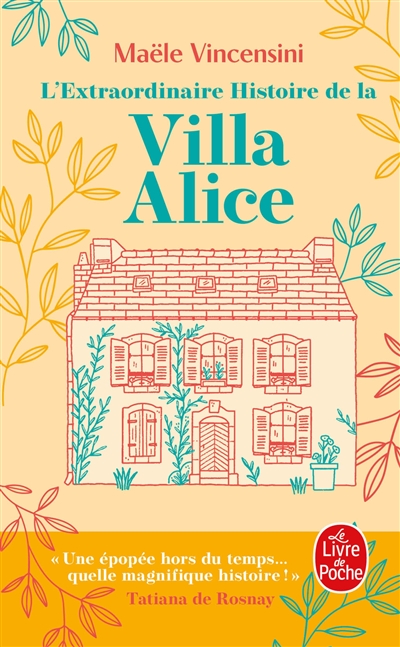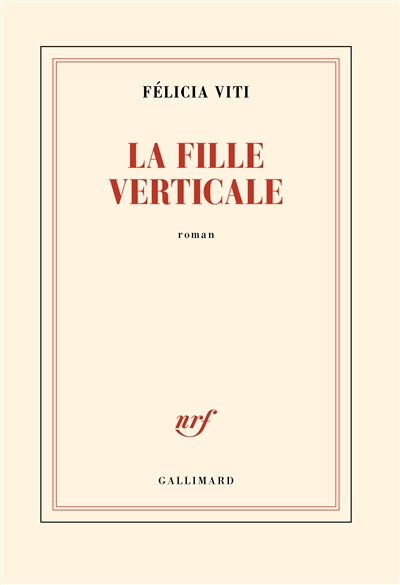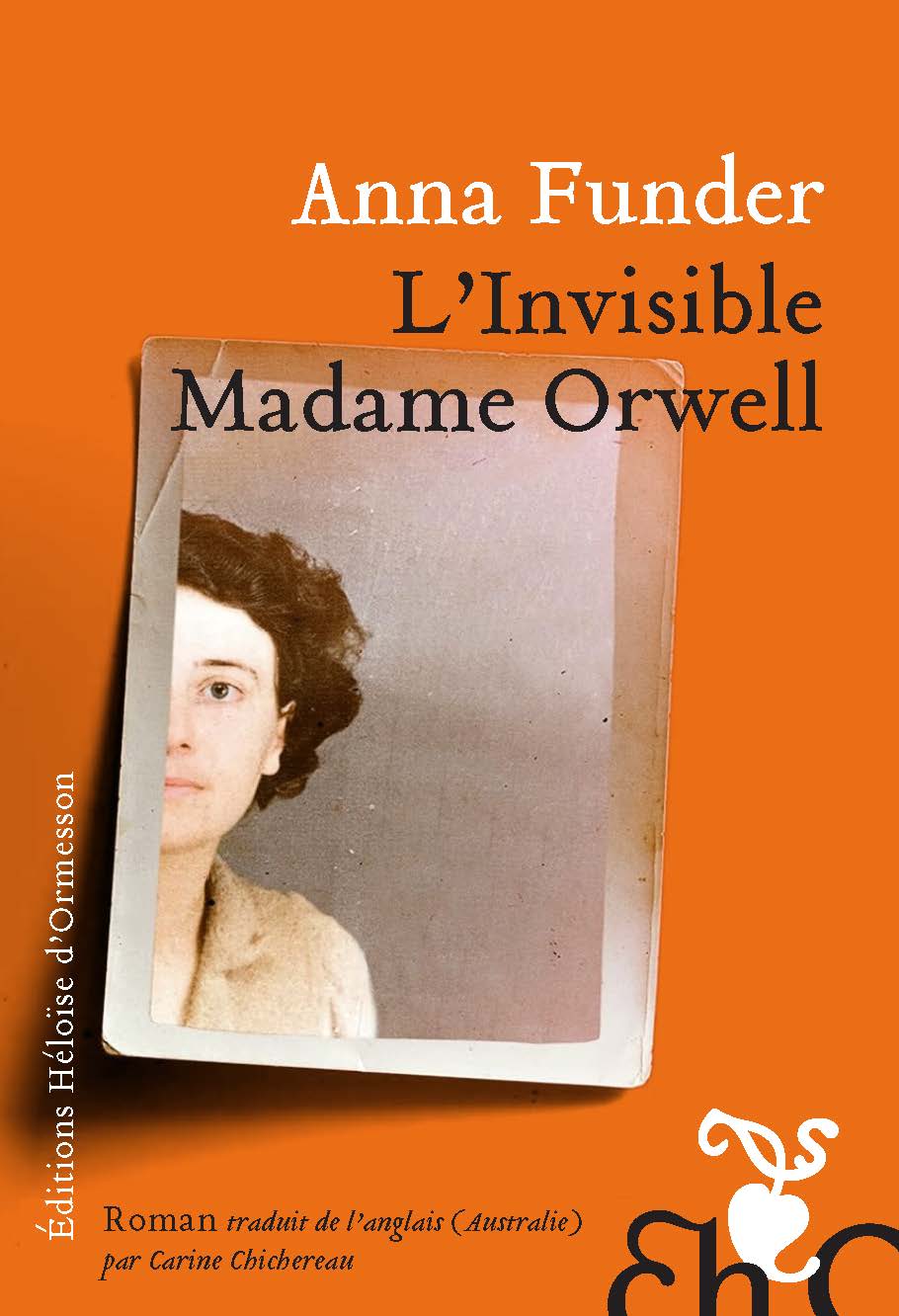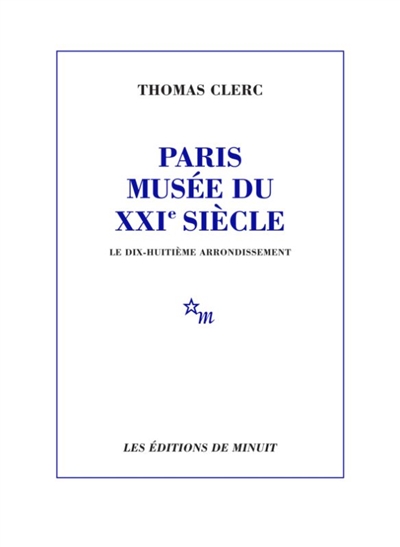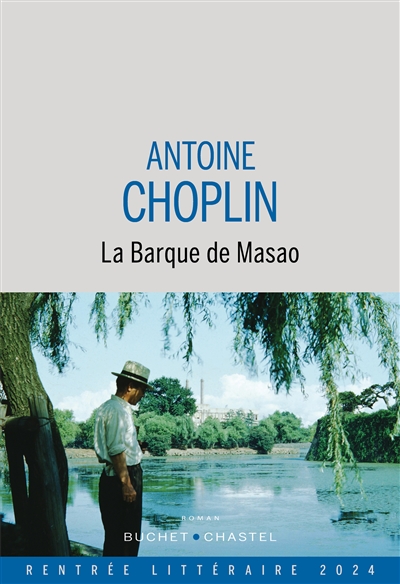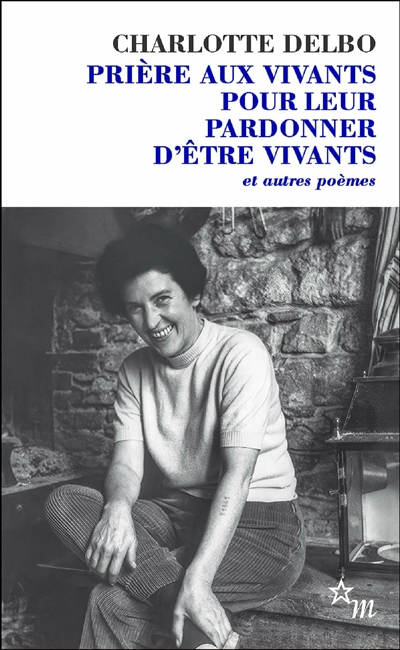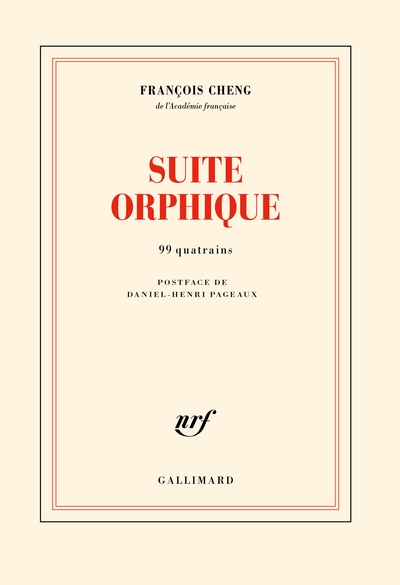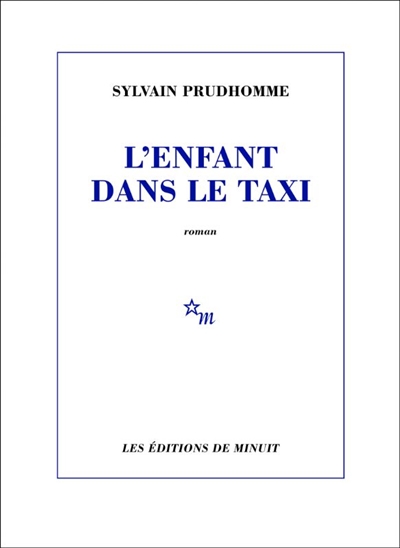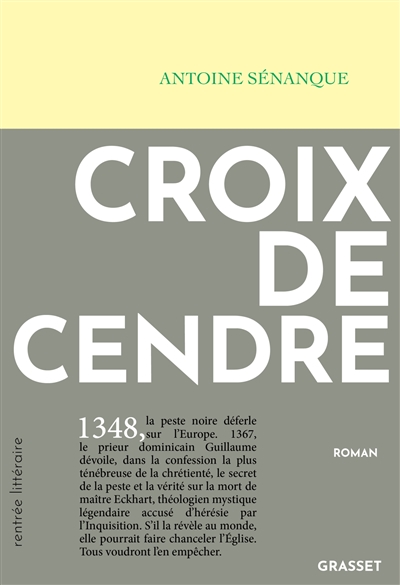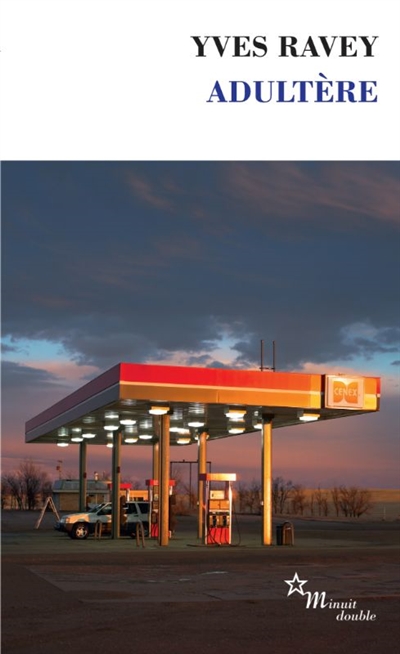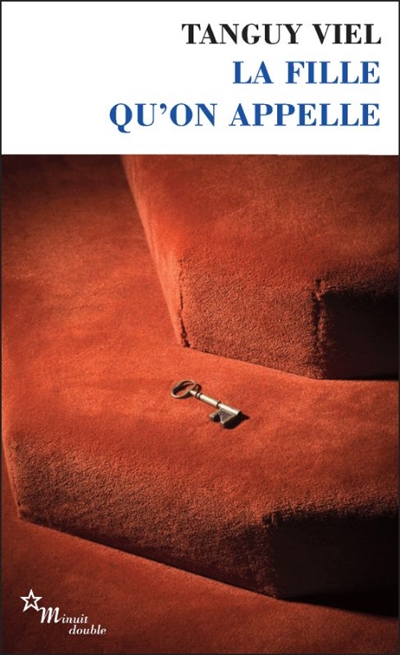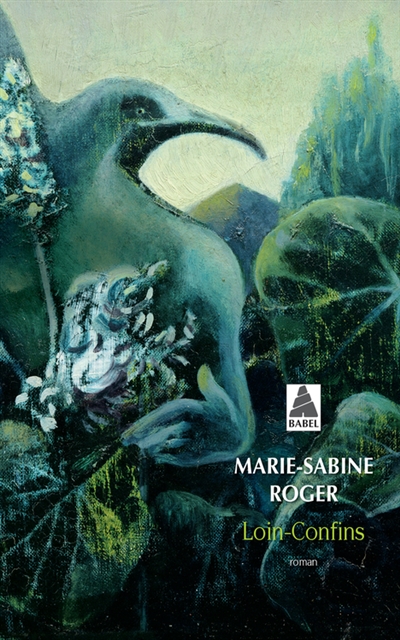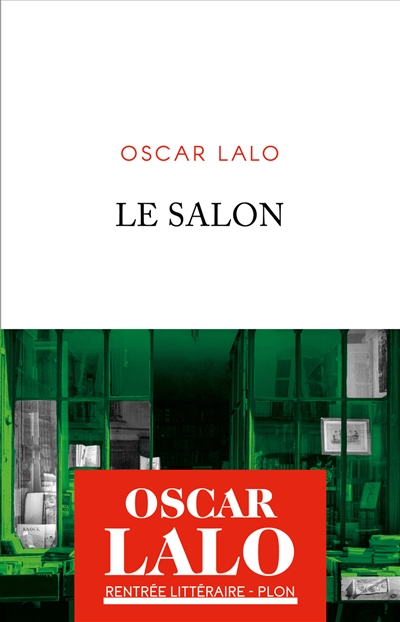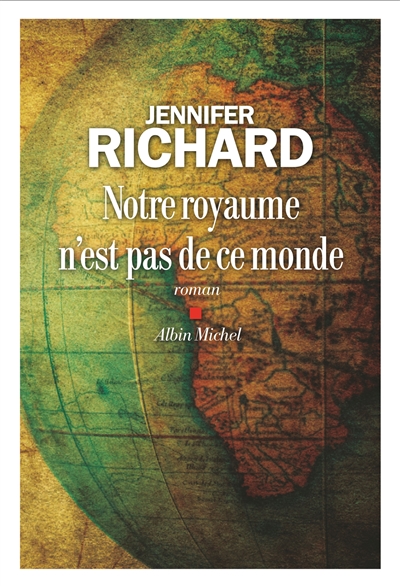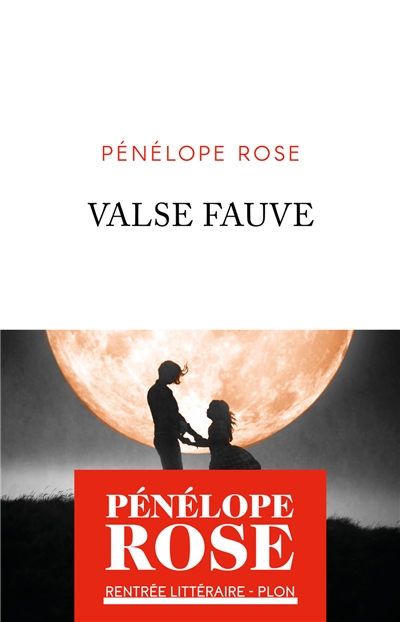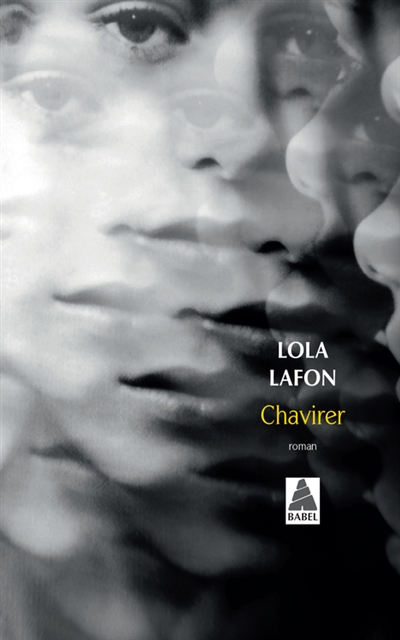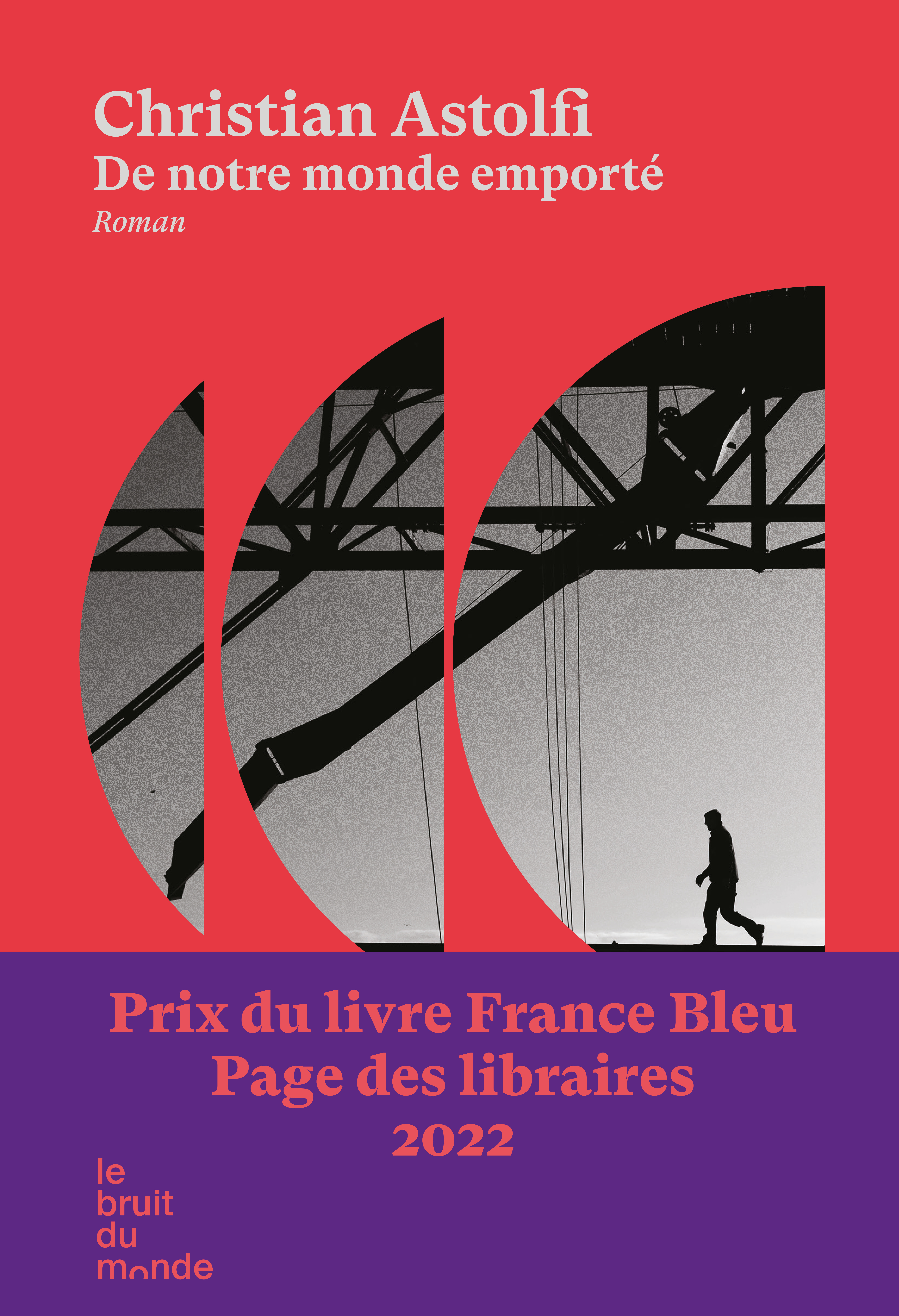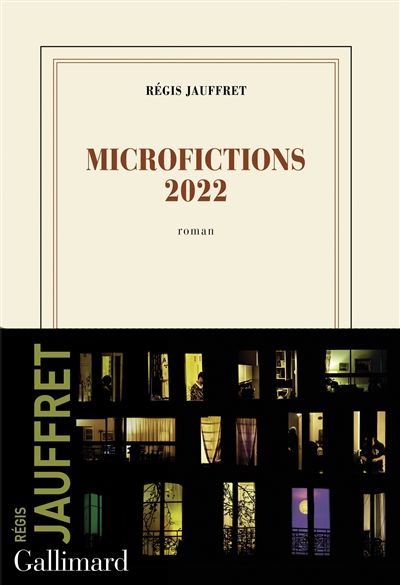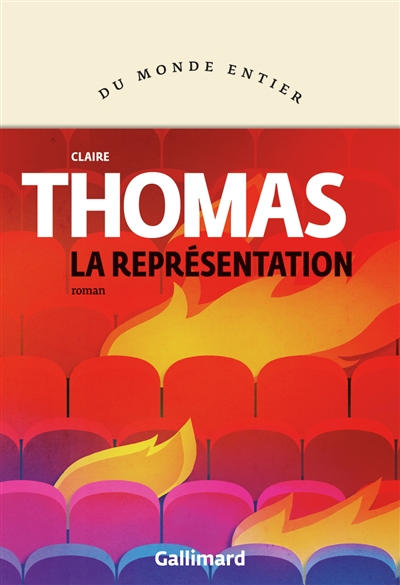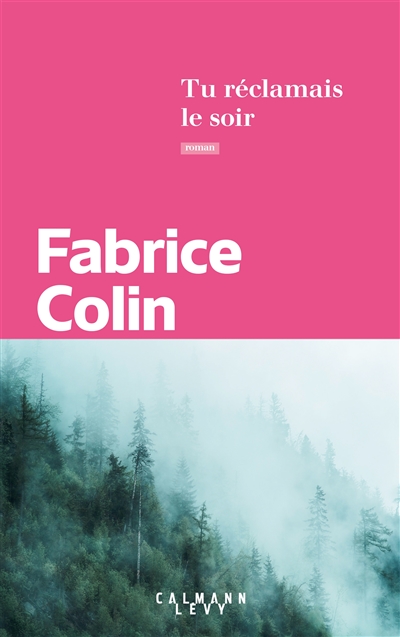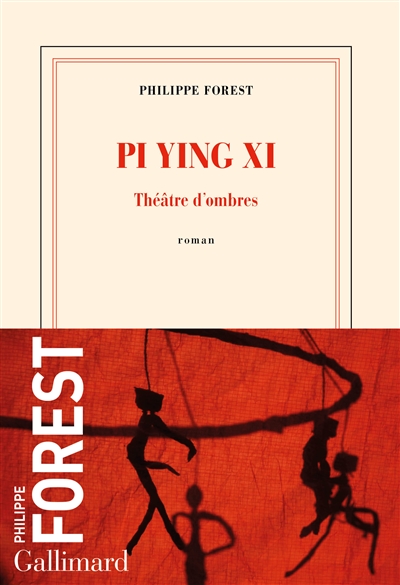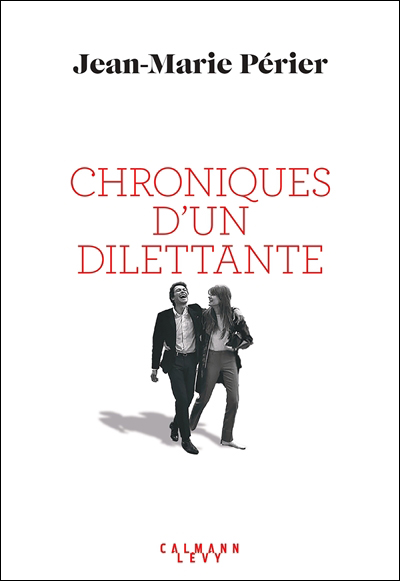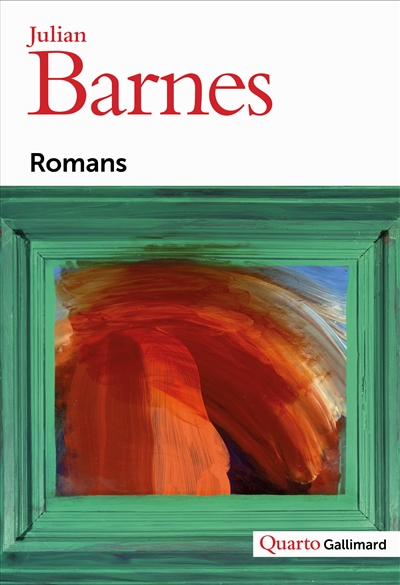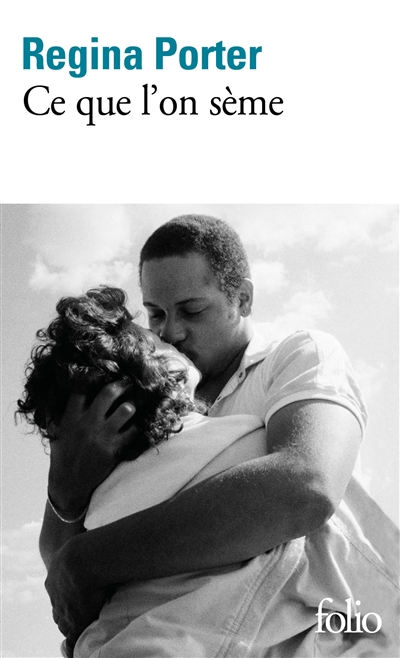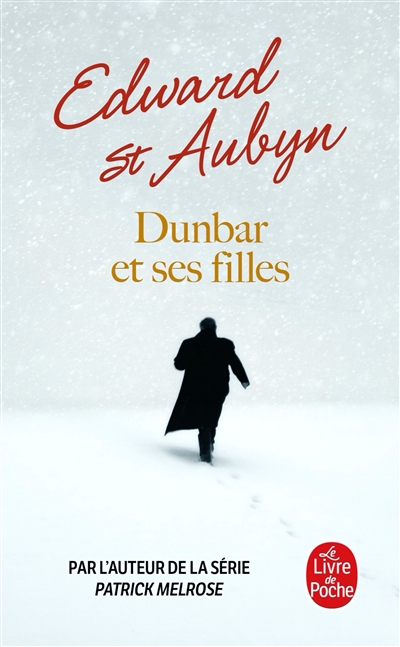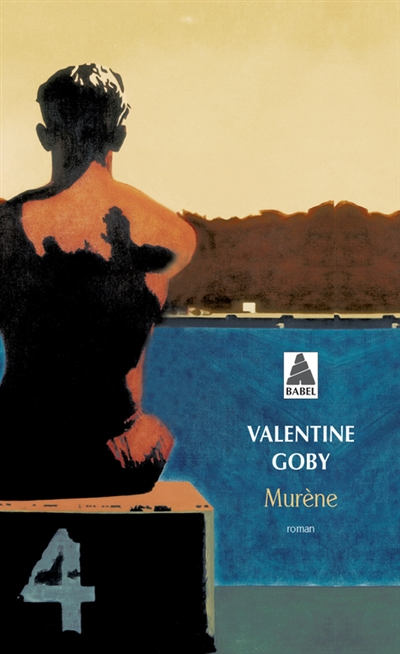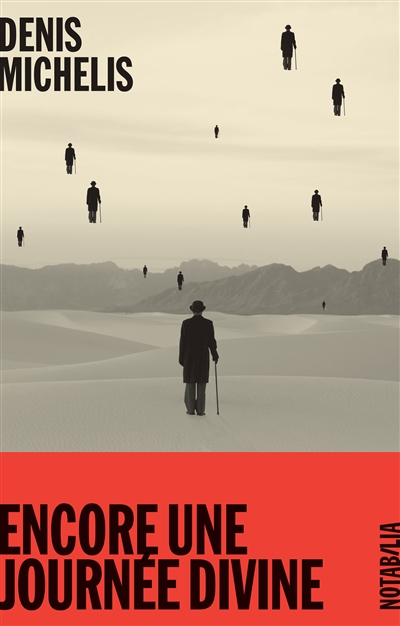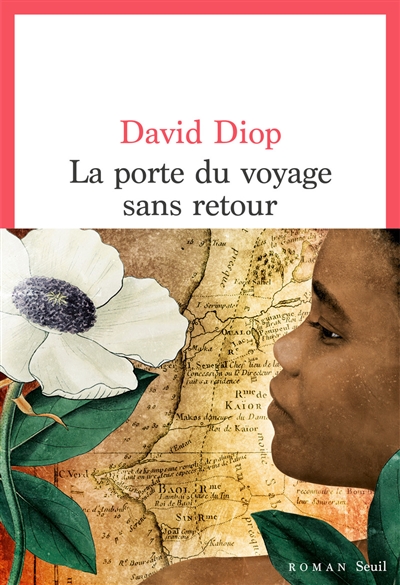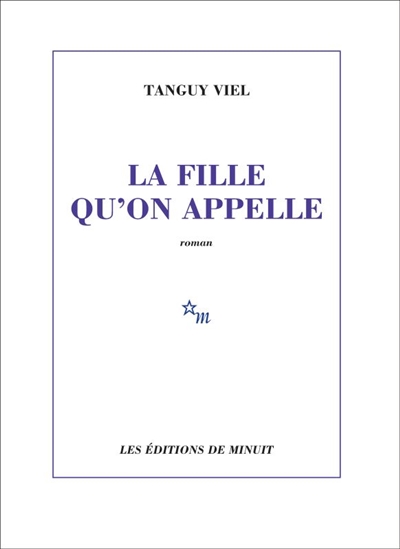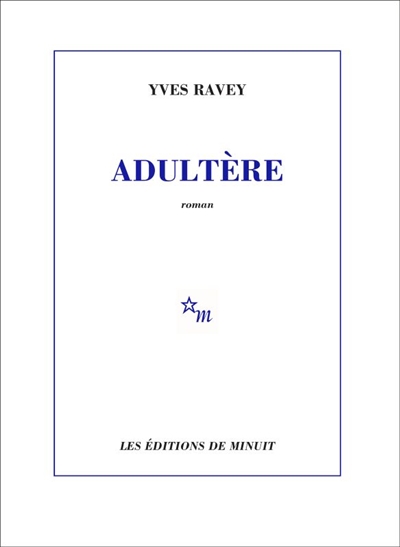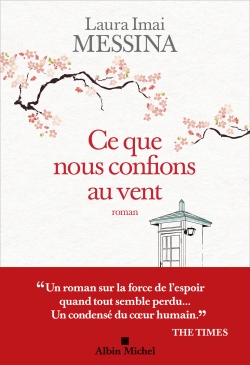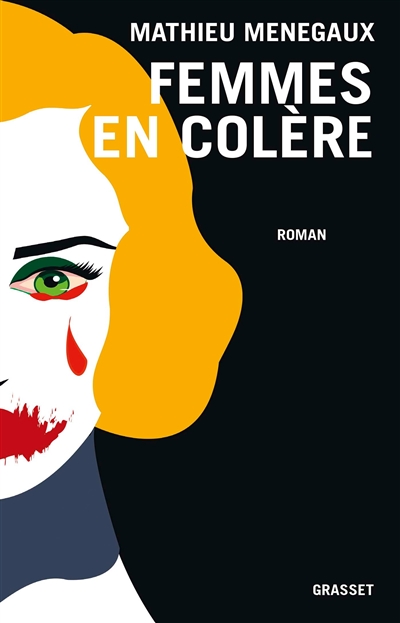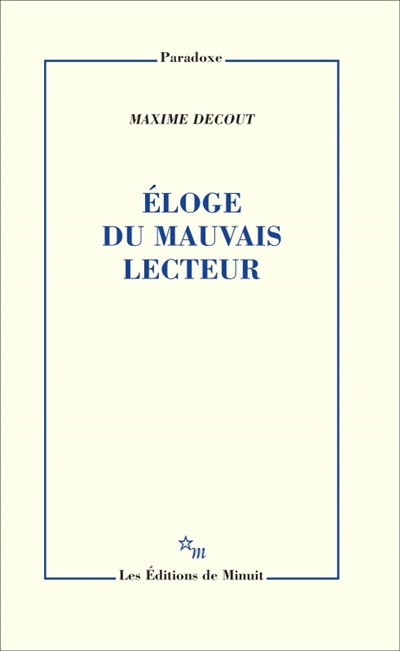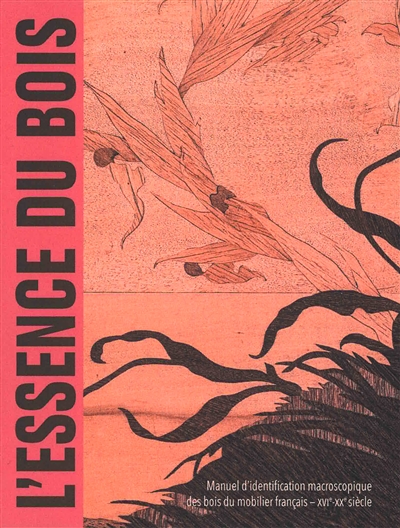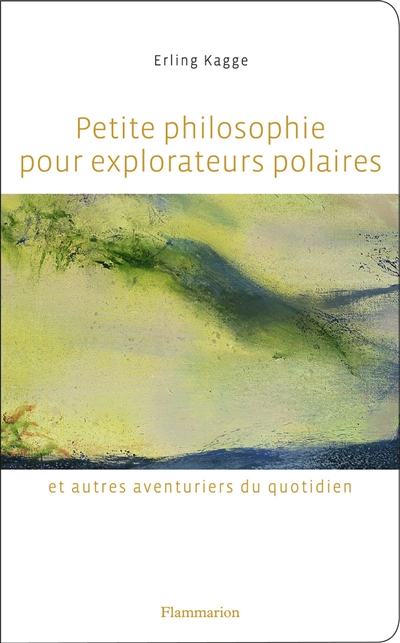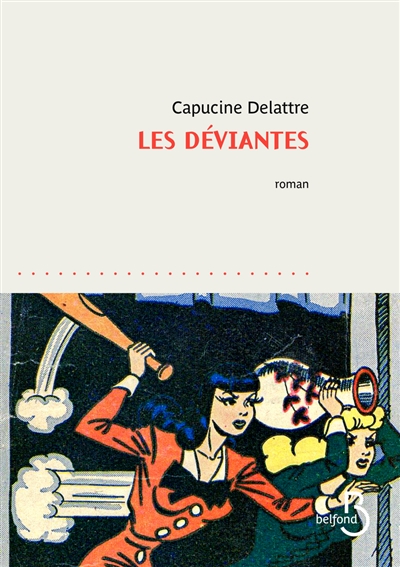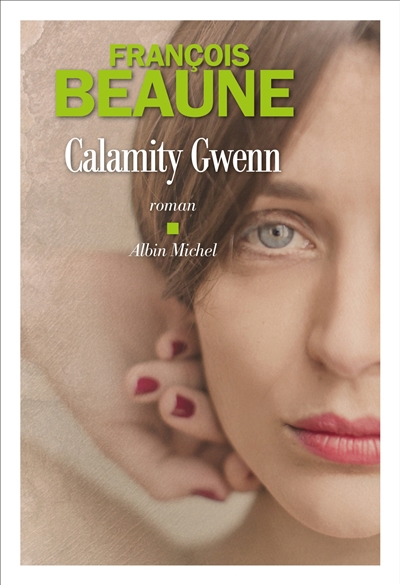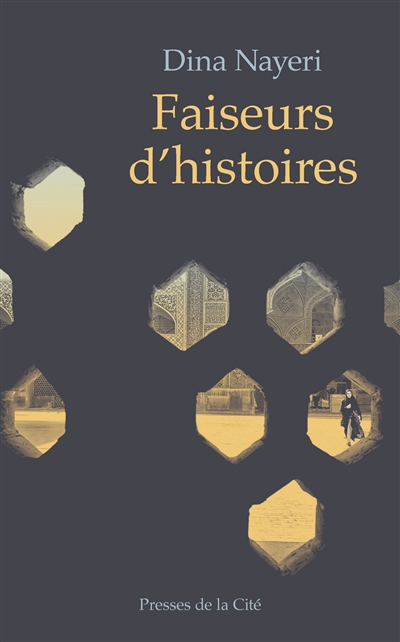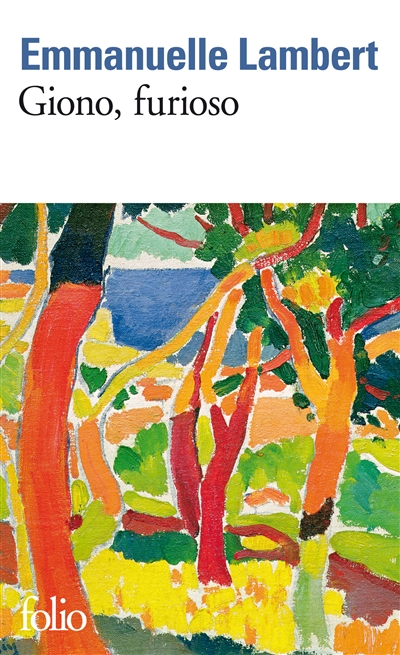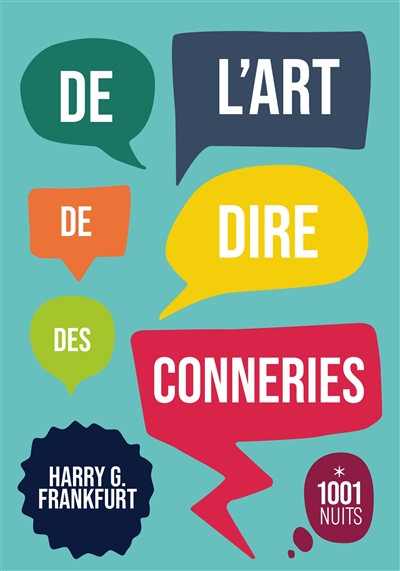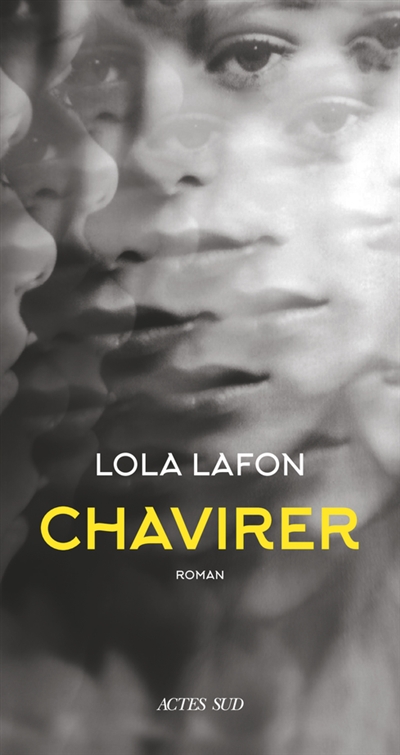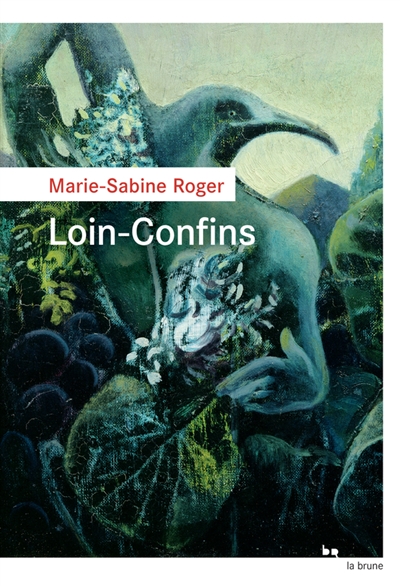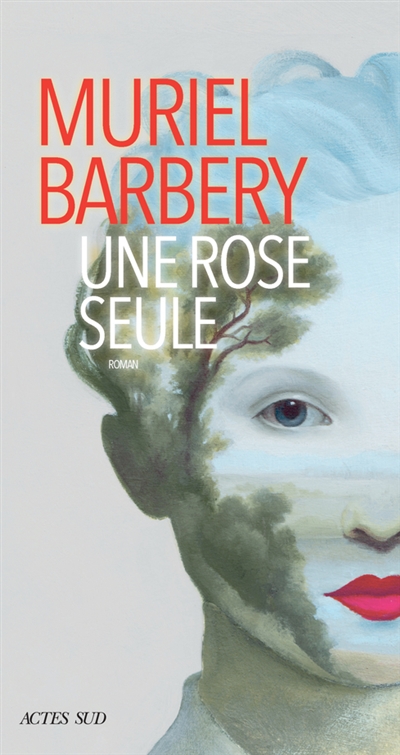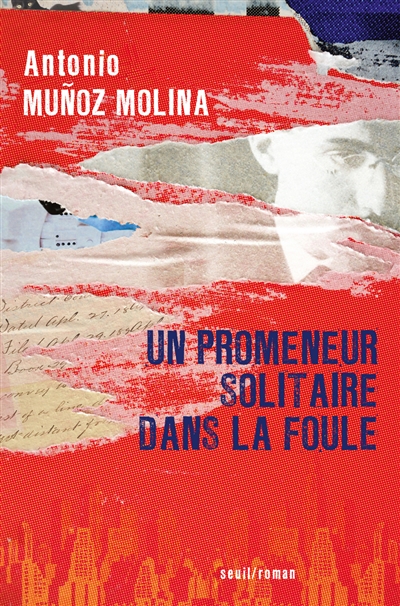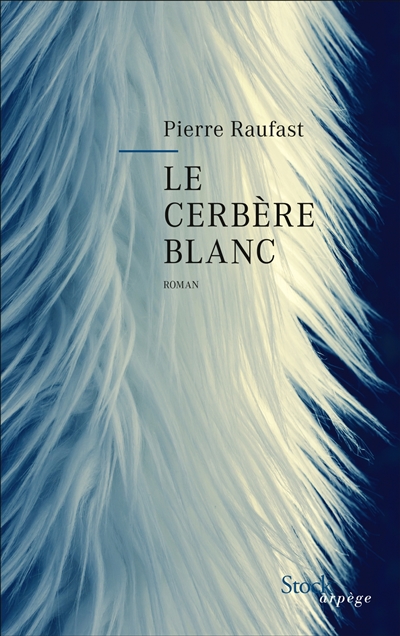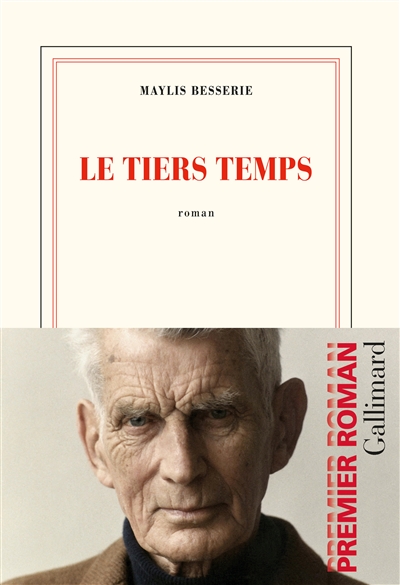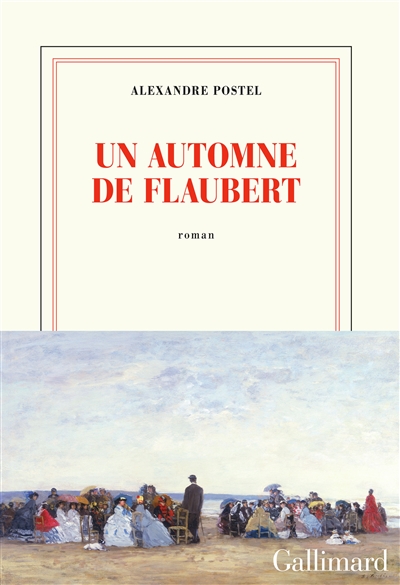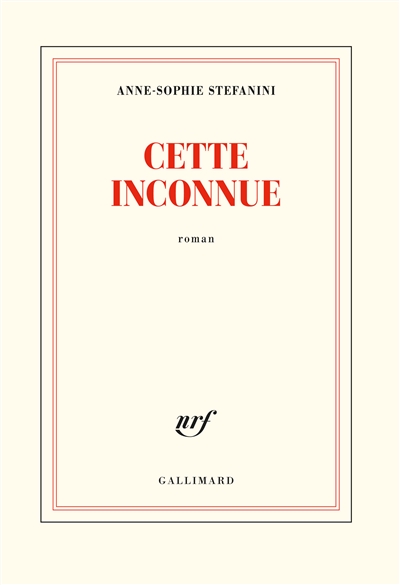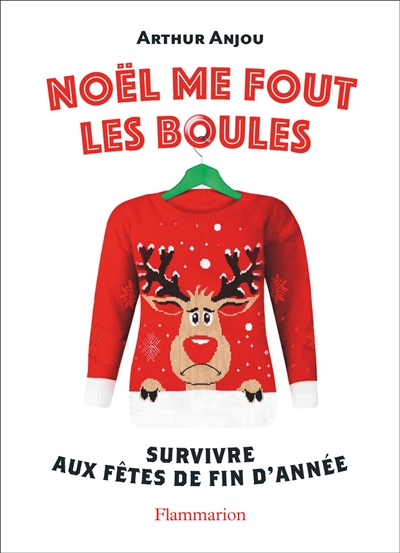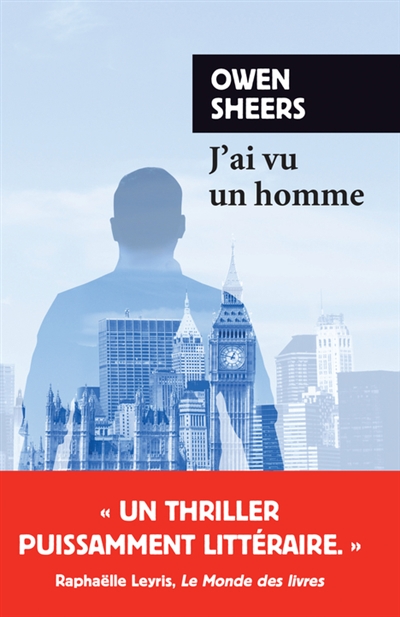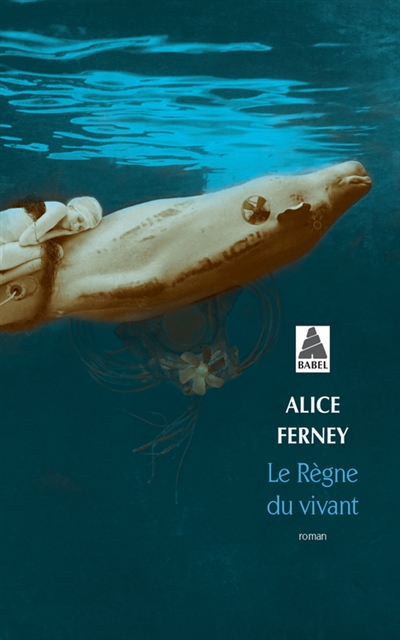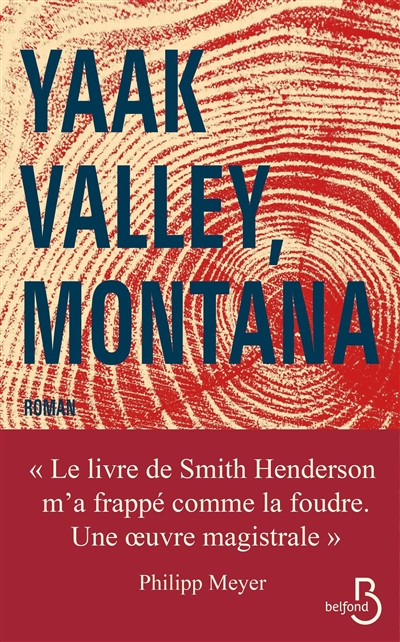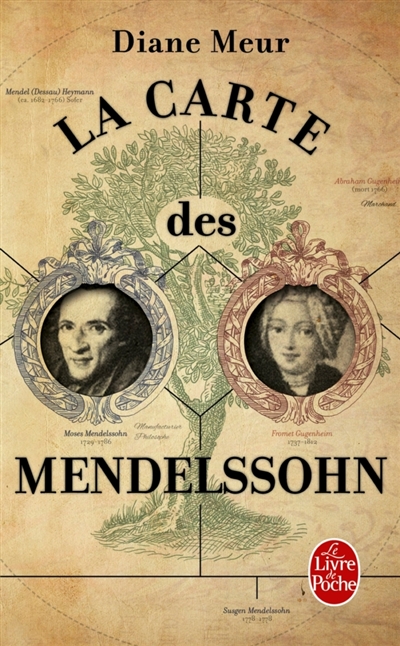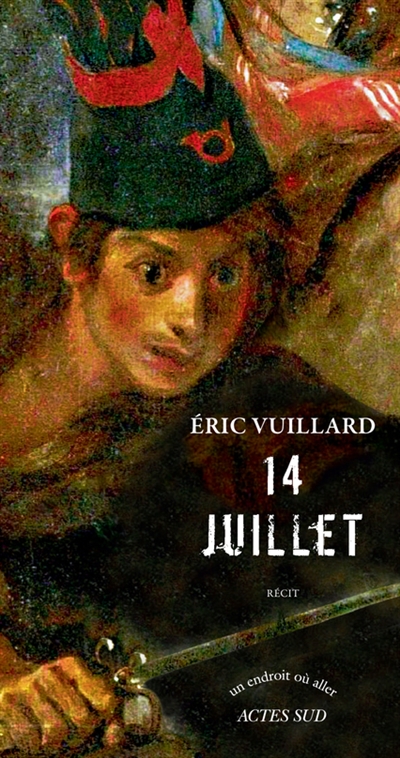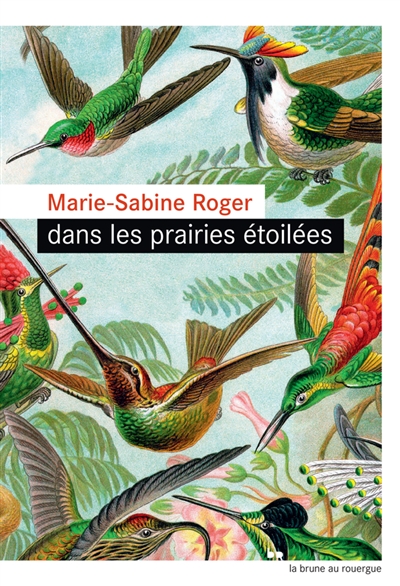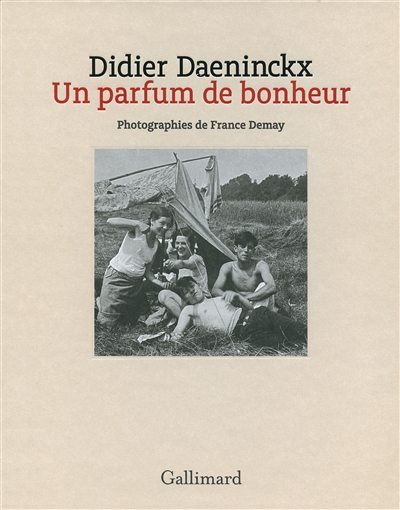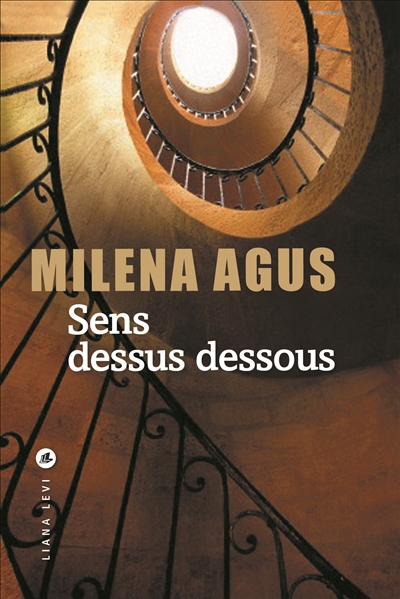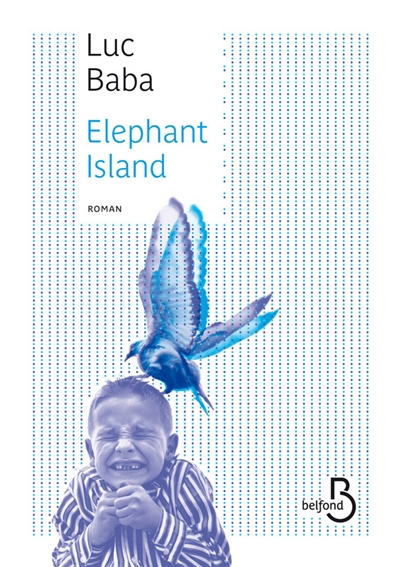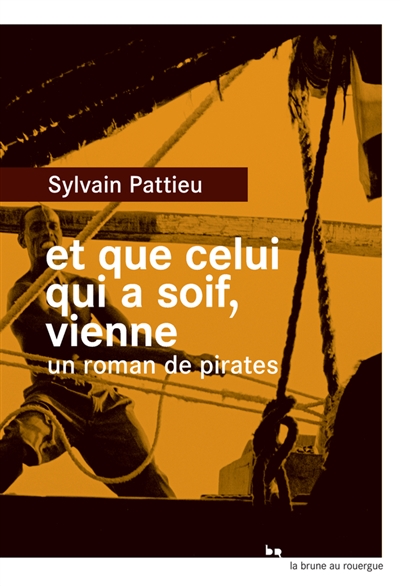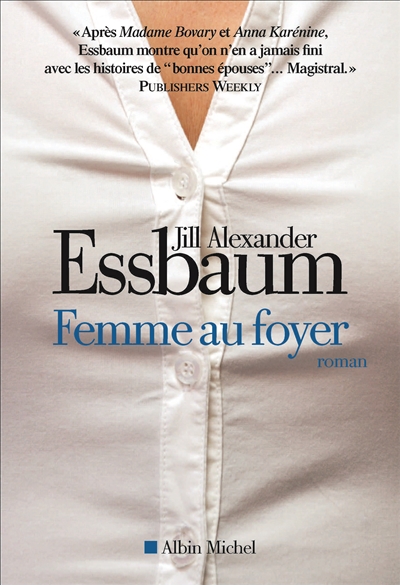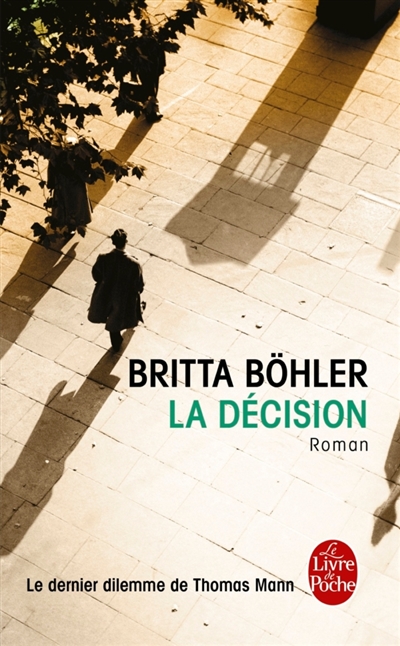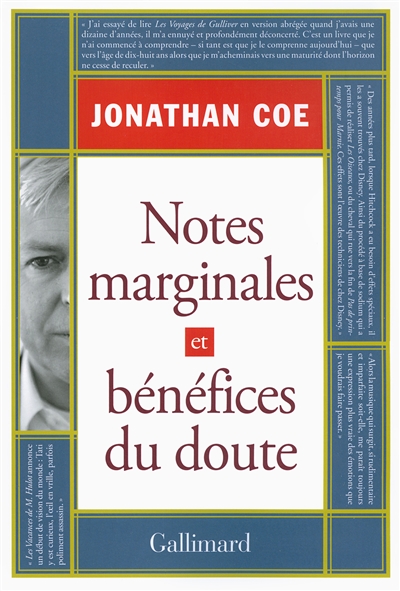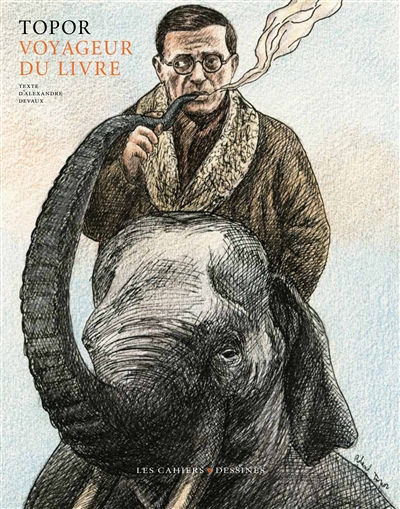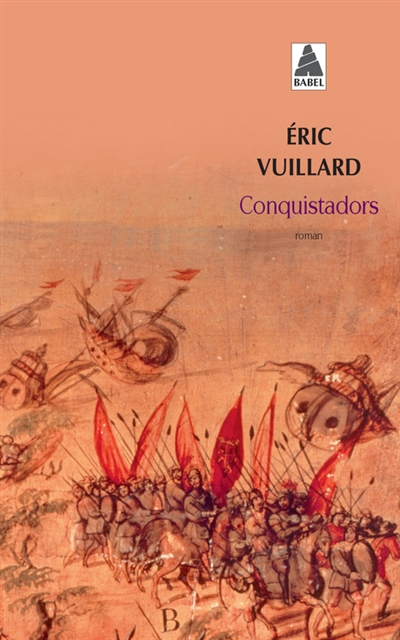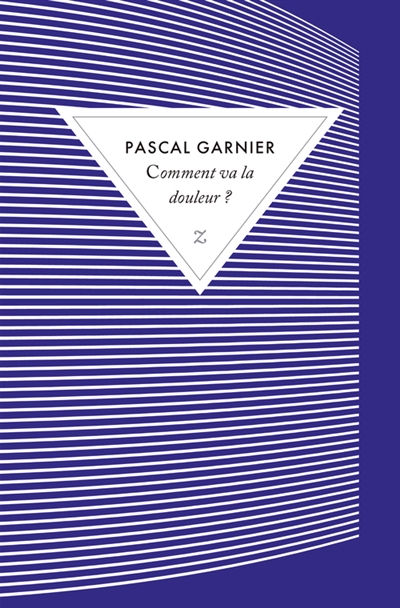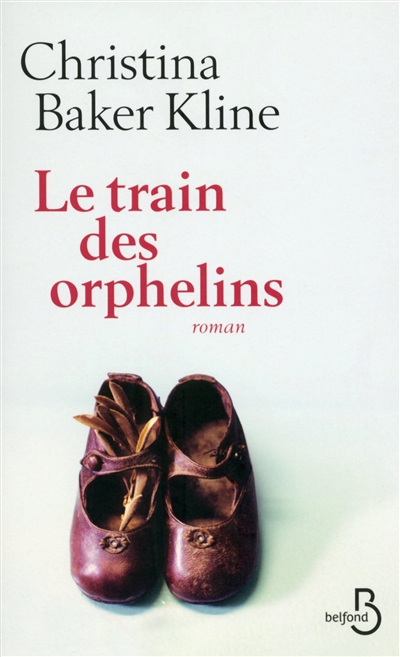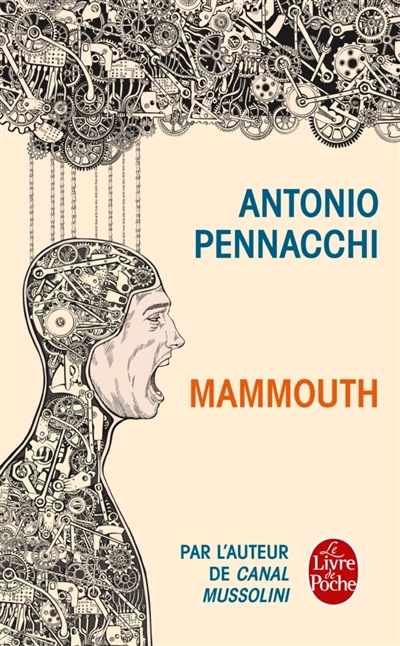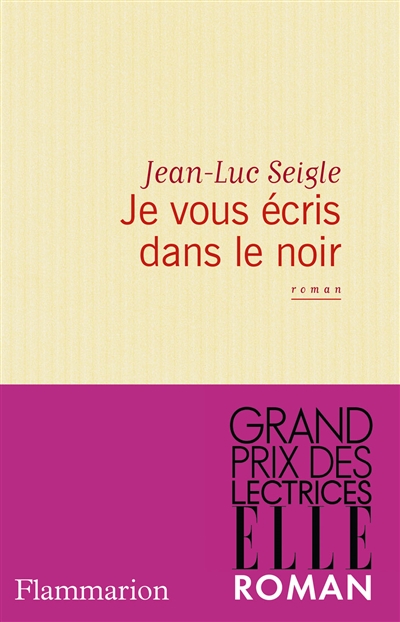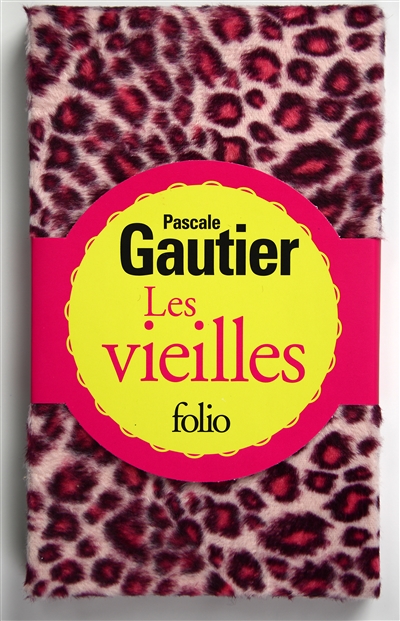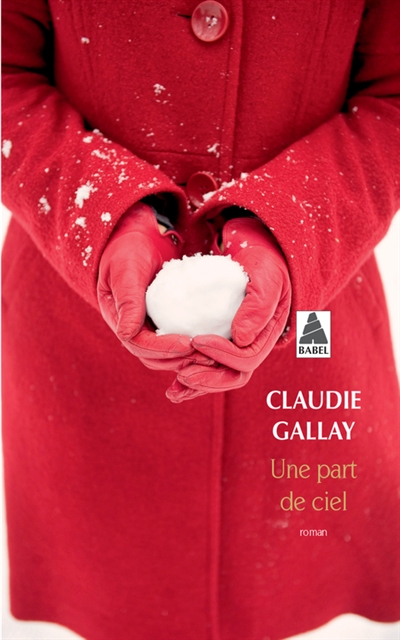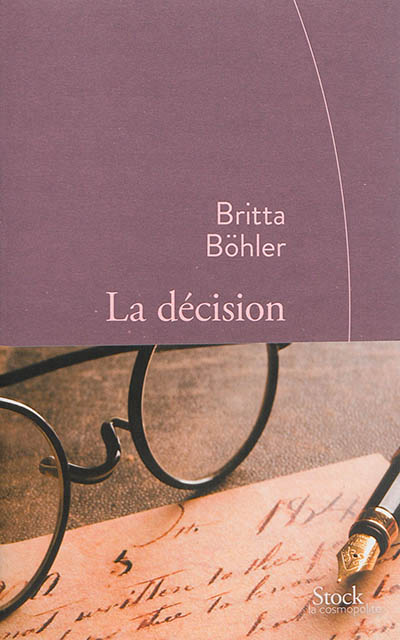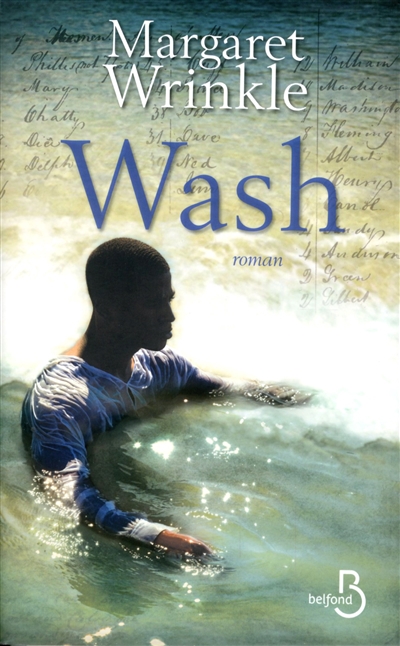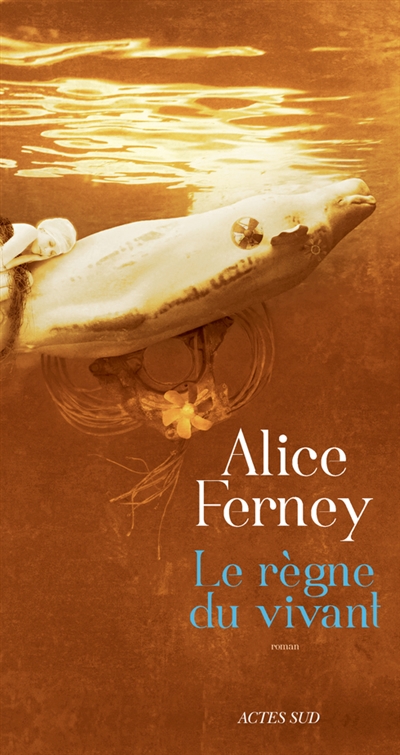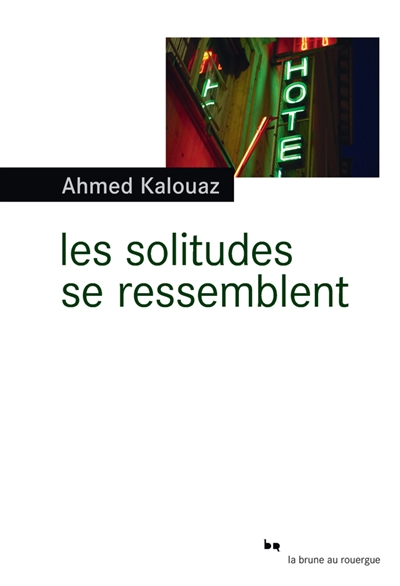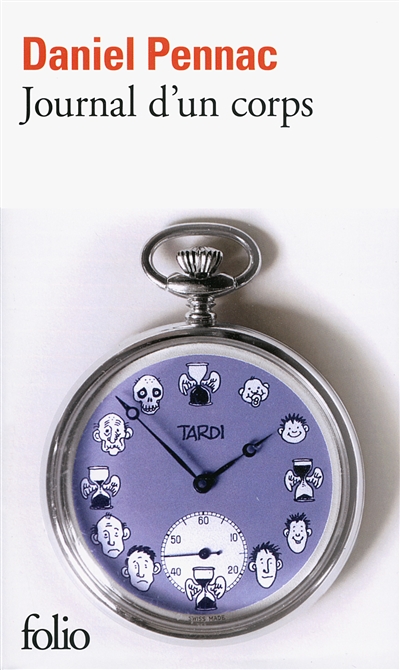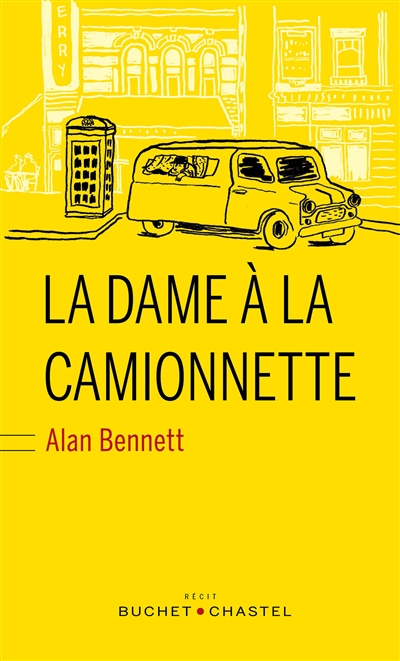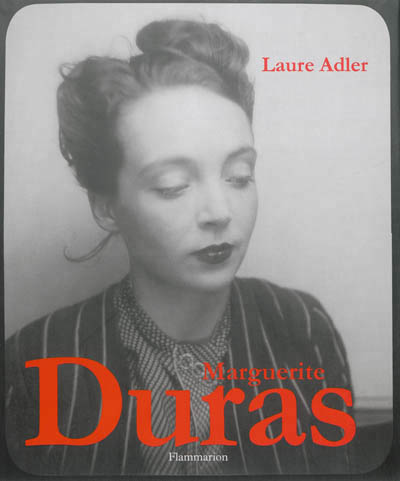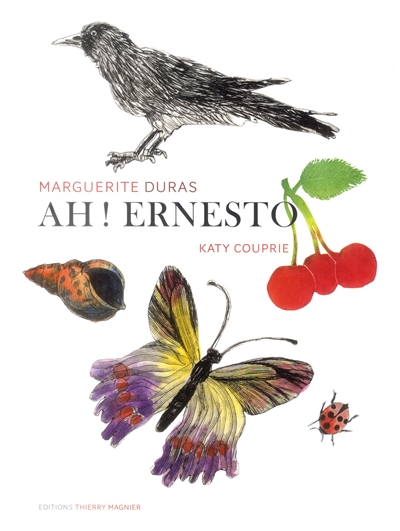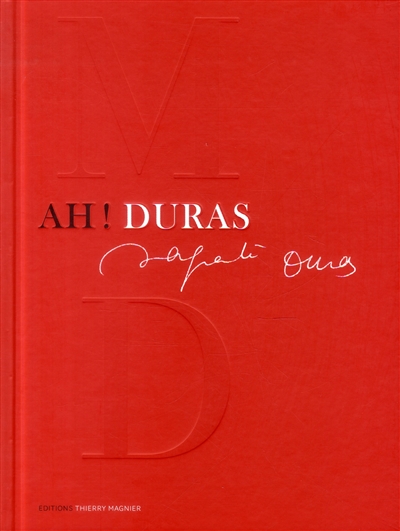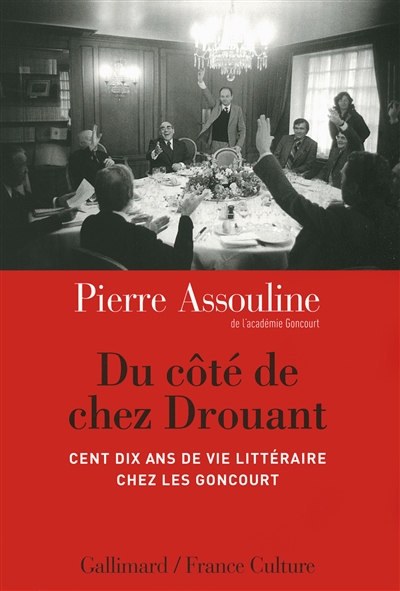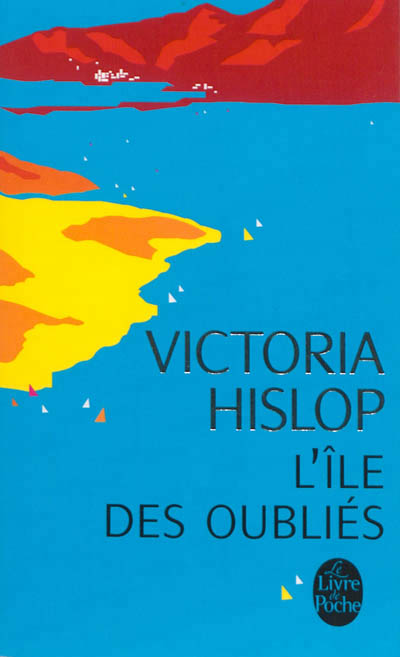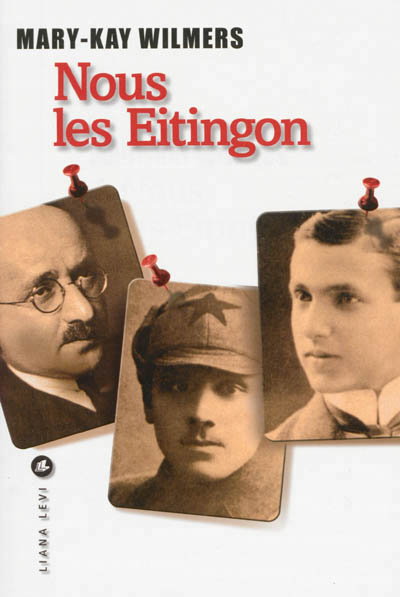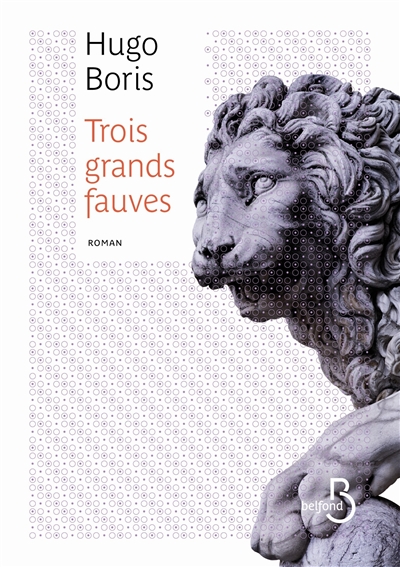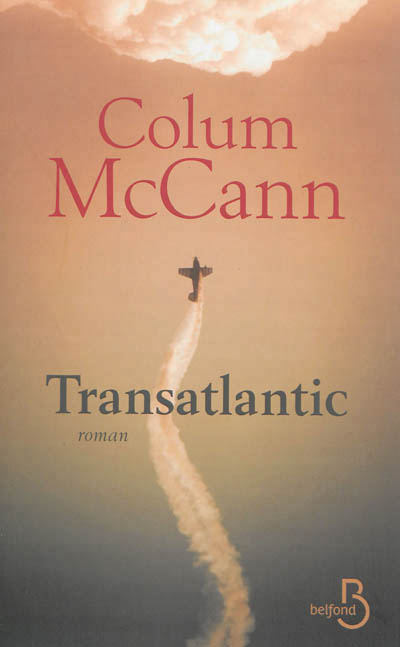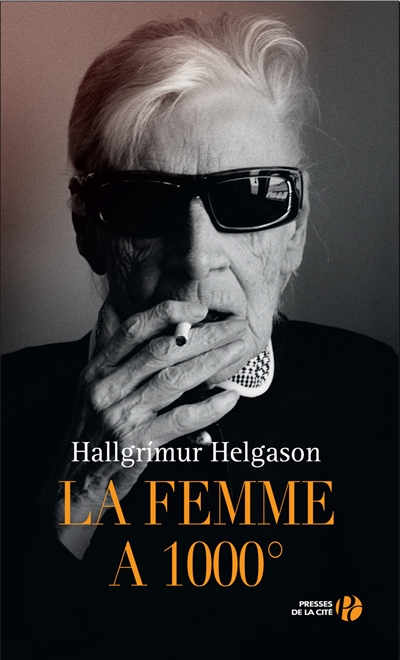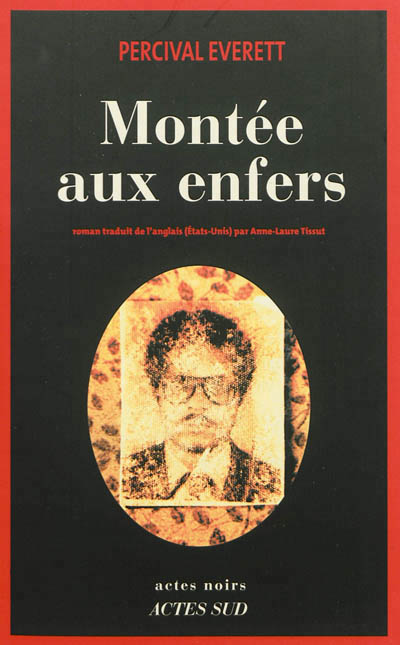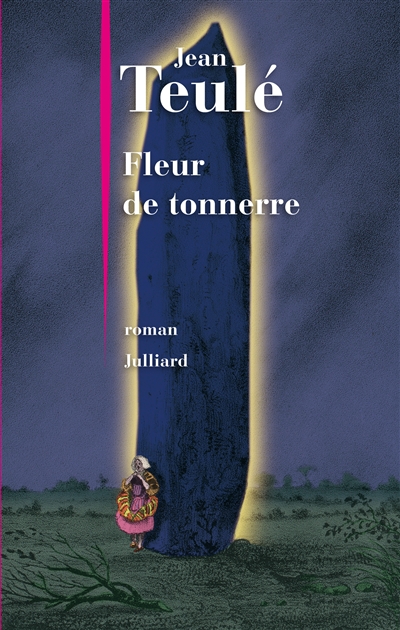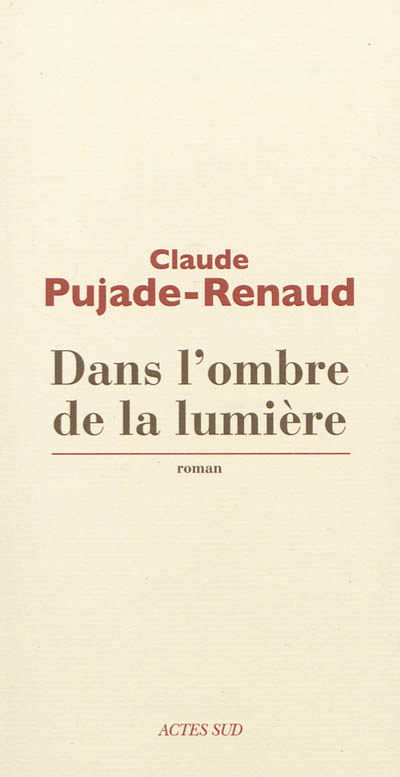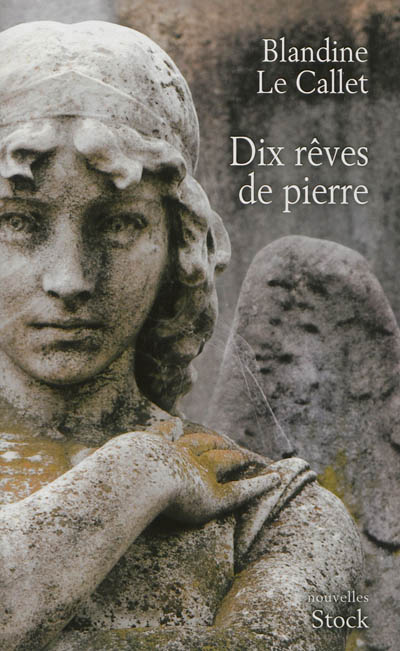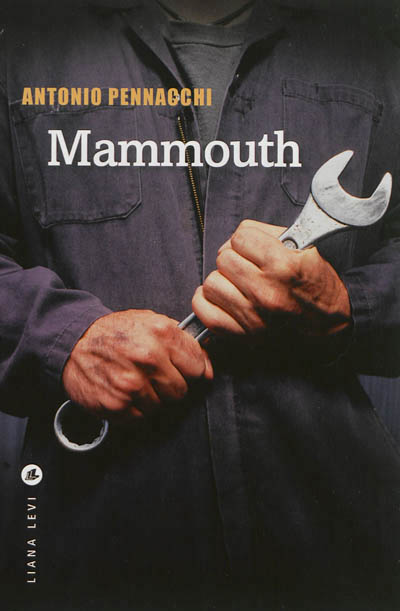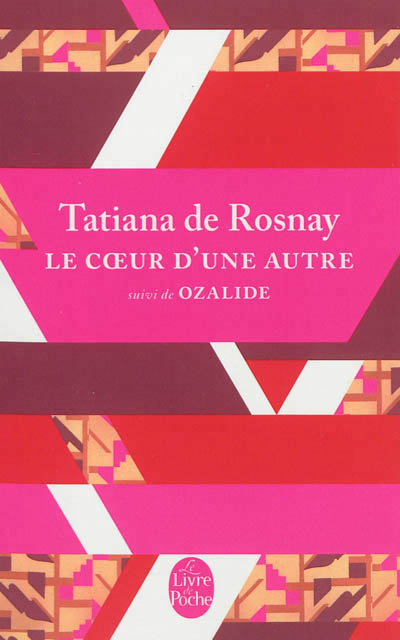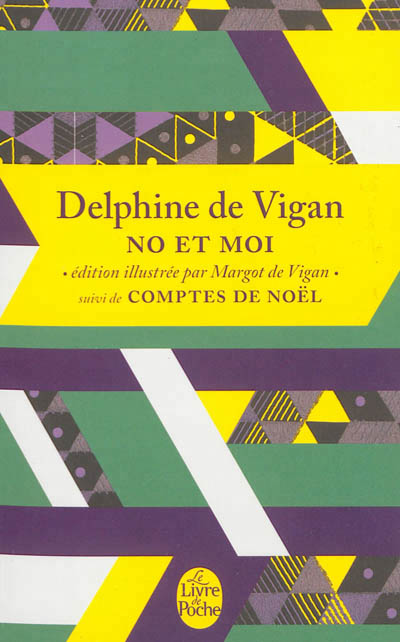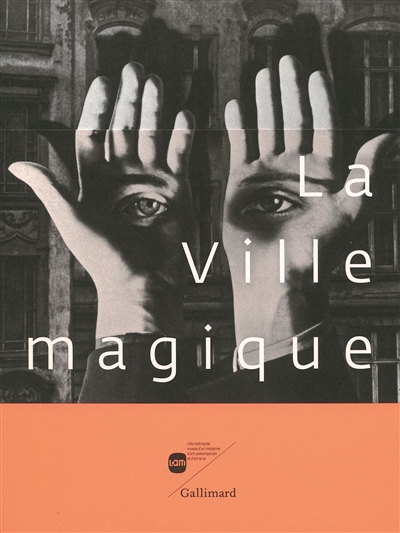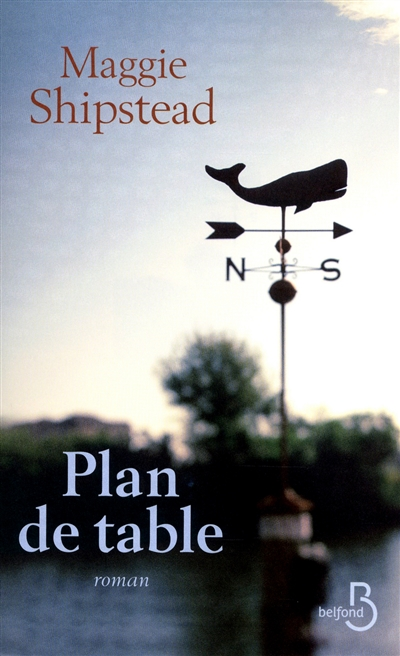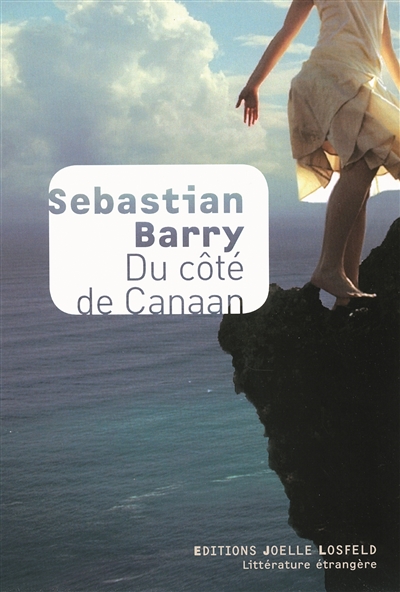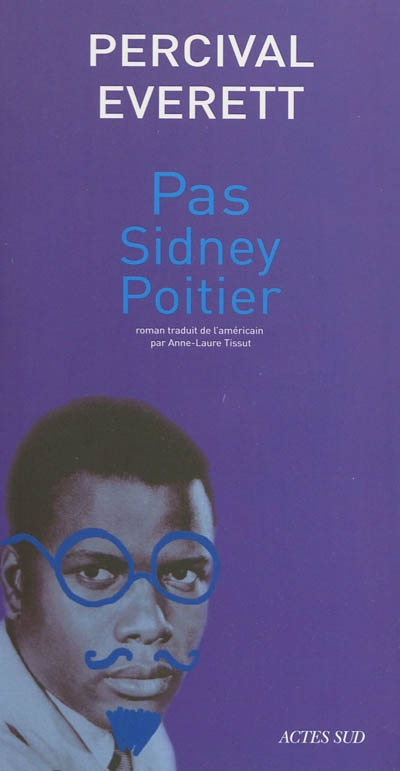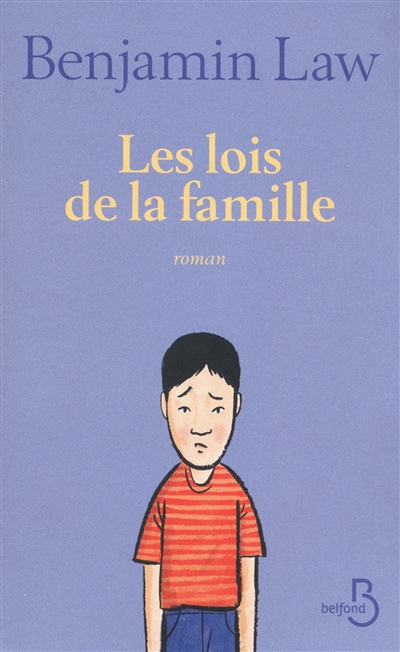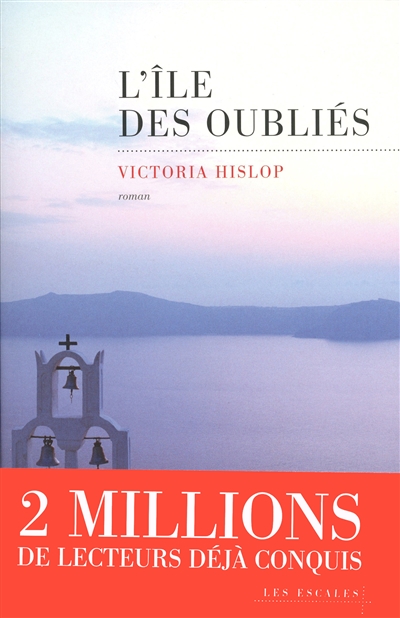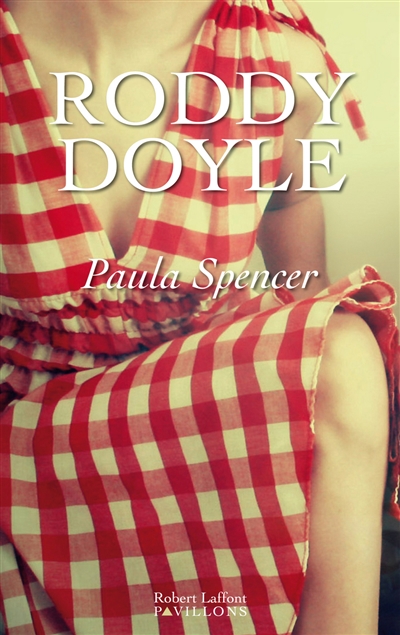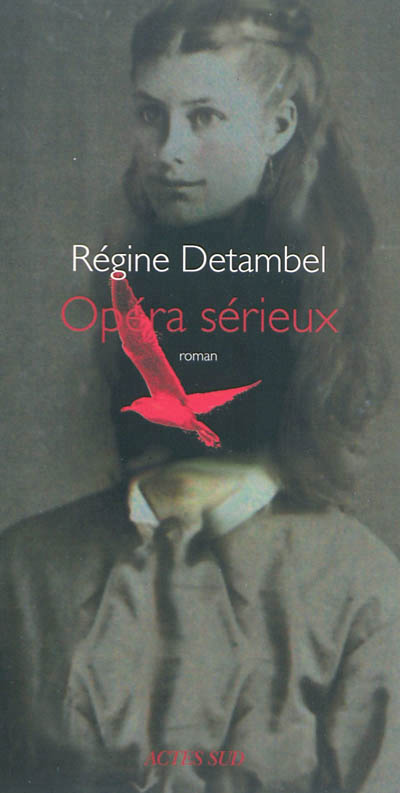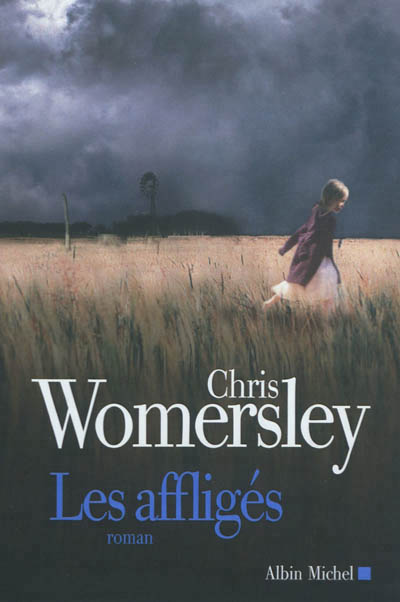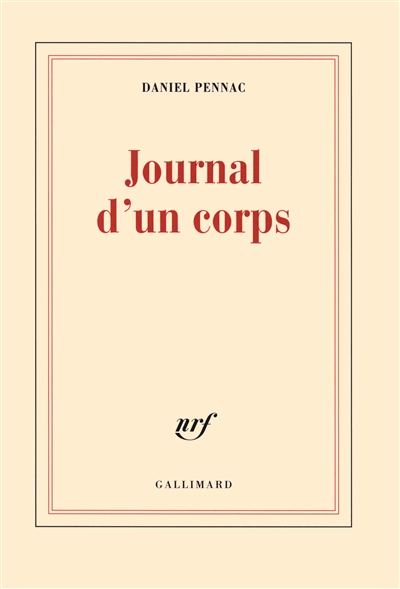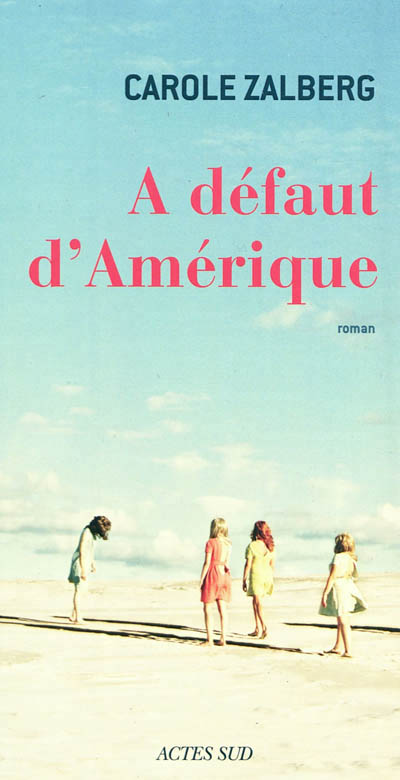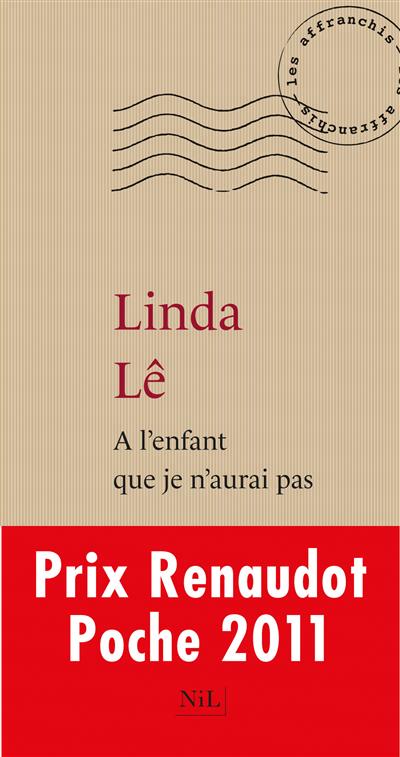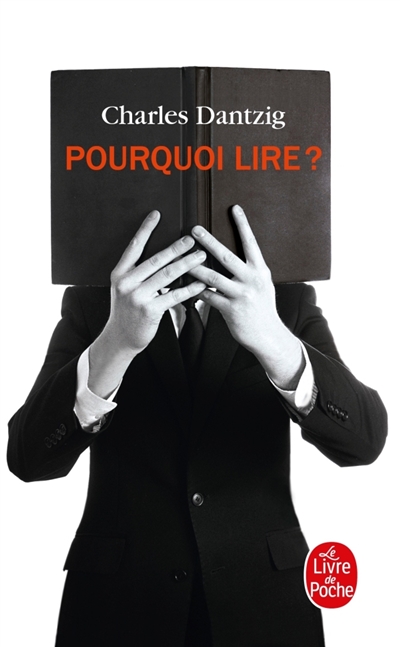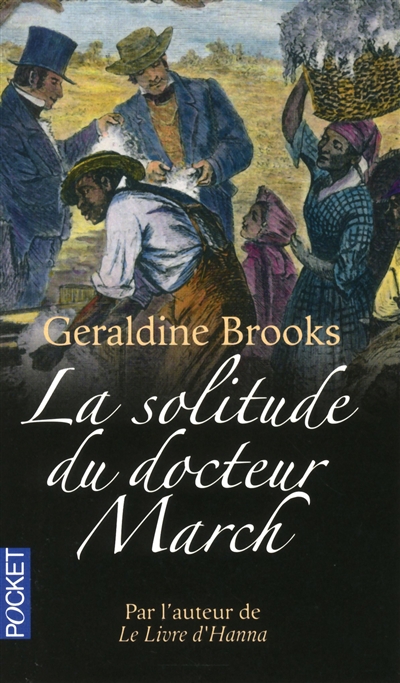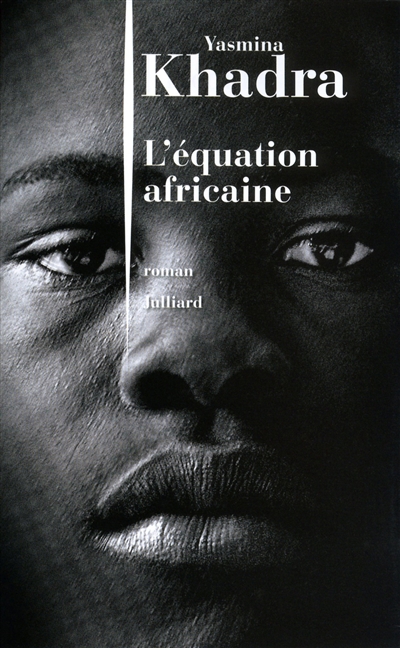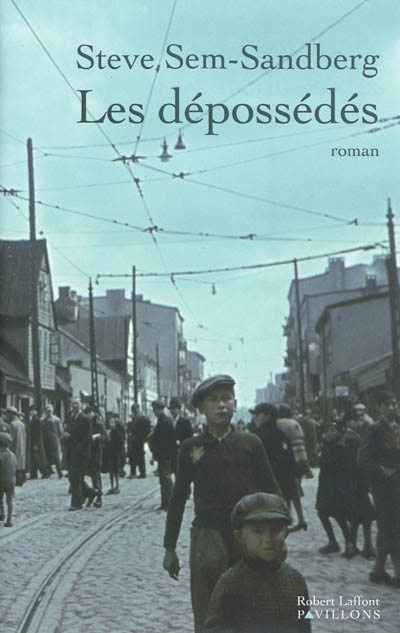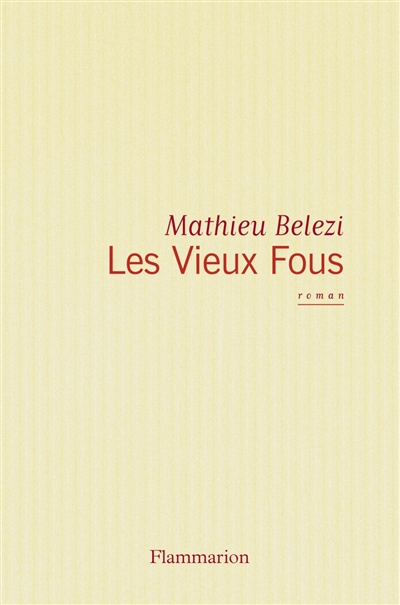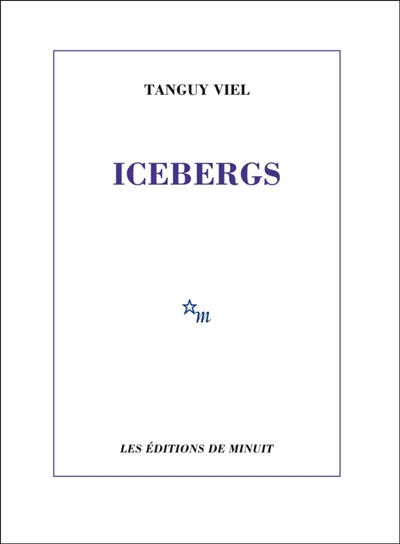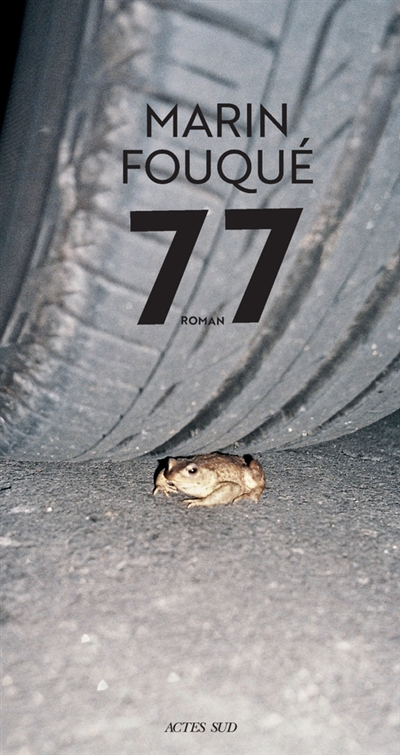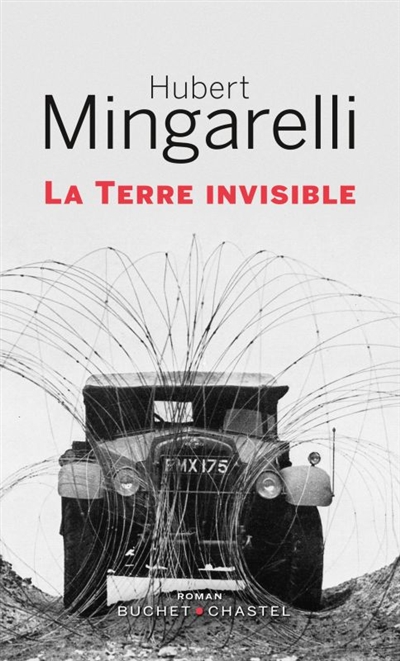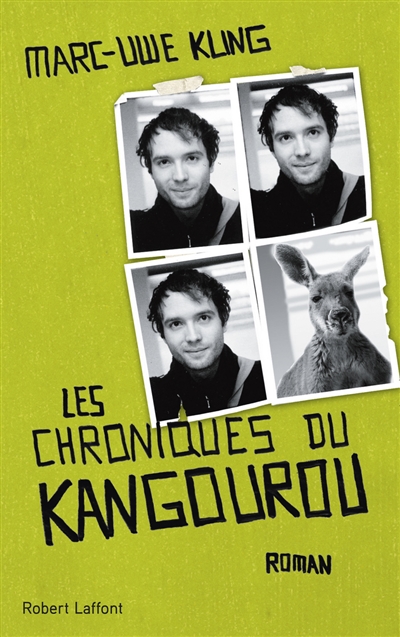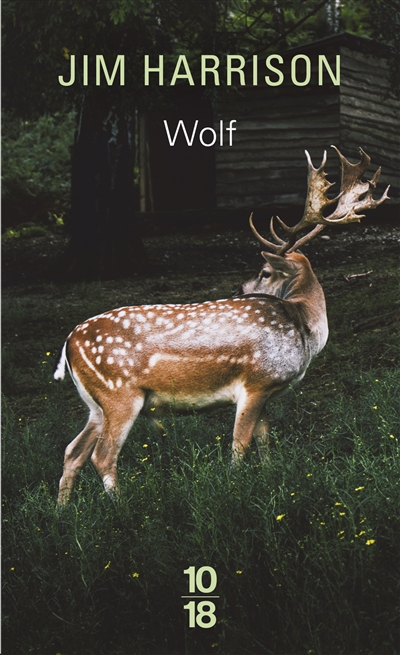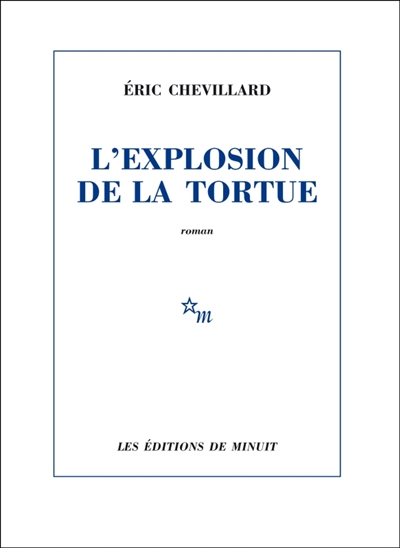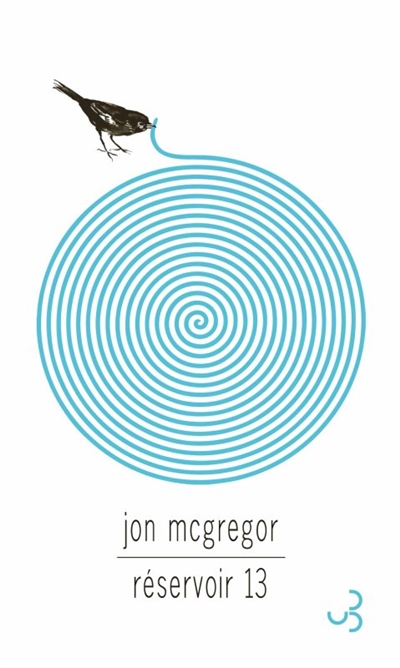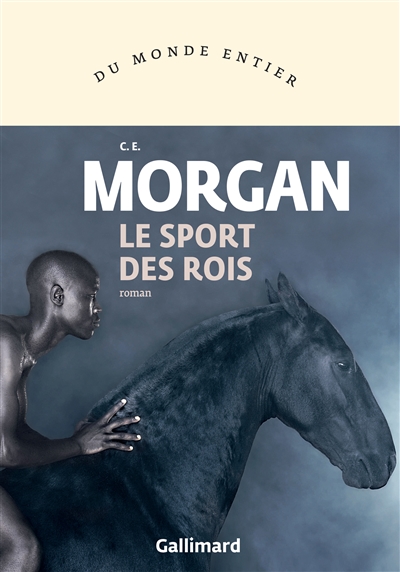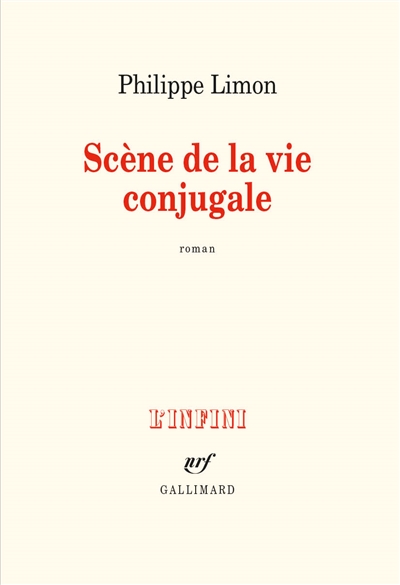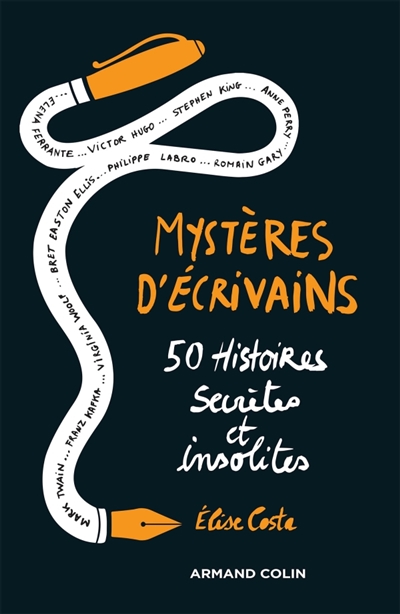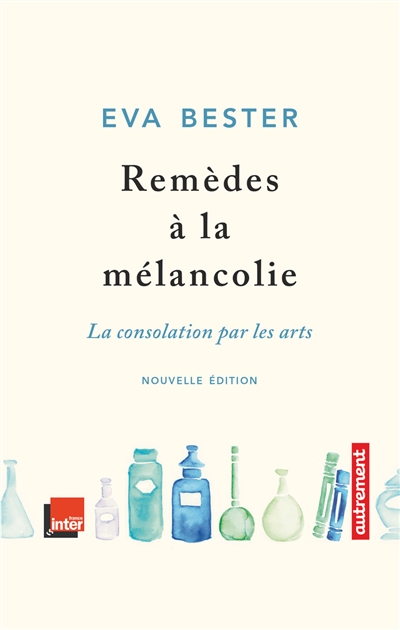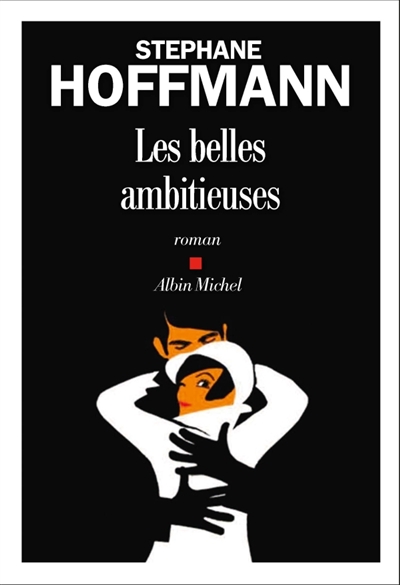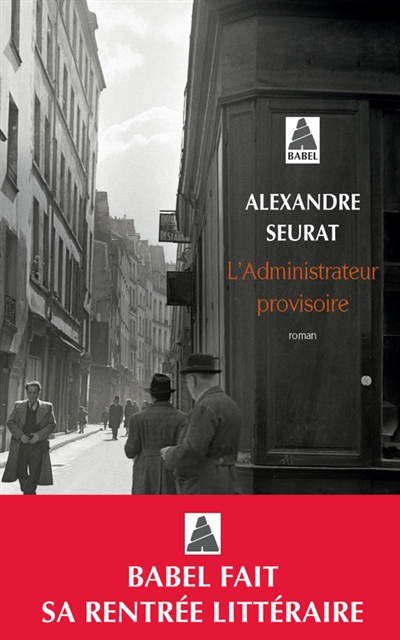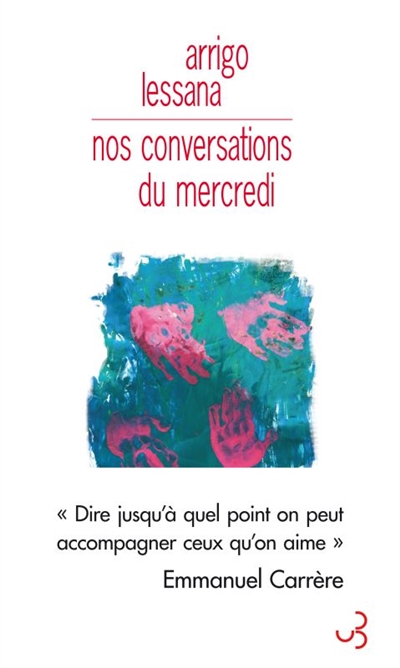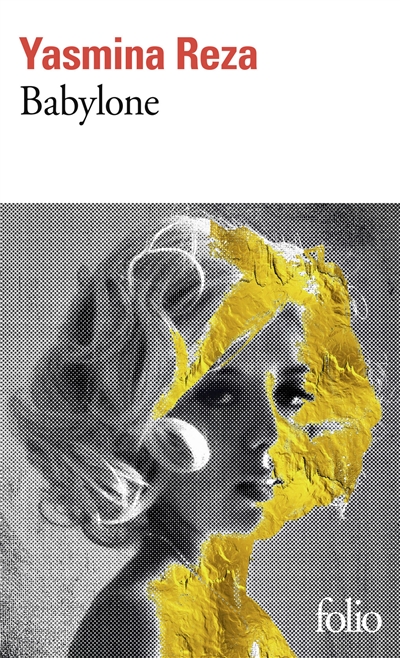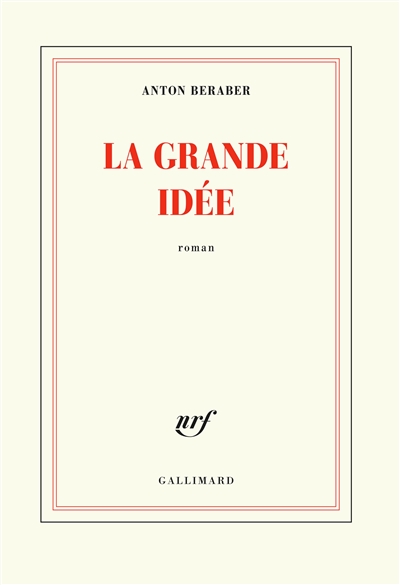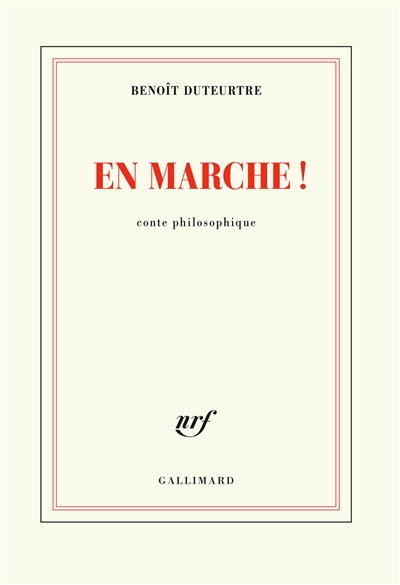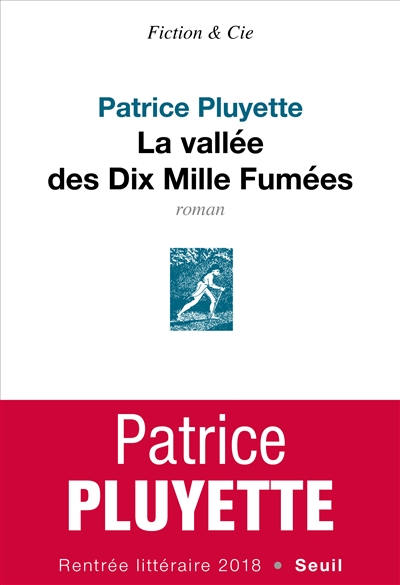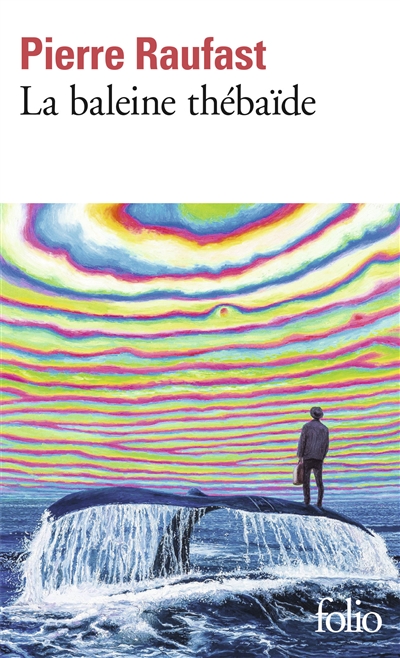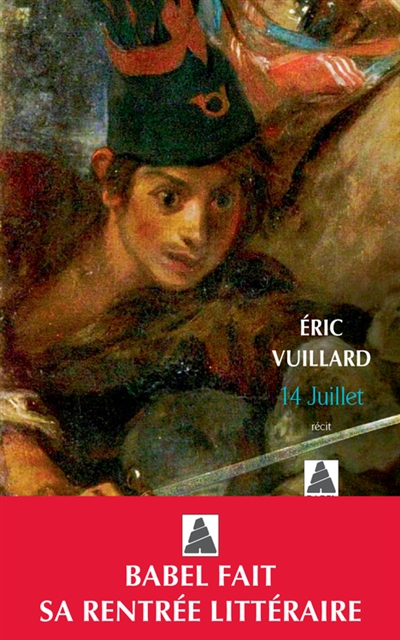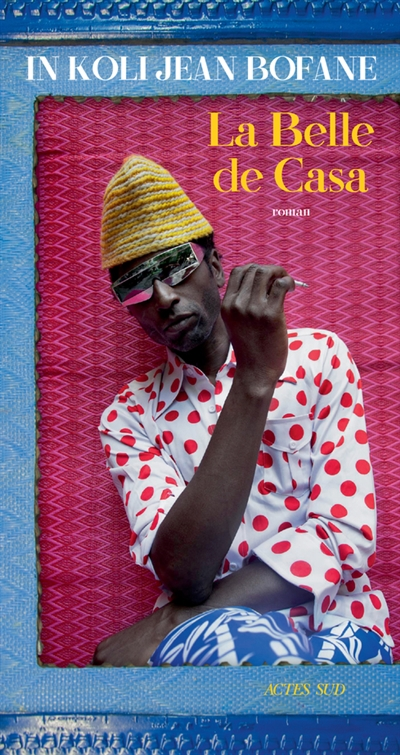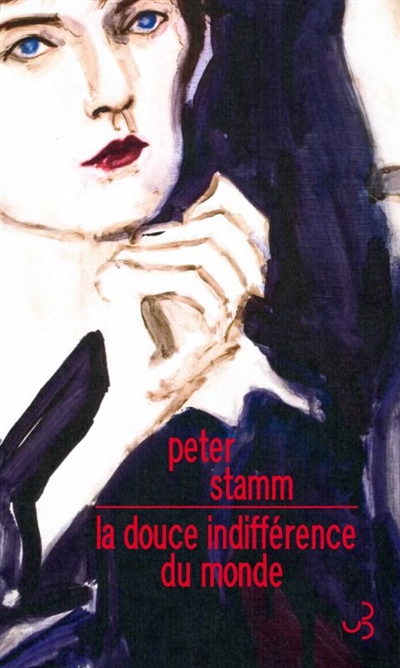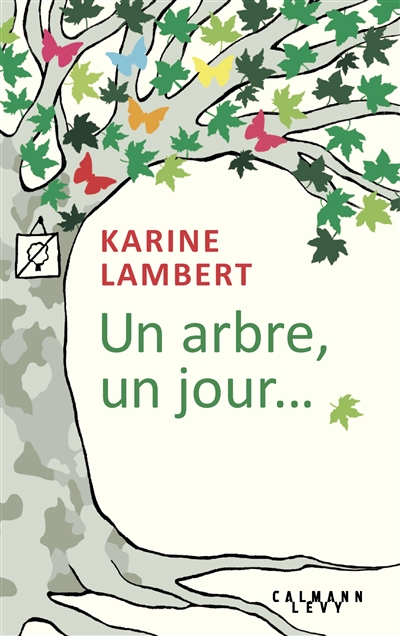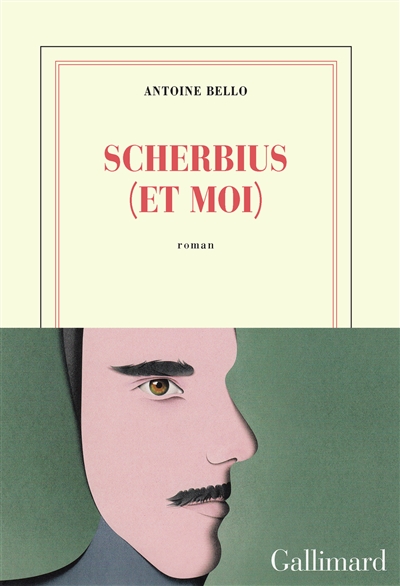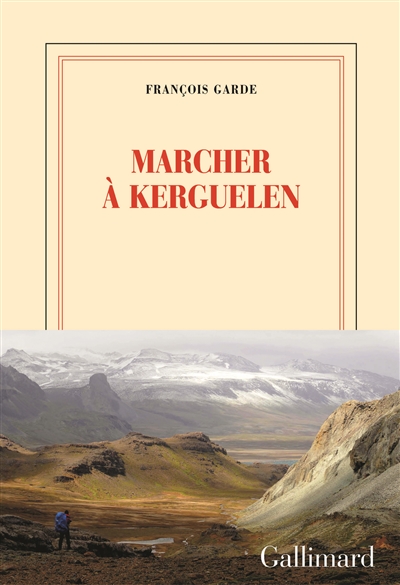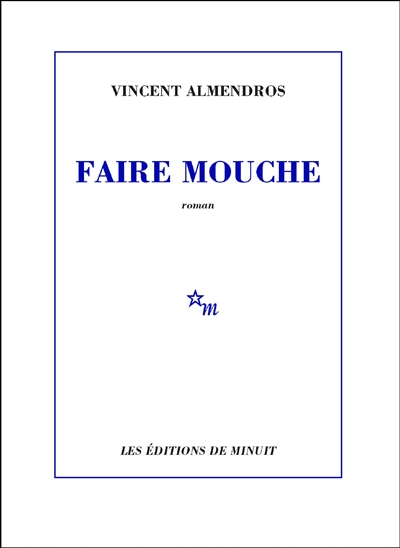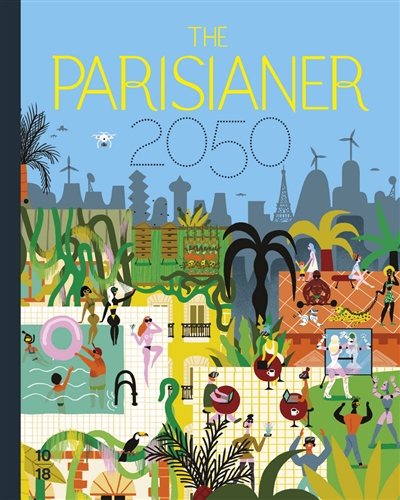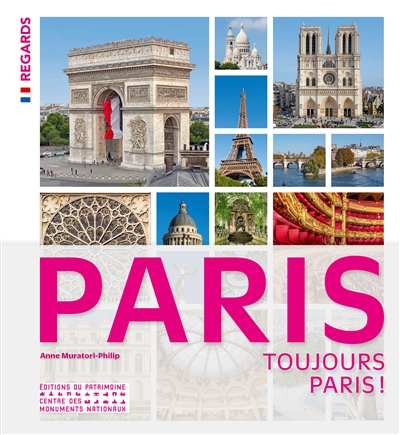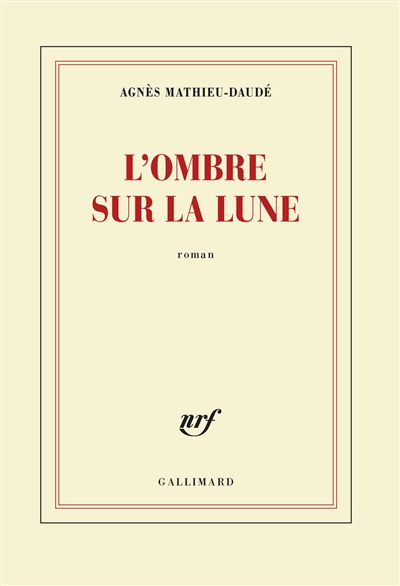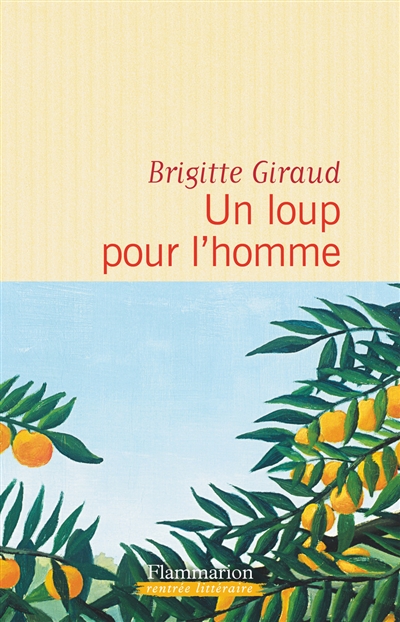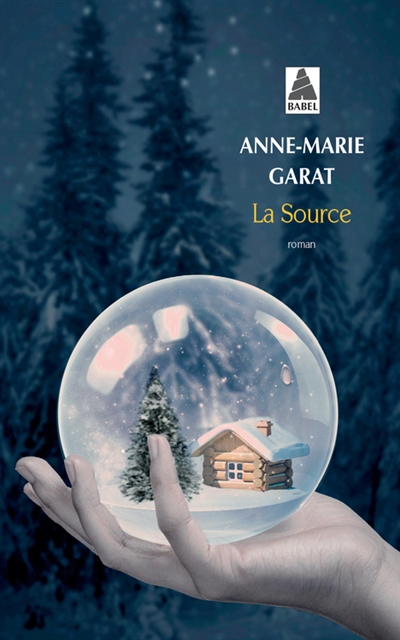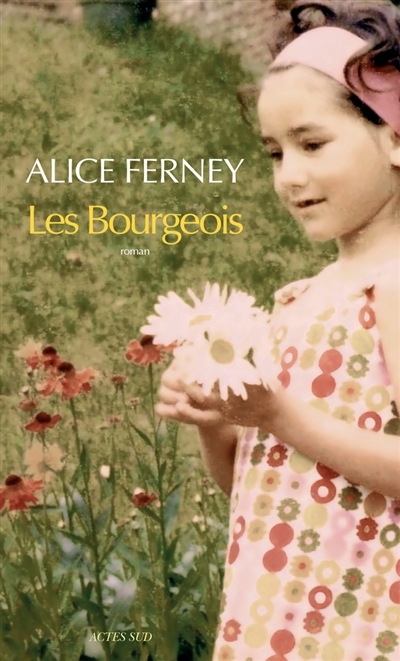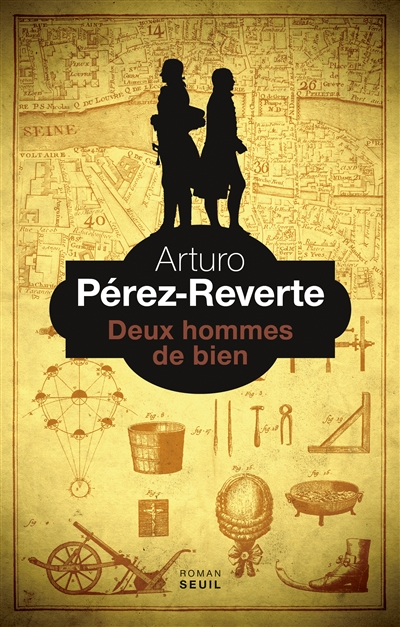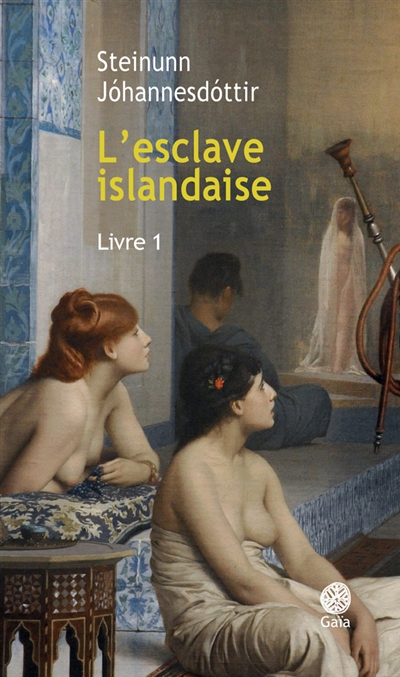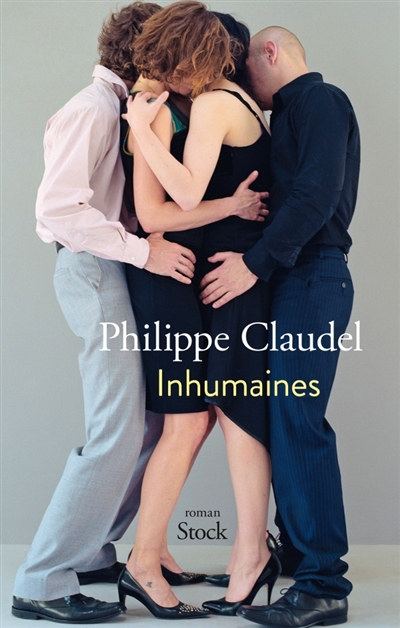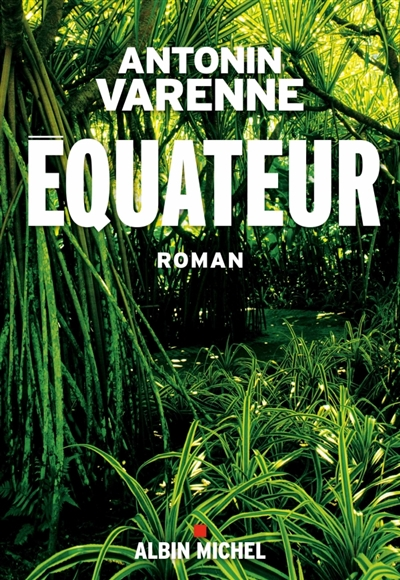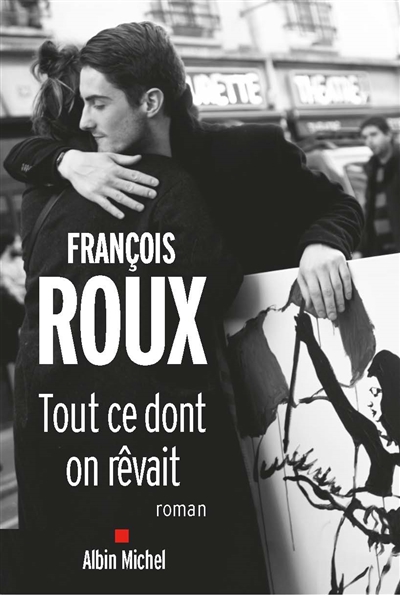Littérature française
Frédérique Martin
Sauf quand on les aime

-
Frédérique Martin
Sauf quand on les aime
Belfond
14/08/2014
224 pages, 18 €
-
Chronique de
Emmanuelle George
Librairie Gwalarn (Lannion) - ❤ Lu et conseillé par 11 libraire(s)

✒ Emmanuelle George
(Librairie Gwalarn, Lannion)
Voici un roman qui chante l’amitié et l’amour d’une bande de jeunes amis colocataires. Dans une société où la précarité, la violence, l’indifférence peuvent mener au pire, le respect, la tendresse et la solidarité qu’ils s’évertuent à préserver auront le dernier mot. Ils sont ensemble, c’est tout !
Frédérique Martin compose une touchante histoire d’amitié entre quatre jeunes colocataires. Assurément un hymne à la tendresse ordinaire et la solidarité improvisée, soutenu par une juste mélodie stylistique que rythment l’humour et l’émotion. Déjà malmenés par la vie, ses personnages puisent au quotidien, dans l’amitié et les échanges, la force de tenir, d’avancer, de grandir, de vivre. Certes, le portrait de cette discrète jeunesse est attachant, mais il n’occulte en rien les difficultés et les tourments contemporains, voire même les tragédies de la vie. Ce très beau roman est à l’image du quotidien, il évolue au plus près des existences. Dans une journée, il faut bien l’avouer, on peut passer du rire aux larmes : il se passe la même chose dans et avec ce roman. Face à la fragilité et aux doutes de cette tribu d’« invisibles », comme face au « joyeux » désespoir du plus discret des voisins (inoubliable Monsieur Bréhel !), difficile de rester de marbre. Une fois le livre refermé, vous n’êtes pas prêts d’oublier ce petit conseil de vie et d’ami : « Se répéter qu’il y a tout à craindre des gens et des jours, des jours et des gens, sauf quand on les aime ».
Page — La tendresse et la solidarité, l’humour et l’émotion sont au cœur de votre roman. Cependant, la scène inaugurale est saisissante…
Frédérique Martin — Dans un train, une jeune femme est agressée par un homme plus âgé qu’elle. Une femme s’interpose au milieu de l’indifférence générale et tente d’arrêter l’agresseur. C’est là que Tisha rencontre Claire qui la défend. Cette scène est très particulière car quand je l’ai écrite, j’étais déjà à l’œuvre depuis plusieurs semaines. Je possédais mes personnages, j’avais imaginé cette trame en trois parties et façonné une langue, un rythme, un temps narratif, etc. Je cherchais alors à mettre l’oralité des jeunes au cœur de l’écriture, je voulais que la langue soit à la fois légère et grave, vulgaire et soutenue, qu’elle reproduise toute la palette des émotions de la vie. Et puis, un jour, dans le train, j’ai assisté à l’agression d’une jeune fille et suis intervenue pour empêcher que les choses ne dégénèrent. Le souvenir de cette confrontation m’a poursuivi longtemps, jusqu’à ce que l’évidence s’impose. J’avais le début de mon roman !
Page — Ici, la violence et le mal-être sont souvent conjurés par l’optimisme. Cet optimisme est-il lié à la vie en communauté ?
F. M. — Claire habite avec Juliette et Kader. Ils viennent d’emménager tous les trois dans un appartement de Toulouse lorsque survient l’agression de Tisha. Claire la ramène et la présente aux deux autres. Les premières pages du roman mettent le lecteur en phase directe avec ces jeunes colocataires. On les découvre dans leur intériorité, leur quotidien, leur travail et la vie qu’ils partagent tous les quatre.
Page — Leurs blessures respectives se dévoilent peu à peu, en même temps que la faculté qu’ils ont, ensemble, d’y apporter des remèdes. Que dites-vous de cette jeunesse ?
F. M. — Cette jeunesse très ordinaire, que j’appelle silencieuse, dont on n’entend peu parler, ce sont nos filles et nos garçons de 20 ou 25 ans. Quand les médias s’y intéressent, c’est presque toujours pour la stigmatiser. Je m’inscris absolument en faux contre cette vision. La plupart de ces jeunes ne font jamais la moindre vague, certains ont des diplômes, d’autres non, mais ils ont tous en commun de rencontrer les mêmes difficultés face aux exigences de la vie, ils éprouvent tous la même peine à s’insérer dans une société qui ne cesse de les rejeter, qui les empêche de réaliser leurs rêves et de se construire un avenir décent. C’est pour eux que j’ai écrit ce livre. Je l’ai d’ailleurs dédié à mes personnages, à ces jeunes gens que je regarde vivre depuis des années. Je les ai vus grandir, j’ai assisté à l’éclosion de leurs rêves, j’ai observé la façon dont ils prenaient conscience des injustices, parfois, du monde qui les entoure. Devenus de jeunes adultes, ils ont dû se confronter à la réalité, dans toute son impitoyable rigueur. La société actuelle idéalise la jeunesse, en même temps qu’elle la rejette. Pour l’instant, la jeunesse se tait, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne pense pas, qu’elle n’agit pas, qu’elle n’est pas pénétrée de grandes espérances…
Page — Vous parlez de chômage, de religion, de racisme, de sexualité, des liens familiaux qui se délitent, de l’isolement… Pensez-vous que ces questions, dans la fiction, prennent une dimension particulière ?
F. M. — L’idée était d’accéder à la vie intérieure de cette jeunesse, d’offrir une fenêtre à des gens qui, peut-être, ne les comprennent pas et se méprennent lourdement quand ils en parlent. Les jeunes dont s’inspirent mes personnages ne se livrent pas facilement – mais qui se livre facilement ? Je voulais dessiner leur portrait tout en m’inscrivant dans un propos plus large, en explorant la réalité sociale de ce début de XXIe siècle ; je voulais les dévoiler tels qu’ils sont ou, en tout cas, tels que j’ai pu les voir, les percevoir et les entendre.
Page — Autour de ce quatuor gravitent quelques savoureux personnages secondaires. Le plus singulier, le plus attachant, peut-être aussi, c’est Monsieur Bréhel.
F. M. — Monsieur Bréhel est leur voisin de palier. La première fois qu’il croise Claire, il tombe fou amoureux d’elle. Mais Monsieur Bréhel n’a plus 20 ans depuis longtemps. Il est à la retraite et vit seul. Derrière son humour, sa truculence pleine de poésie, il cache en réalité une nature introvertie et désespérée. Il a d’abord été un personnage assez secondaire, puis, très vite, il a imposé sa voix et pris une importance presque égale à celle des quatre jeunes gens. Une phrase définit le lien qui unit ces cinq individus : souci de l’autre et quête de soi.
Page — Et pourtant, il y a toujours des failles et une violence prête à jaillir…
F. M. — C’est un roman en trois parties, des retournements interviennent. Chacun d’entre nous a vécu une ou plusieurs tragédies ; ça n’existe pas un être humain qui traverse l’existence sans connaître de tragédie. Le roman est aussi le lieu où se manifestent la violence et la tragédie. Ce sont les épreuves qui nous forgent et nous permettent – parfois, pas toujours – de trouver le chemin vers une vie plus heureuse. D’une certaine manière, mon roman est un roman initiatique. 20 ans est la période où l’on est susceptible d’affronter seul, pour la première fois, les drames qui émaillent tout parcours. Certains s’en relèvent, d’autres pas. Je crois néanmoins que la vie triomphe toujours. J’ai écrit le roman pour cette jeunesse et je voulais, la réalité étant assez dure comme ça, que la vie remporte la partie. C’était là le plus important !