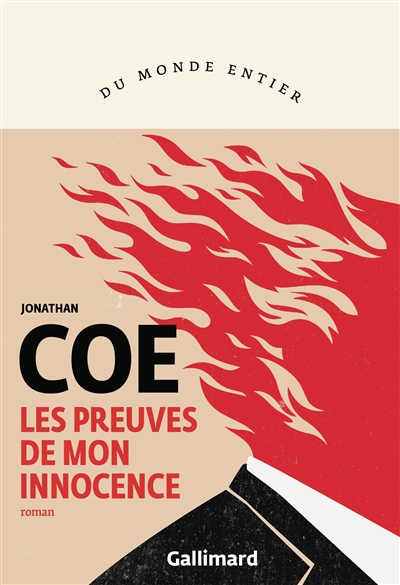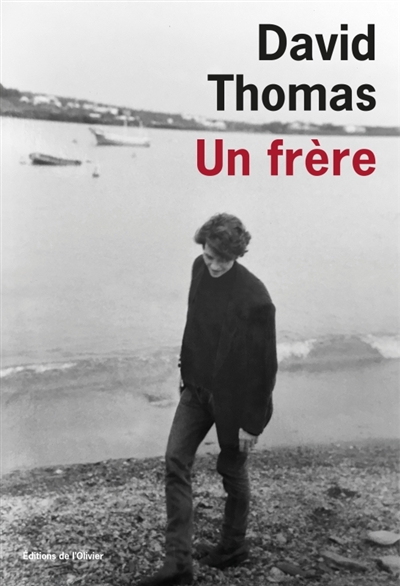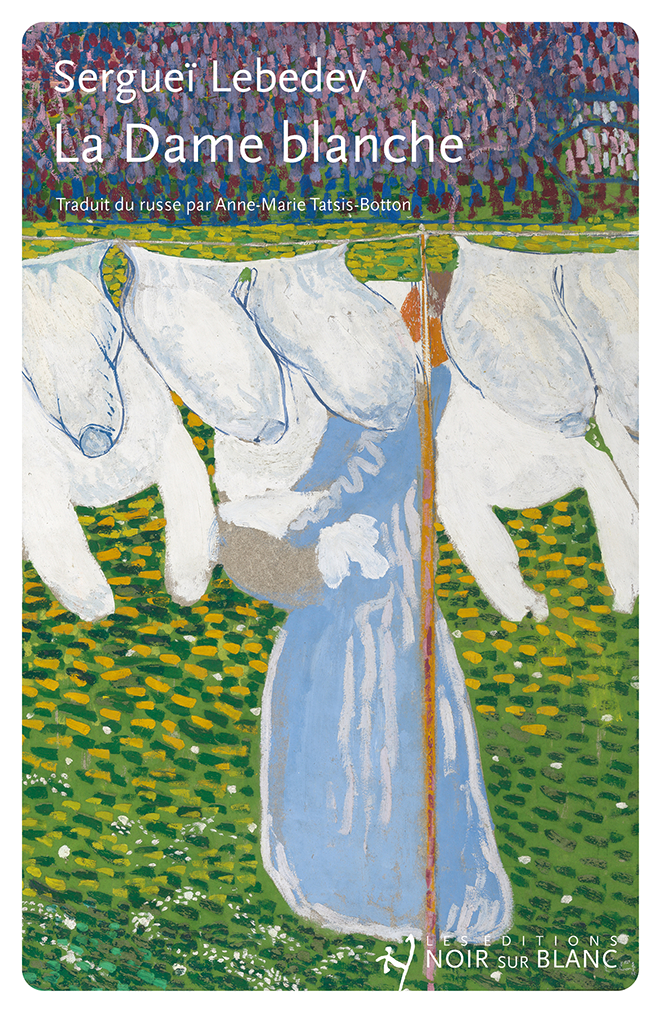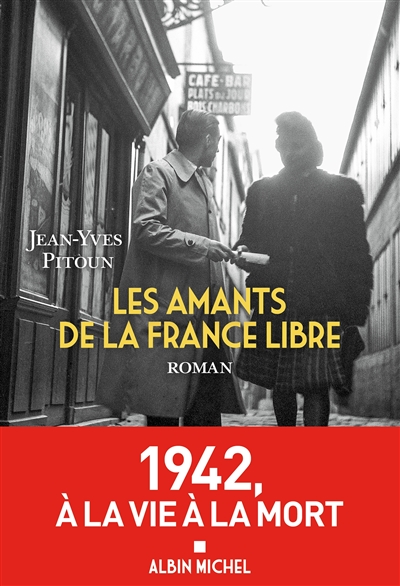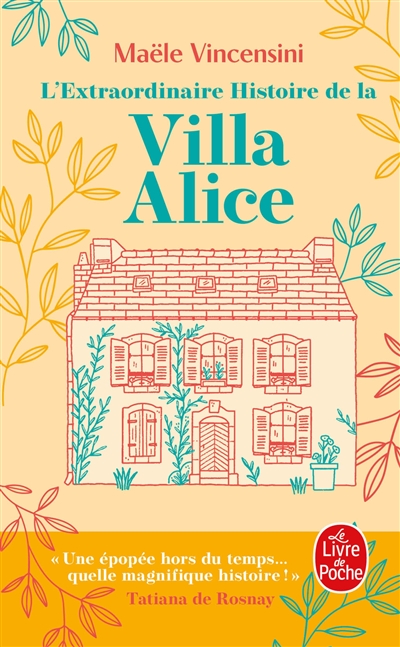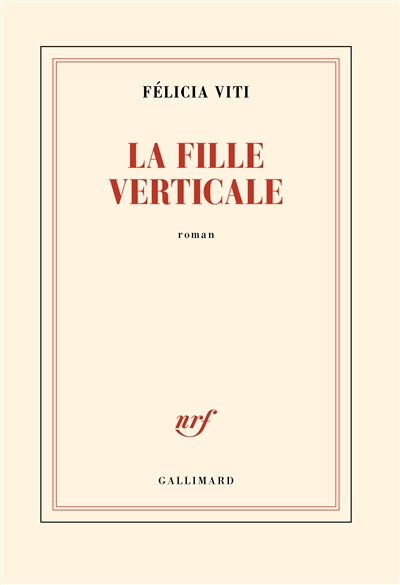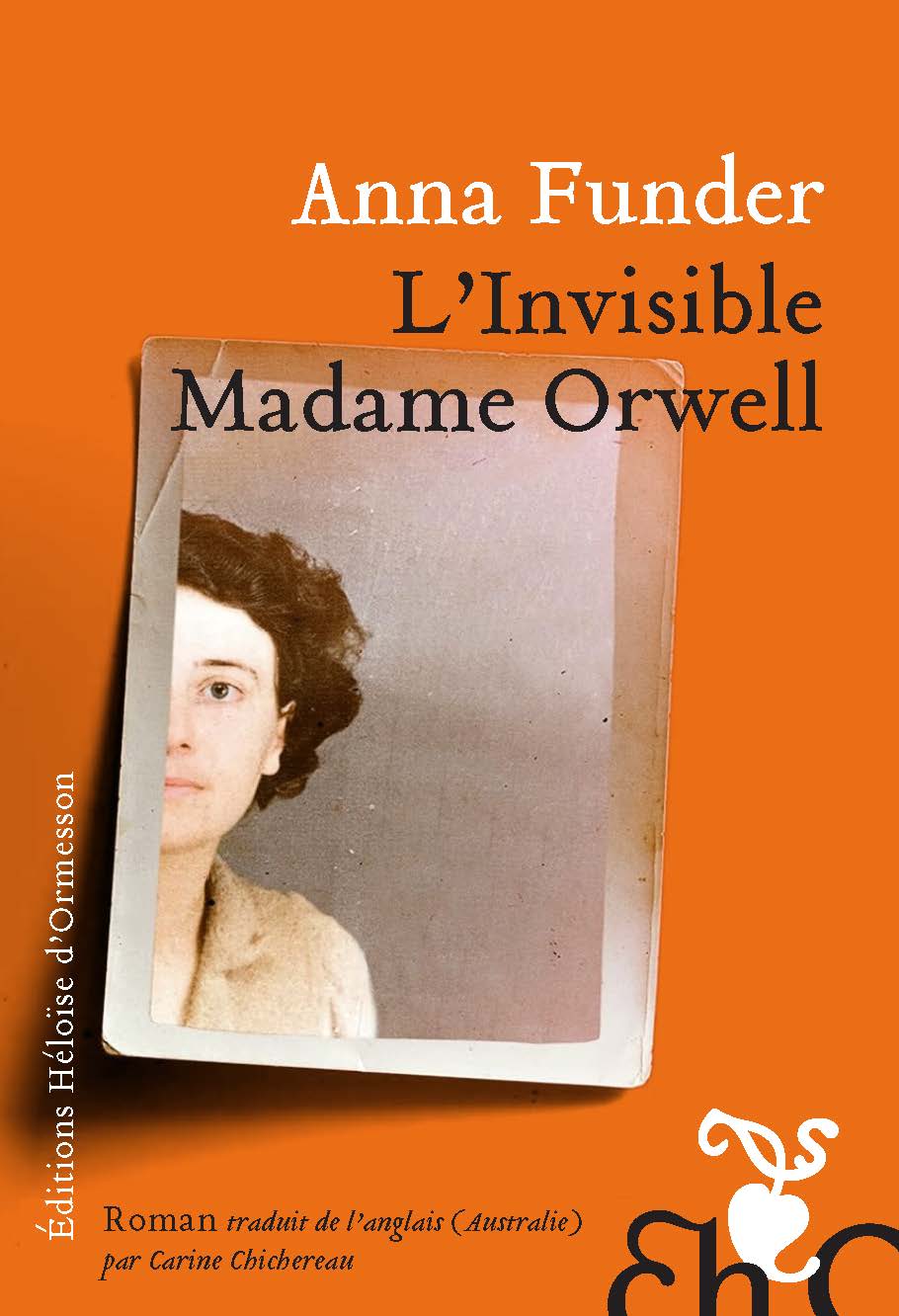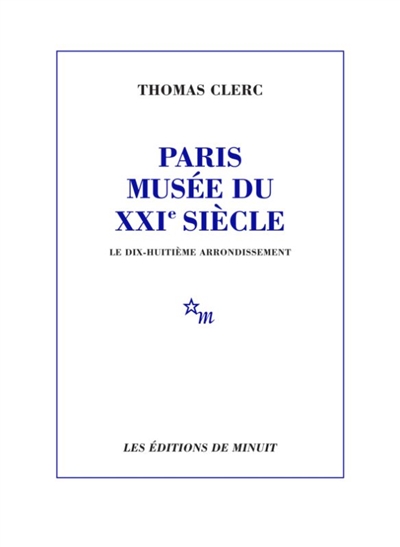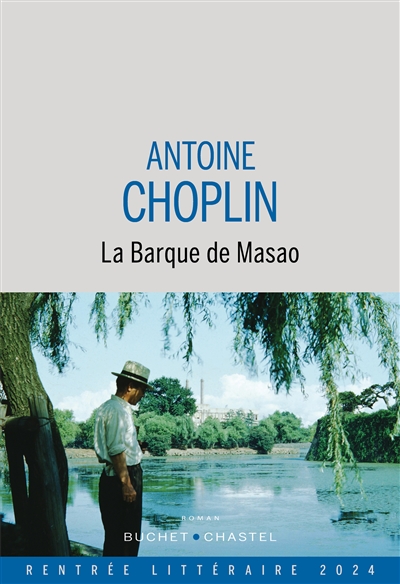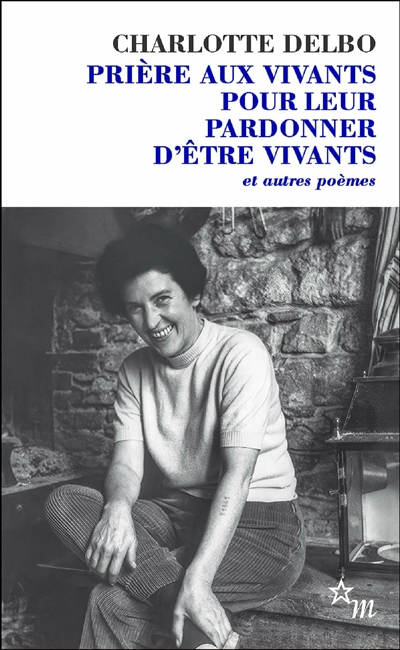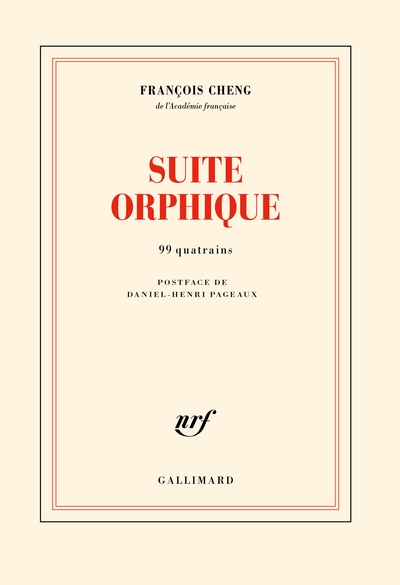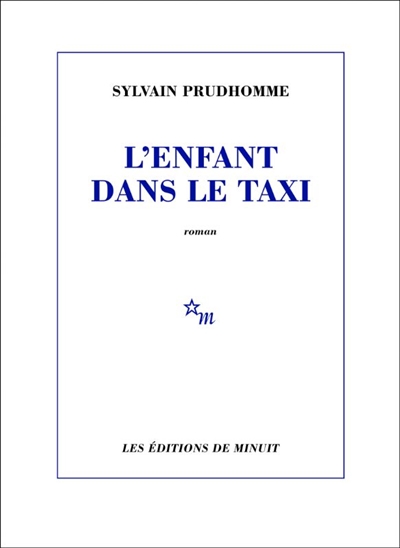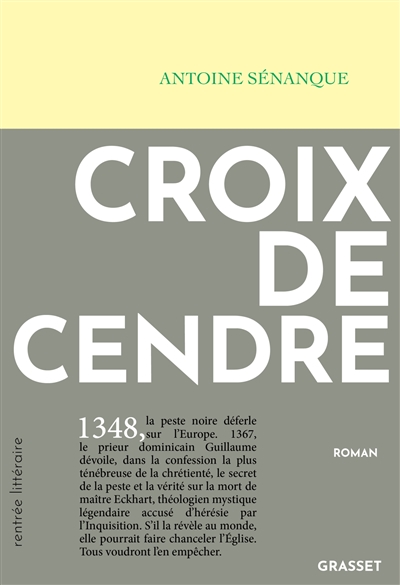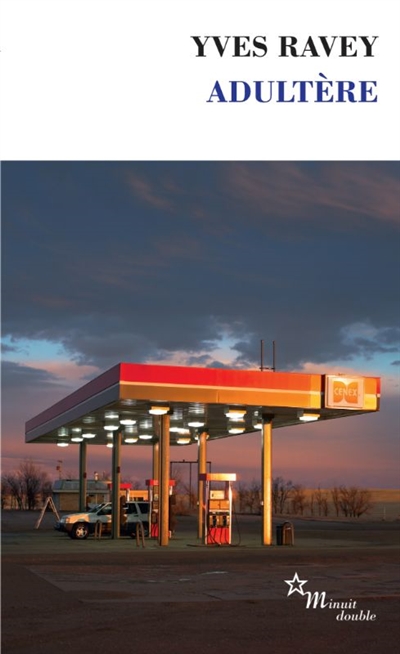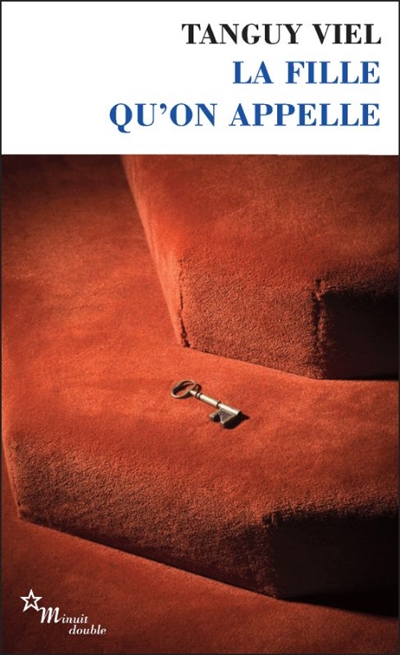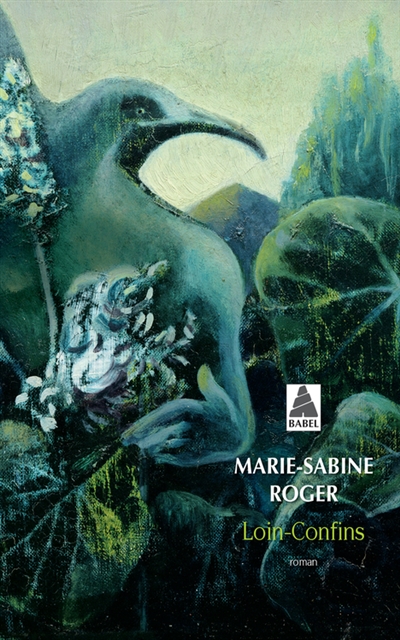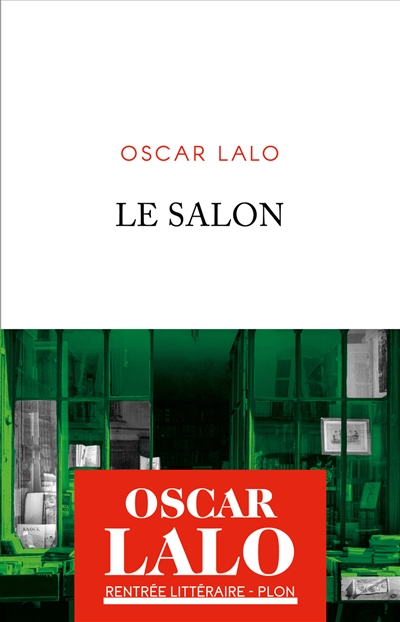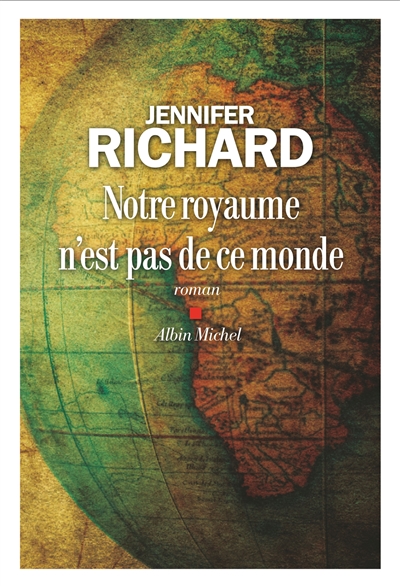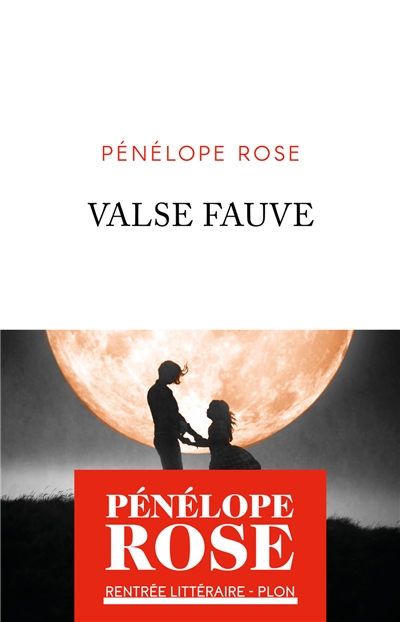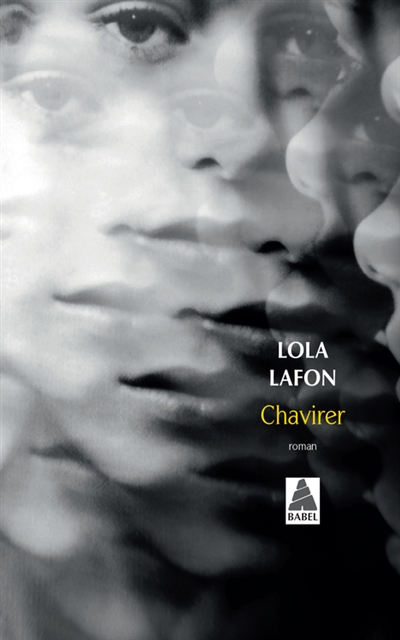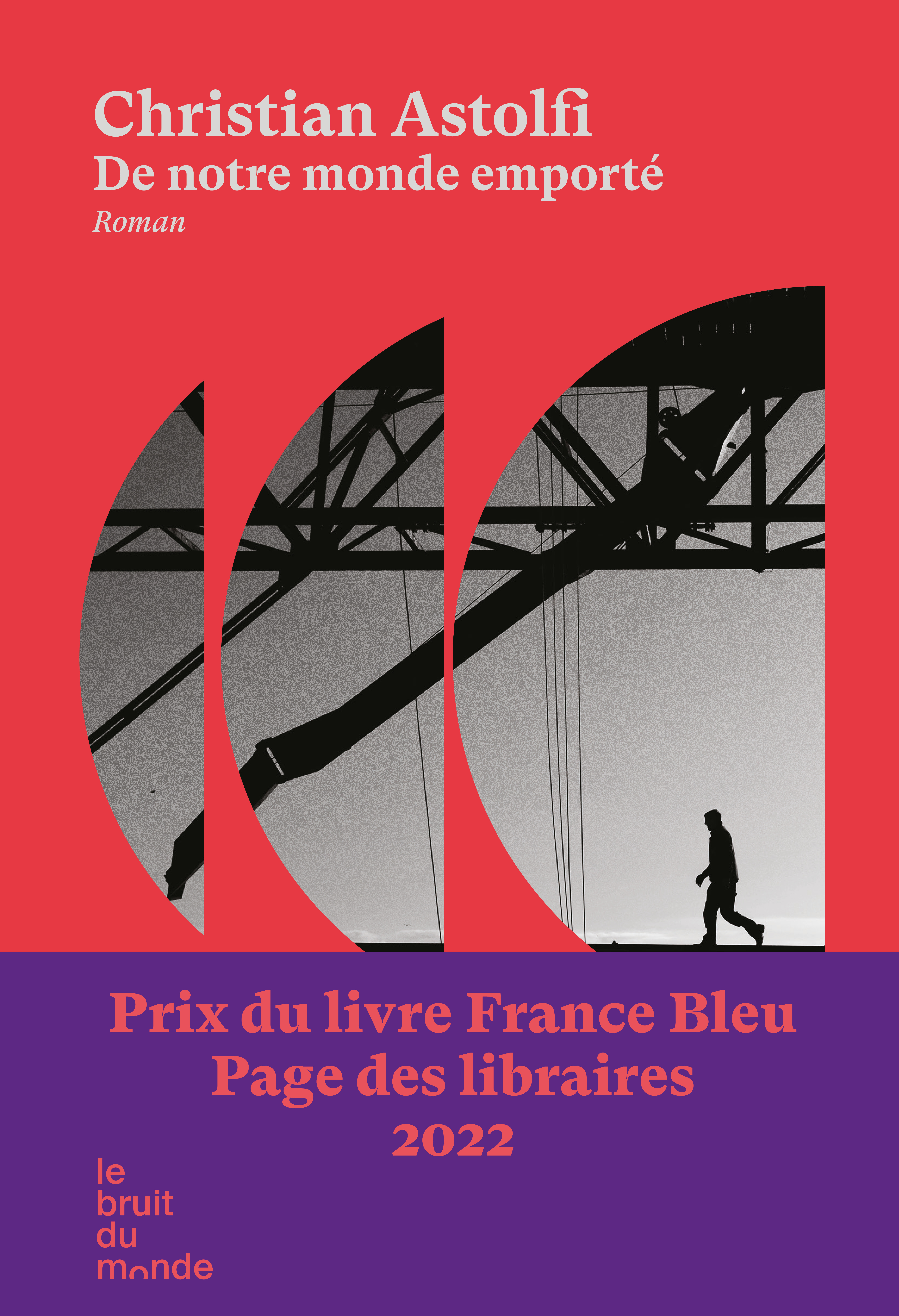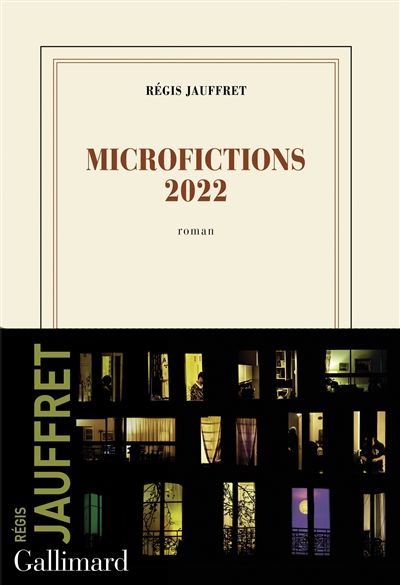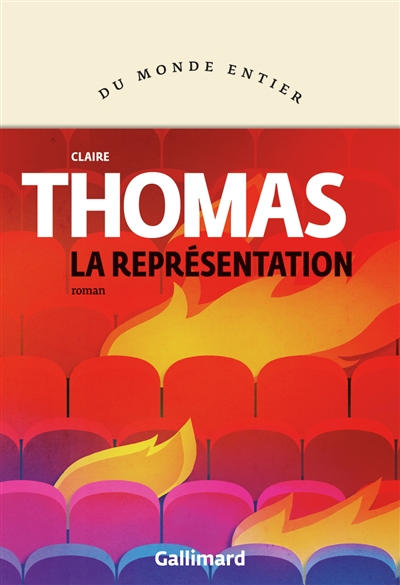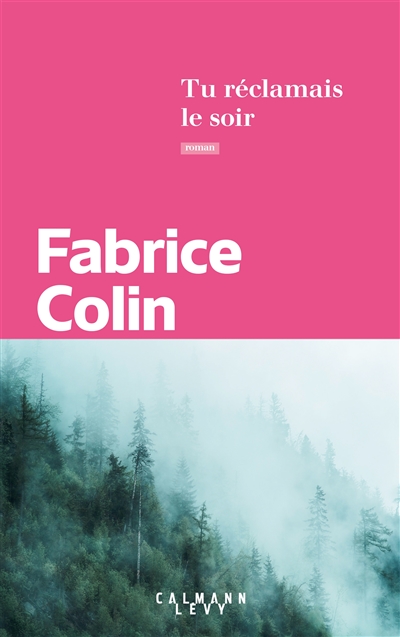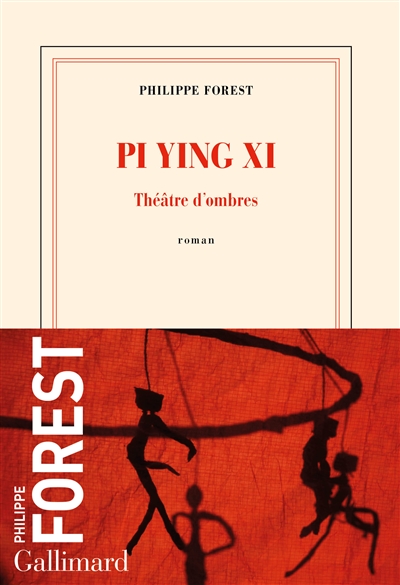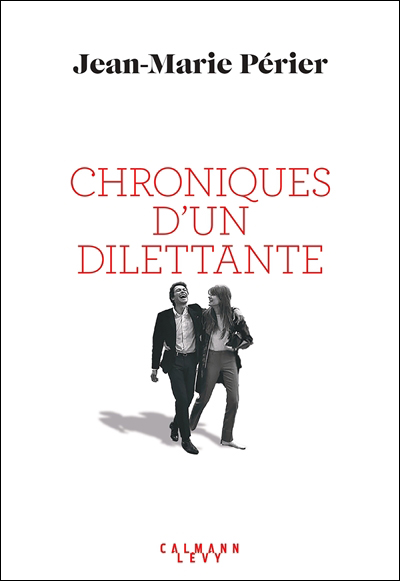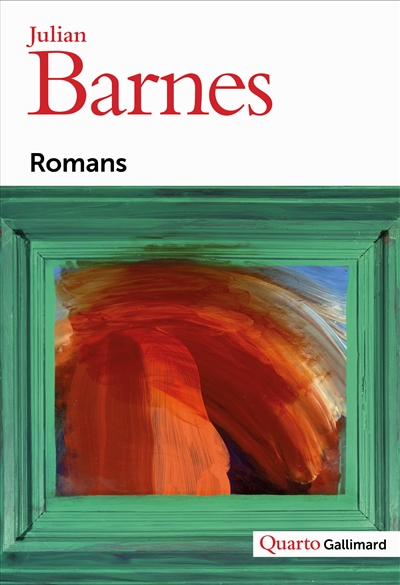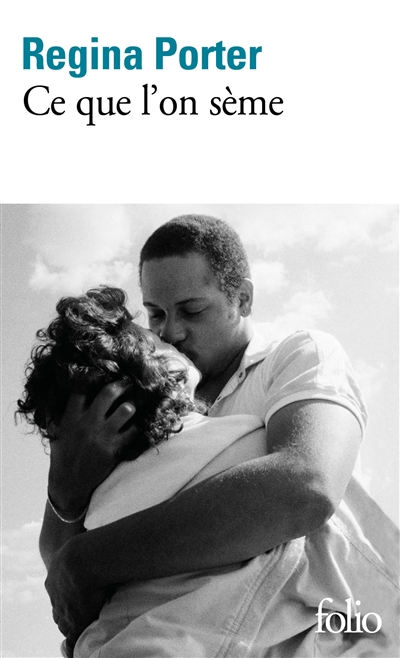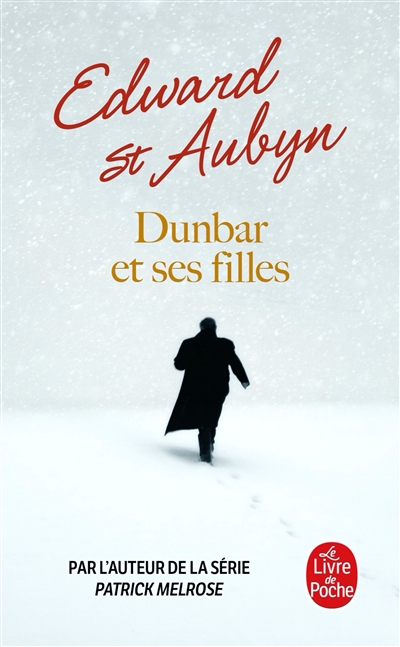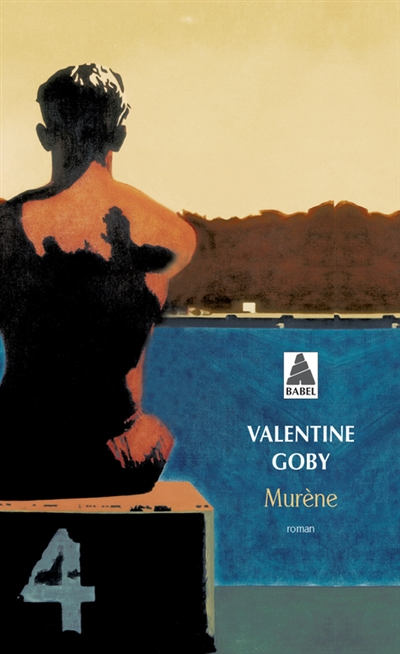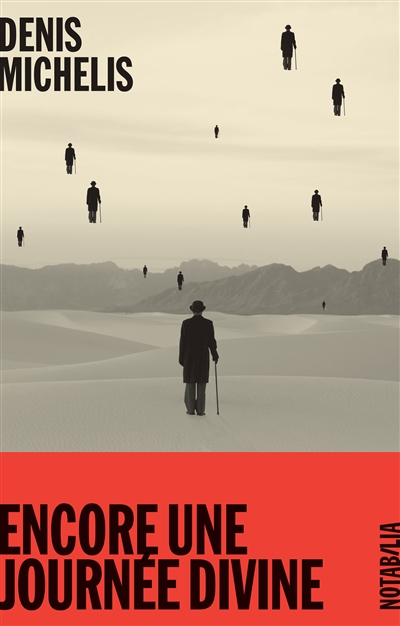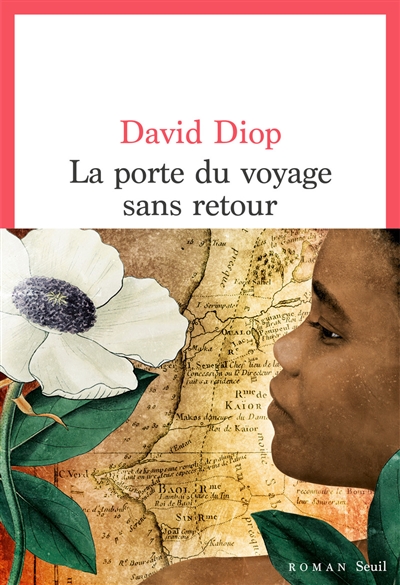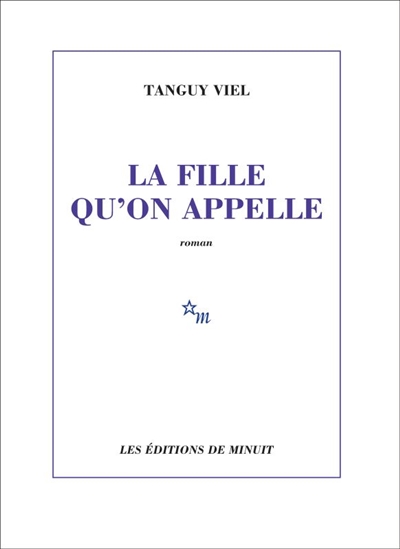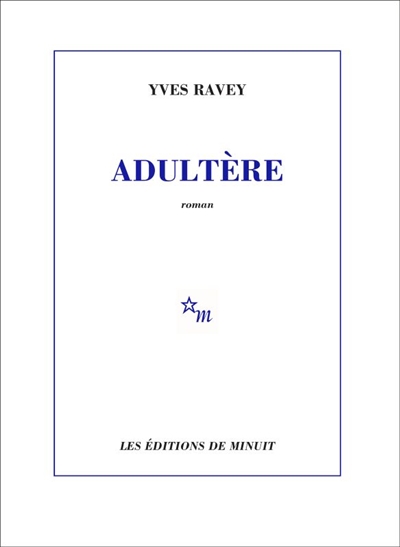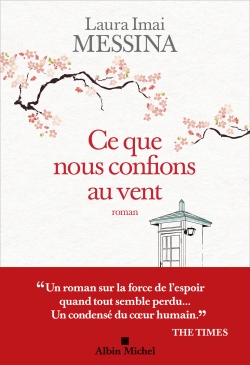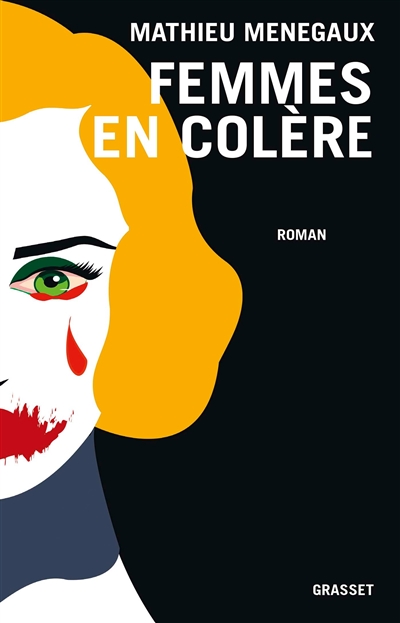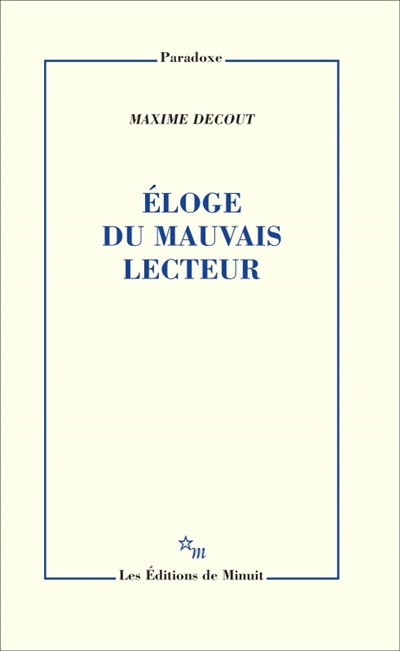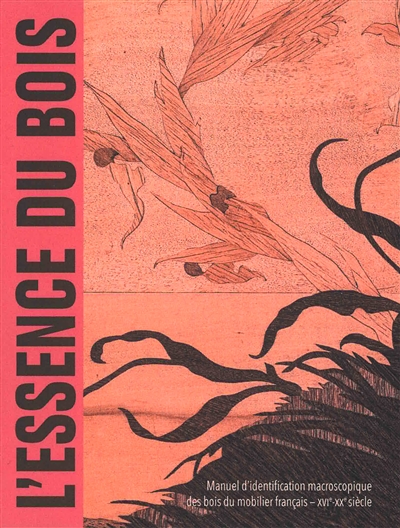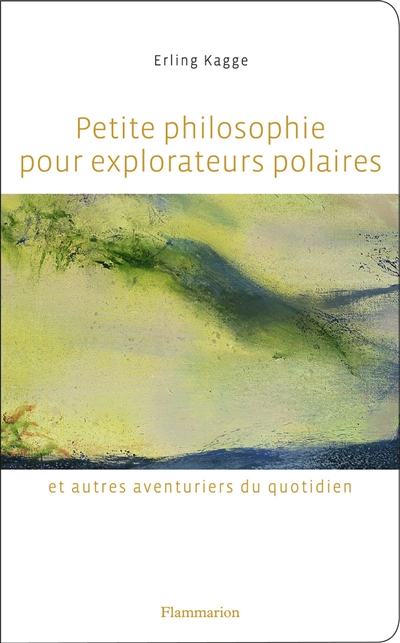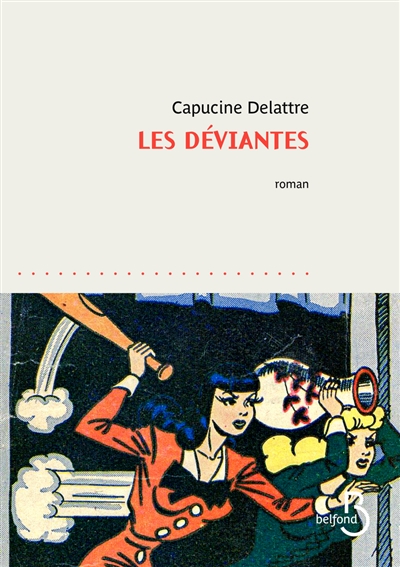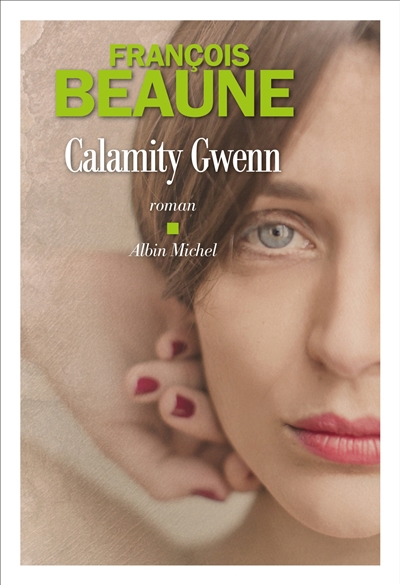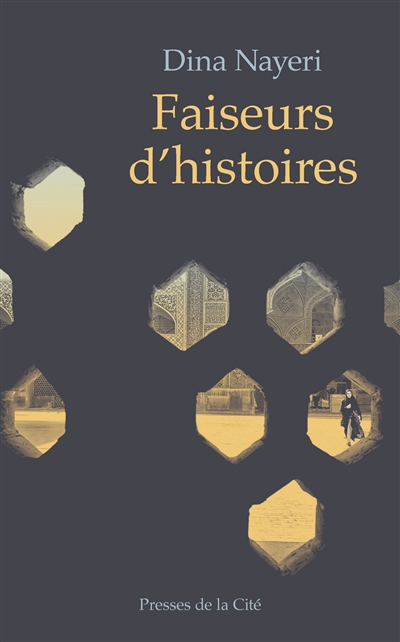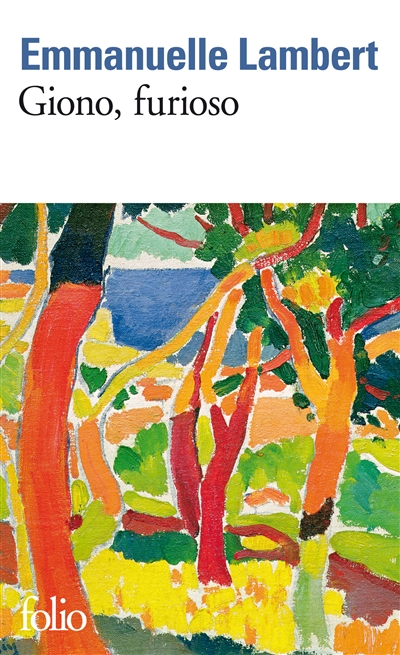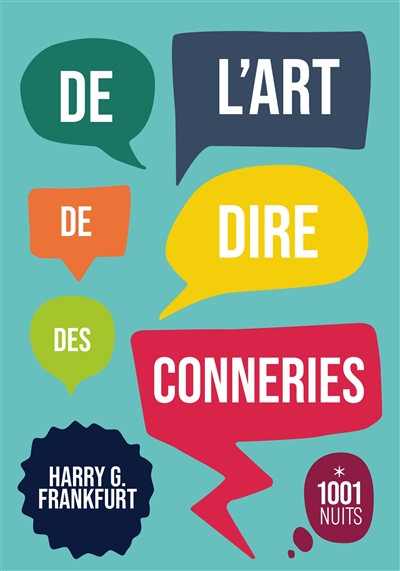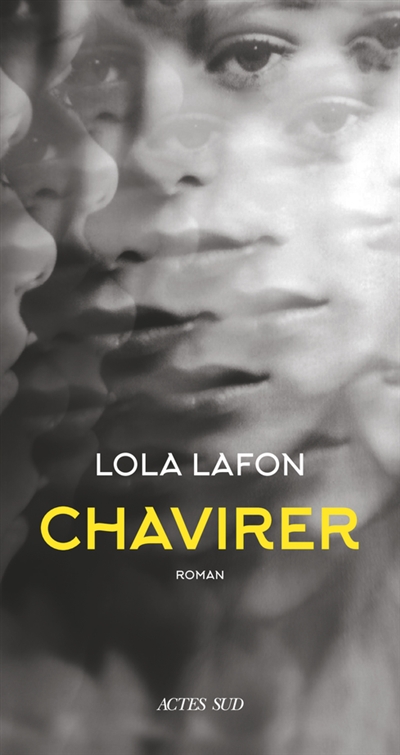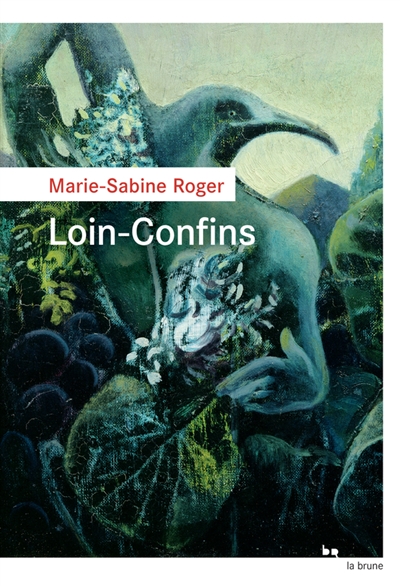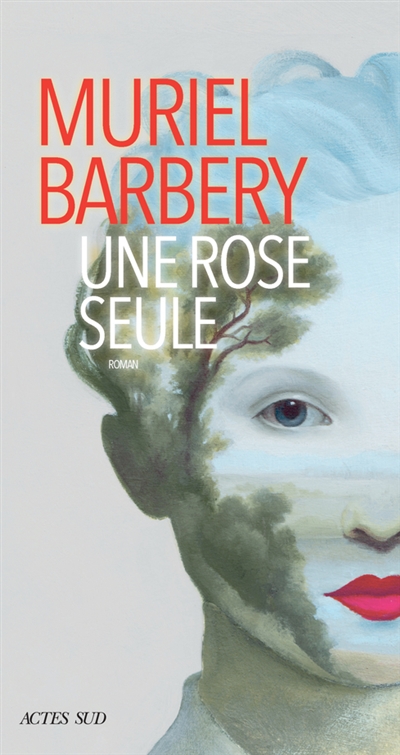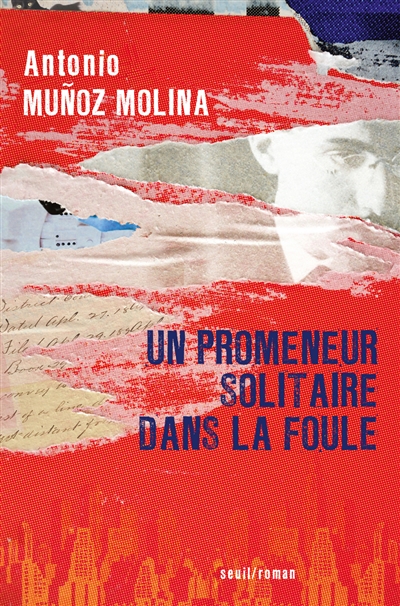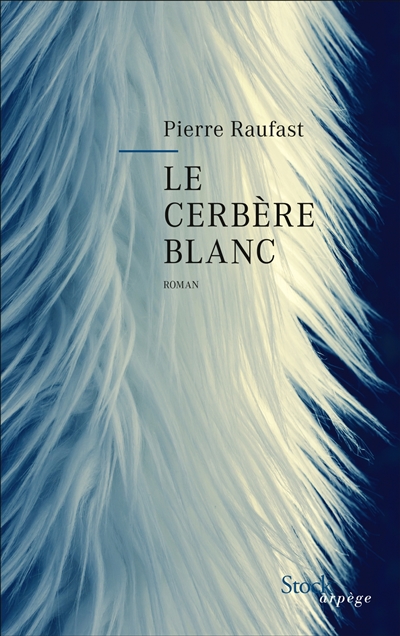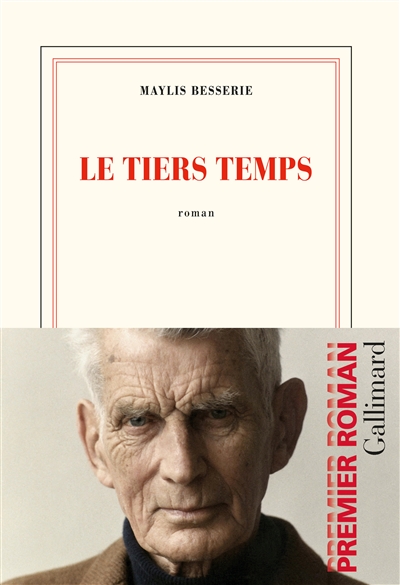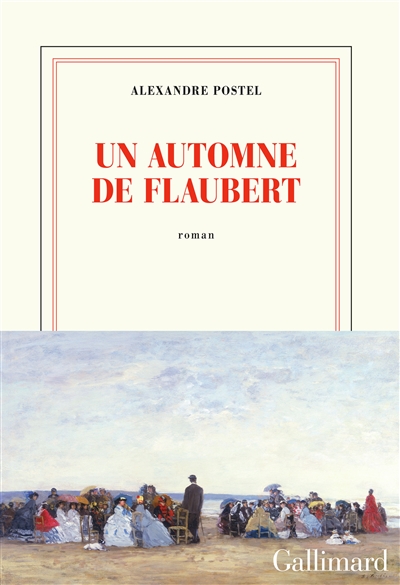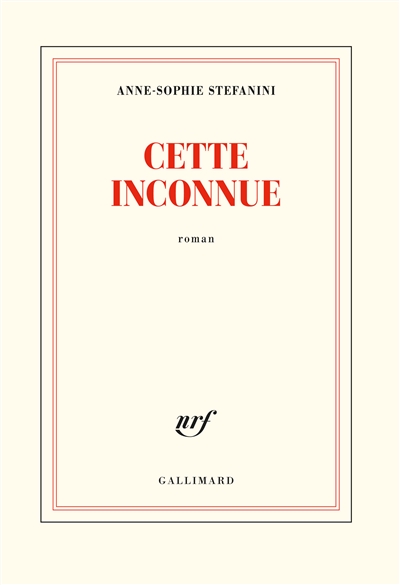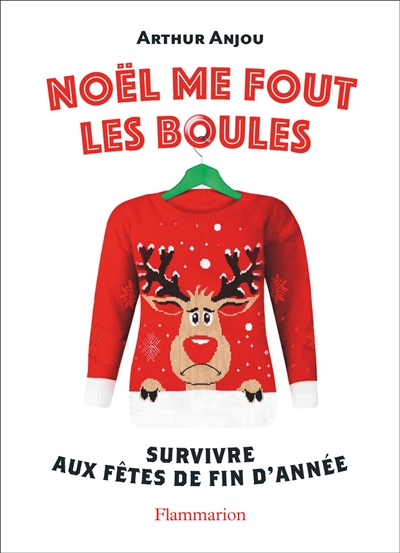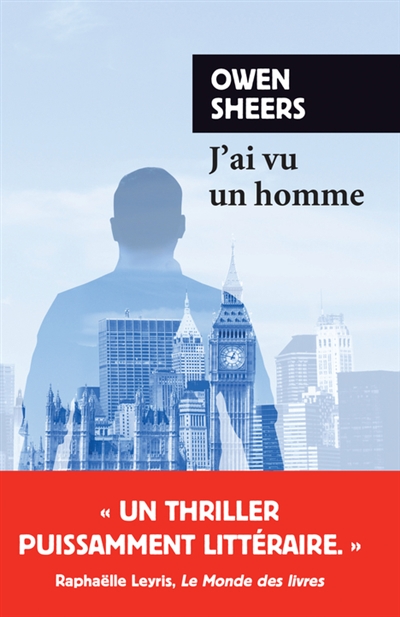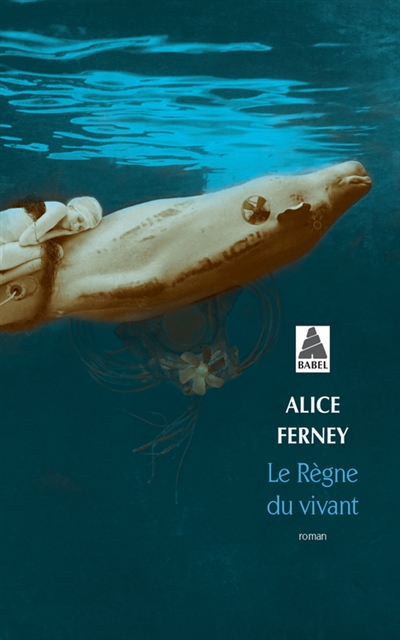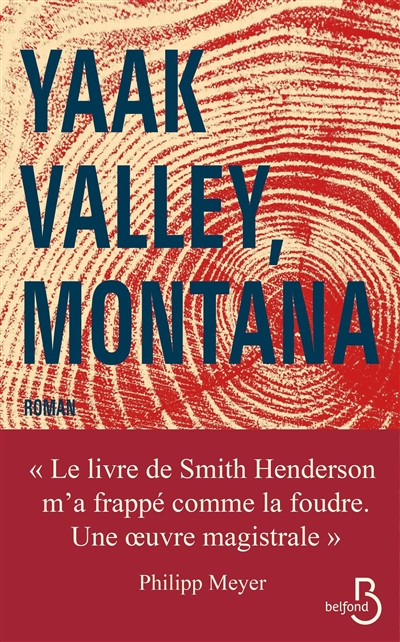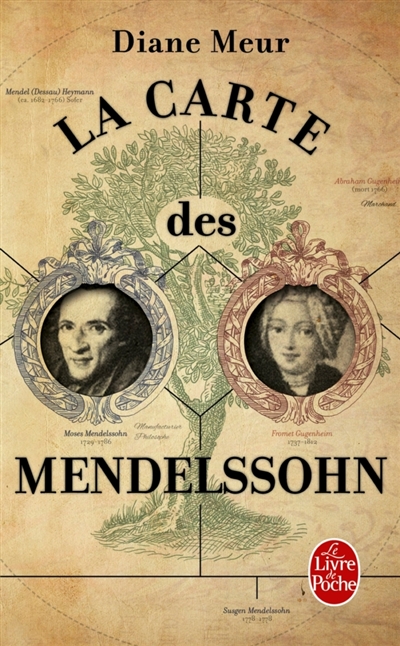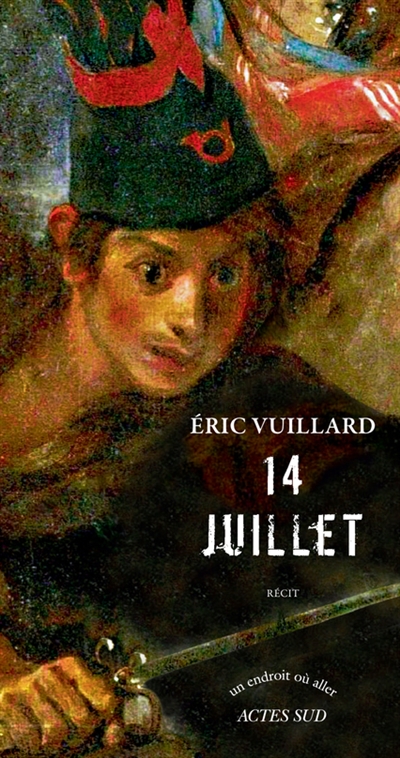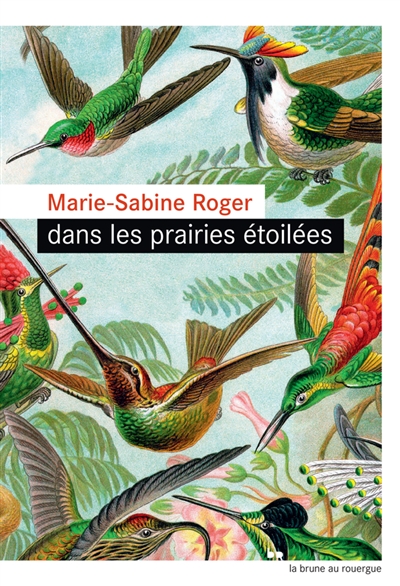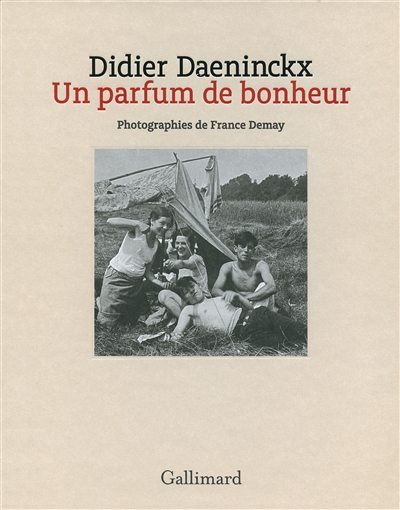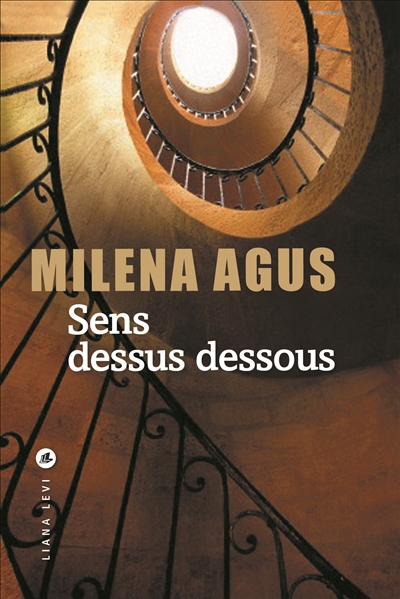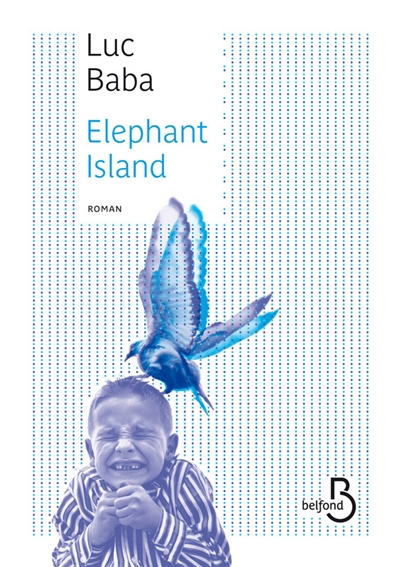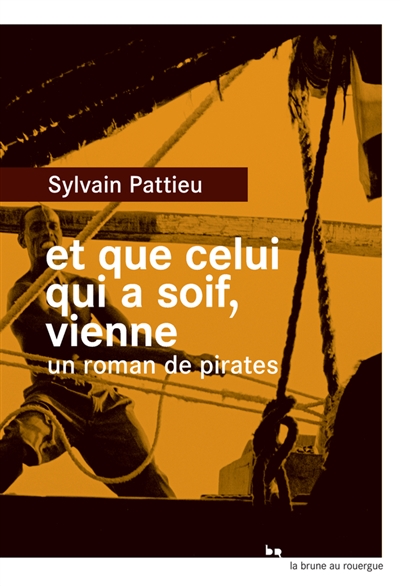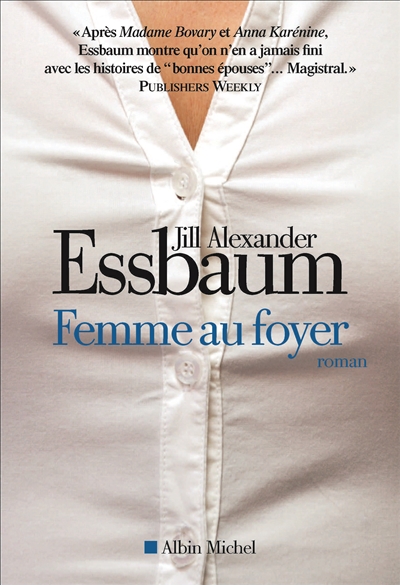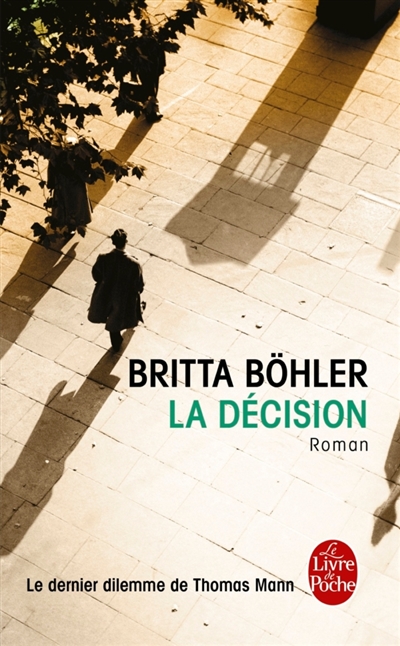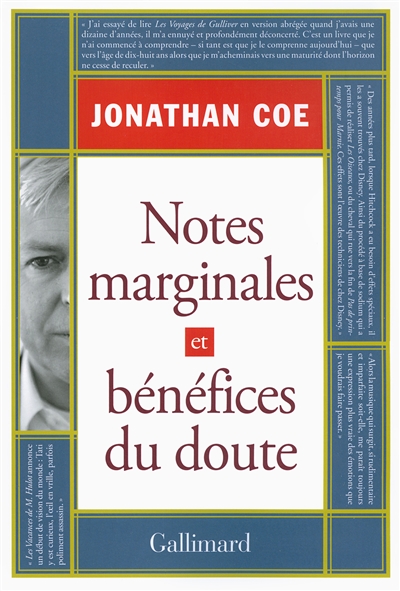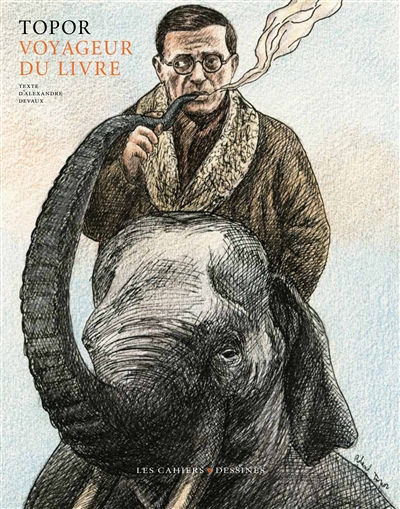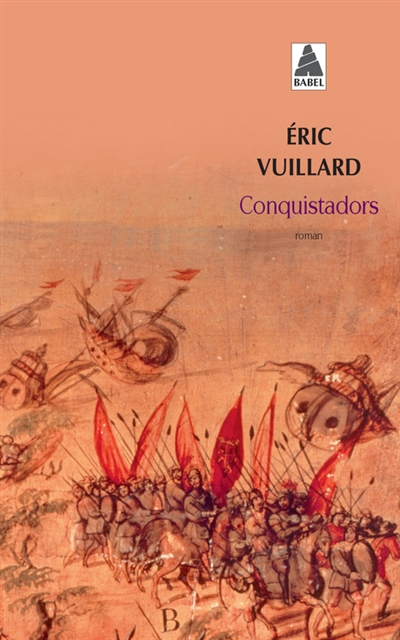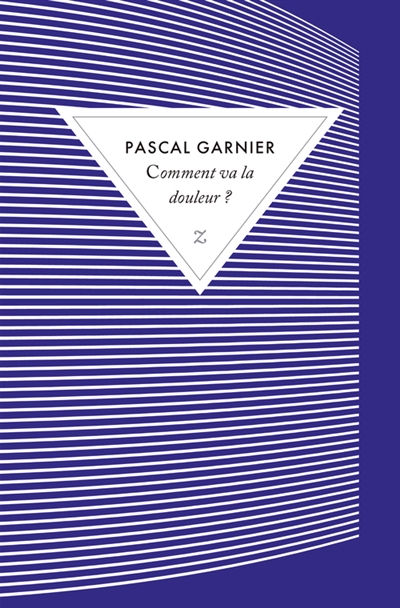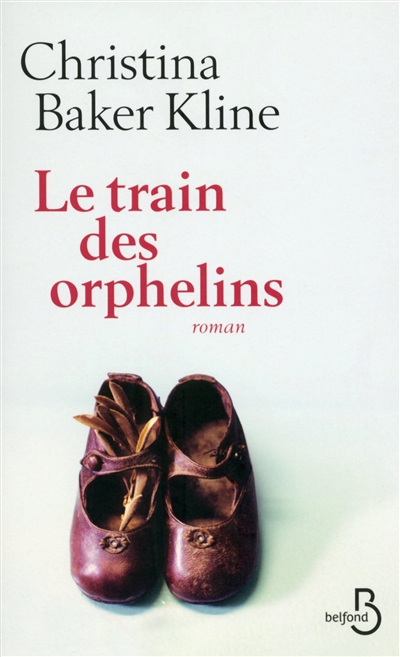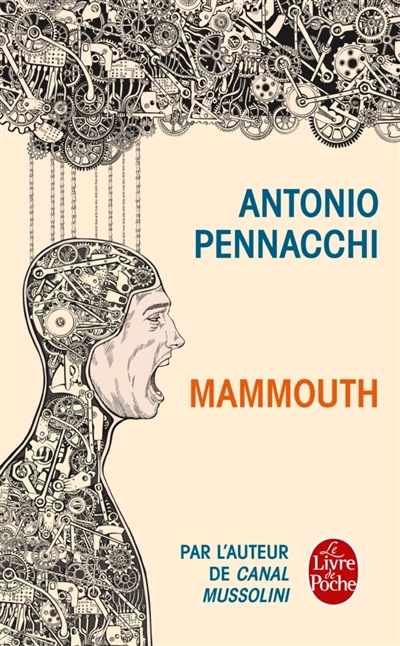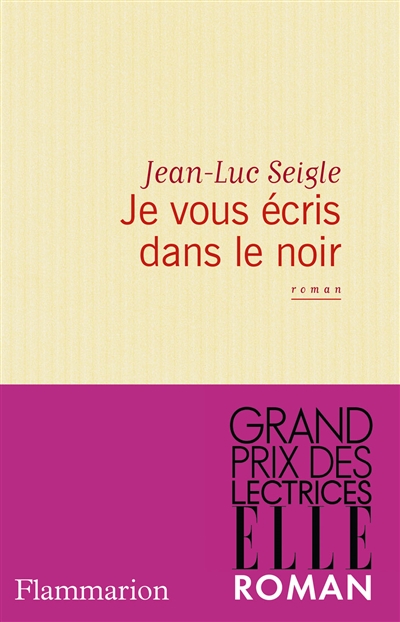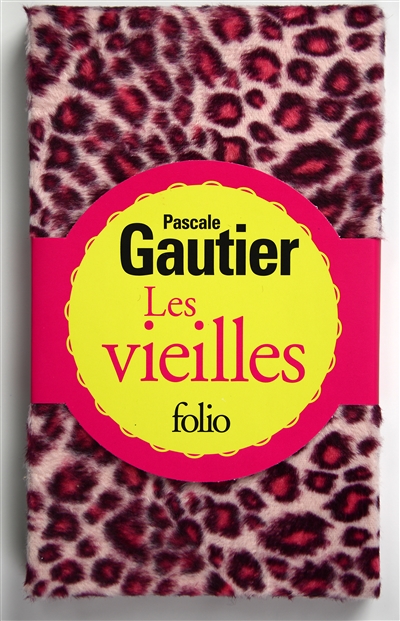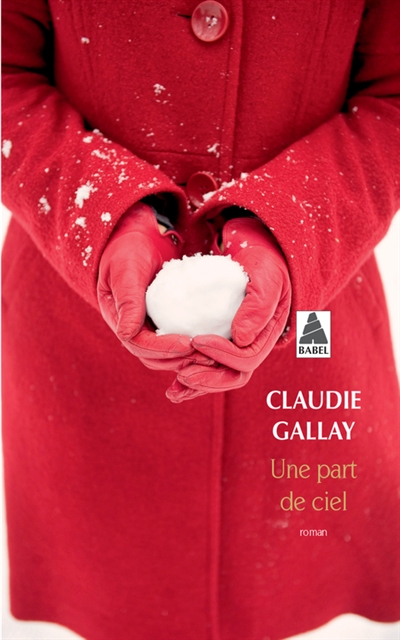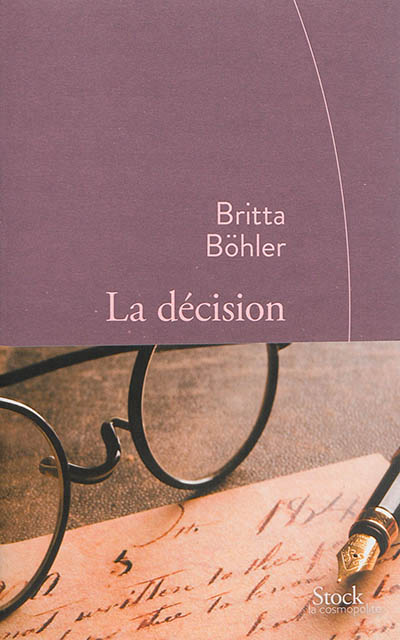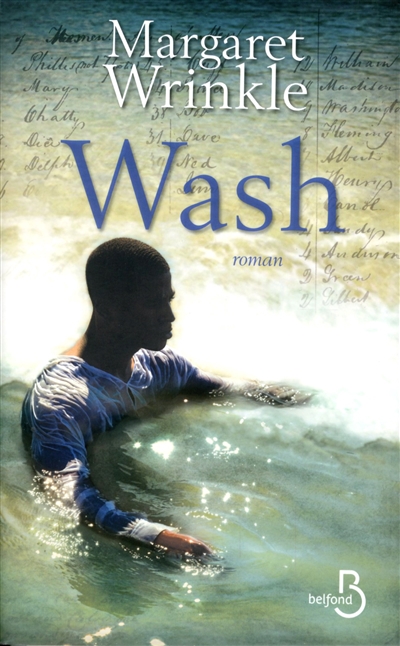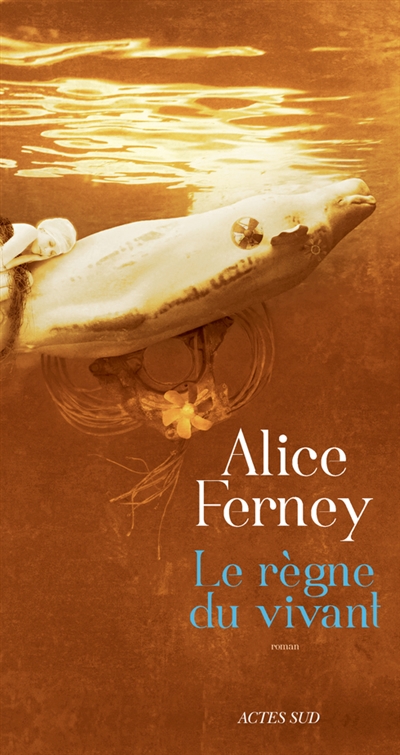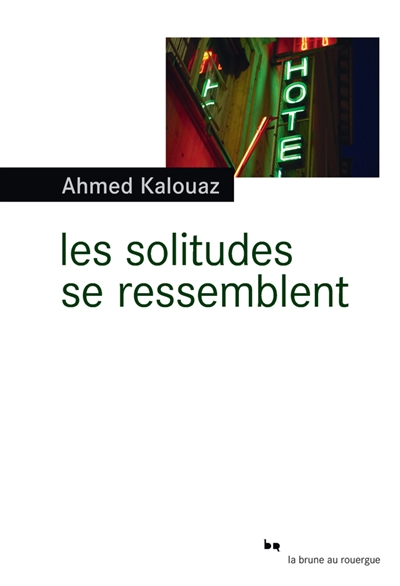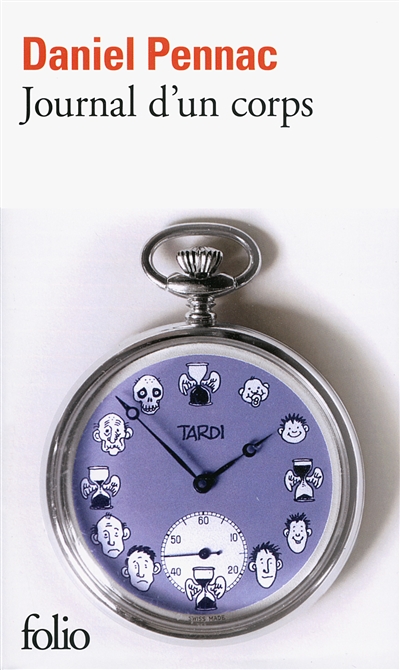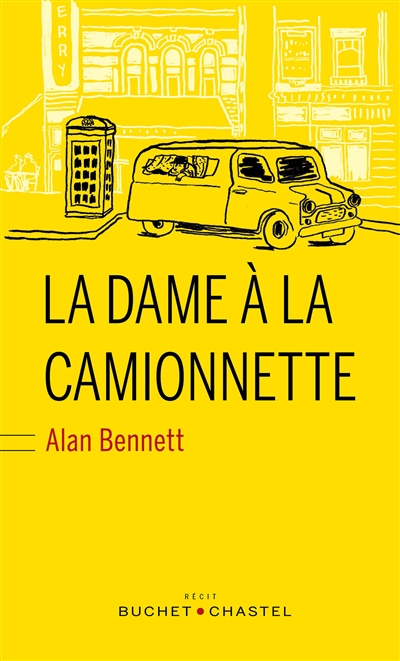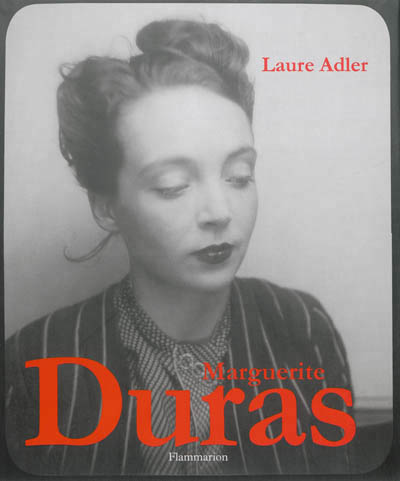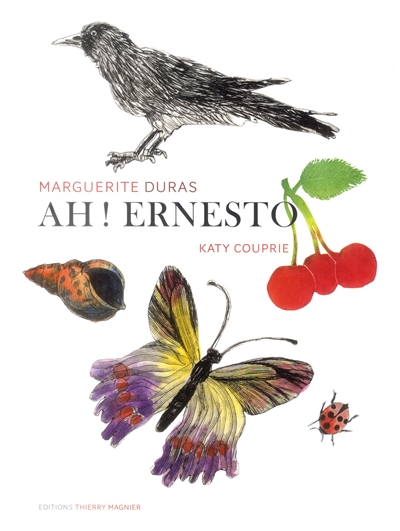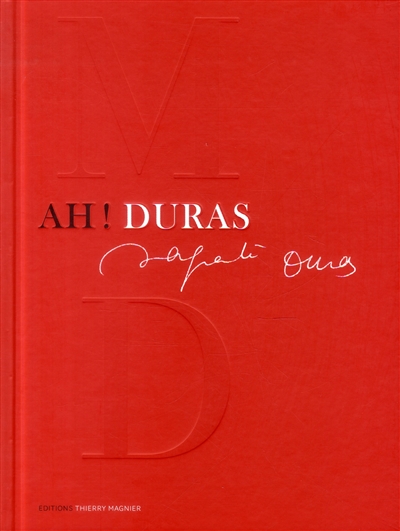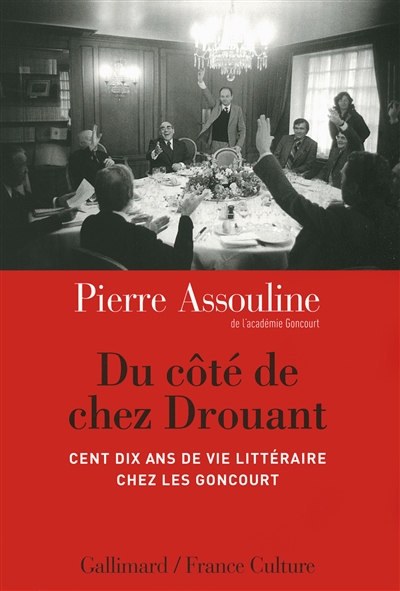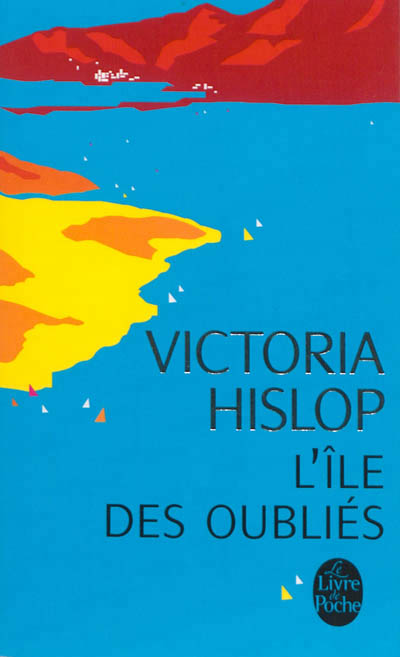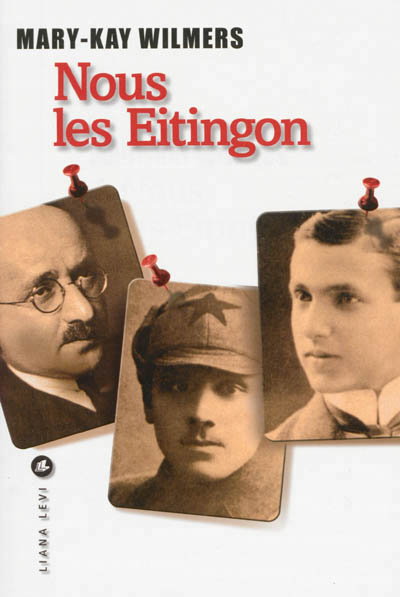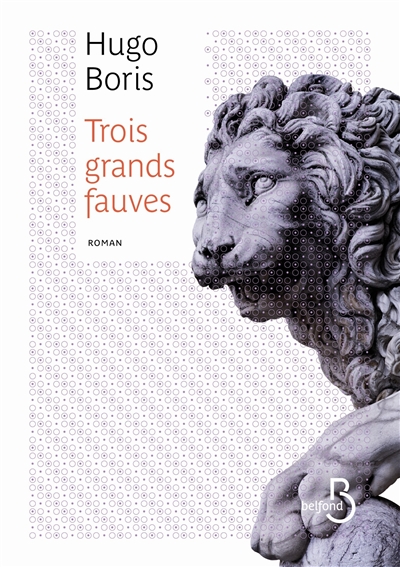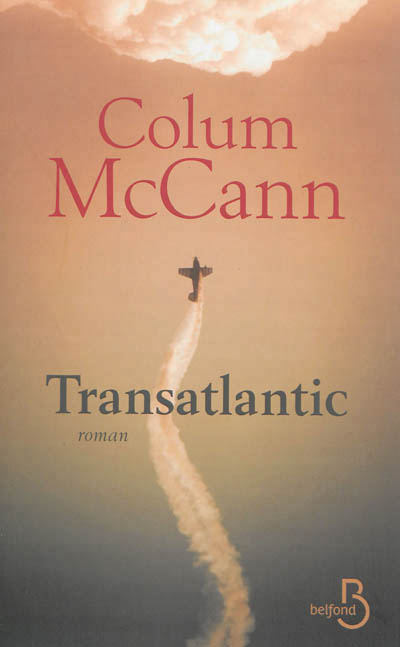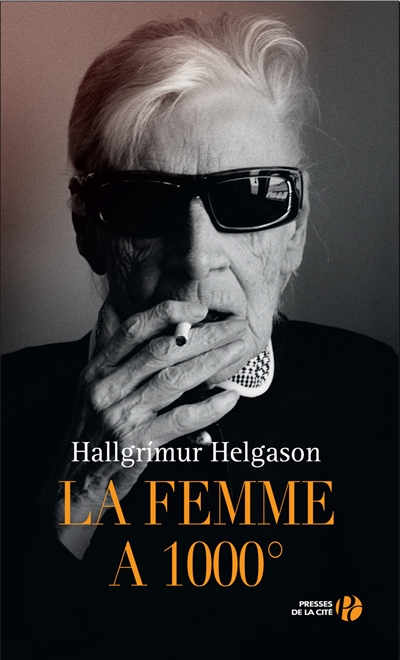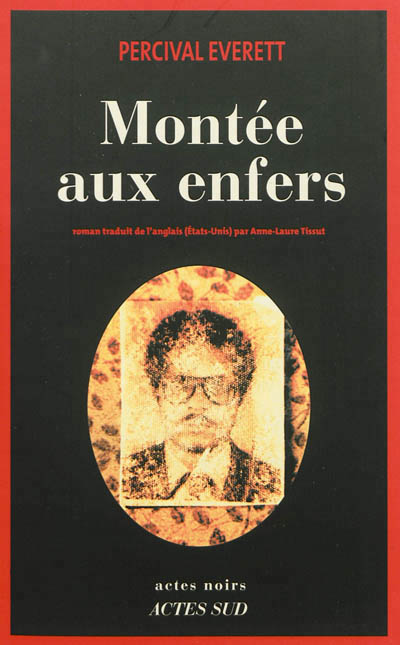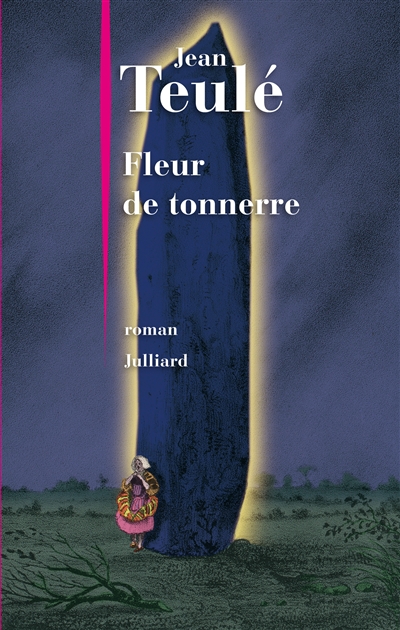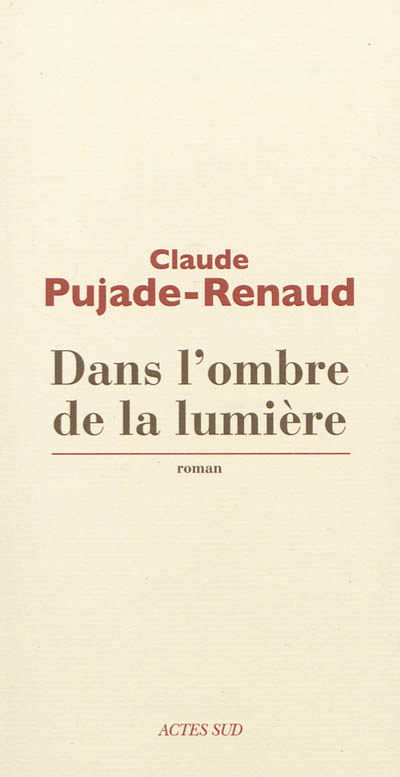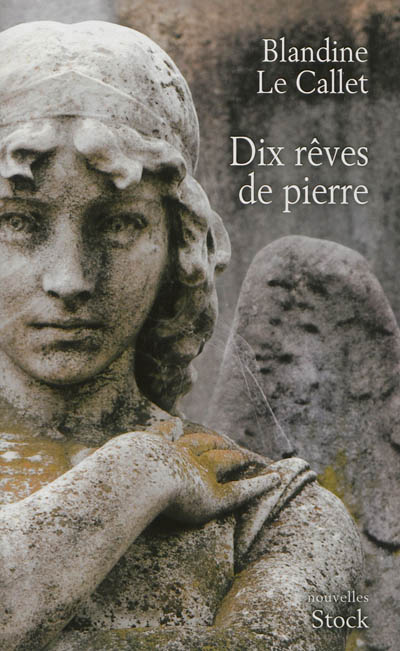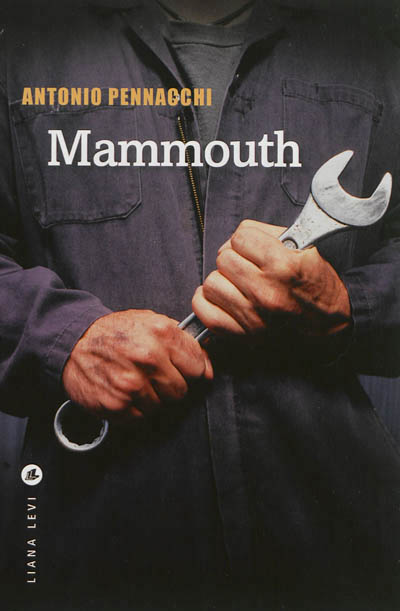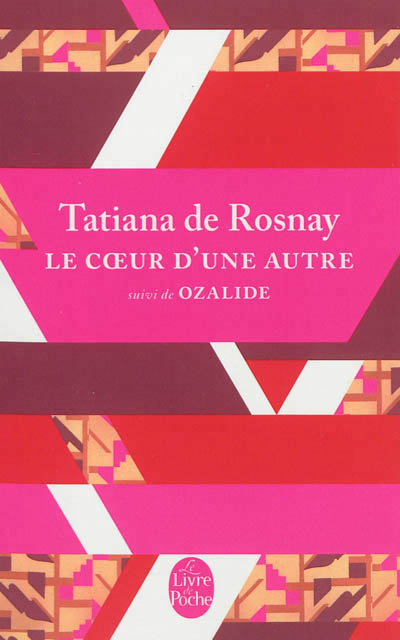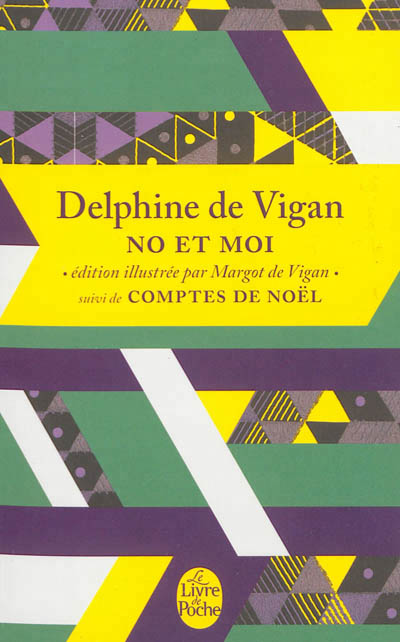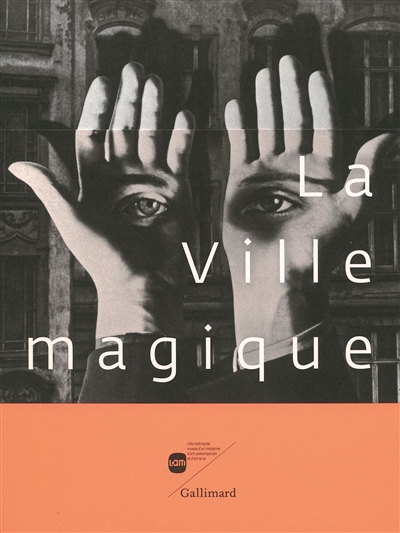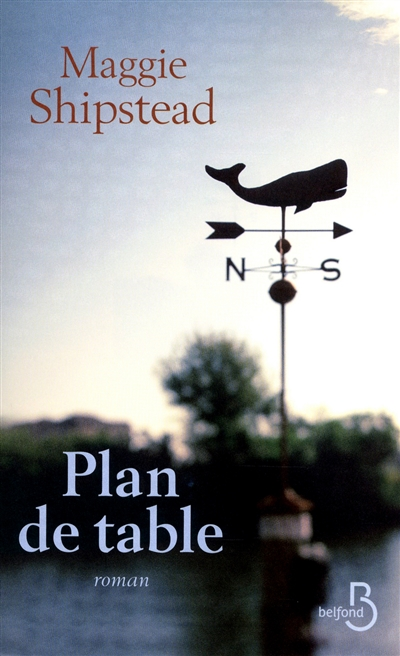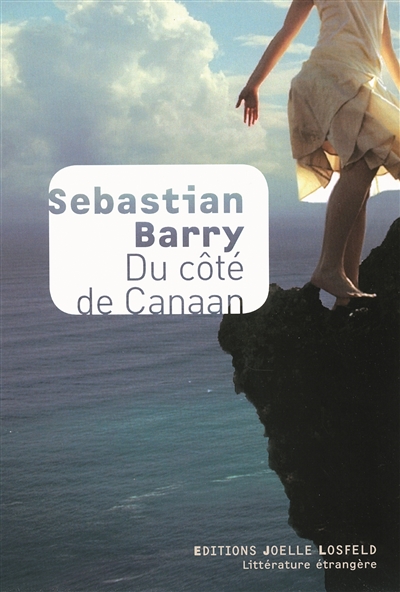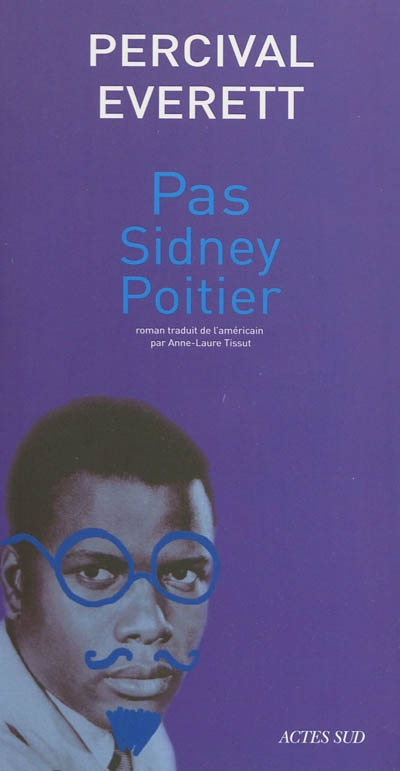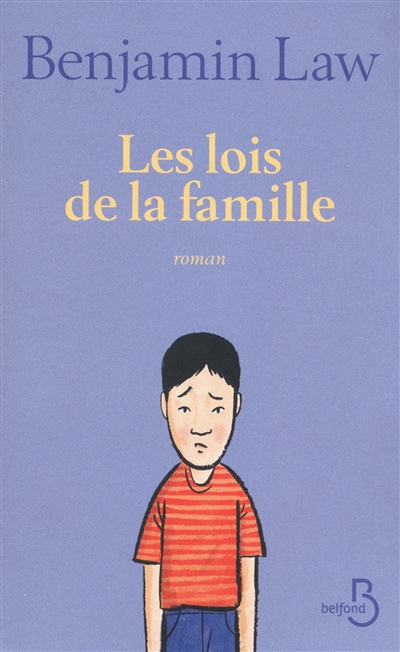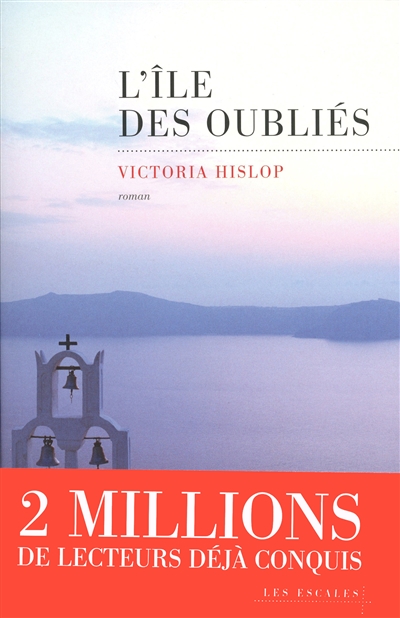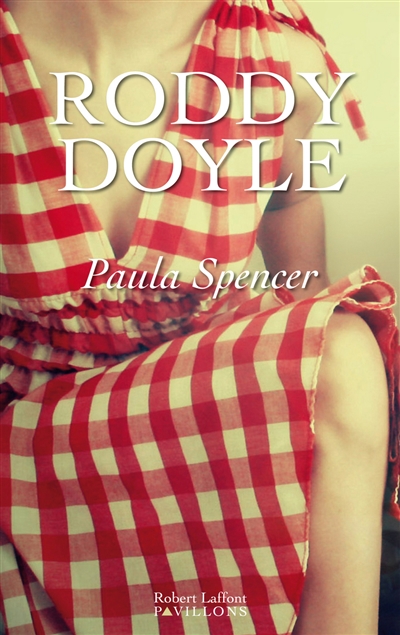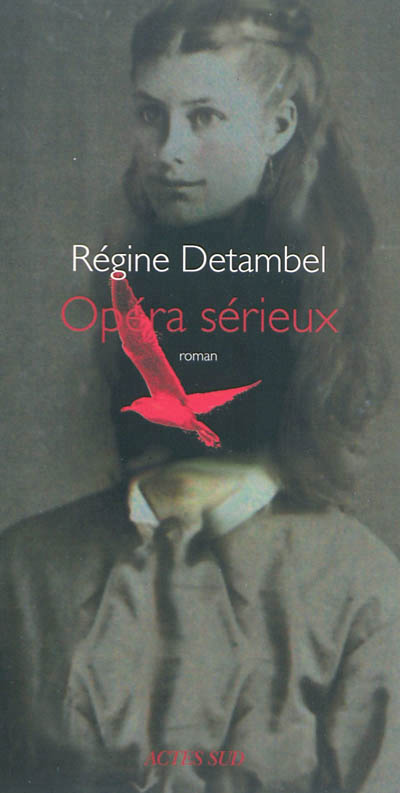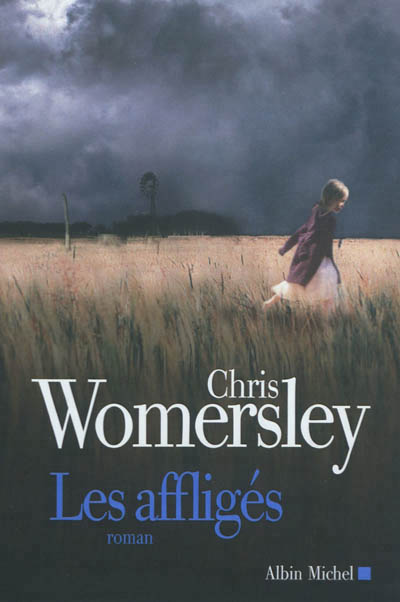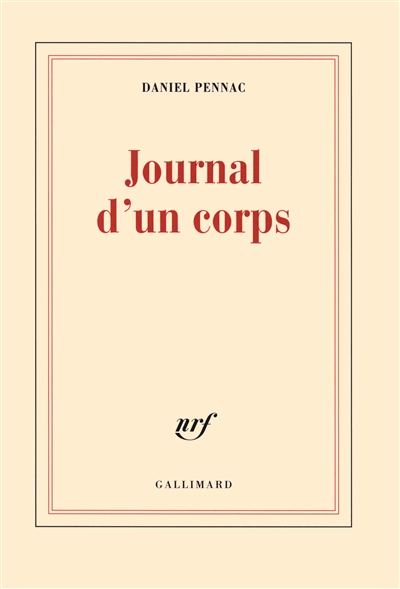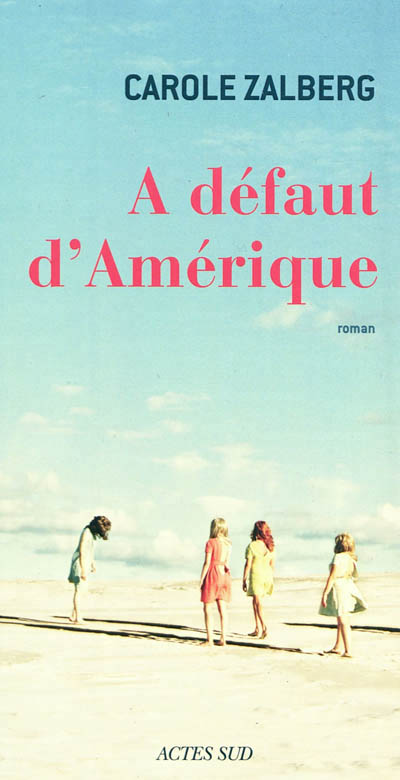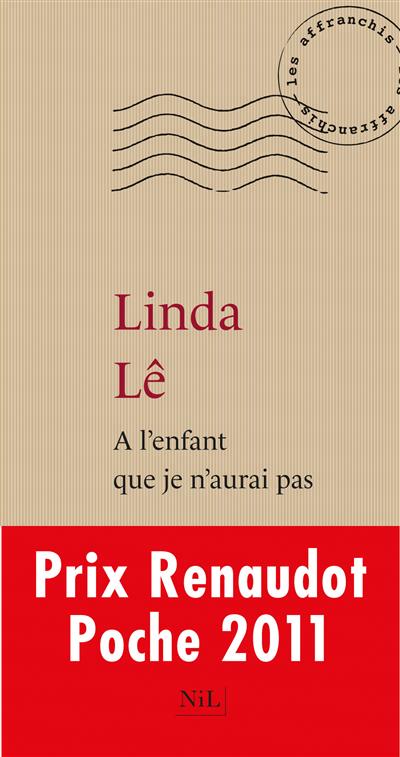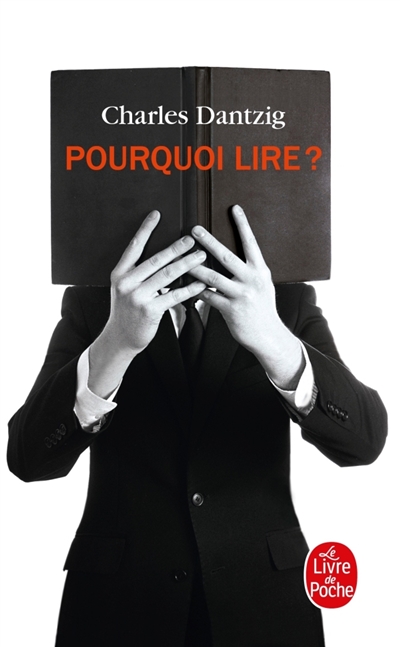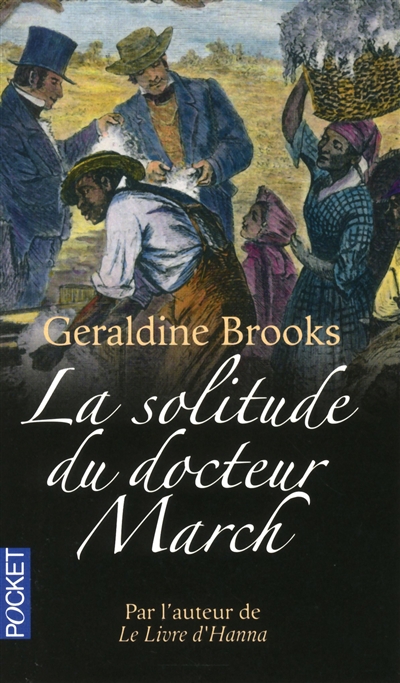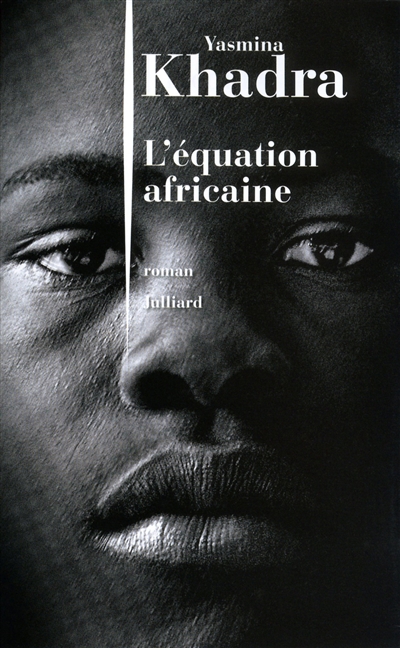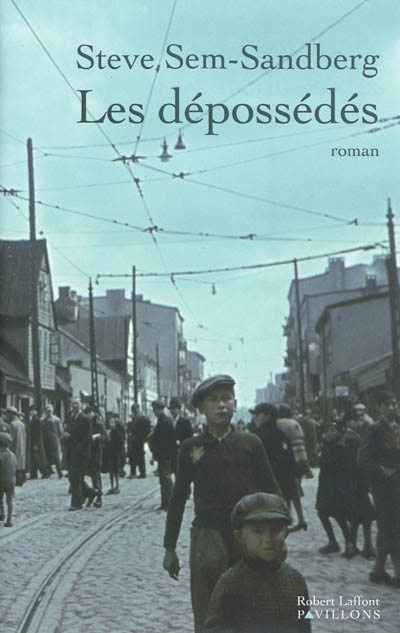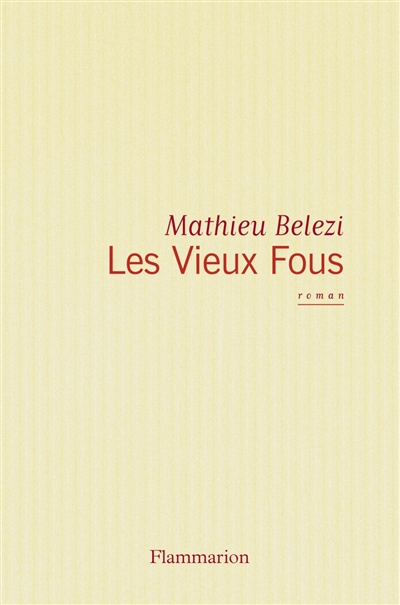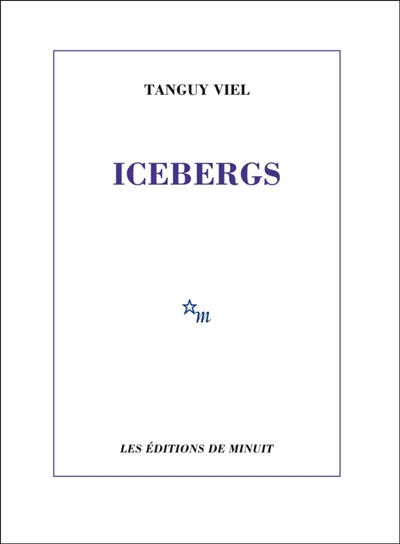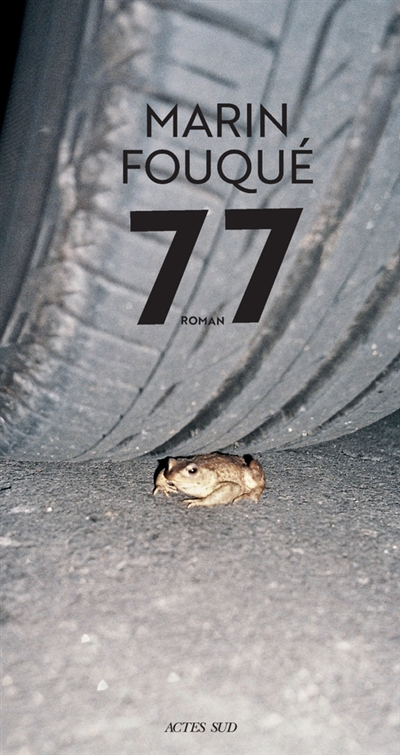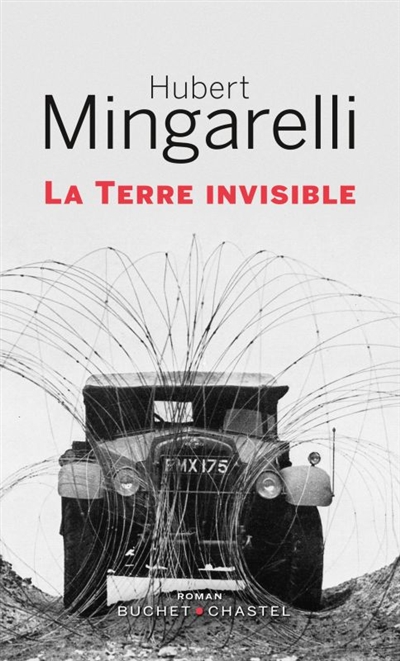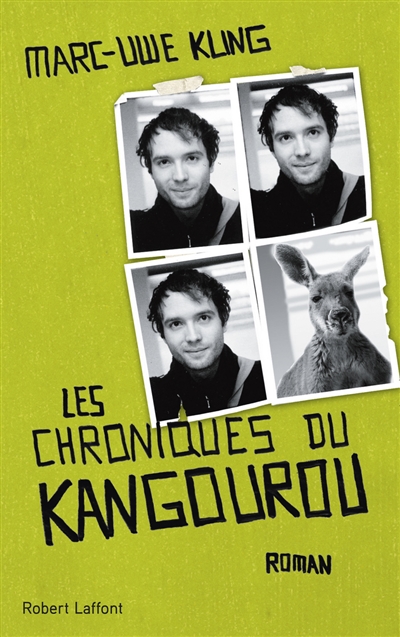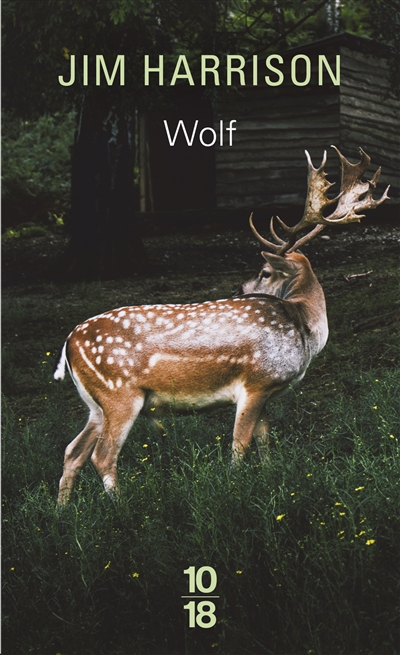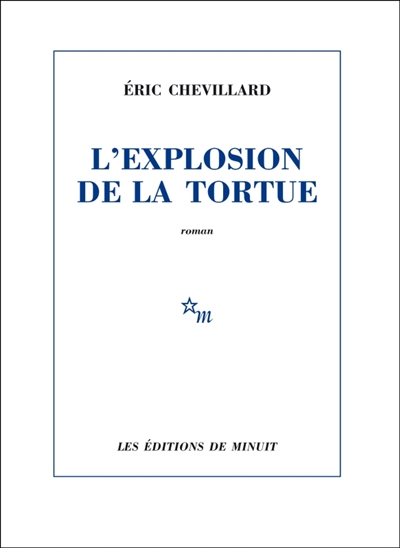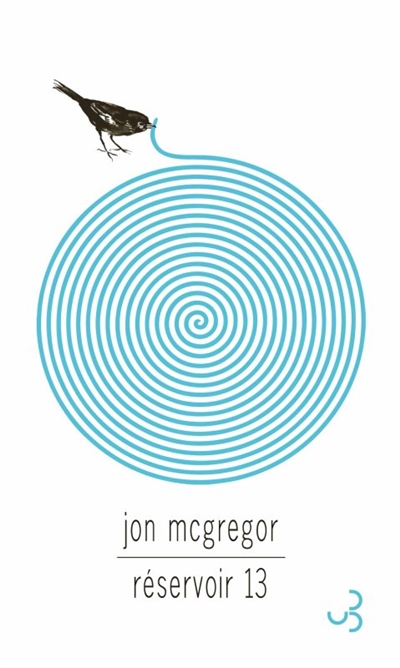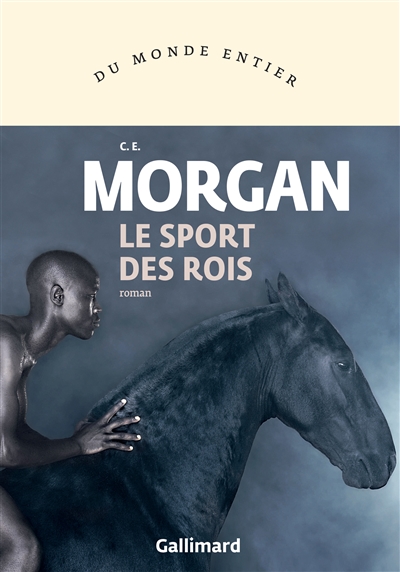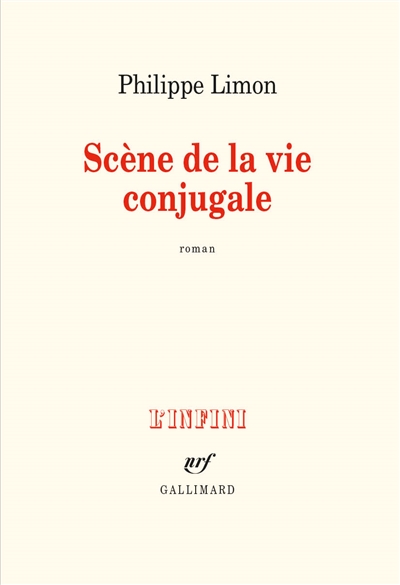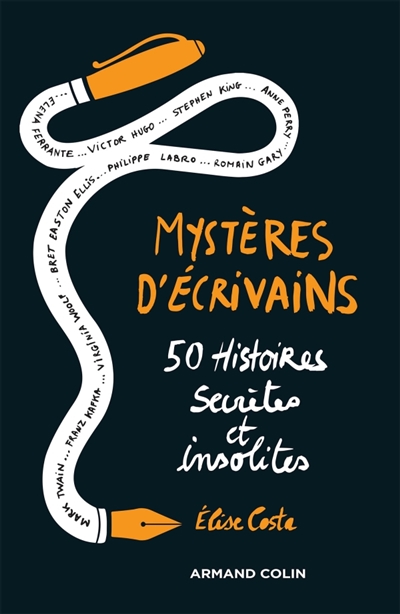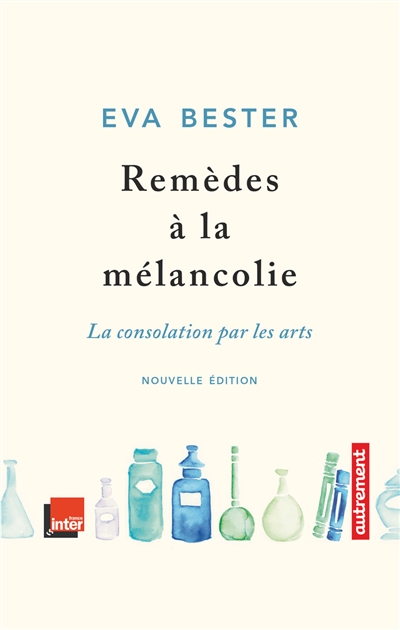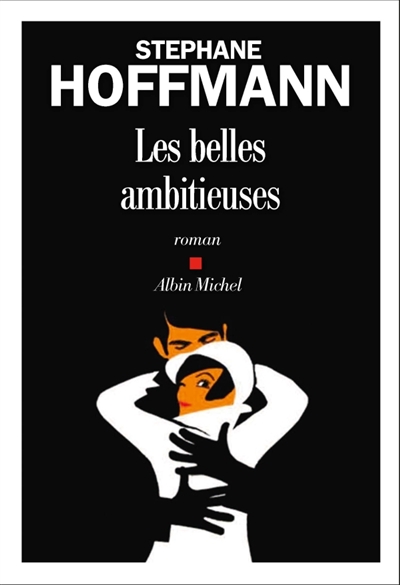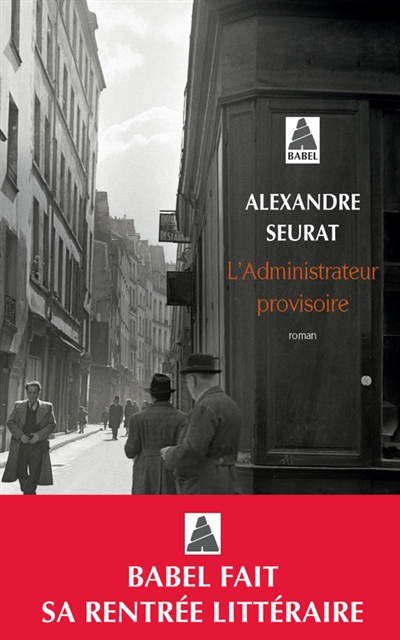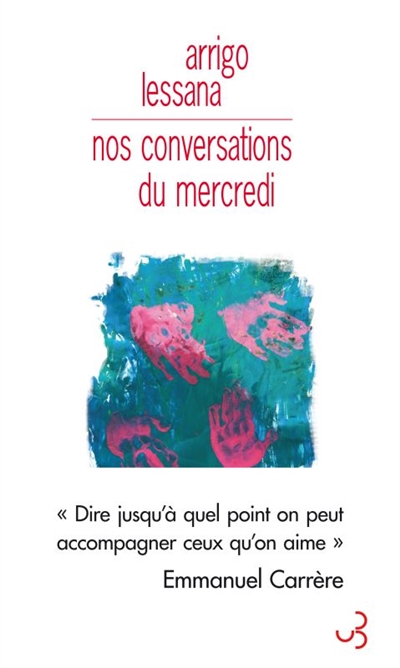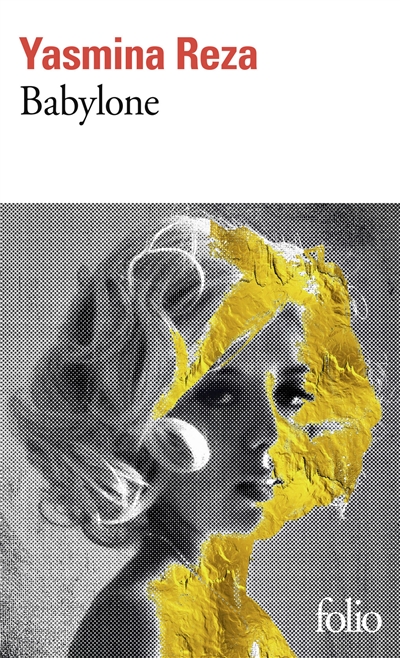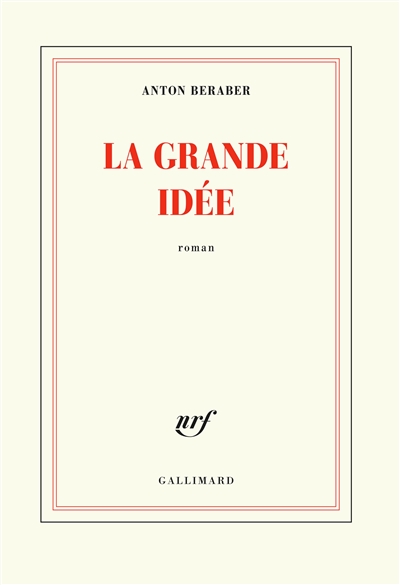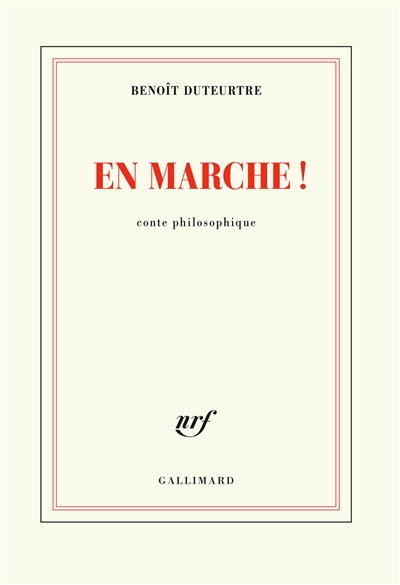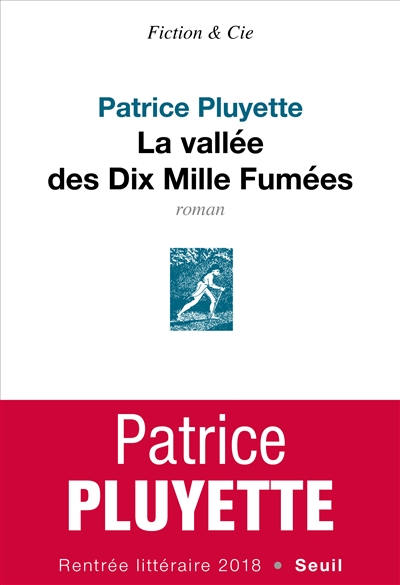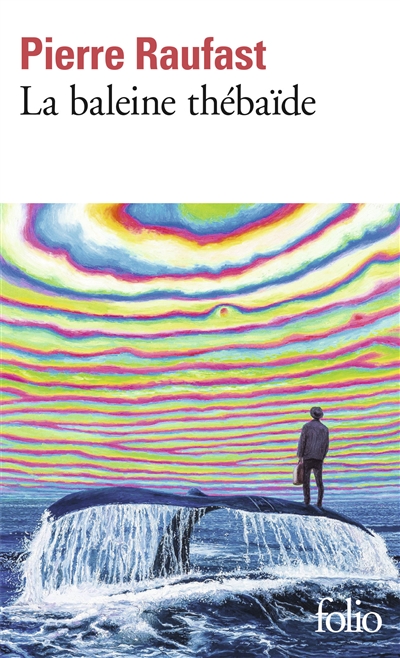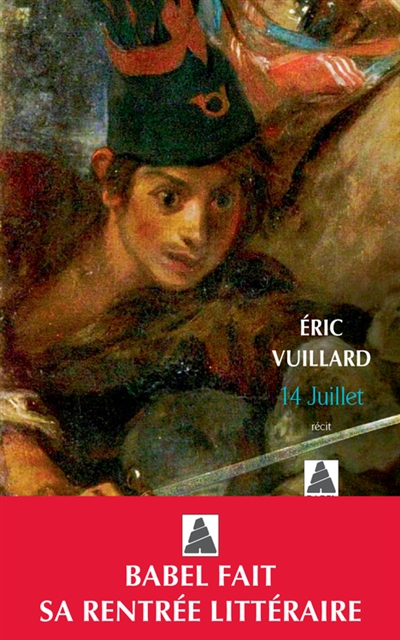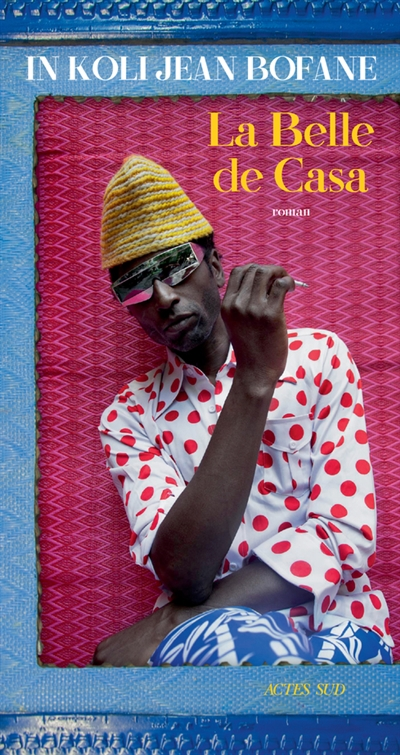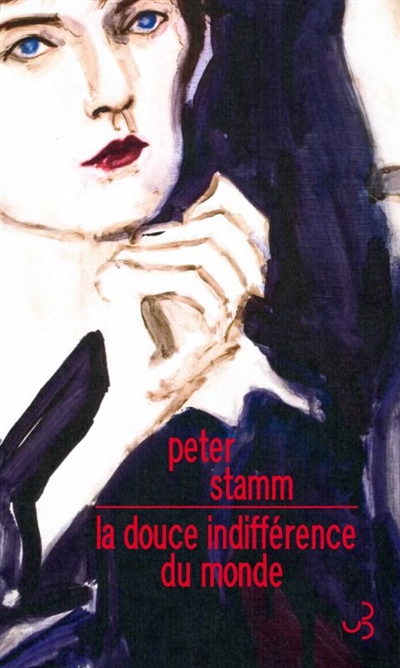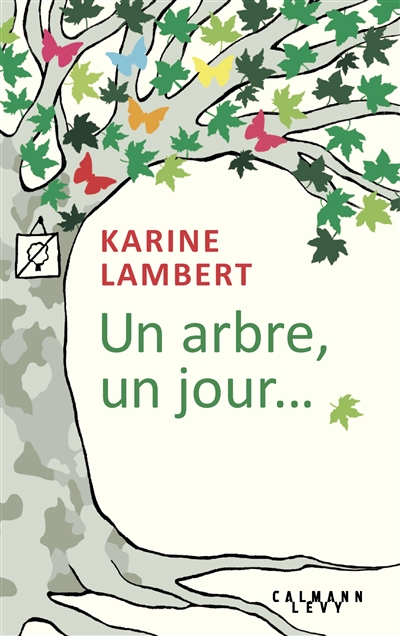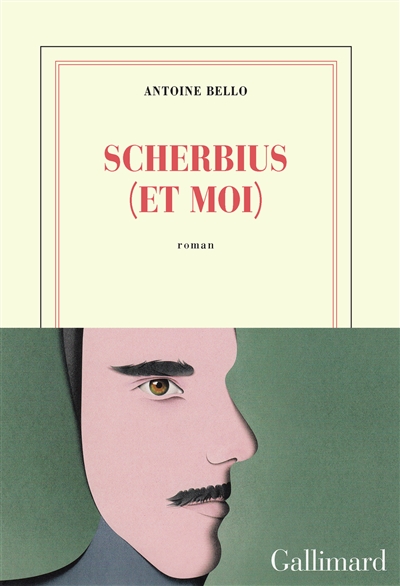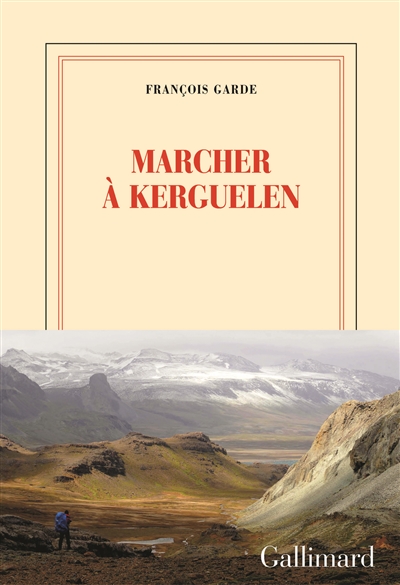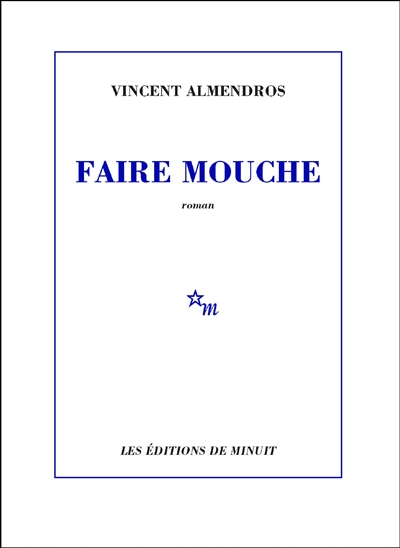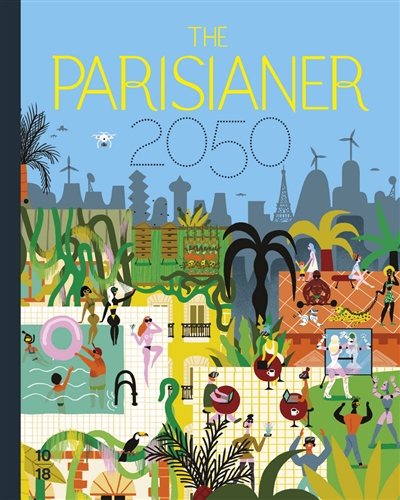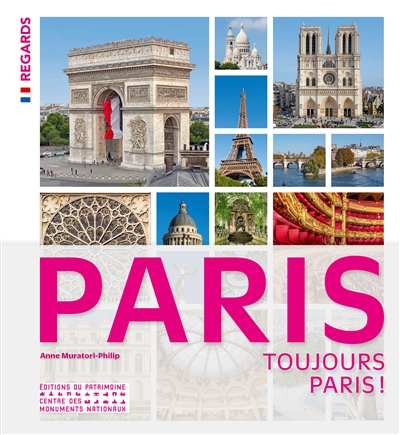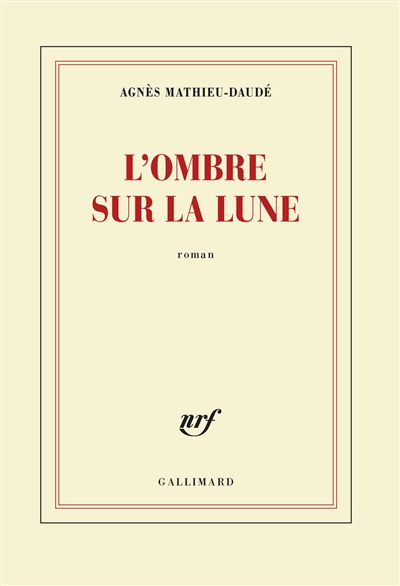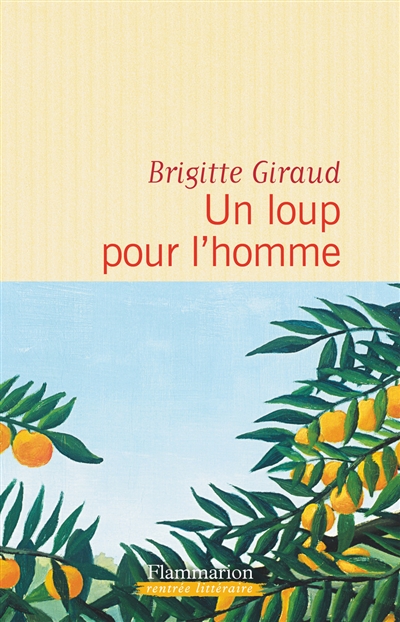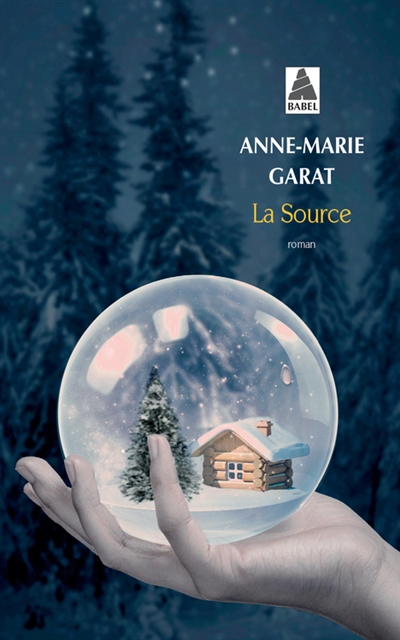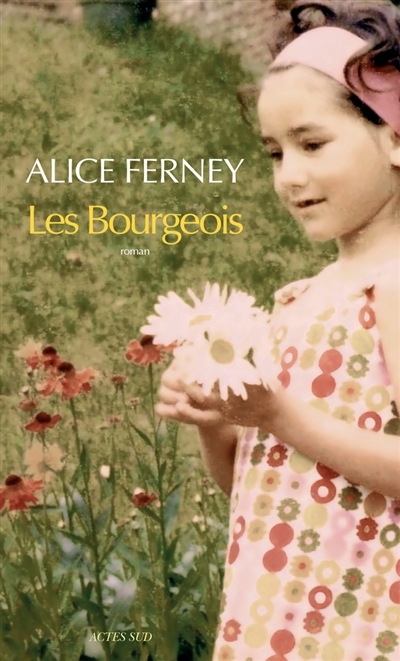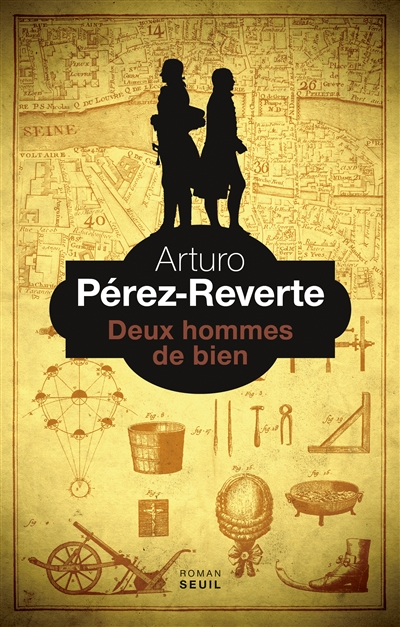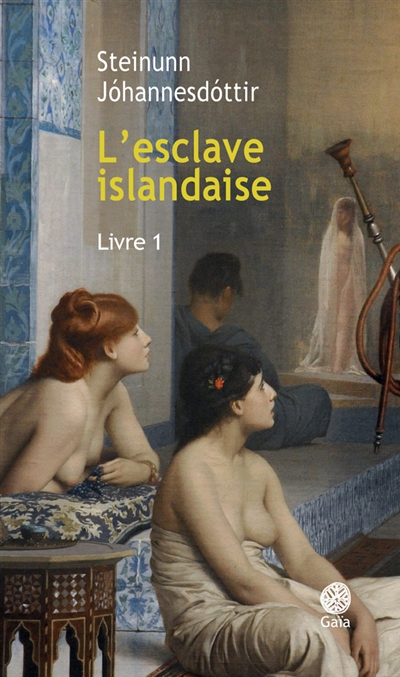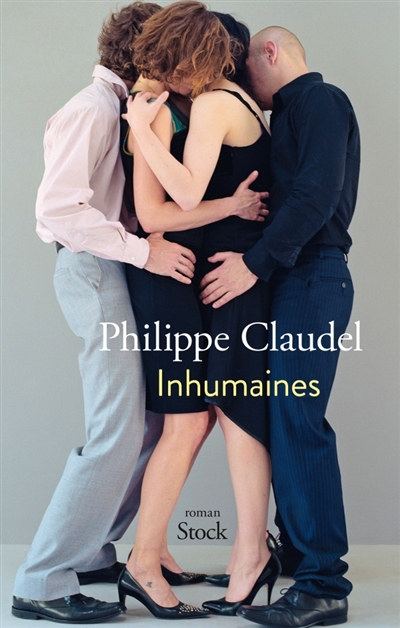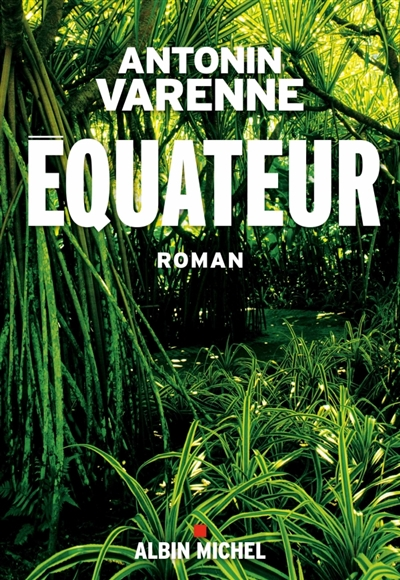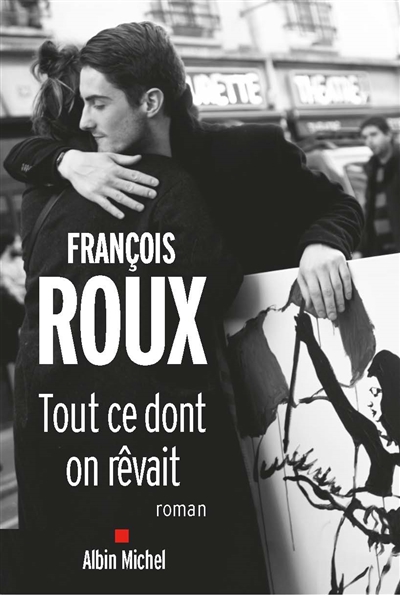Littérature française
Lydie Salvayre
Tout homme est une nuit

-
Lydie Salvayre
Tout homme est une nuit
Seuil
05/10/2017
304 pages, 18,50 €
-
Chronique de
Emmanuelle George
Librairie Gwalarn (Lannion) -
❤ Lu et conseillé par
4 libraire(s)
- Geneviève Gimeno de Maupetit (Marseille)
- Emmanuelle George de Gwalarn (Lannion)
- Serge Vessot de Cultura (Marsac-sur-l'Isle)
- Audrey Andriot de Jonas (Paris)

✒ Emmanuelle George
(Librairie Gwalarn, Lannion)
Quand l’autre surgit, l’étranger arrive, la curiosité est en émoi. Mais quand la peur du « pas de chez nous », du « pas comme nous » murmure aussi à nos oreilles, obtient-elle une réponse ? Dans le piquant roman de Lydie Salvayre, les habitants d’un paisible village sont tout ouïe et en verve, hélas !
Il est arrivé sans prévenir au village, c’est un étranger, un gars « pas du coin ». Il vient de la ville, il s’installe, il vit seul. Et il éveille toutes les curiosités. Surtout au Café des Sports, sorte de grande salle annexe du conseil municipal, où chaque concitoyen (plus ou moins aviné) peut donner de la voix. Lui, c’est un professeur de français, de famille immigrée, la peau brune. Il est atteint d’un cancer et a tout quitté pour se soigner, apprivoiser sa peur, et espérer respirer, au sud, en Provence. Mais les choses ont mal commencé et il raconte : « Le fait est que, dès que j’eus poussé la porte, je perçus dans la salle un mouvement de surprise suivi, sitôt après, d’une réaction de méfiance qui figea les visages. Je dis Bonjour. Nul ne me répondit ». Ce sont des choses qui arrivent diront certains, une sorte d’effet de surprise, d’inattendu qui laisse les gens perplexes. Sauf qu’ici, notre narrateur prend sur lui, commande un café, salue les villageois en traversant la chaussée, fait ses courses à l’épicerie locale, etc., et les choses vont de mal en pis. Car derrière son comptoir, il y a Marcelin qui trône, qui vitupère, qui blague, qui chambre, qui fustige, qui assène ses préjugés, en magistrat, et aussi, de l’autre côté, accoudés au zinc, il y a son public, sa clientèle. Dédé, Émile, Gérard, Étienne et les autres. Aussi bon public qu’acteurs d’une ignoble mise au ban de l’étranger. À mesure que les tournées s’enchaînent et que les jours se succèdent, la curiosité devient malsaine, les propos insultants. La peur, la colère, la haine sont des croûtes suintantes de pus que chacun s’évertue à gratter. Pendant ce temps, l’« accusé » perd confiance, s’isole, doute, prend peur et ne quitte plus la chambre qu’il loue sans une réelle appréhension. Et tout y passe, d’autant plus que, horreur, l’homme, malade, noue quelques amitiés ! « Toujours est-il que ma présence les amenait à se mobiliser fébrilement contre un danger que j’incarnais et dont j’ignorais la teneur, un danger dont ils ignoraient la teneur tout autant que moi, je l’aurais juré, quoiqu’ils feignissent de lui donner un caractère risiblement sexuel. » Progressivement, la colère monte, gronde et semble occuper la vacuité de chacune de ses vies de minables. « On la cultivait, on l’épiçait et on la faisait longuement mijoter. Puis on la dégustait, à petites bouchées d’abord, puis à grosses lampées, puis à très grosses. On s’en pourléchait. On s’en empiffrait. Et tout le reste devenait insipide au palais. » La question se pose du côté de l’accusé : comment réagir ? Plaider sa cause ? Faire acte de résistance ? Ici, la farce est incarnée et terrible car diablement réaliste. Elle fait écho à de tristes heures de l’Histoire, tout comme à d’insupportables actualités. L’alternance de points de vue et de registres de langue renforce la pertinence du propos. Le roman de Lydie Salvayre fait mouche et nous cloue le bec : désespérément juste, joyeusement malin.