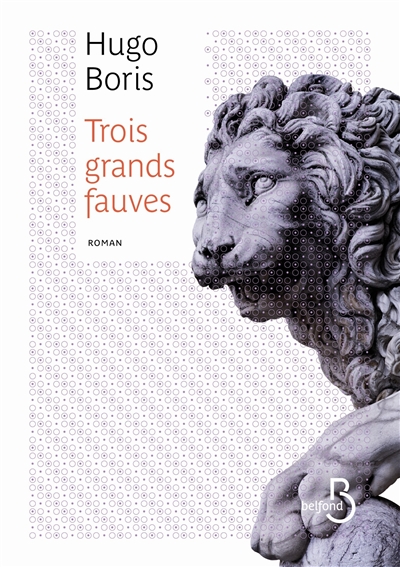En un court roman, développer une filiation imaginaire entre Danton, Hugo, Churchill, trois monstres sacrés de l’Histoire et dresser leurs portraits avec acuité : voilà le projet d’Hugo Boris, audacieux et remarquable. Narguer la mort et dévorer la vie, tel est le credo de ces héros. Sur le chemin de l’échafaud, Danton, effrayant de laideur n’entend-il pas son ventre qui crie famine ? Ogre inépuisable et poignant, Hugo est-il jamais rassasié de nourriture, d’écriture et de femmes ? Monstre guerrier, alcoolique et dépressif, Churchill ne souffre-t-il pas dès l’enfance du désamour parental comme d’une blessure d’où puiser une force débordante de résister ? Ici, à chaque instant, à des siècles différents, la grande faucheuse rôde. Pourtant, dans ces trois portraits volontairement parcellaires, aux sous-titres malicieux et gouailleurs, l’amour, la fraternité et l’humour ont souvent le dernier mot. Inattendu, rythmé, émouvant, le nouveau roman d’Hugo Boris est tout simplement brillant.
Page — Trois Grands Fauves est une sorte d’hydre à trois têtes. C’est un roman qui invite à rencontrer Danton, Hugo et Churchill, trois monstres sacrés, trois hommes illustres qui ont marqué l’Histoire à des siècles différents. Pourquoi ces trois grands hommes ? D’où vient l’intérêt que vous leur portez ?
Hugo Boris — J’ai commencé à écrire ce roman il y a treize ans. Tout est parti de Danton. Vous savez à quel point l’imagination est encline à emprunter toutes sortes de détours avant de se constituer en une idée plus ou moins originale. Trois Grands Fauves est justement issu de l’un de ces caprices de la pensée. À l’époque, je préparais le concours d’entrée à l’École Louis Lumière et je prenais des cours du soir. À partir de 19 h 00, je suivais un cours qui durait trois heures. Je ne dînais qu’après. Jusqu’à 22 h 00, je restais le ventre vide. Un soir, à l’un de ces cours, j’ai ressenti une faim de plus en plus forte. L’angoisse a commencé à me tenailler, j’étais de plus en plus fébrile, de moins en moins en mesure de me concentrer sur les propos du professeur. Pour tenter de tromper cet insupportable manque, j’ai laissé mon esprit divaguer et, comme il fallait s’y attendre, mes rêveries m’ont ramené à l’idée de nourriture. Je me suis alors demandé à quoi pouvait ressembler le comble de l’ironie pour quelqu’un d’affamé, et je me suis dit qu’il n’existait sans doute pas de situation plus saugrenue que de se trouver sur le chemin de l’échafaud sans pouvoir empêcher son ventre de crier famine. Avoir faim au moment où on s’apprête à séparer votre tête du reste de votre corps, subir la tyrannie de la mécanique du corps alors que ça n’a plus la moindre importance : quelle cruelle ironie ! La figure de Danton s’est imposée à moi, puis, par une intuition que je ne saurais expliquer, celles de Victor Hugo et Winston Churchill. Je me suis documenté sur chacun de ces personnages et je leur ai trouvé quantité de points communs, qui justifiaient à mon sens de les réunir au sein d’un roman. Jean-Marc Hovasse, le biographe le plus méritant de Victor Hugo, a calculé qu’il faudrait dix années, à raison de quatorze heures par jour, pour lire la totalité de ce qu’il a écrit ; et vingt ans, toujours au même rythme quotidien de quatorze heures, pour lire tout ce qui a été écrit à son sujet. Je n’ai pas relevé le défi des quatorze heures chaque jour pendant vingt ans, mais j’ai quand même mené d’abondantes recherches sur chacun de mes trois fauves. […]
Page — Le livre prend la forme de trois récits qui s’intéressent à des aspects méconnus ou inattendus de Danton, Hugo et Churchill. Les trois récits se répondent fréquemment, parce que ces trois fauves, vous l’avez dit, partagent nombre de points communs, notamment un monstrueux appétit de vivre…
H. B — Incontestablement, ce sont des monstres ! Ils ont tous trois en commun d’avoir échappé à la mort lorsqu’ils étaient enfants. De cette fréquentation de la mort alors qu’ils étaient très jeunes, ils ont puisé une force dévorante, un appétit incroyable pour la vie, qui les a amenés, entre autres choses, à devenir ce qu’ils sont devenus. Mais aussi à vampiriser leur entourage et à devenir, pour celui-ci, monstrueux. L’histoire de Danton commence sous l’Ancien Régime, en 1763. Il est un petit garçon qui joue dans un jardin, non loin de sa première nourrice qui n’est autre qu’une vache, comme le veut la coutume champenoise quand une mère est trop faible pour allaiter son enfant. Ce jour-là, il se dirige vers l’animal afin de se nourrir au pis, quand surgit un taureau qui le charge, le renverse et lui élargit la lèvre. L’anecdote est fameuse, mais ce que l’on sait moins, c’est que, trois ans plus tard, Danton décide de venger l’affront en s’attaquant à un malheureux taureau qui se trouve là par hasard. Pour le coup, il est de nouveau malmené et se fait écraser le nez. Quelques années plus tard encore, il est piétiné par des porcs qu’il tentait d’écarter de son chemin. Danton compensait sa gueule impossible par une stature imposante, athlétique, dont il a façonné l’aspect à force d’exercice, ce qui n’a pas tardé à être la cause d’autres maux. En nageant un jour dans une rivière – il faisait une pratique intensive de la natation –, il prend froid, sa fièvre se surinfecte et il attrape la petite vérole, qui achève de ravager son apparence. Physiquement, Danton était un monstre, mais de cette jeunesse exposée à mille périls, il a puisé une extraordinaire énergie.
Danton aura rejeté la mort tout au long de sa vie, il n’aura cessé de la défier et de la vaincre. Encore cette anecdote emblématique du rapport qu’il entretient à la mort. En 1793, la Convention l’envoie à la forteresse de Condé pour qu’il établisse un rapport sur l’état des armées. Mais une sinistre nouvelle concernant la santé de sa femme le rattrape. Son beau-frère le fait prévenir que Gabrielle, son épouse, qui vient de mettre au monde un quatrième fils, est sur le point d’expirer. Danton se précipite dans une voiture de poste, mais quand il rejoint Paris, il est trop tard. Sa femme a déjà été inhumée. Alors, à la nuit tombée, il se rend devant le cimetière Sainte-Catherine, force le fossoyeur à le laisser entrer et à déterrer le cadavre de Gabrielle. Puis il fait venir au bord de la fosse le sculpteur de Mirabeau
et Robespierre, Claude-André Deseine, à qui il demande de pratiquer un moulage du visage de son épouse chérie afin d’en conserver un ultime souvenir. Mon livre retrace les parcours de trois personnages qui ont refusé la mort, qui l’ont évitée, qui en sont revenus. Trois survivants qui se sont crus immortels.
Page — Vous vous focalisez sur quelques instants emblématiques de la vie de vos personnages, et vous insistez sur ce qui vous a tout spécialement frappé chez chacun d’eux…
H. B — Exactement. Il n’était évidemment pas question de rédiger trois biographies. Le parti pris, c’est plutôt de composer trois anti-biographies. Là où une biographie conventionnelle, comme celle de Jean-Marc Hovasse sur Victor Hugo s’attache à une forme d’exhaustivité, je me concentre, moi, sur une poignée de moments clés. Je procède à l’inverse de l’entreprise biographique classique. Je mets en perspective ces moments clés de façon résolument subjective, avec mon regard et mon point de vue personnel. Mais la vie est aussi comme ça, la vie est constituée de moments très brefs qui nous constituent, qui comptent bien davantage que le reste. Pour autant, il ne s’agit pas d’une simple juxtaposition de trois destinées exceptionnelles. J’ai aussi cherché à établir une sorte de filiation imaginaire entre ces trois personnages, afin de donner naissance à un quatrième, qui serait ce qu’on pourrait appeler le « grand homme ». Cette notion de grand homme me fascine, ce besoin que certains éprouvent d’être acclamé par la foule alors qu’ils se montrent incapables d’aimer un fils, leur épouse, ou de s’en faire aimer.
Page — Vos récits sont trépidants. Ils sont aussi très émouvants pour la raison que vous venez d’évoquer. Au regard de votre travail de romancier et de la documentation accumulée, quelle définition donneriez-vous de la notion de grand homme ?
H. B — Je pense qu’elle est à chercher dans ce refus de la mort, dans cet engagement du corps. Quelque chose me fascine, qui je crois irrigue chacun de mes livres : le rapport à l’animalité, le fait que, dans nos sociétés contemporaines toujours plus submergées de technique, l’animalité persiste à se manifester avec une telle prégnance. Sans doute s’exprimait-elle de manière plus visible aux XVIIIe et XIXe siècles, mais l’animalité imprègne encore très largement nos sociétés, et tout spécialement chez les hommes de pouvoir, chez ces gens qui, en vous serrant la main, vous écrasent les doigts, ou qui vous parlent tout près du visage, bien plus près que ne le veut la bienséance. Il y a là comme une volonté de prendre le pouvoir, d’exercer sur l’autre une emprise. Il s’agit en quelque sorte d’empiéter sur le territoire de l’autre.