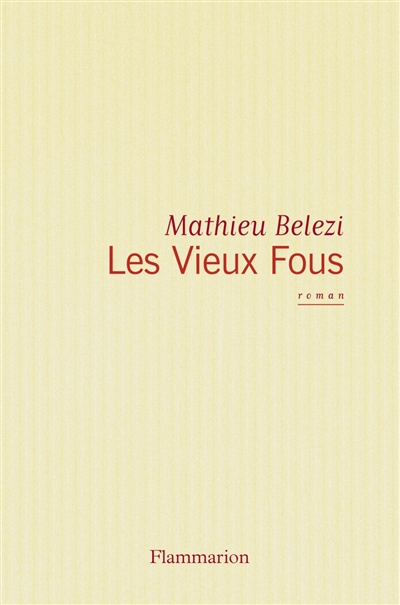Page : Dans Les Vieux Fous, on écoute la voix d’un certain Albert Vandel qui s’exprime avec beaucoup de virulence. On réalise assez vite que, bien plus qu’un personnage, il incarne tout un pan de l’Histoire de France et de l’Histoire de l’Algérie, il incarne la colonisation ! Pourquoi avoir opté pour ce procédé littéraire ?
Mathieu Belezi : Il n’y a pas de procédé littéraire. Vous savez, j’essaye d’être le plus innocent, le plus libre possible quand j’écris. Simplement après C’était notre terre, où six voix s’invectivaient tout au long du roman en un maelström verbal à la fois poétique et réaliste, musical et emporté, j’avais envie de poursuivre mon exploration de ces 130 années d’Algérie coloniale, et j’avais par-dessus tout le désir de lever enfin le voile sur ce que la France s’obstine à tenir soigneusement dans l’ombre, à savoir la folie de ces décennies de conquêtes au sein d’un xixe siècle convaincu de son bon droit civilisateur et pacificateur. Mais comment faire ? J’ai cherché longtemps un personnage… longtemps…, avant que finisse par résonner en moi cette voix hors normes d’un homme de 145 ans que je sentais capable d’incarner à lui seul la folie de ces 130 années de colonisation. L’écriture, baroque, torrentielle, inventée dans C’était notre terre, a tout naturellement retrouvé sa place dans Les Vieux Fous, son souffle, sa musique. Sans doute s’est-elle engagée sur des voies encore plus démesurées, plus baroques, plus ubuesques.
P. : C’est une forme singulière, novatrice, qu’on n’a pas l’habitude de rencontrer dans la littérature française contemporaine…
M. B. : C’est au prix de cette liberté-là que je me suis engagé dans ce travail, d’abord avec C’était notre terre, ensuite avec Les Vieux Fous. Écrire des chapitres de 20, 30, 40 pages comme des compositions musicales, avec contrepoints et répétitions, passant de l’adagio d’une symphonie à l’allegro d’une sonate, c’est se libérer de bien des entraves, c’est se donner des ailes. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout au long de la rédaction des Vieux Fous, je me suis tenu dans cette transe musicale, écrivant chaque jour quatre ou cinq heures, et relisant à haute voix pour traquer les fausses notes.
P. : Cela se ressent, on plonge dans votre écriture, on est emporté par les histoires que raconte Albert Vandel. Et on n’en sort pas indemne. On se demande ce qui est vrai, ce qui est faux. On s’attache à des noms ; cachent-ils des secrets, sont-ils des clins d’œil à quelques références littéraires ?
M. B. : Par exemple, le nom du personnage Vandel, je l’ai pris dans le récit de voyage d’Eugène Fromentin Une année dans le Sahel, où l’on voit galoper auprès de Fromentin une sorte d’aventurier qu’il nomme Louis Vandell. Pour le reste, je laisse le lecteur démêler le vrai du faux.
P. : Parlons à présent de la violence des massacres et des actes atroces commis contre des personnes considérées comme inférieures ?
M. B. : Oui, vous avez raison de préciser « considérées comme inférieures ». C’est le postulat de départ qu’il faut avoir en tête pour comprendre la colonisation européenne : la race supérieure des pays européens s’en va porter les lumières aux races inférieures d’Amérique ou d’Afrique. Ce que je tiens aussi à dire, c’est que je n’ai pas inventé la violence de la conquête. Tout est vérifiable, dans les textes littéraires (Choses Vues de Victor Hugo, par exemple), comme dans les lettres des militaires à leurs familles (citons celles du Maréchal de Saint-Arnaud).
P. : La violence va crescendo, vous rendez avec force détails chacun des moments de la colonisation, alternant des chapitres ancrés dans le présent du printemps 1962, lorsque Vandel et ses dix vieux fous de compagnons enfermés dans un bordj au-dessus d’Alger tentent une dérisoire résistance, et des chapitres où la mémoire d’Albert Vandel s’égare toujours plus profondément dans les méandres d’un passé colonial peu glorieux. Pensez-vous faire œuvre d’historien en révélant ainsi au lecteur des pans trop mal connus de cette histoire coloniale ?
M. B. : Mais je ne veux surtout pas prendre la place de l’historien. Je suis avant tout un écrivain, et je fais un travail d’écrivain, c’est-à-dire que je m’octroie la liberté d’écrire sur n’importe quel sujet, avec l’innocence et le culot dévastateur de la littérature.
P. : Pourtant vous vous êtes abondamment documenté…
M. B. : J’ai passé quelques mois dans les bibliothèques, c’est vrai, sans trop savoir sur quoi j’allais tomber ! Ce qui est formidable, c’est que durant la conquête de l’Algérie, à peu près quarante années de guerre entre 1830 et 1870, les militaires écrivaient à leurs familles demeurées en France et racontaient au jour le jour les combats qu’ils livraient contre les tribus, leurs vies quotidiennes dans les montagnes de Kabylie et les marécages de la Mitidja. J’ai donc accumulé pas mal de documentation. Mais ensuite, lorsque je me suis installé à ma table et que le personnage d’Albert Vandel a pris la parole, je me suis efforcé d’oublier ce que j’avais appris, enfin oublier n’est peut-être pas le terme exact, je devrais plutôt dire enfouir, oui, enfouir au plus profond de moi la mémoire de ces témoins pour en faire ma propre mémoire, et, par le tour de force de l’écriture, la mémoire d’Albert Vandel.
P. : Revenons au personnage principal du roman, Albert Vandel. C’est un personnage vraiment haut en couleur, sûr de son bon droit de colon, fanfaron, prêt à toutes les infamies, mais capable d’actes héroïques, outrancier comme on ne sait plus l’être, coléreux, autoritaire… et obsédé sexuel, courant après toutes les femmes de la colonie…
M. B. : Parce que Vandel est un méditerranéen, et que pour tout méditerranéen l’acte sexuel est la forme symbolique de la puissance masculine. On est fier de son sexe, on le nomme de mille façons, on en mesure la longueur, ce que ne cesse de faire Albert Vandel.
P. : Mais d’aucuns pourraient vous reprocher d’en faire trop, d’être trop démonstratif. Que leur répondez-vous ?
M. B. : Que je ne suis pas dans la démonstration mais dans la démesure. Dans la démesure de la littérature qui permet tout. Vous savez, ces 130 années d’Algérie coloniale sont encore très mal connues ; l’excès était partout sur ces terres de barbarie (comme on disait à l’époque) : le grotesque, l’abjection, l’héroïsme, la cruauté.
P. : C’est un livre qui ne laissera pas indifférent…
M. B. : J’espère en tout cas qu’il bousculera le lecteur, qu’il l’entraînera là où il n’avait peut-être pas l’intention d’aller.
P. : Votre dernière phrase est une sorte d’apothéose, qui résume le livre, permet d’en comprendre en effet tous les excès !
M. B. : Jusqu’à la fin je ne savais pas comment le livre se terminerait. Et pourtant c’est un moment important le point final. Il ne faut pas que le roman rate sa sortie. La phrase m’est venue en dormant. Réveillé d’un coup, je suis allé écrire la phrase en question, et puis je me suis recouché et rendormi. Et le lendemain matin, en relisant ce que j’avais maladroitement griffonné sur une feuille, j’ai compris que le roman était enfin terminé.