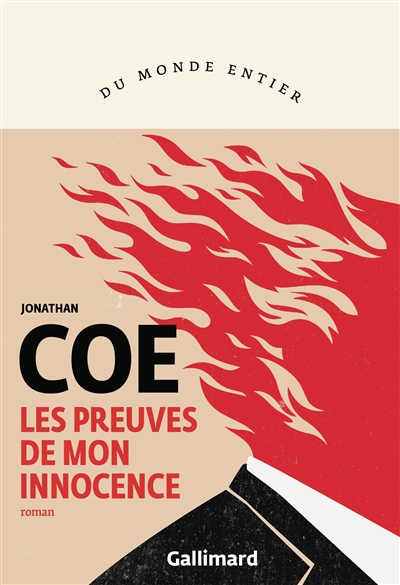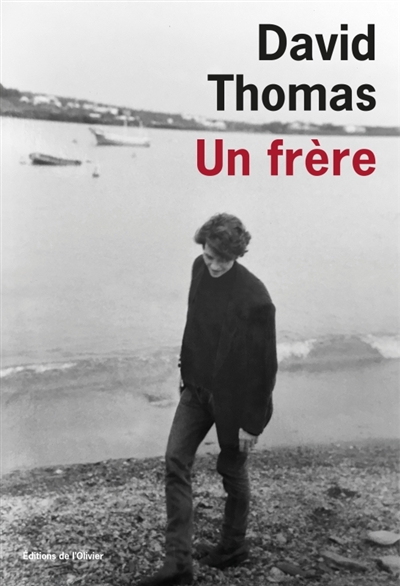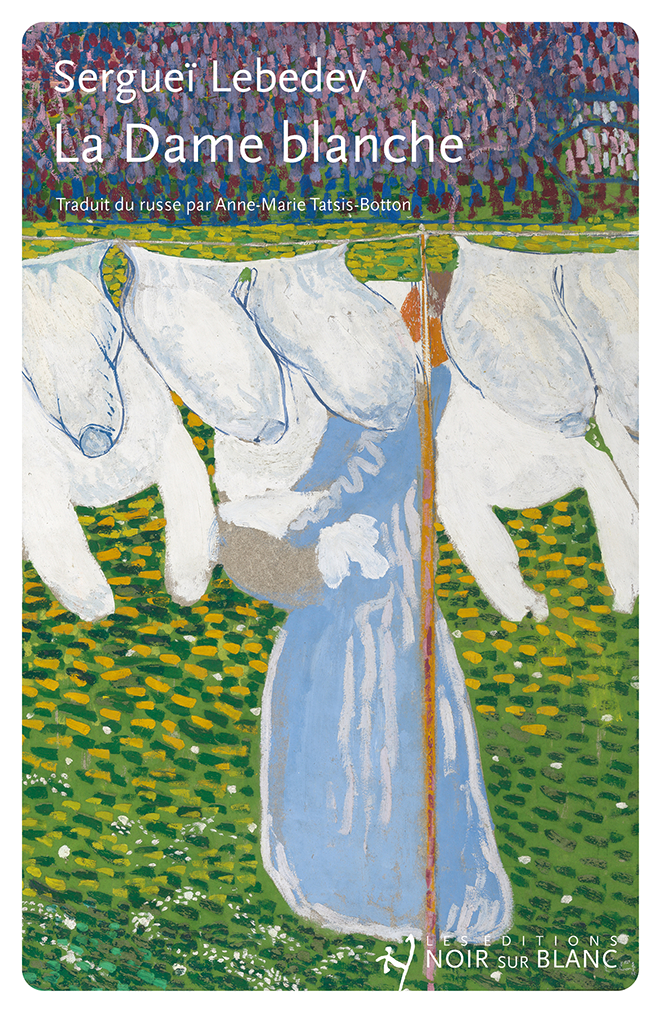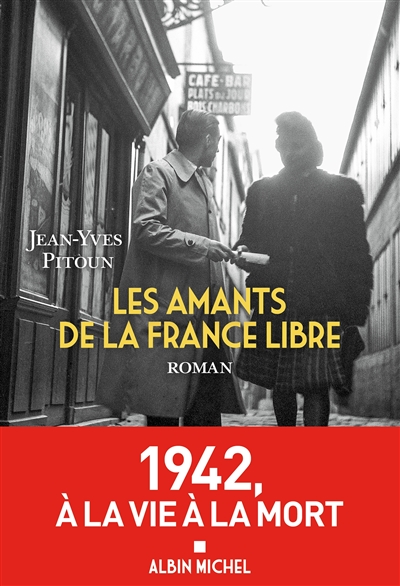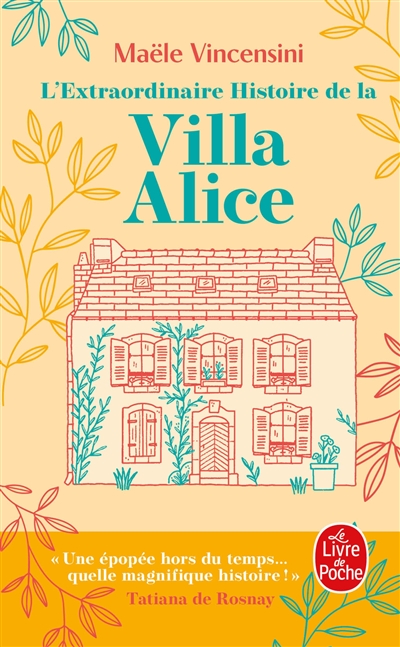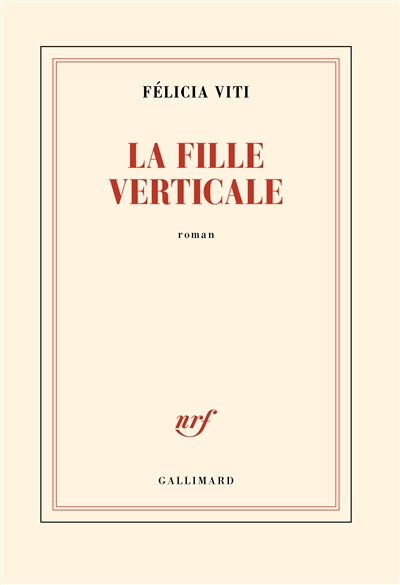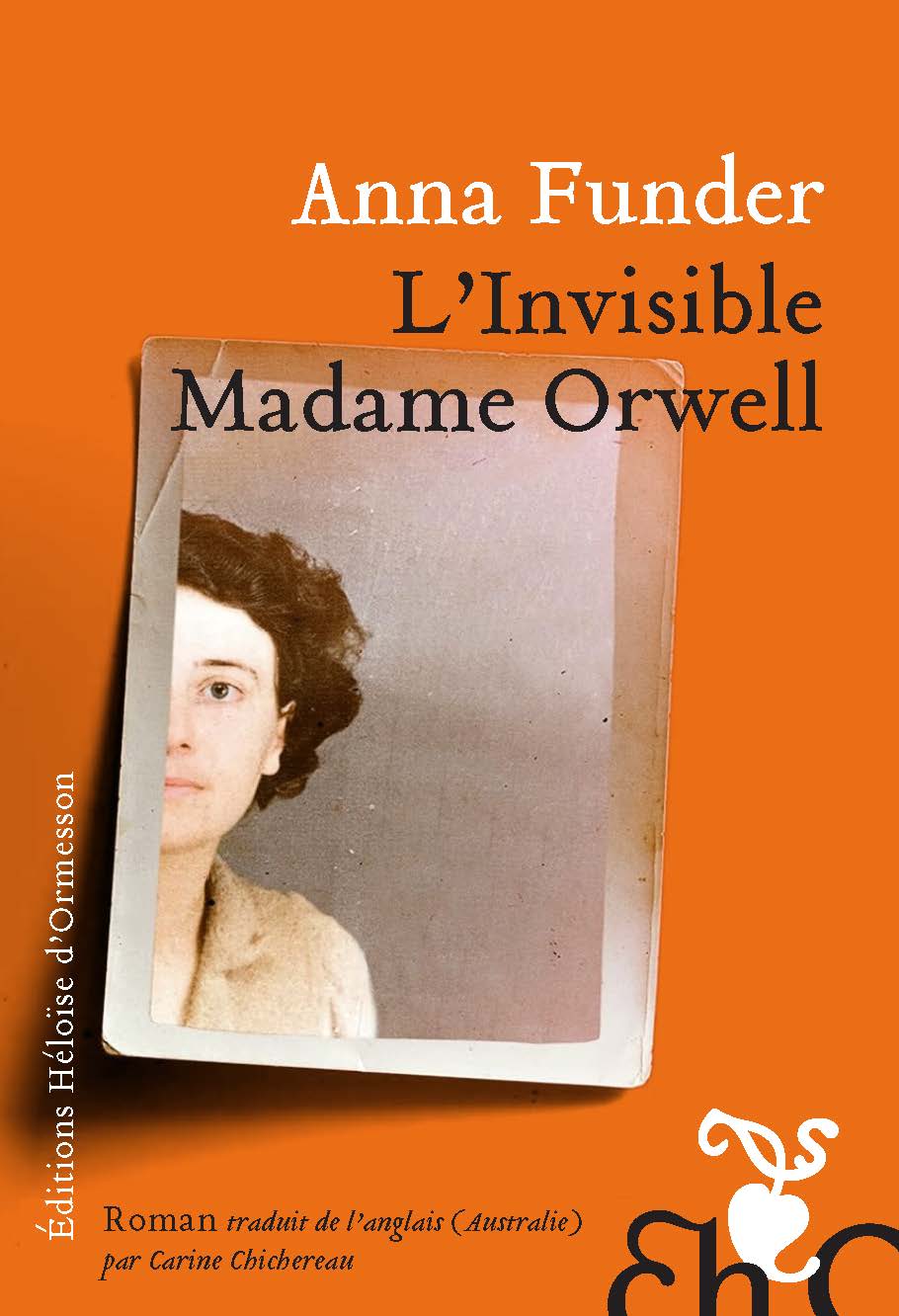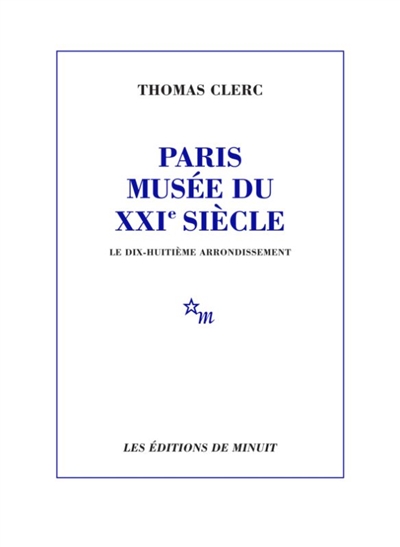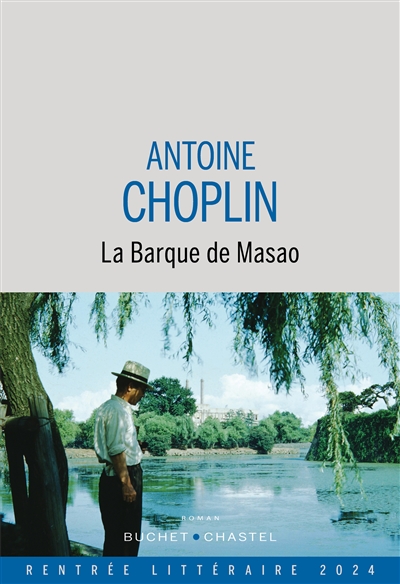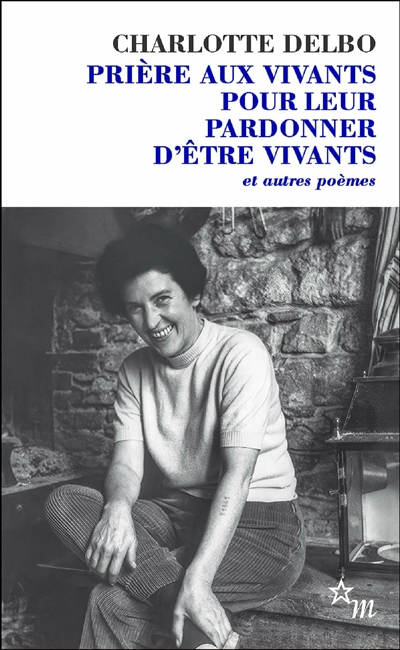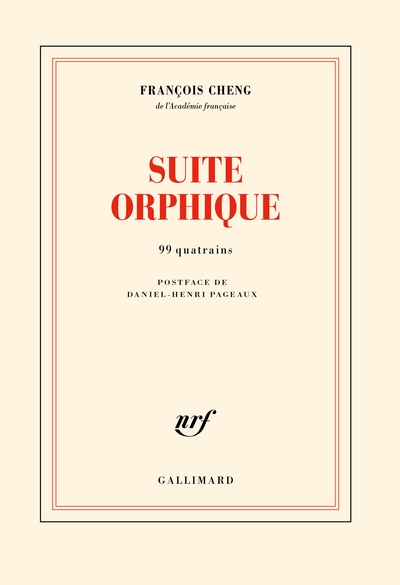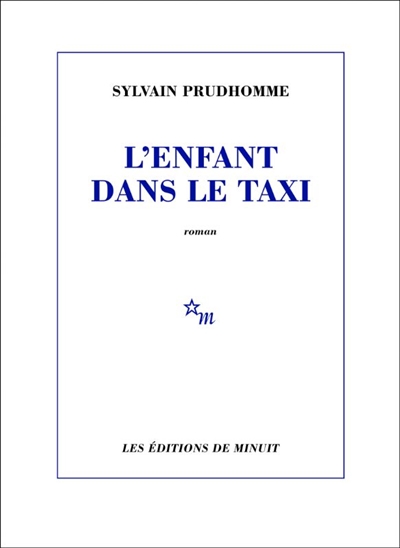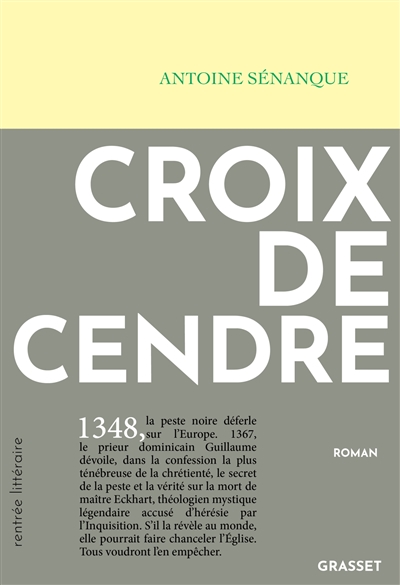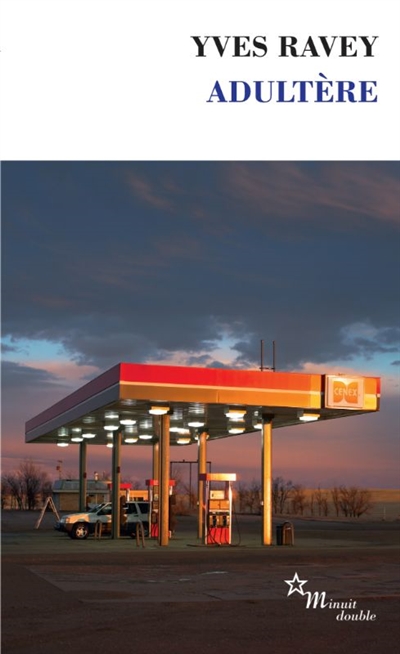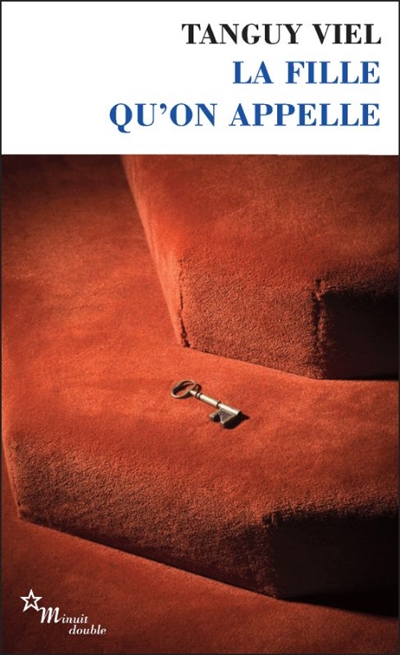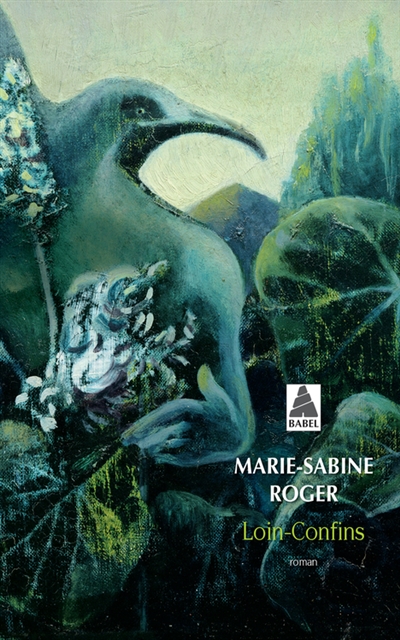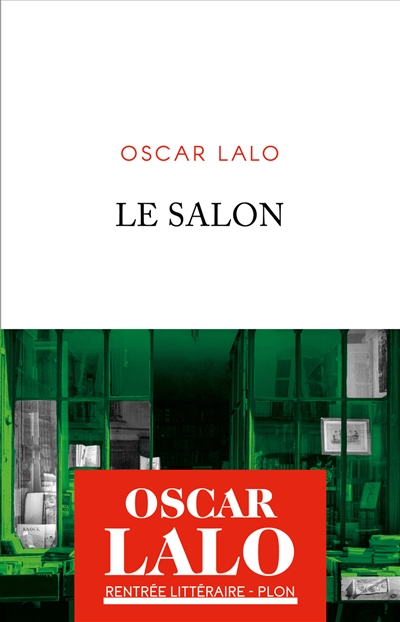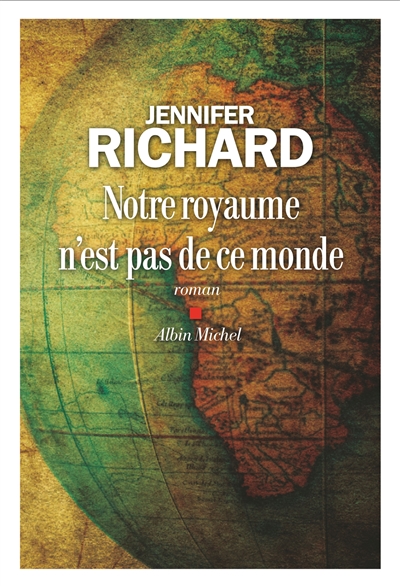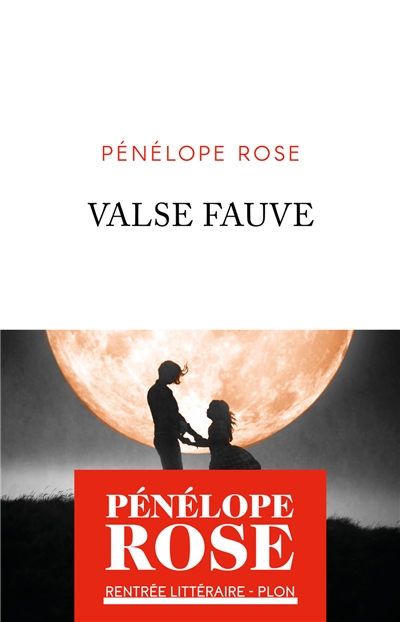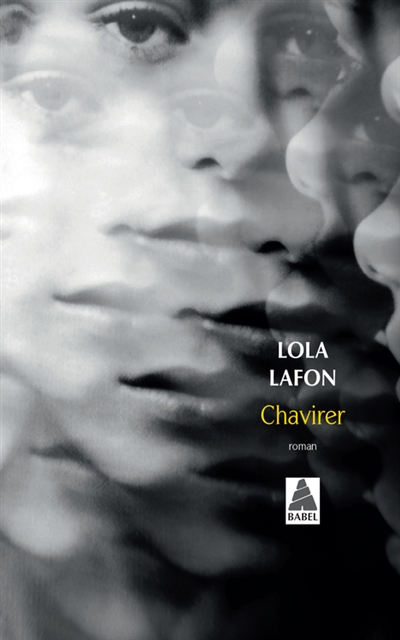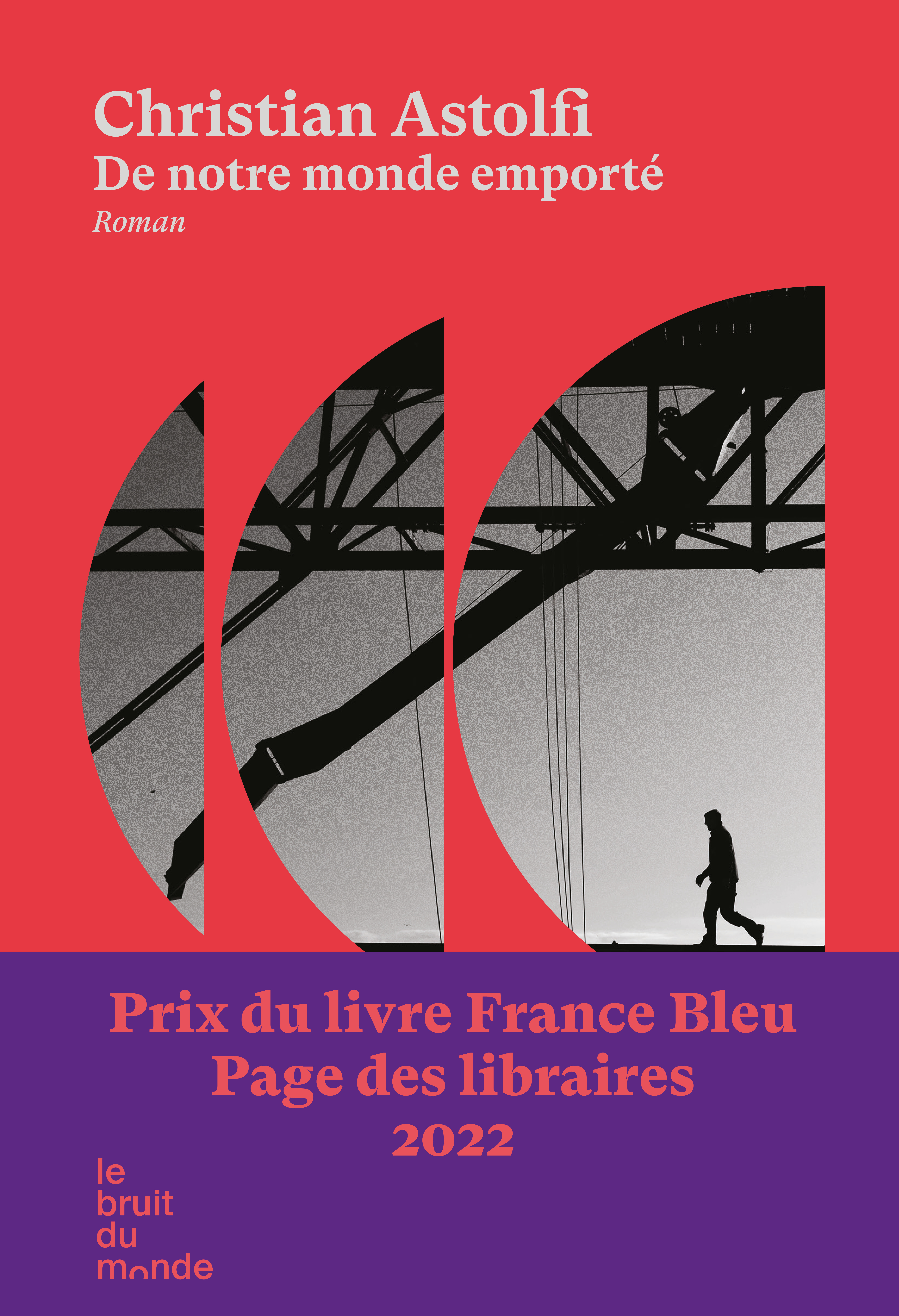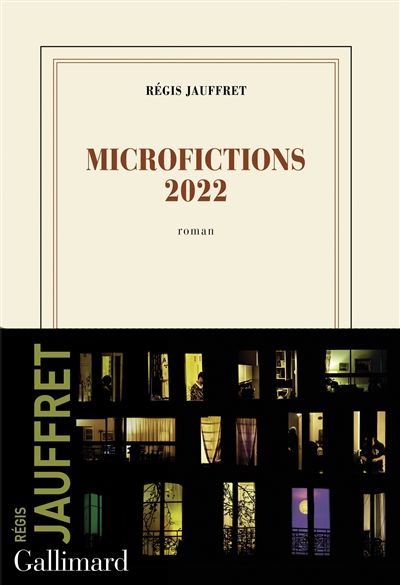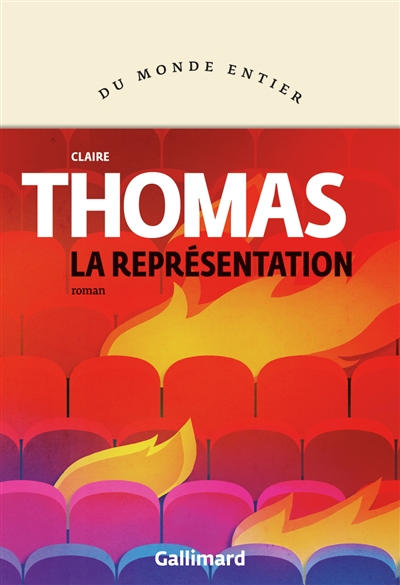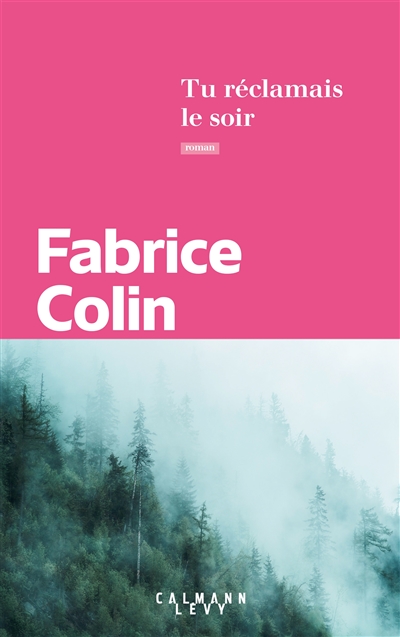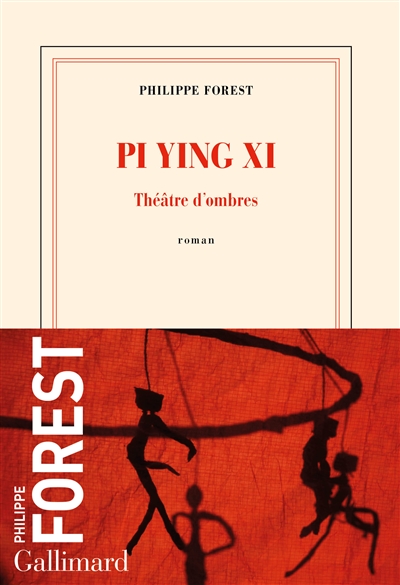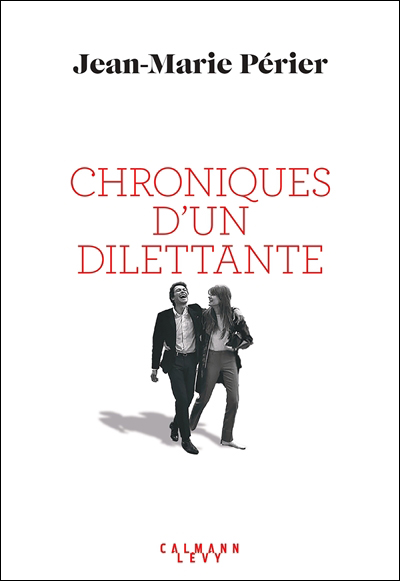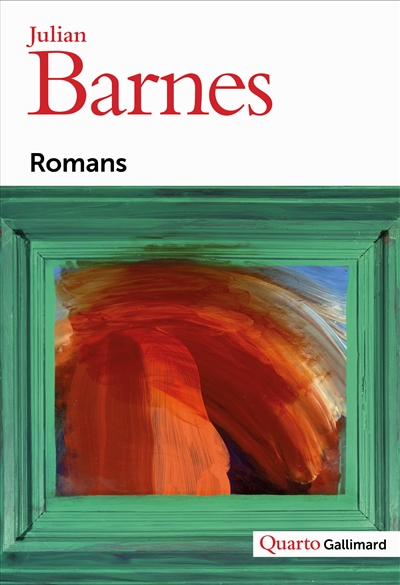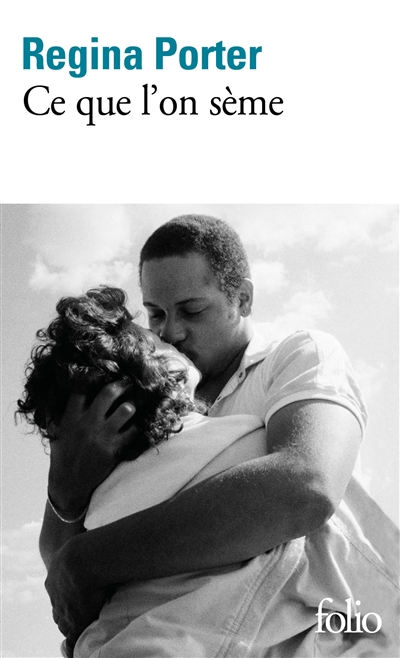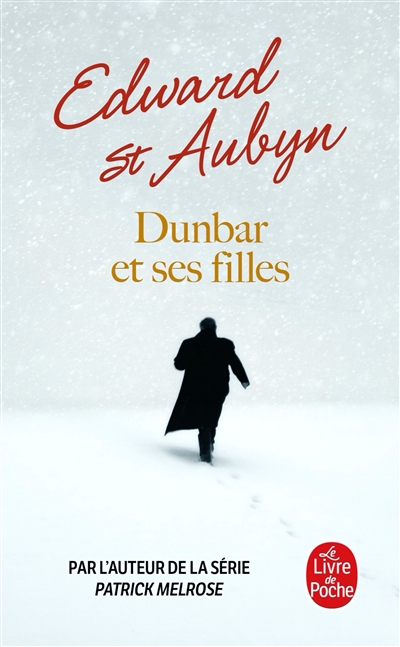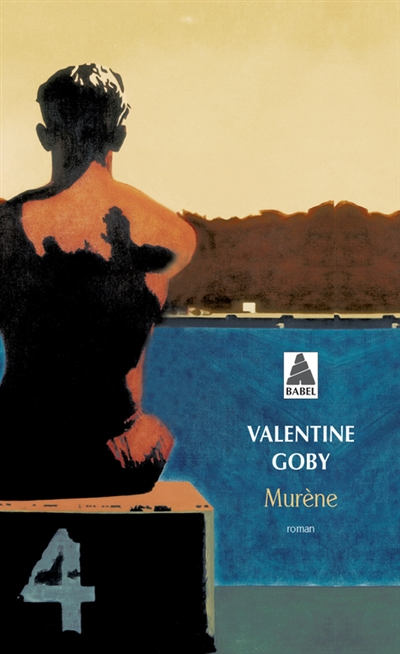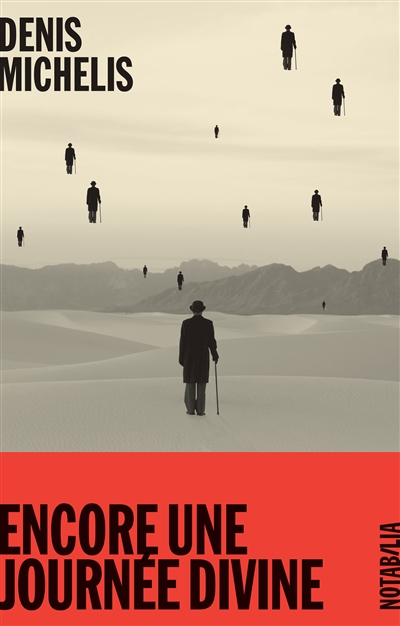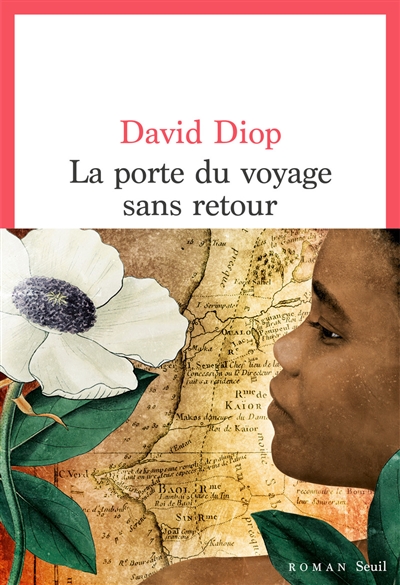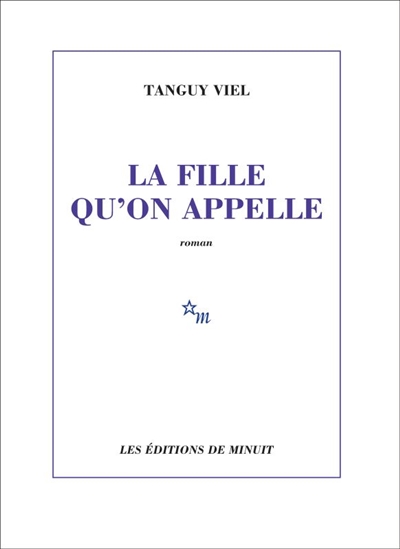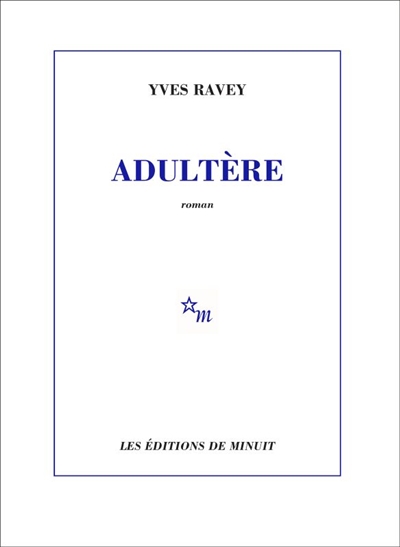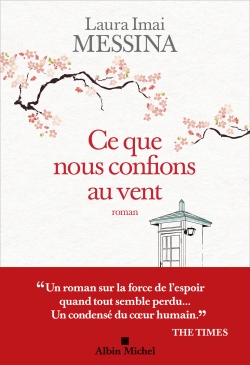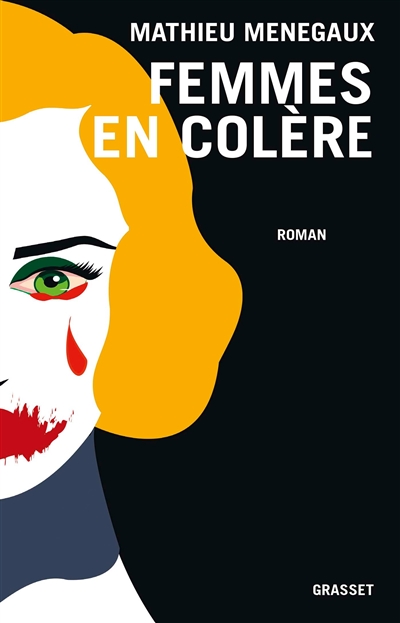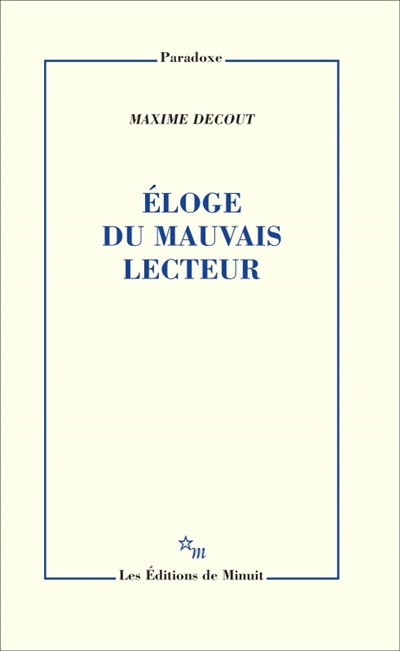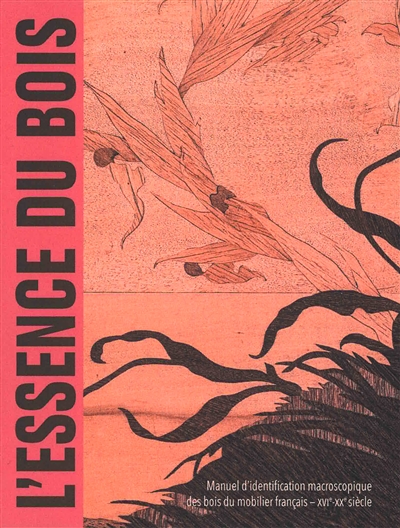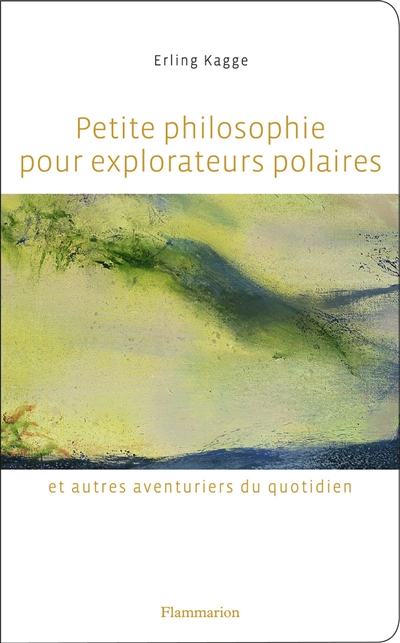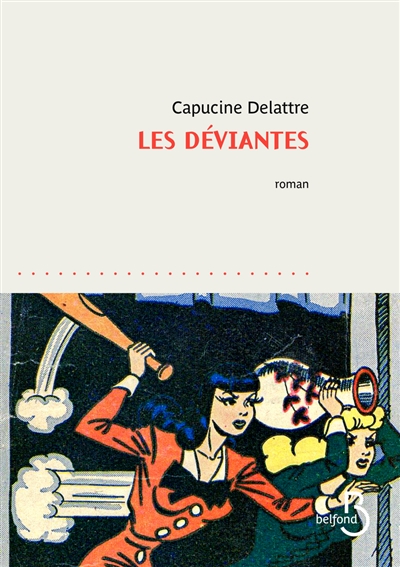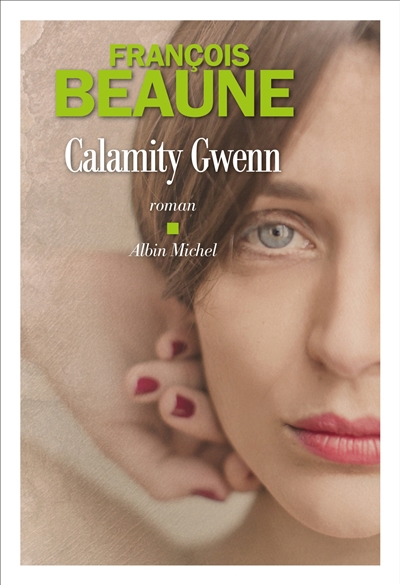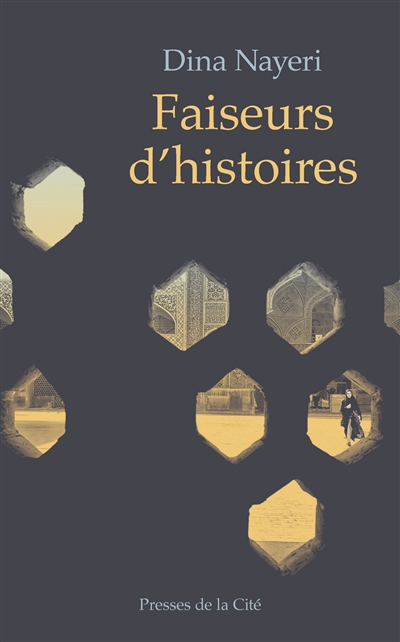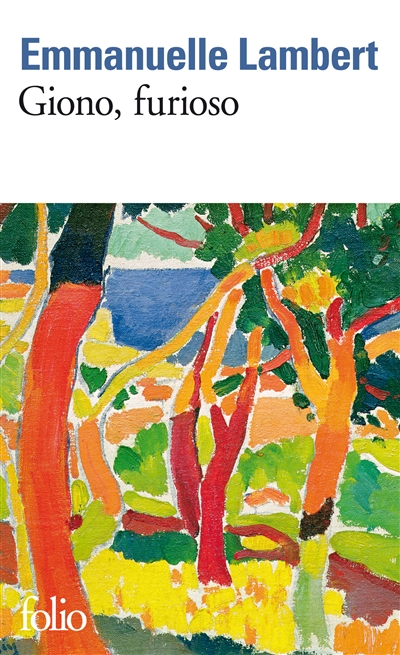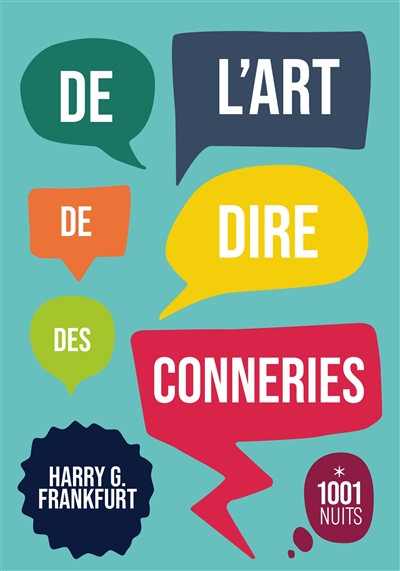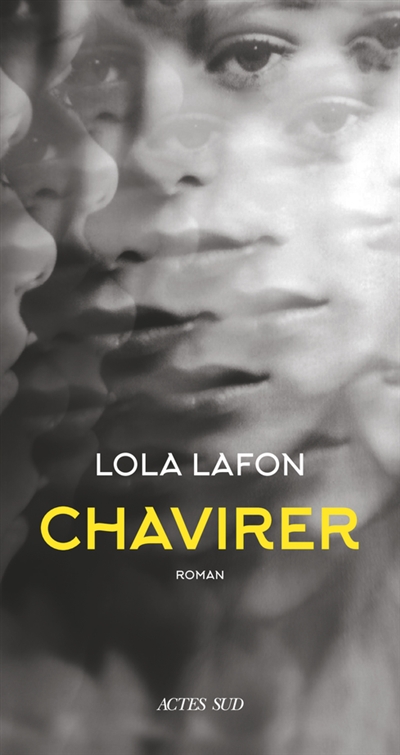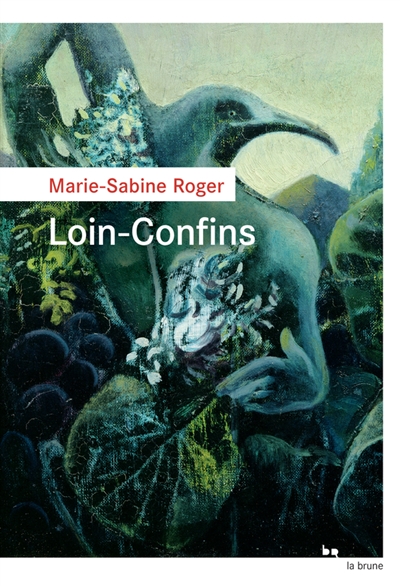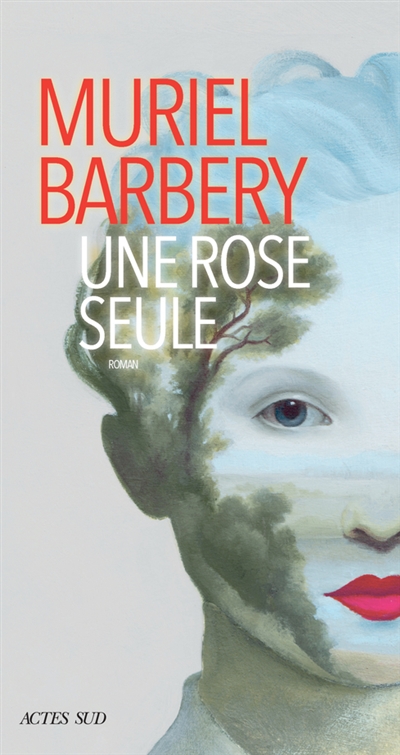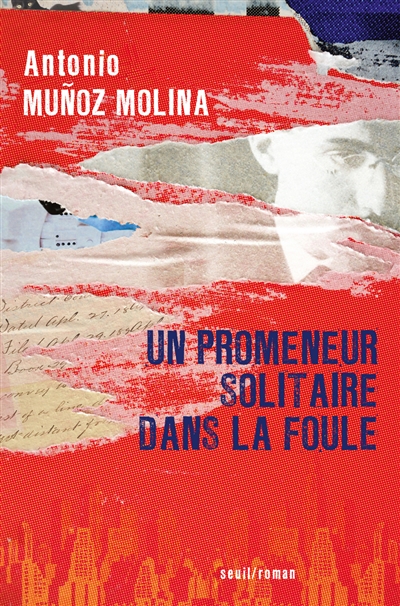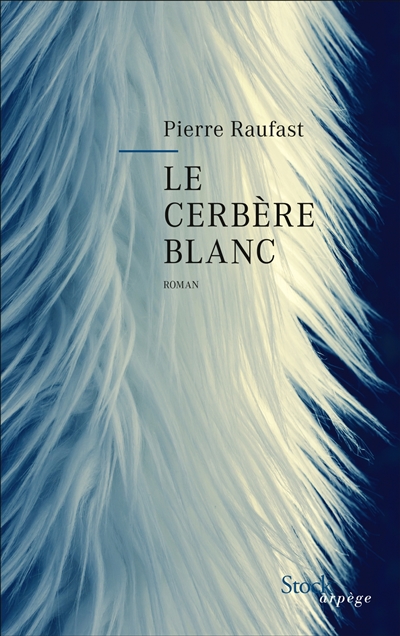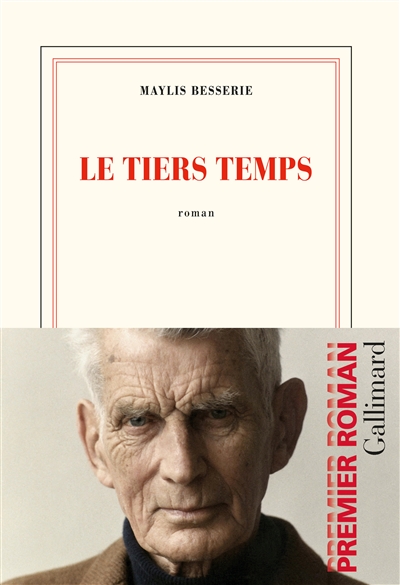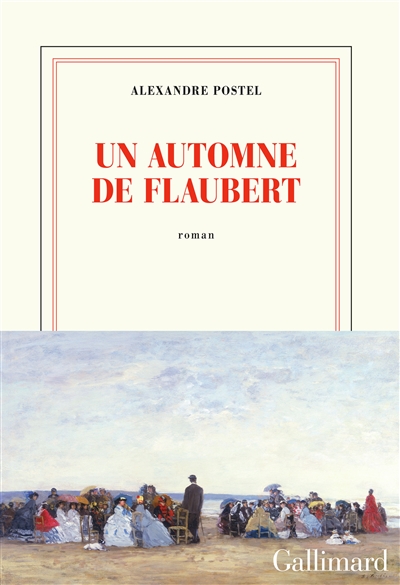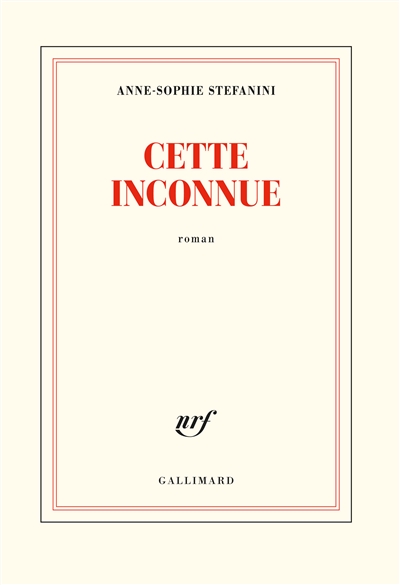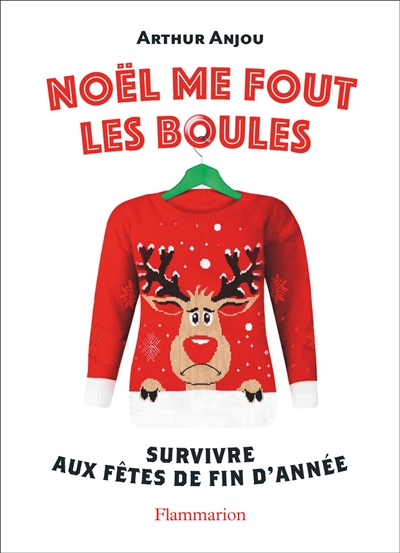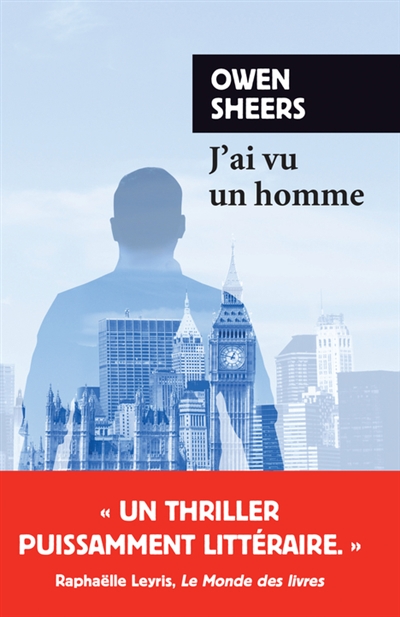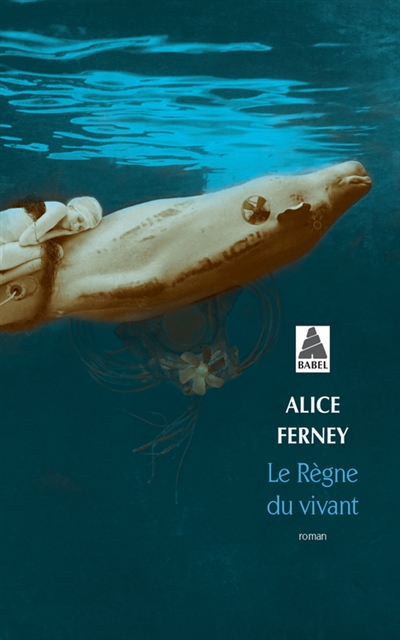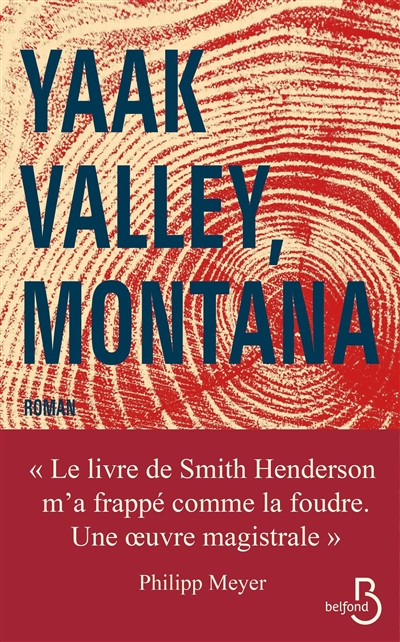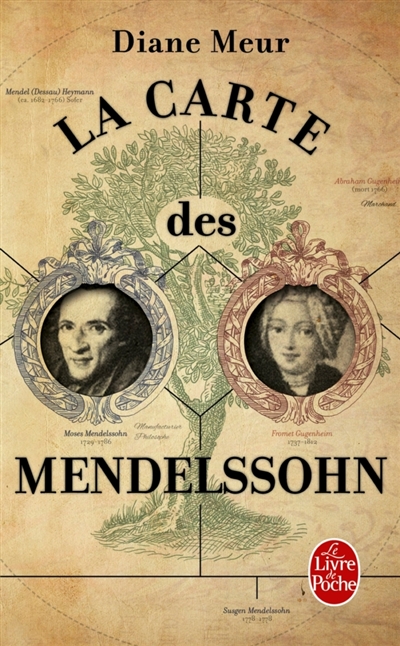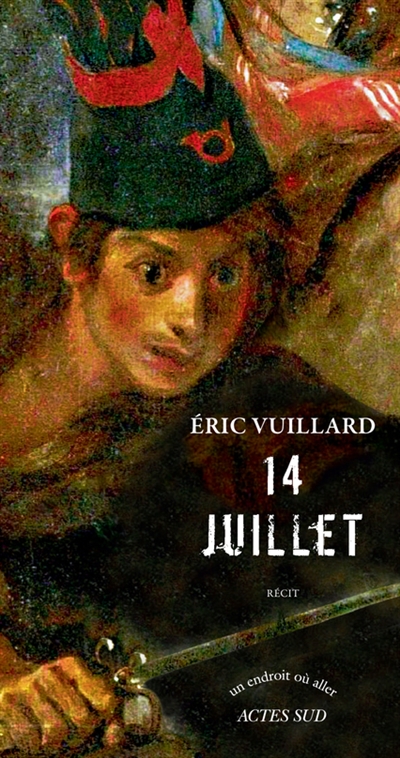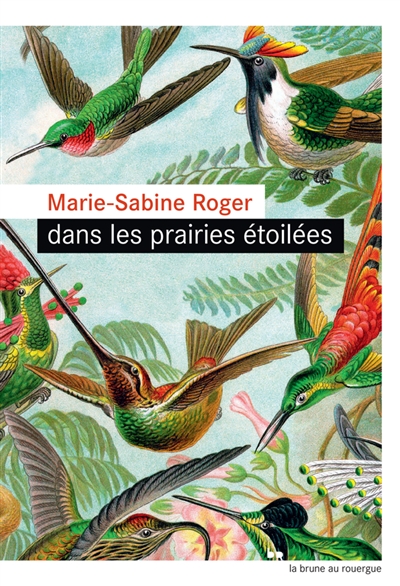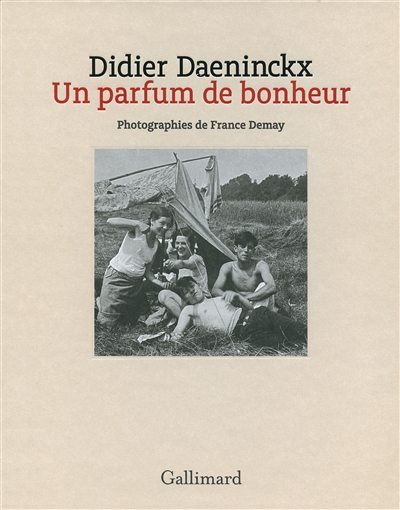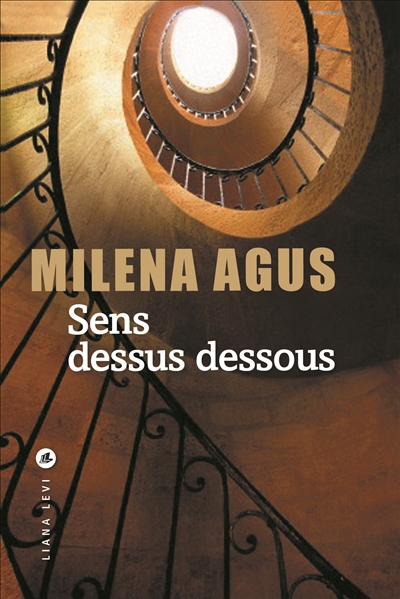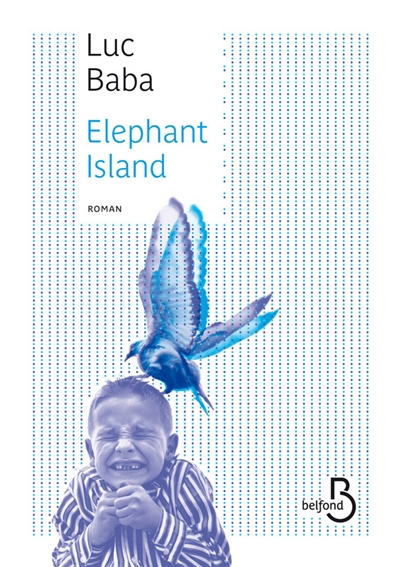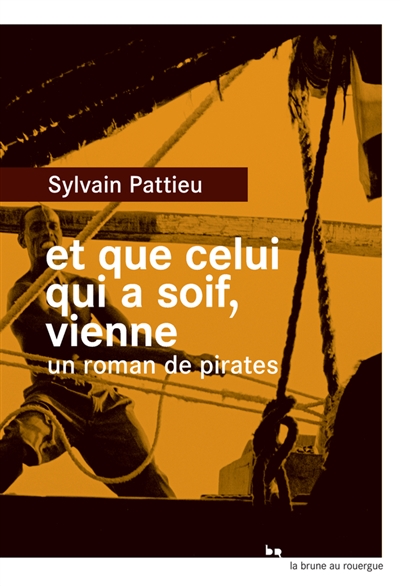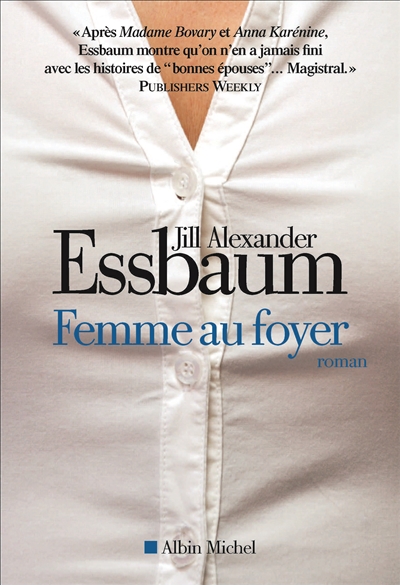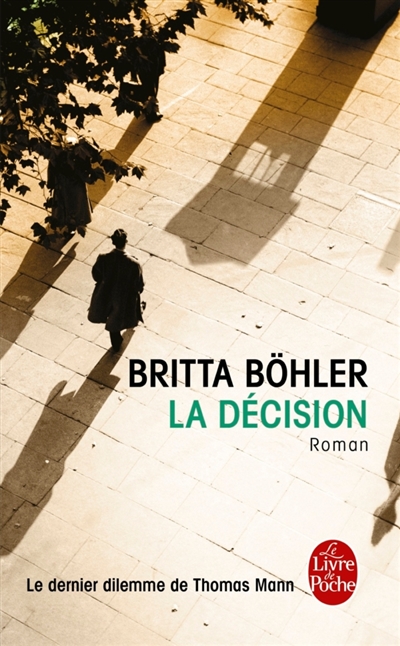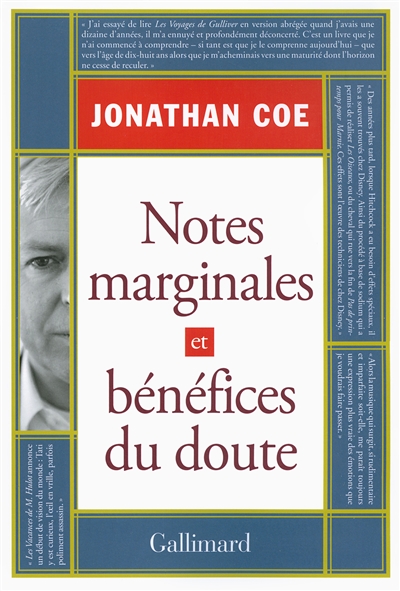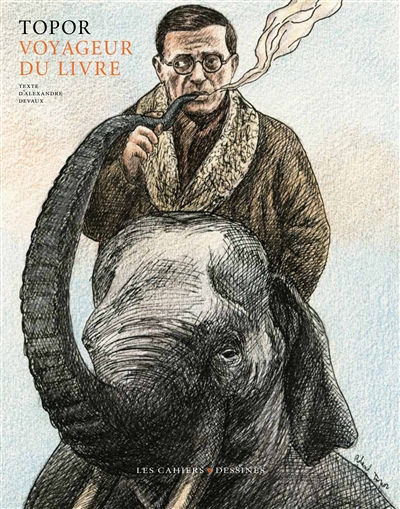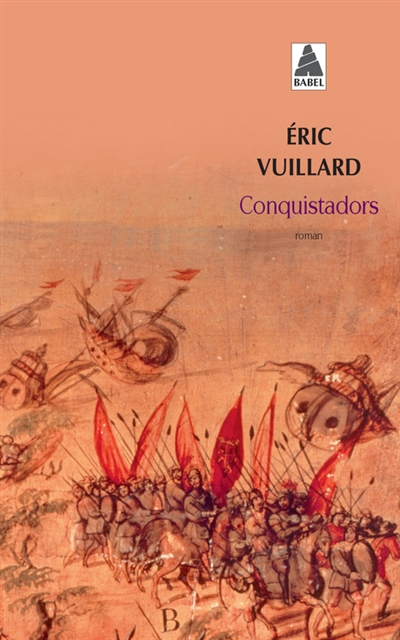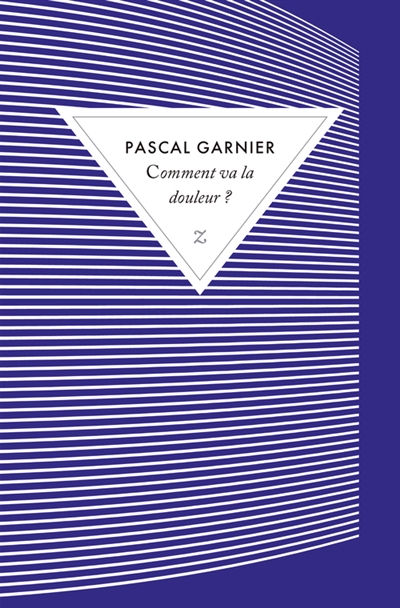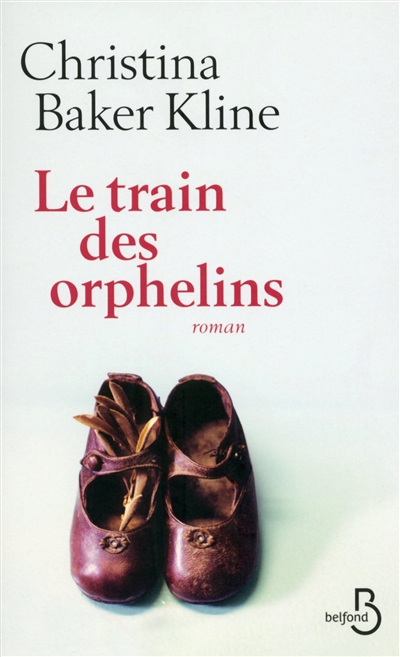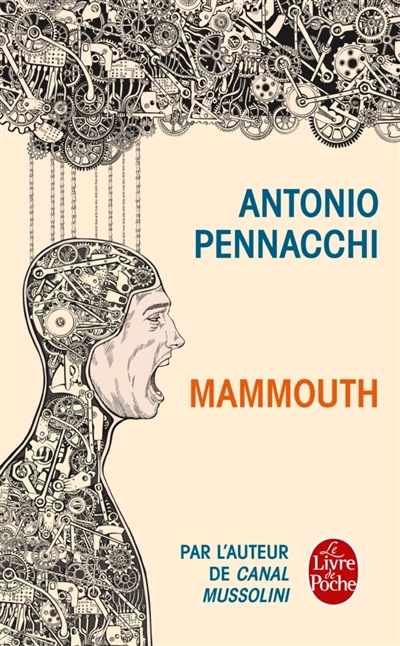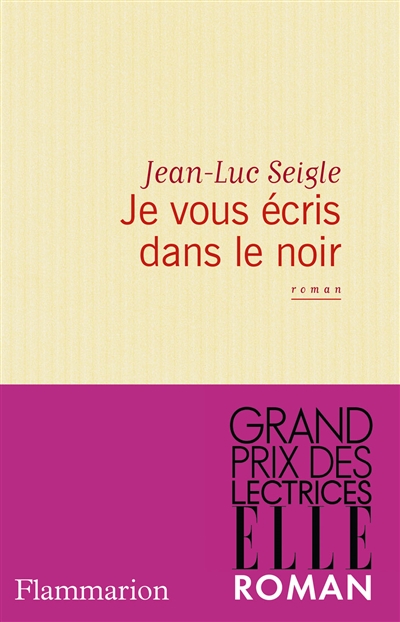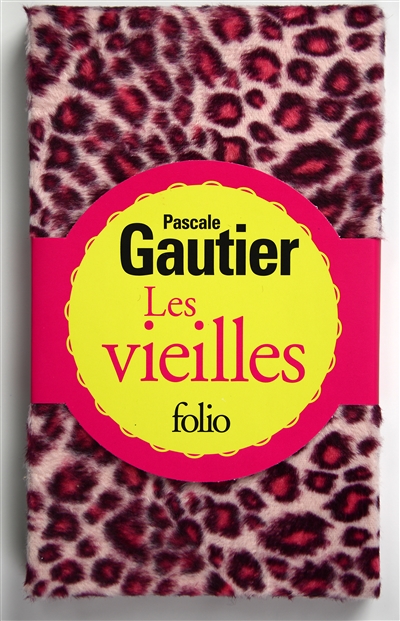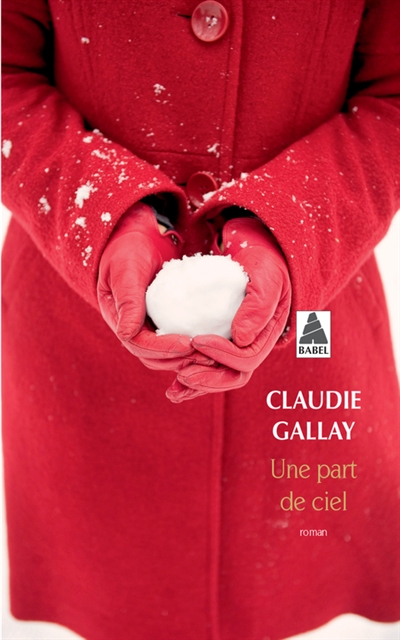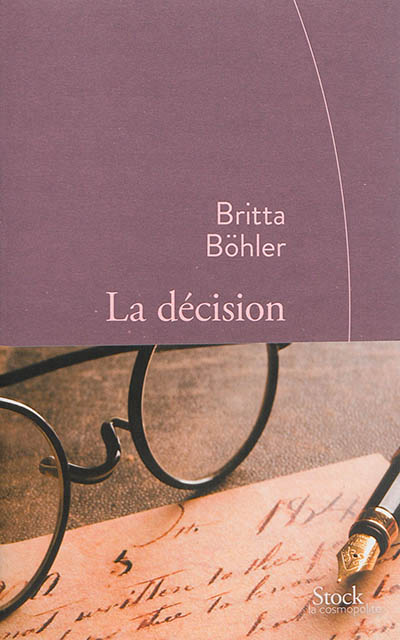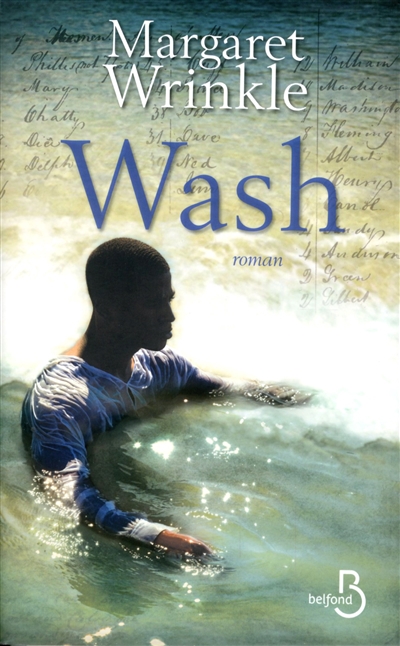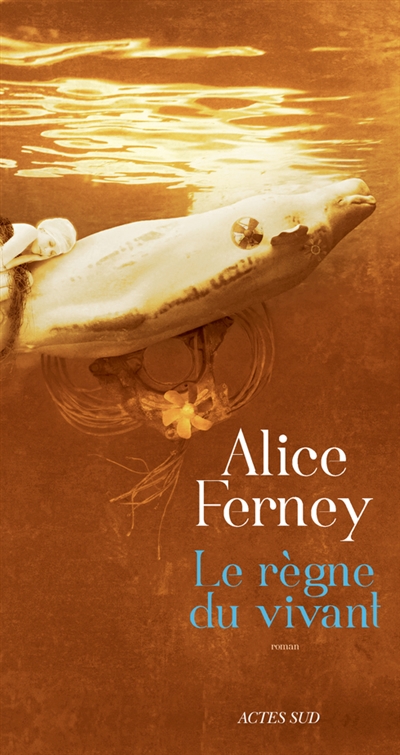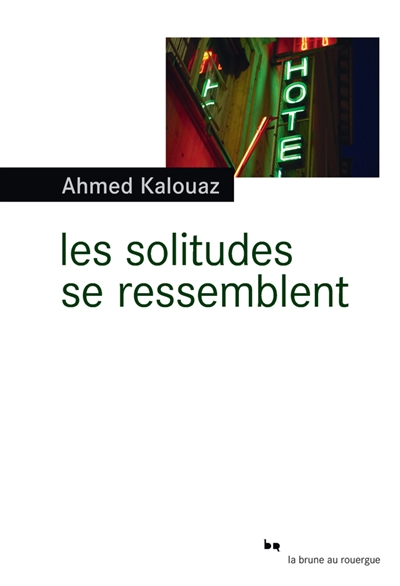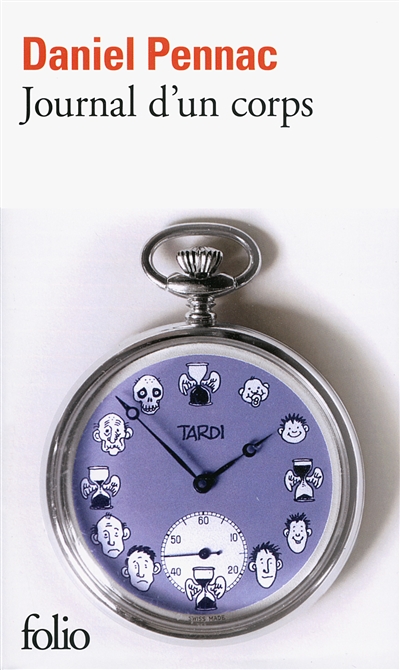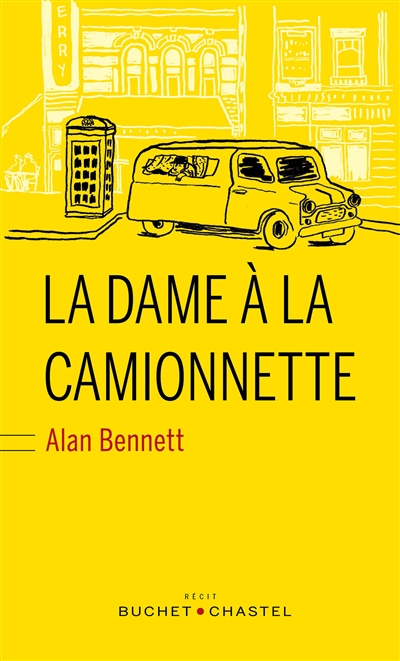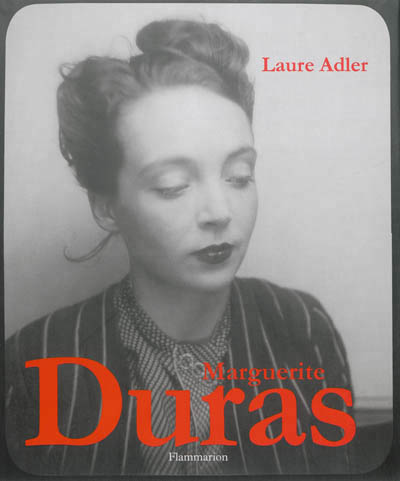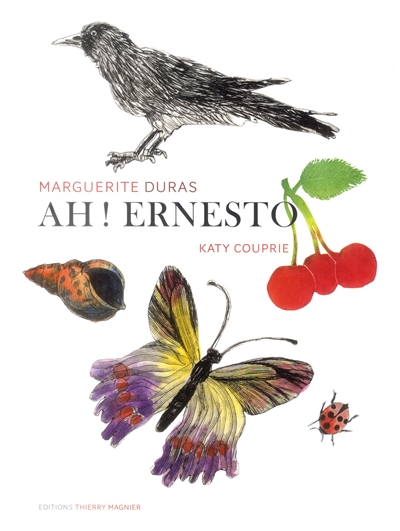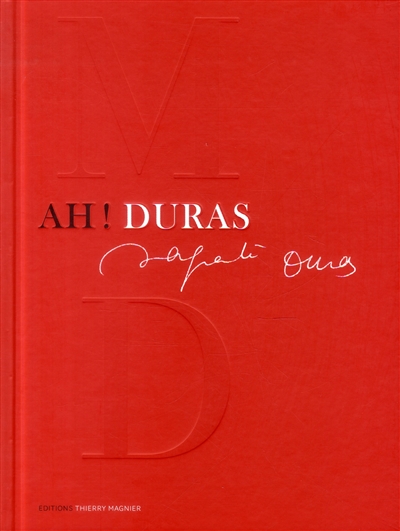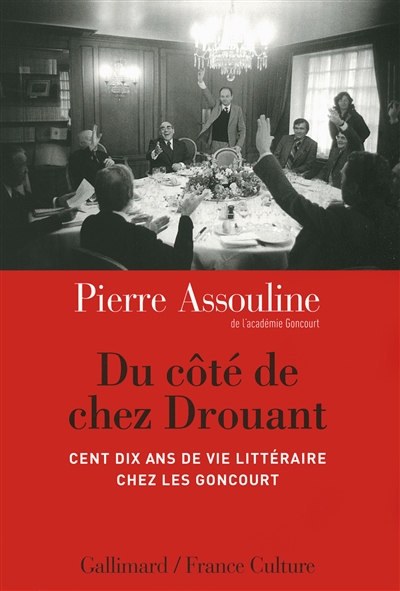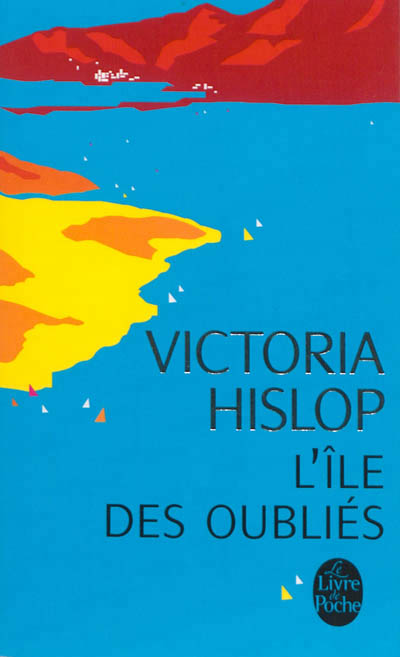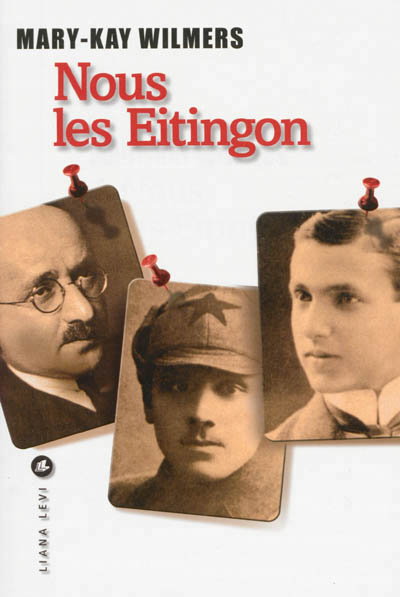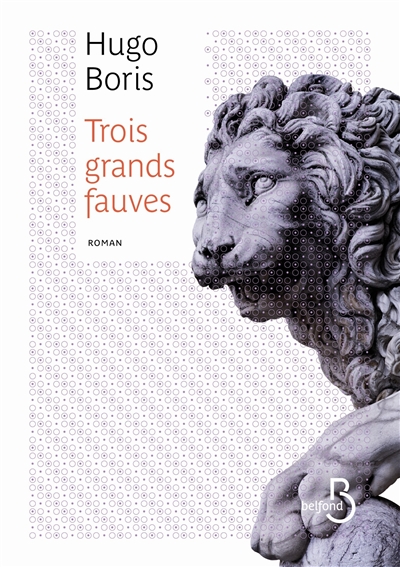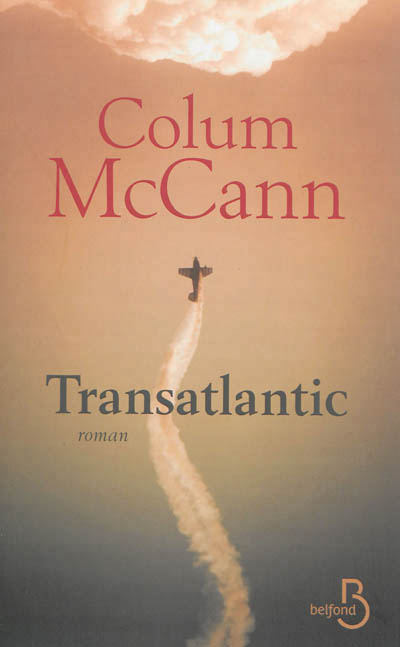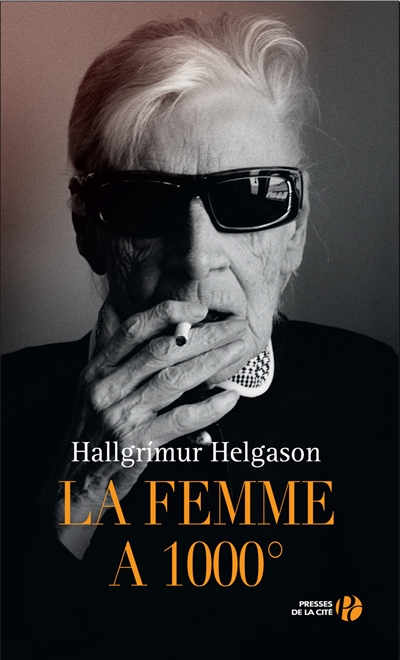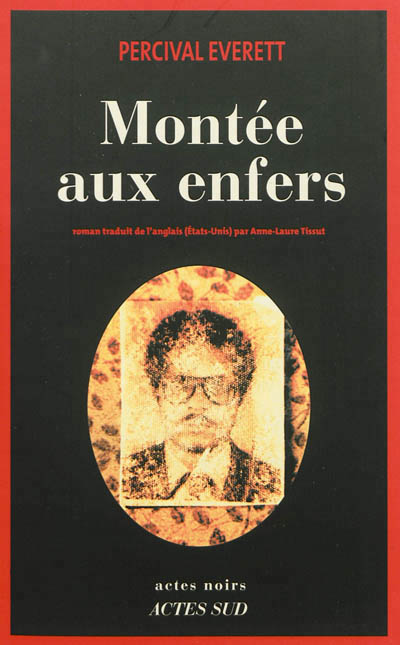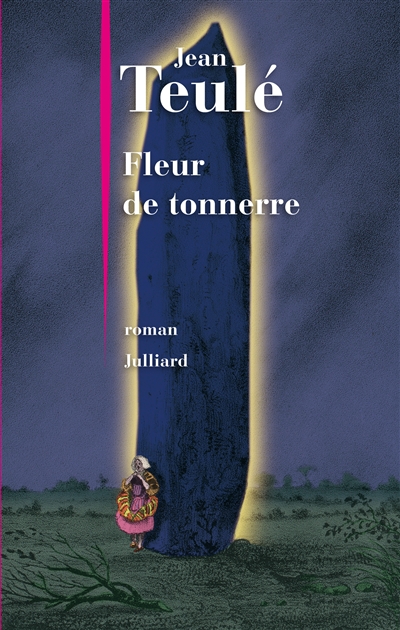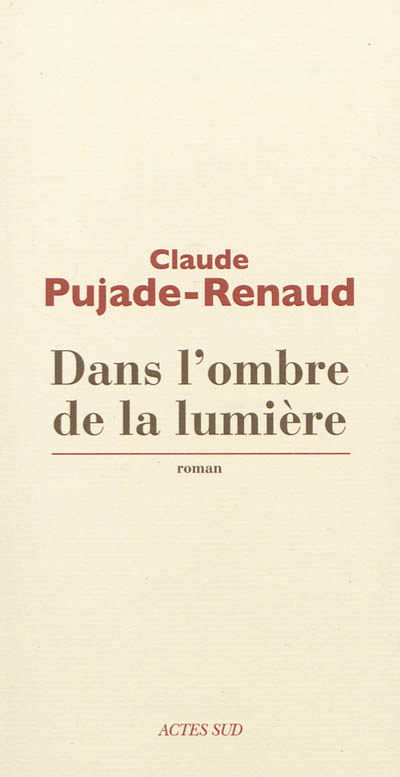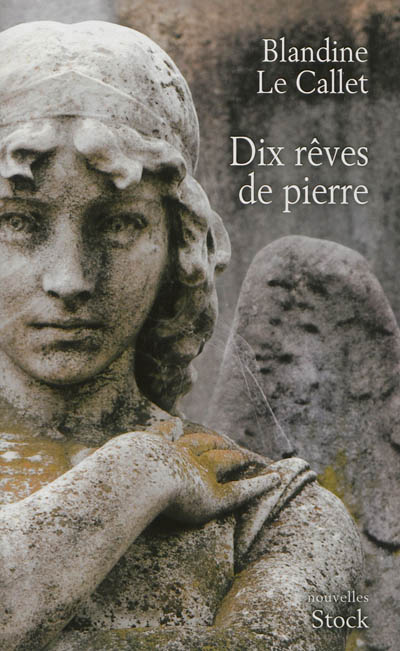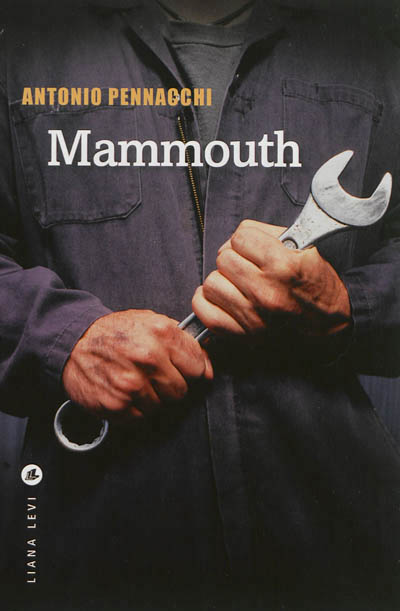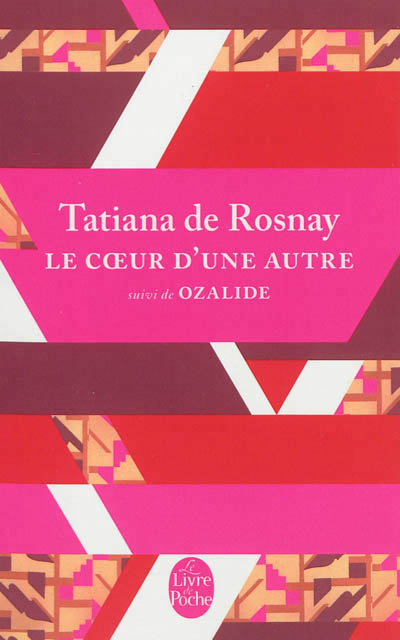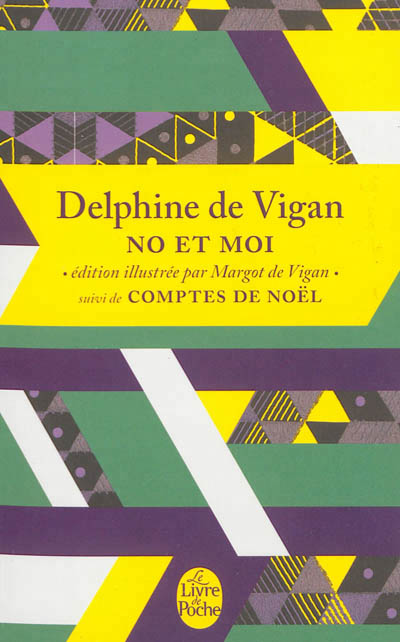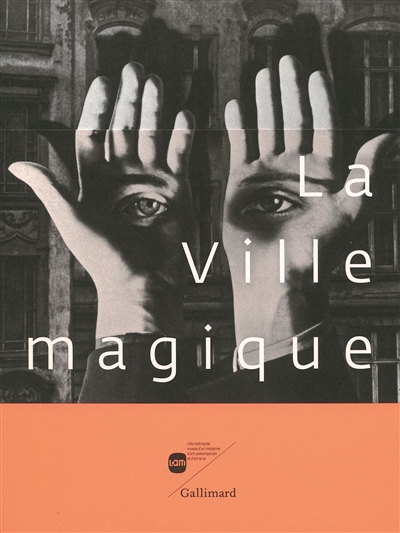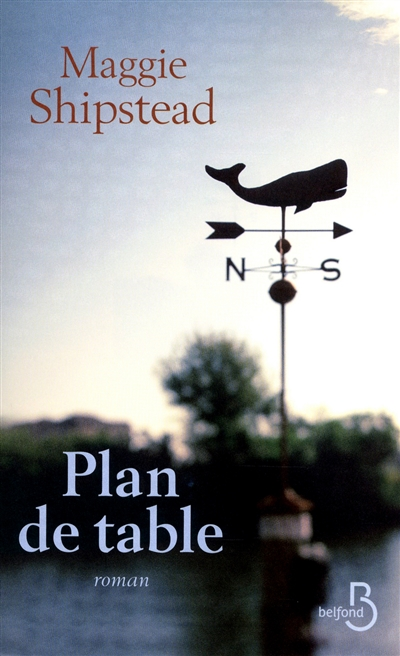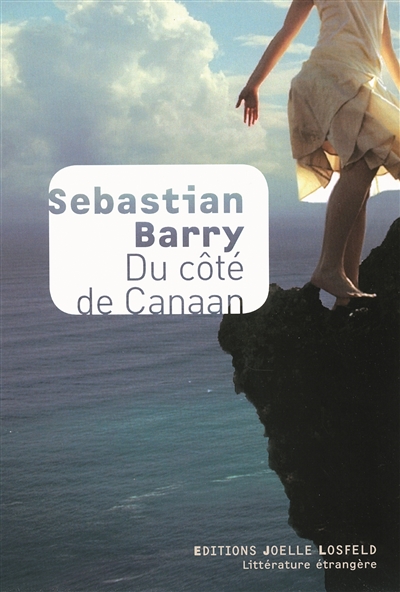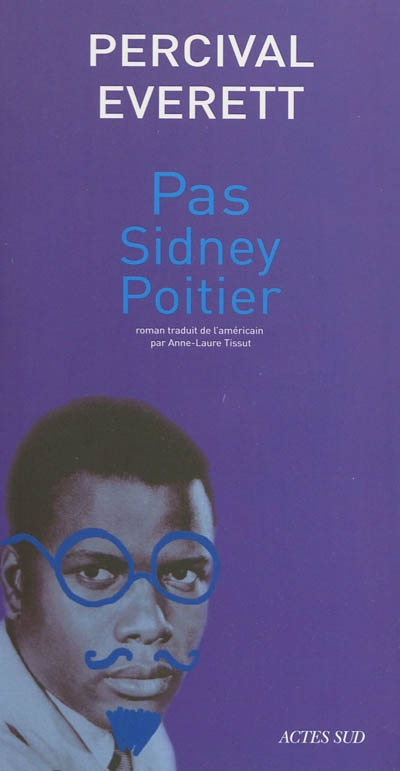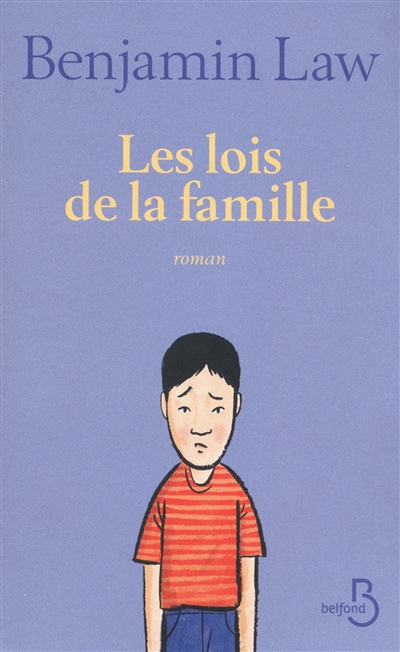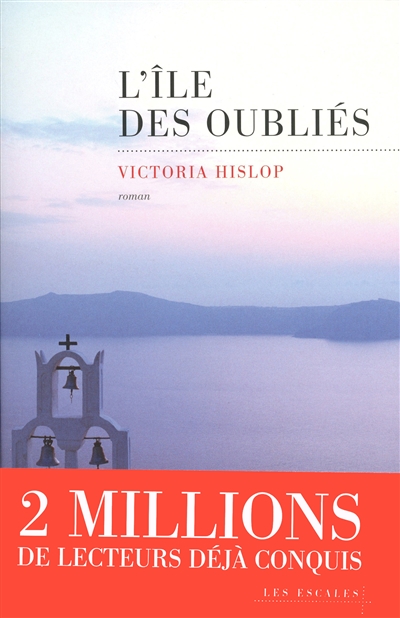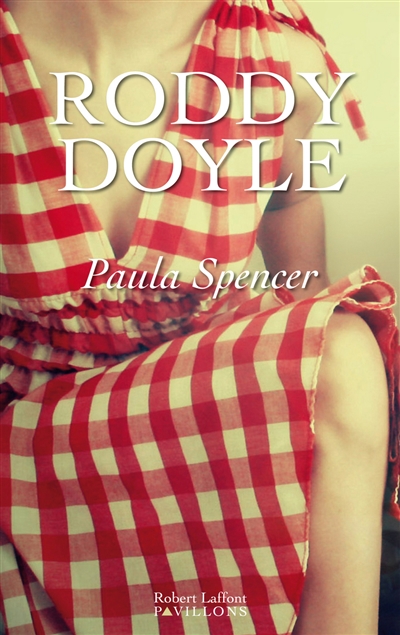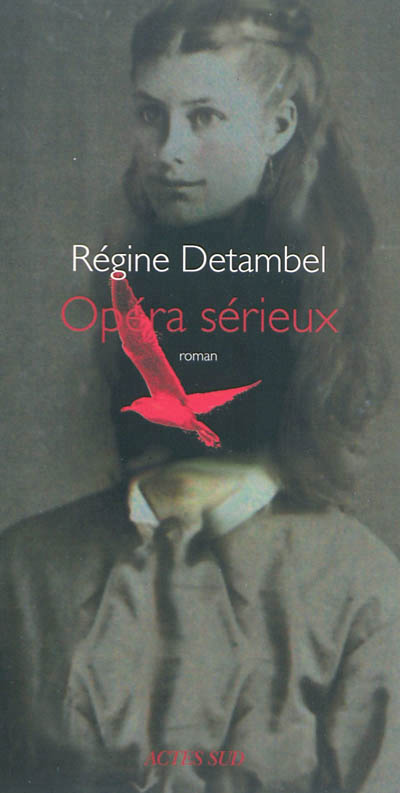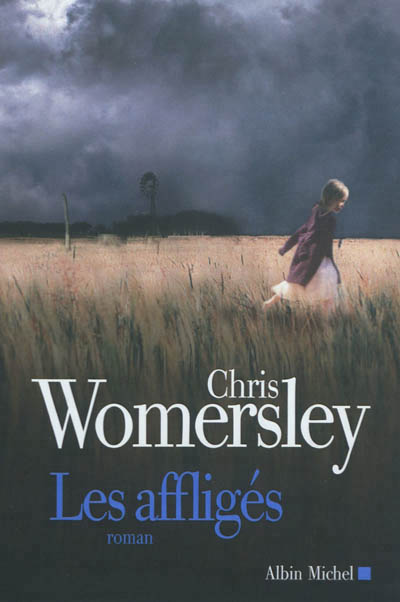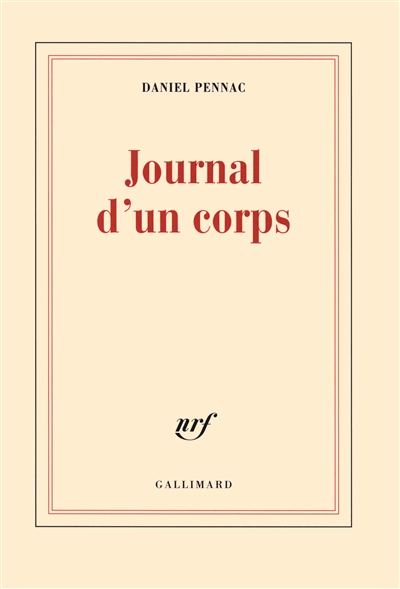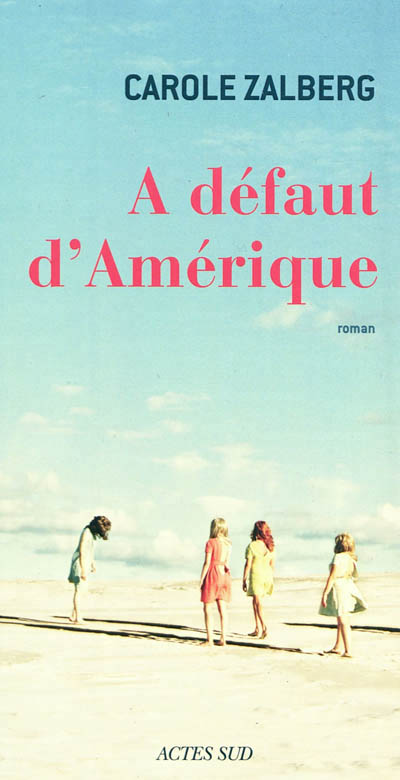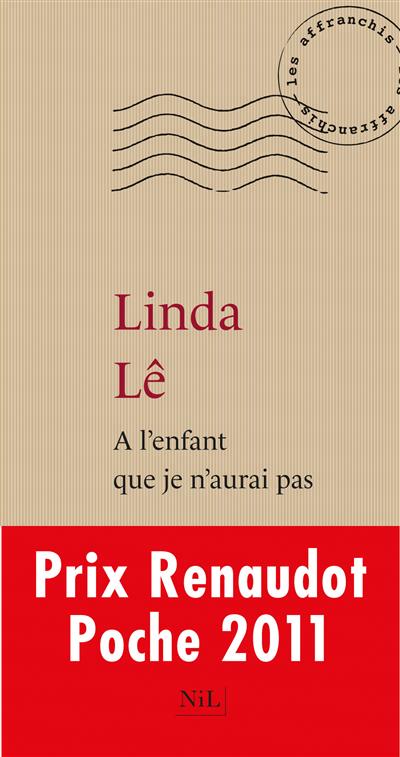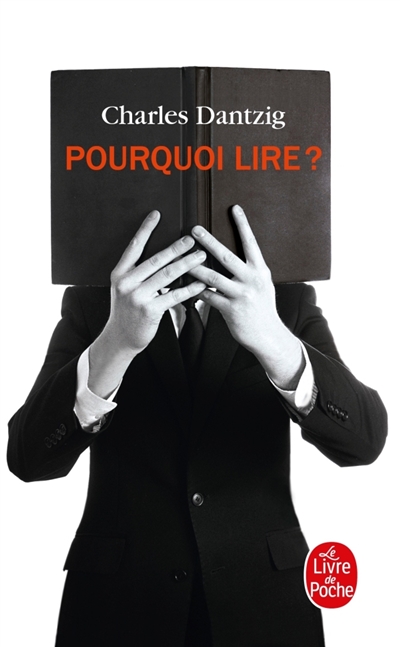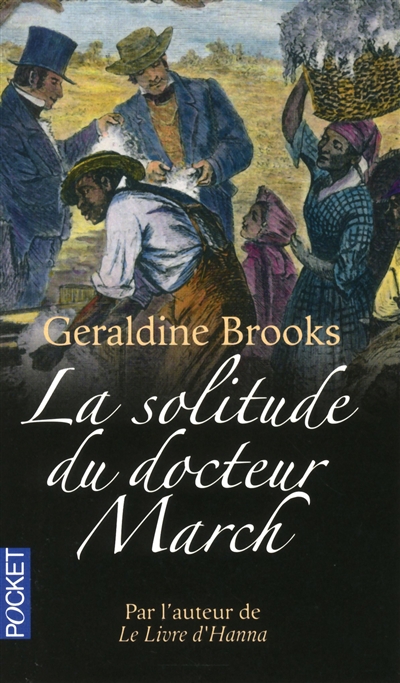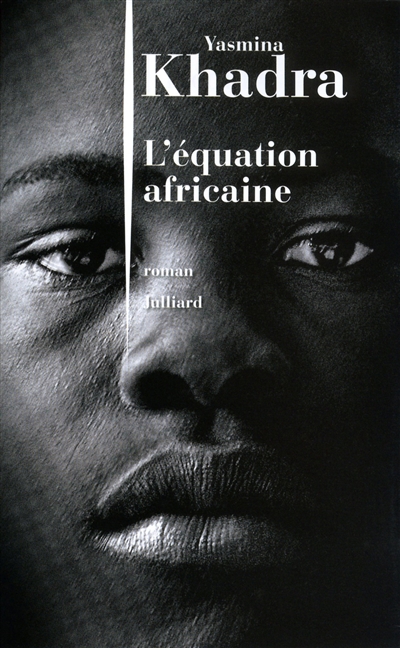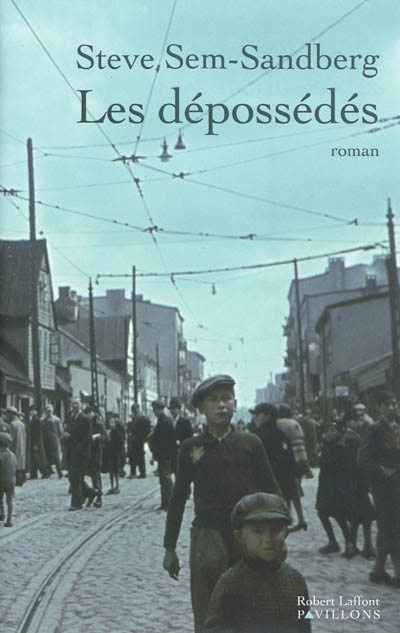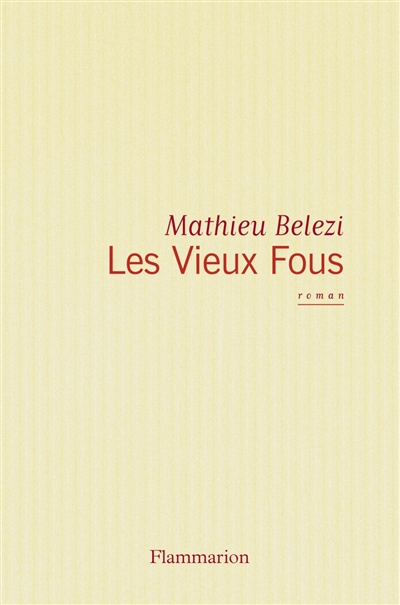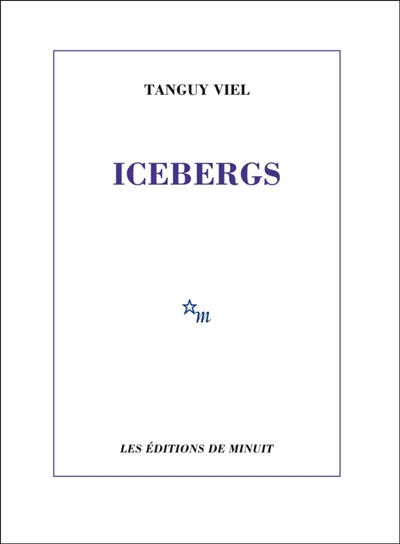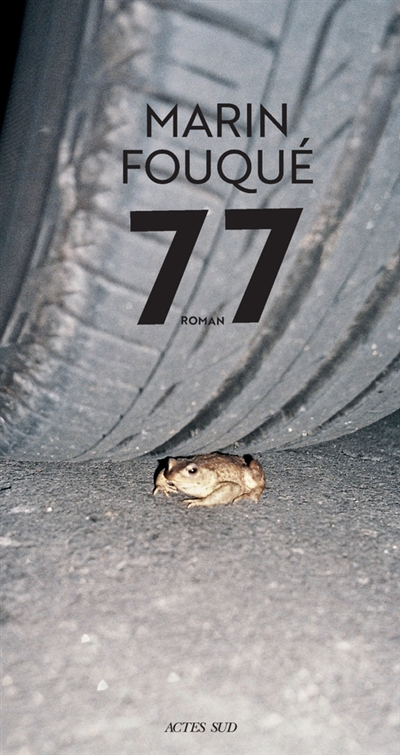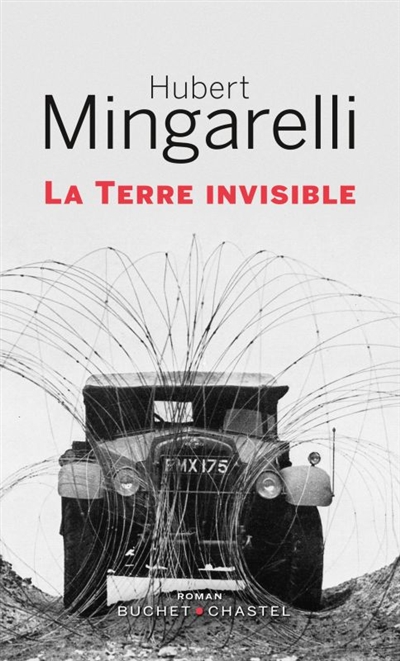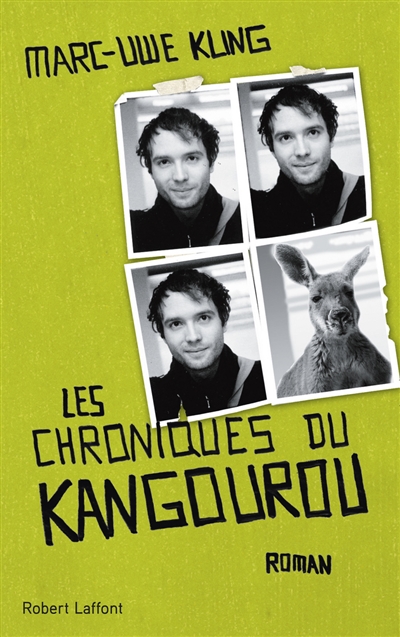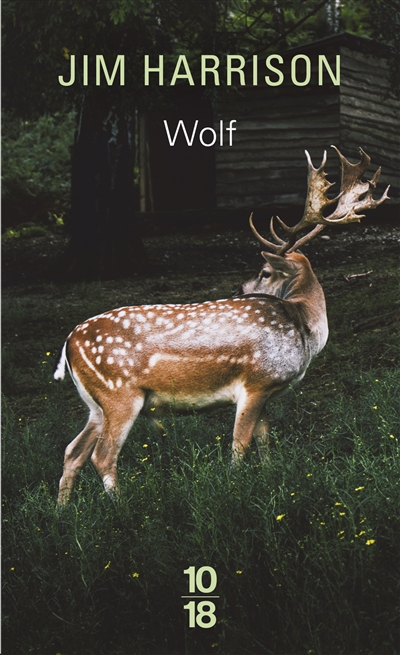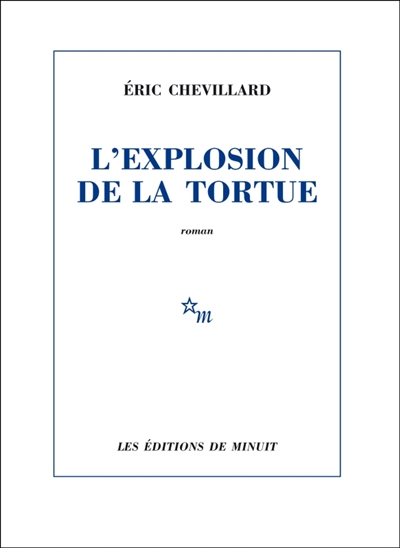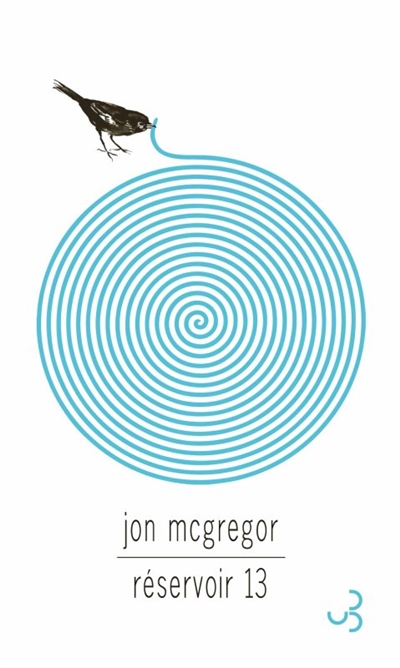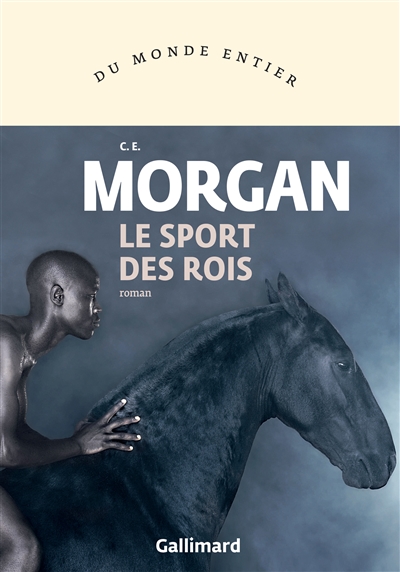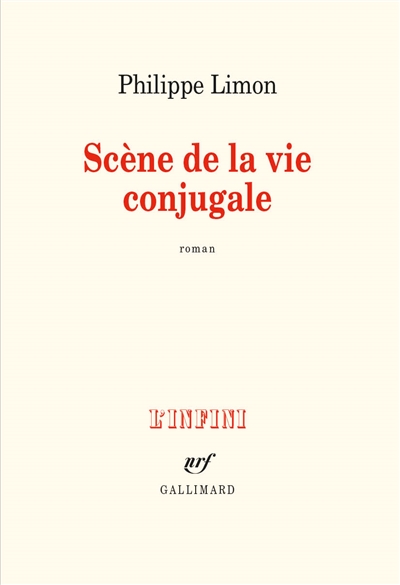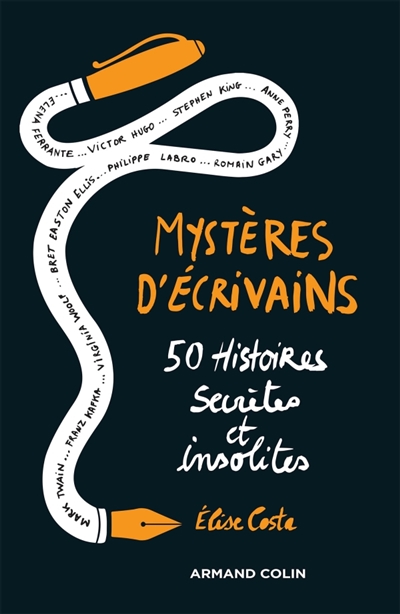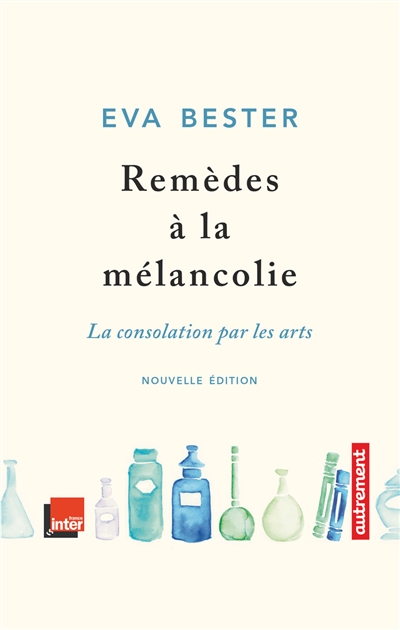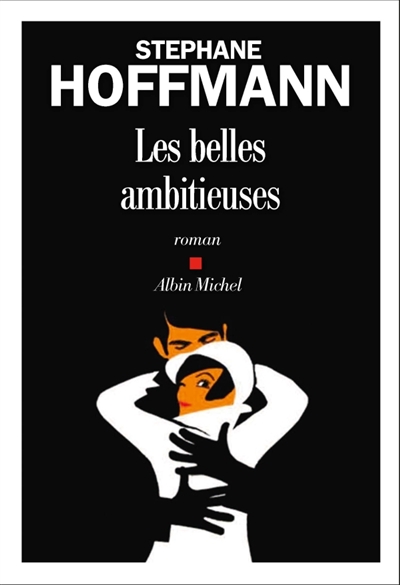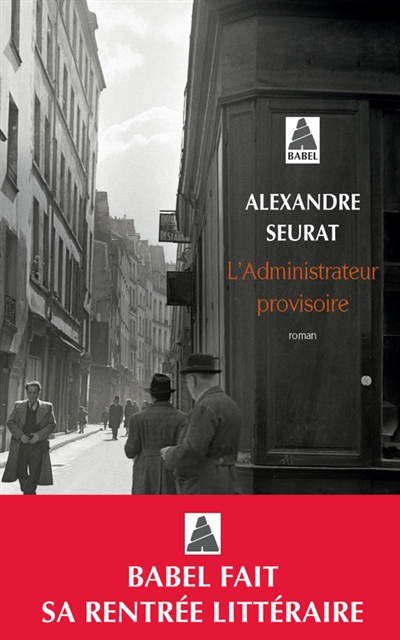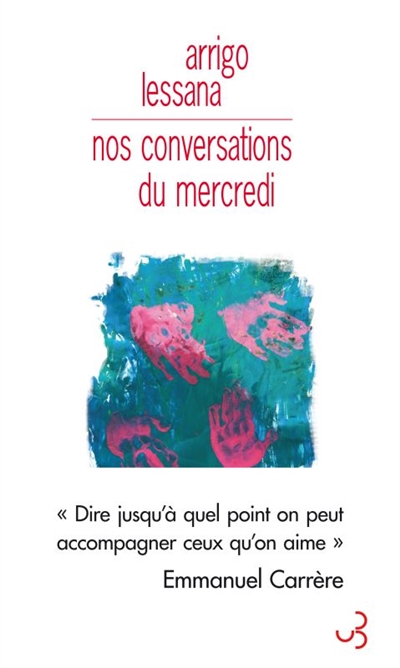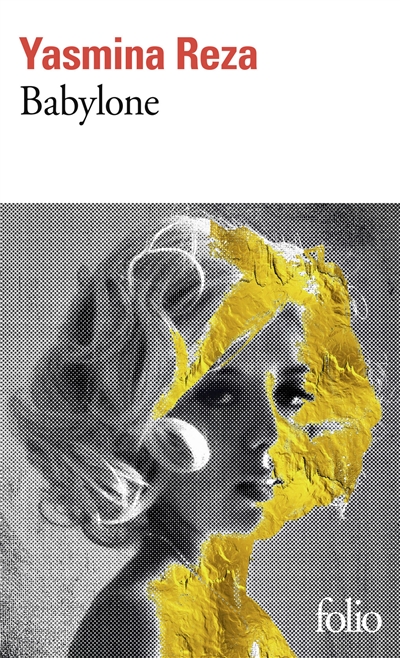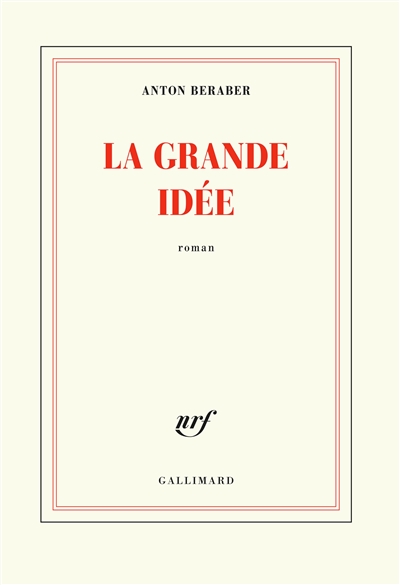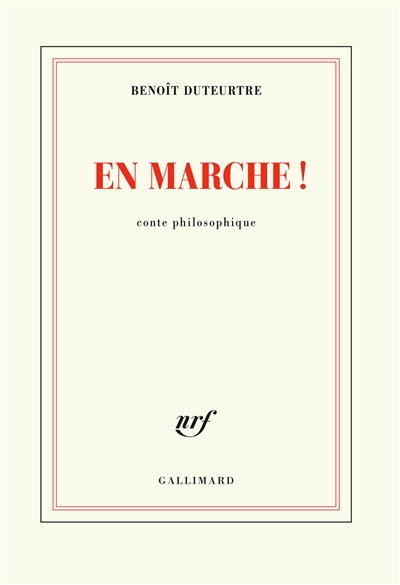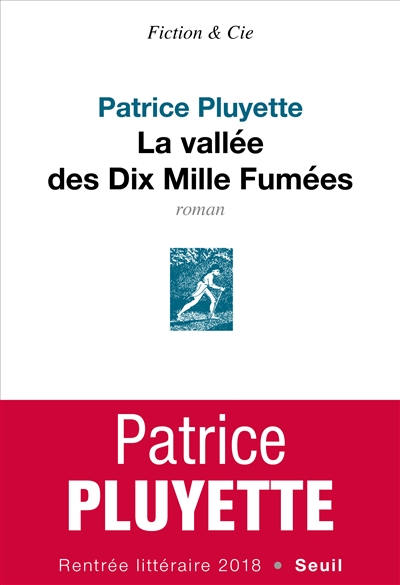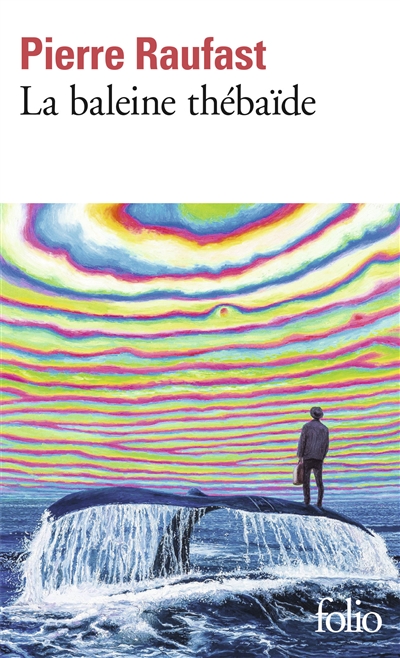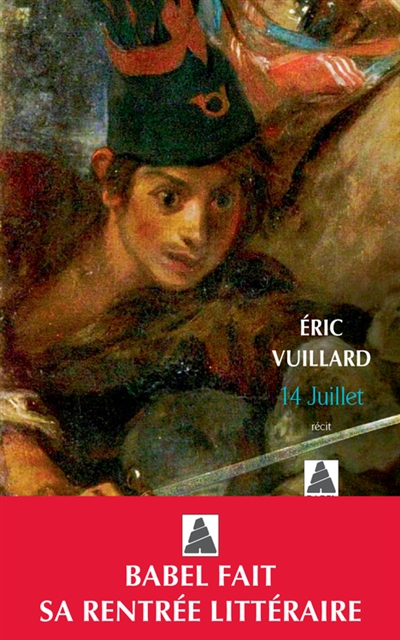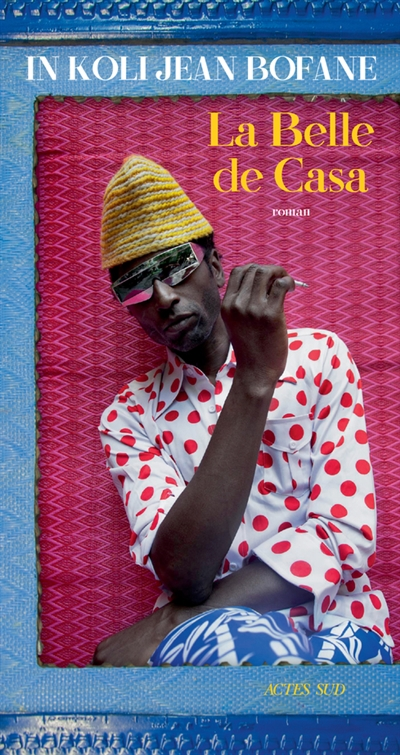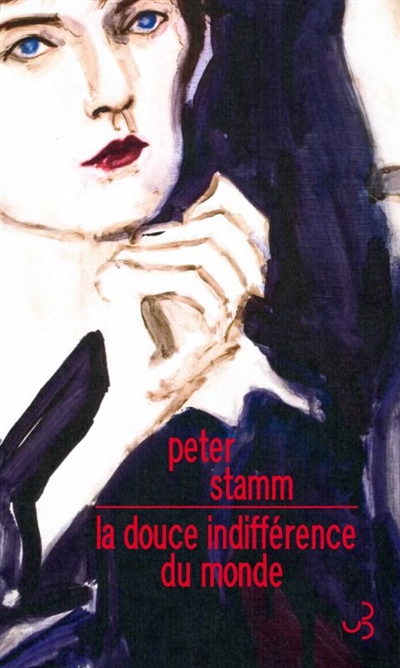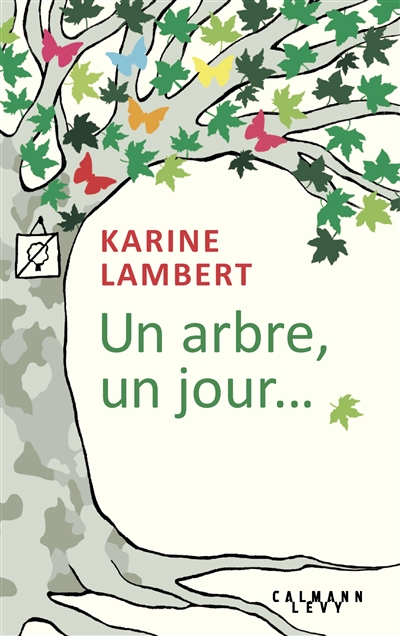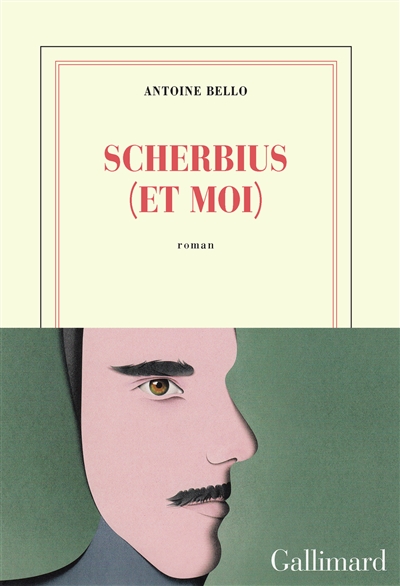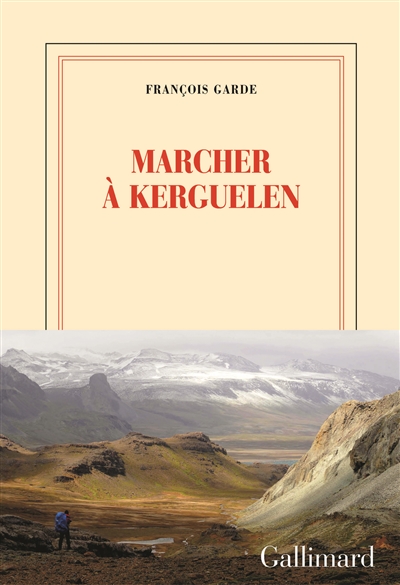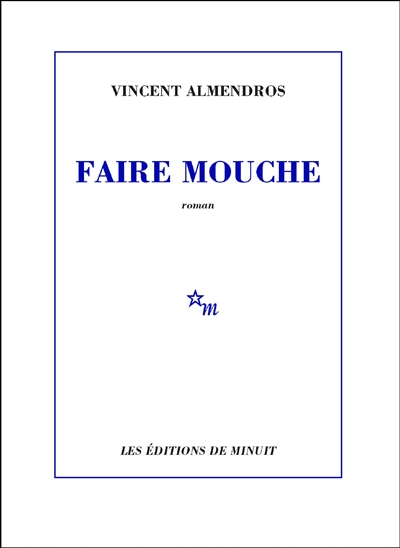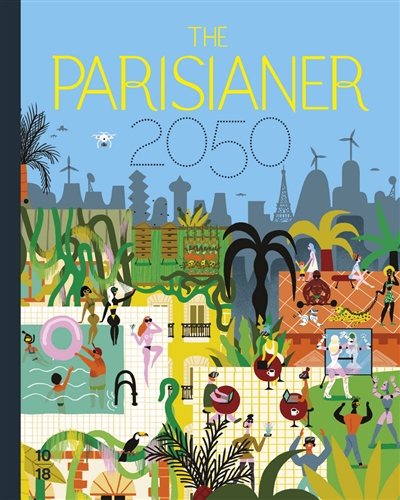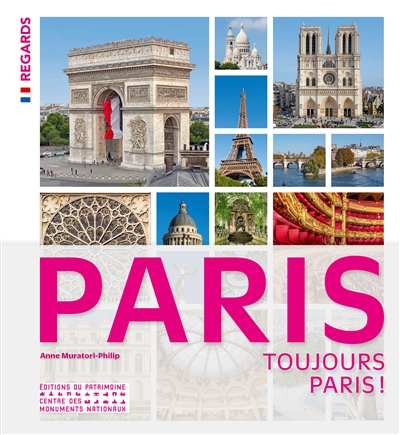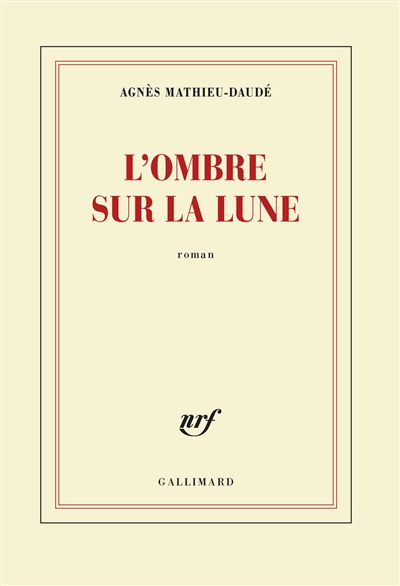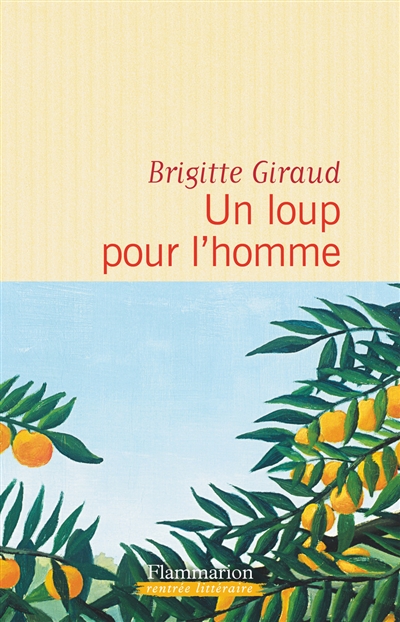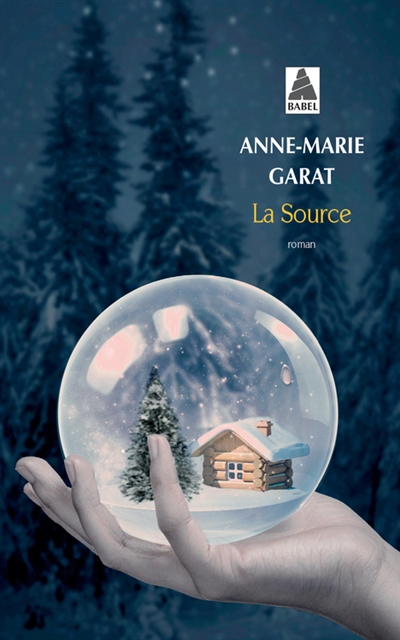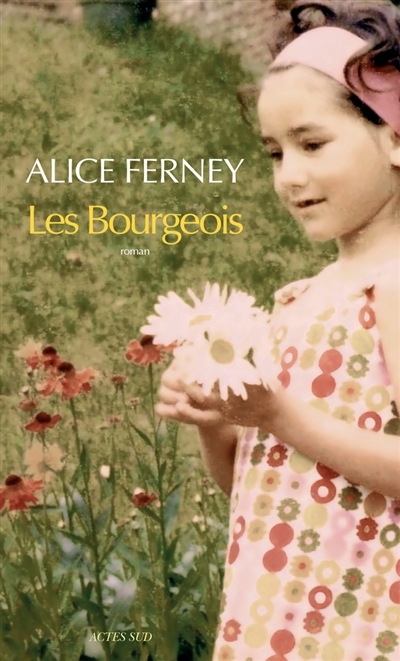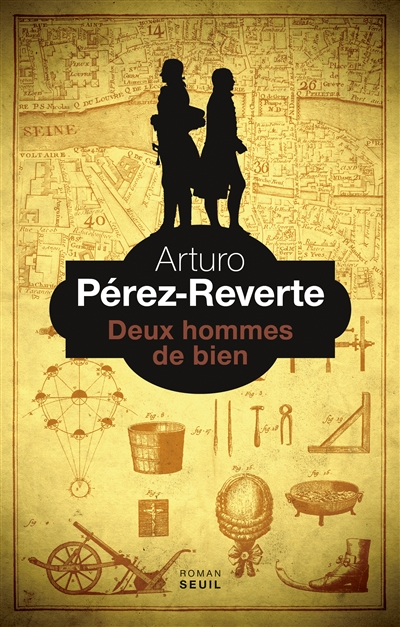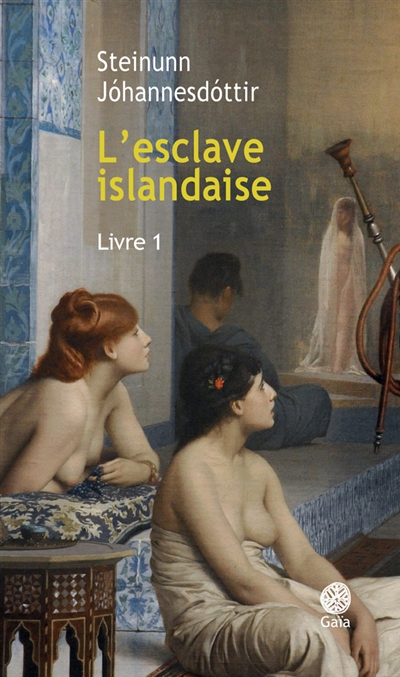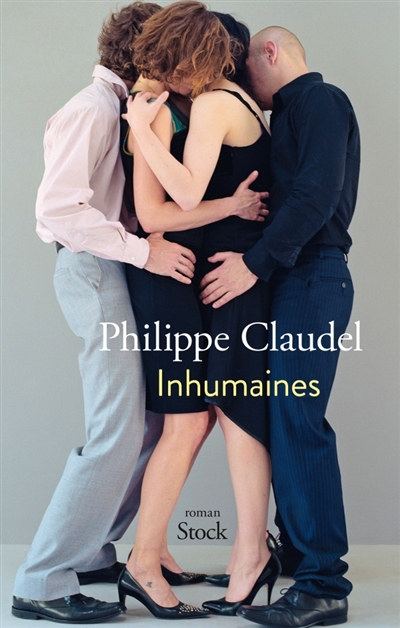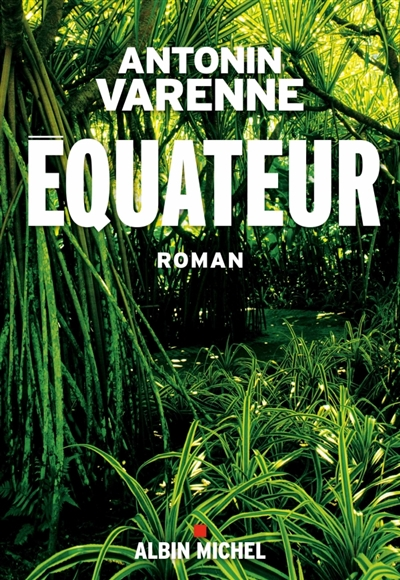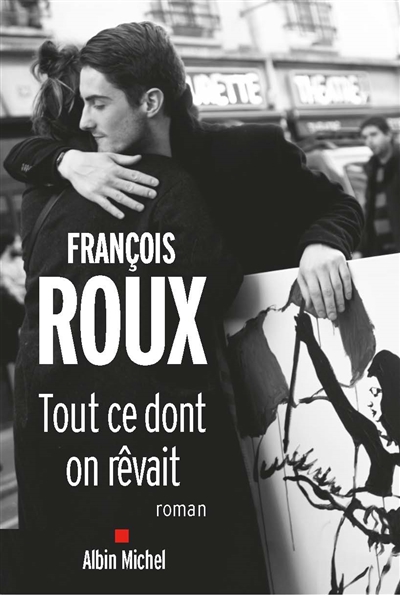Littérature française
Olivier Rolin
Le Météorologue

-
Olivier Rolin
Le Météorologue
Seuil, Paulsen
09/09/2014
224 pages, 18 €
-
Chronique de
Emmanuelle George
Librairie Gwalarn (Lannion) - ❤ Lu et conseillé par 11 libraire(s)

✒ Emmanuelle George
(Librairie Gwalarn, Lannion)
C’est la découverte de la correspondance qu’Alexeï Féodossiévitch Vangengheim adressa à sa fille qui a décidé Olivier Rolin à enquêter sur son terrible destin. Exilé puis exécuté par le régime totalitaire soviétique, ce météorologue fut l’une des nombreuses victimes de la Grande Terreur (1937-1938). En un opus incisif, âpre et dépouillé, Olivier Rolin compose une sépulture de papier, un tombeau de mots. Pour cet « innocent moyen ».
Alexeï Féodossiévitch Vangengheim était un homme qui aimait les nuages et rêvait de lire dans la Bible des vents. À la fin des années 1920, il devint le premier directeur du service hydrométéorologiste de l’URSS. Fêté par le régime de Staline, il fut dénoncé pour sabotage en 1934 et condamné à dix ans de travaux forcés sur l’archipel des Solovki, où l’ancien monastère orthodoxe cerné par les eaux glacées de la mer Blanche, fut transformé en camp d’internement. Curieusement, sa solitude et son enfer y seront peuplés de livres et d’échanges avec ses codétenus, pour la plupart intellectuels ou artistes. Inlassablement, Alexeï a écrit à sa femme et à sa fille. À partir de 1937, plus une lettre ne leur parvint. Ce n’est qu’en 1956 qu’elles apprirent que leur époux et père était mort exécuté, dix-neuf ans plus tôt. Tel un archéologue, un enquêteur, Olivier Rolin se penche sur les indices et les raisons de l’horreur, sans jamais cacher les faiblesses de ce communiste moyen, cet homme ordinaire auquel il offre, comme à tant d’autres victimes innocentes, un tombeau de mots remarquables, nourri de réflexions incisives et de références littéraires essentielles.
Page — Alexeï Féodossiévitch Vangengheim, ce météorologue russe dont vous retracez le destin tragique, comment l’avez-vous rencontré ?
Olivier Rolin — Je me rends souvent en Russie et, en 2010, j’avais été invité à l’université d’Arkhangelsk, cette ville portuaire située à l’est de la mer Blanche. De là, j’avais emprunté le petit avion qui, en une heure de vol, rallie les îles Solovki. J’étais curieux de voir le monastère-forteresse fondé au xve siècle, dont des photos m’avaient montré l’extraordinaire beauté et dont je savais qu’il avait abrité, à partir de 1923, l’un des tout premiers camps du Goulag, celui, selon Soljenitsyne, dont était sorti toute la partie nord de l’archipel concentrationnaire. Sur les îles, une historienne locale, Antonina Sotchina, m’avait montré divers documents relatifs à l’histoire du camp et, parmi eux, un album édité à compte d’auteur par la fille d’un déporté à la mémoire de son père. Ce déporté, c’était Alexeï Féodossiévitch Vangengheim, qui dirigeait le service hydrométéorologique unifié de l’URSS au moment où il fut arrêté en 1934. J’avais été frappé et ému par les dessins, les herbiers, etc., dont il illustrait les lettres que, du camp, il envoyait à sa fille, âgée de 4 ans seulement au moment de son arrestation et qu’il ne reverrait jamais.
P. — Le camp dans lequel il fut emprisonné est atypique à bien des égards. Les livres y tenaient une bonne place. Cette présence de la littérature a joué un rôle dans l’enquête que vous avez menée ?
O. R. — Oui, en effet, il y avait dans le camp des Solovki une véritable vie culturelle, avec notamment une importante bibliothèque constituée par les livres apportés par les déportés, ou envoyés par leurs familles, quelquefois même commandés par l’administration. Cette singularité des Solovki s’explique, je crois, par le fait qu’une grande quantité d’intellectuels, d’artistes et, d’une manière générale, de ceux que la terminologie de la police politique appelait byvshe, « gens du passé » (le genre de personnages qu’on rencontre dans Tchékhov), se trouvaient concentrés là. Et aussi peut-être parce que le SLON, « camp à destination spéciale des Solovki », avait été créé au début des années 1920, à une époque où l’Union soviétique n’était pas encore complètement devenue une dictature policière. Tout cela n’empêchait pas, bien sûr, les exécutions, les morts dues aux travaux exténuants, aux épidémies, etc. D’ailleurs, cet espace de – très relative – liberté au sein de l’esclavage n’a cessé de se restreindre, pour disparaître complètement vers la fin des années 1930, à l’époque où l’URSS s’enfonce dans ce qu’on appelle la « Grande Terreur ». Toujours est-il que c’est en enquêtant sur l’histoire de la bibliothèque pour un film, que je suis retombé, il y a deux ans, sur le personnage du météorologue, qui était le responsable de la section des livres en langues étrangères, et que j’ai décidé de m’intéresser à son destin.
P. — C’est un personnage dont vous ne cachez pas les faiblesses : cela vous a aidé, inspiré ?
O. R. — Non, je ne dirais pas ça. J’aurais peut-être spontanément « préféré » qu’il soit plus immédiatement révolté, qu’il se fasse moins d’illusions sur les « camarades dirigeants », sur Staline. Qu’il soit un moins « bon communiste », en somme. Mais au fond, le fait qu’il ait été un citoyen soviétique modèle, croyant de toutes ses forces intellectuelles travailler à la « construction du socialisme », rend son destin à la fois plus représentatif et plus tragique.
P. — Dans votre livre (récit ? enquête ?) à la fois percutant et hybride (avec des dessins, des extraits de lettres, les devinettes d’Alexeï à destination de sa fille et de son épouse), votre voix se mêle à celle du météorologue de façon très troublante. Cette forme narrative s’est-elle imposée à vous dès le départ ?
O. R. — S’il faut qualifier le livre, je dirais, oui, que c’est une enquête. Après, qu’on l’appelle (ou non) « roman » ne me gêne pas. Le territoire du roman est vaste et changeant. Il n’exclut pas l’exactitude. En tout cas, je me suis efforcé d’être aussi rigoureux, aussi exact que possible. Il me semble que je devais ça à la mémoire de cette victime innocente, de sa fille aussi, morte dans les circonstances que je dis à la toute fin du livre. J’avais aussi une dette morale vis-à-vis des travaux, sur lesquels je me suis appuyé, des chercheurs militants de Memorial, une association qui lutte courageusement pour que ne s’efface pas la mémoire des centaines de milliers, des millions de morts, dont la plupart gisent encore en des lieux inconnus de la terre russe. Mais évidemment, cette enquête, je l’ai menée avec ma subjectivité, dont je m’explique dans la quatrième partie, et je l’ai mise en forme avec les moyens, je l’espère, qui sont ceux de la littérature. Alors, par exemple, dans la seconde partie, le mélange, ou plutôt l’entrelacement de ma voix, qui dit « je », avec celle du météorologue, telle qu’elle nous est parvenue à travers ses lettres à sa famille, est une forme qui s’est imposée à moi (c’est comme ça que ça se passe quand on écrit : des choses s’imposent, après on essaie de les comprendre et de les maîtriser). Elle s’est imposée et ensuite je l’ai réfléchie, j’ai voulu que cela sonne comme une espèce de mélopée, de chant lancinant. Je dis « entrelacement » et non « mélange », car tout de même les voix ne se confondent pas, elles se distinguent, la mienne ne fait que commenter la sienne.
P. — Avez-vous conscience que votre livre est non seulement une nécessaire « mise en garde » adressée aux lecteurs du XXIe siècle, mais aussi une belle invitation à lire des essais historiques, politiques, des témoignages, sur l’histoire de l’URSS ?
O. R. — Je l’espère. Pour comprendre notre époque, il faut savoir d’où nous venons. Le présent se construit à l’aveuglette sur les décombres de tous un tas de passés abolis. Cette histoire terrible, c’est la moitié, l’une des deux faces du sombre xxe siècle. L’espérance révolutionnaire a traversé la terre entière. Le communisme, comme on sait, n’a pas concerné que l’URSS, il a été aussi, par exemple, « une passion française », pour reprendre le titre d’un livre d’un ami historien, Marc Lazar (Le Communisme, une passion française, Perrin). Sa fin terrible, qui est advenue bien avant qu’elle soit reconnue, fait sentir ses effets jusque dans notre monde d’aujourd’hui.