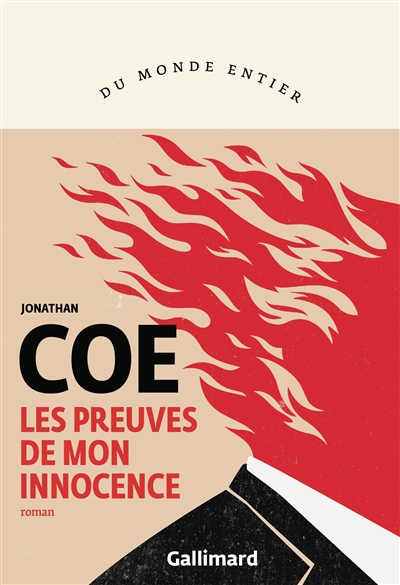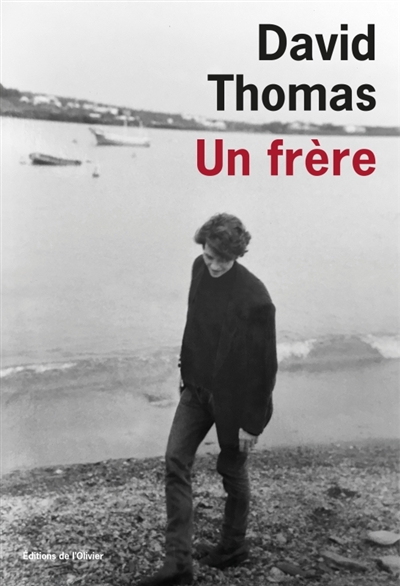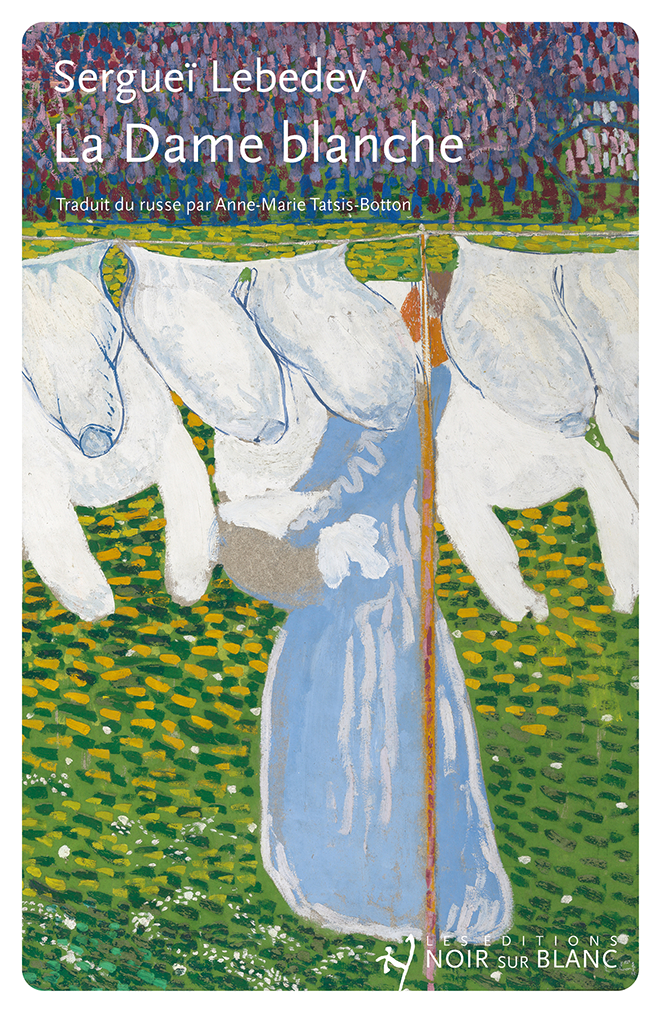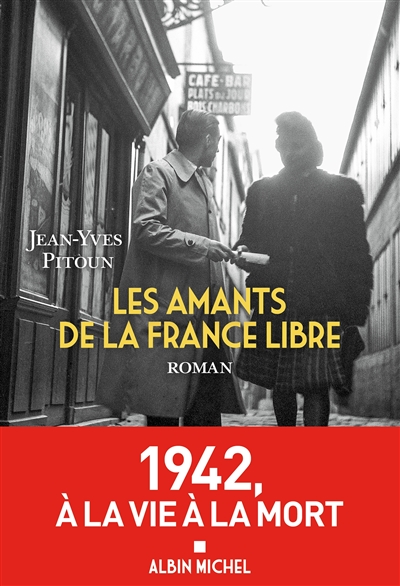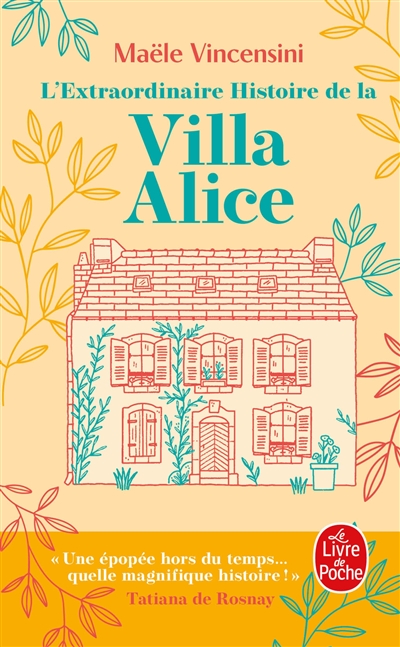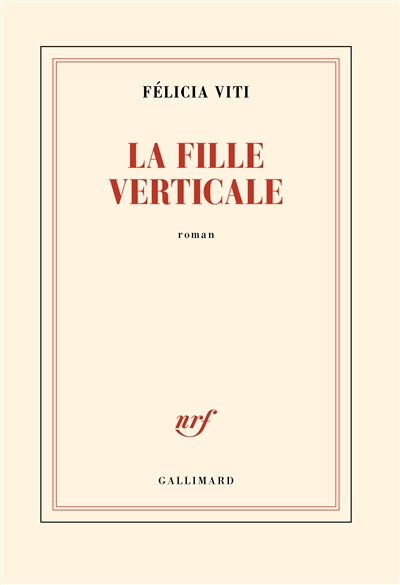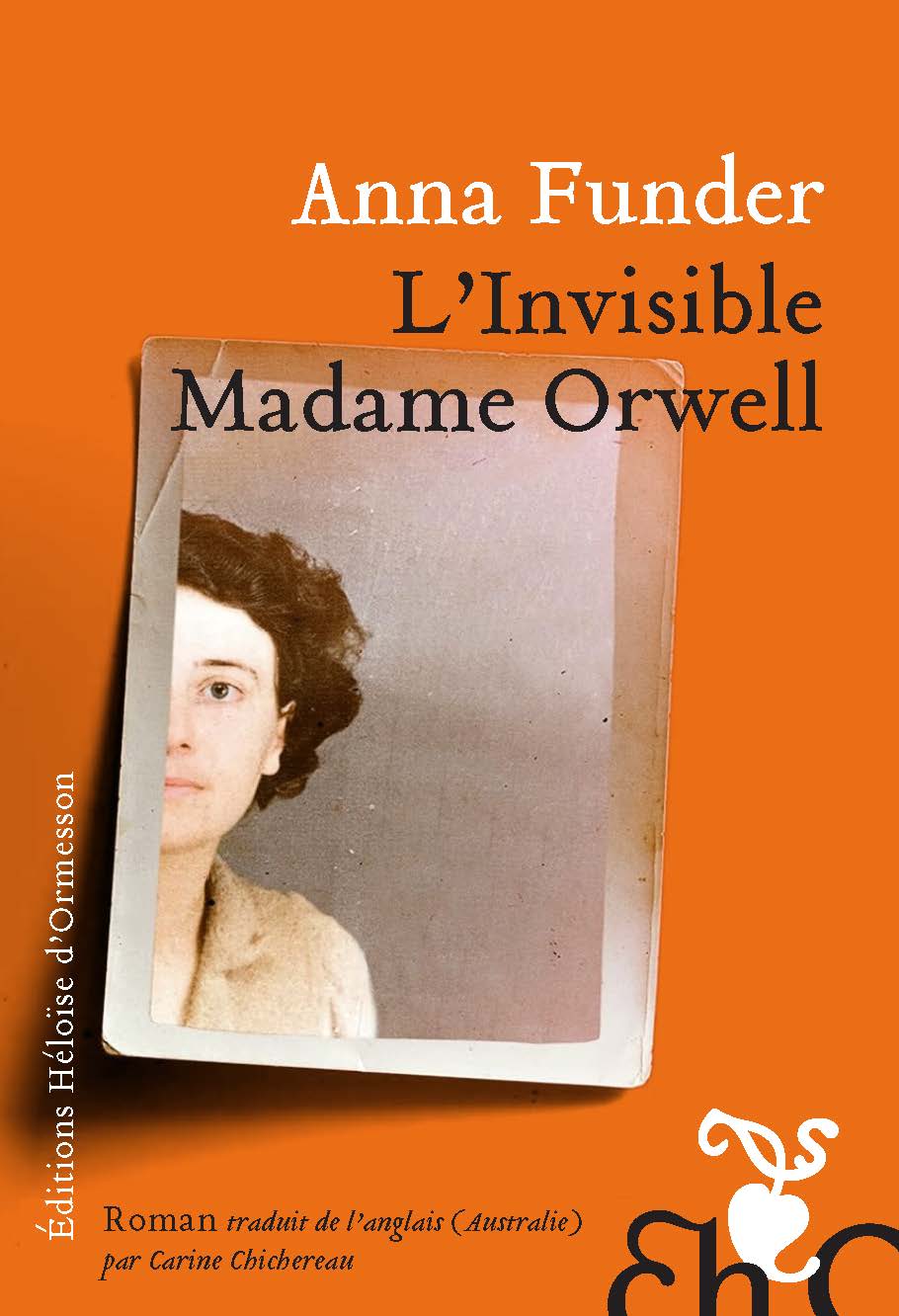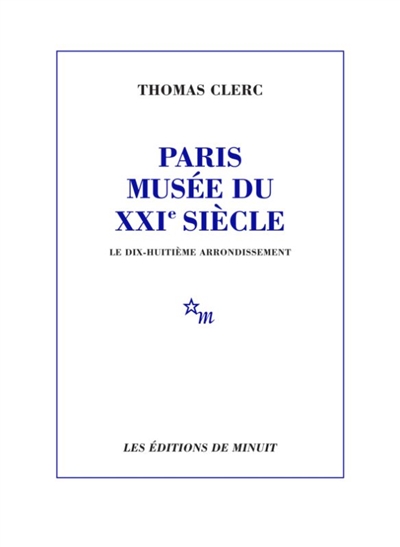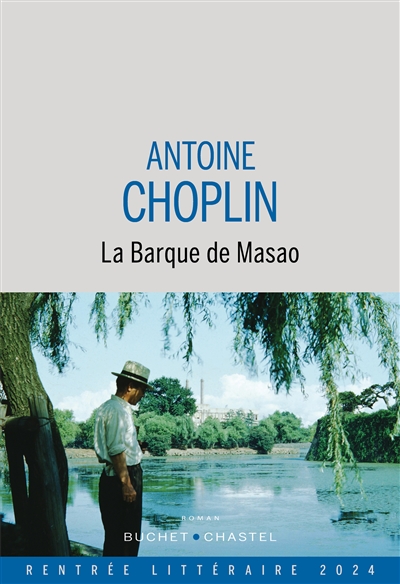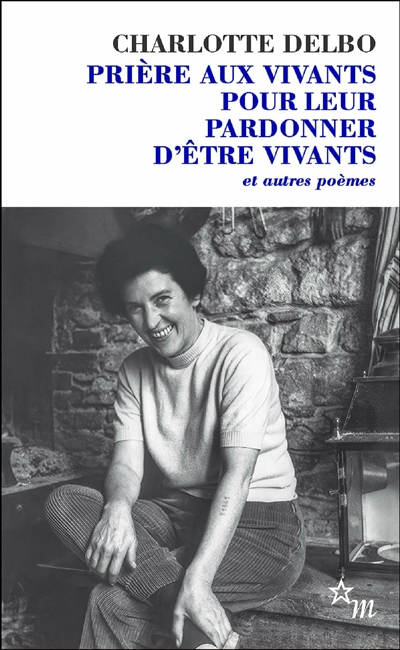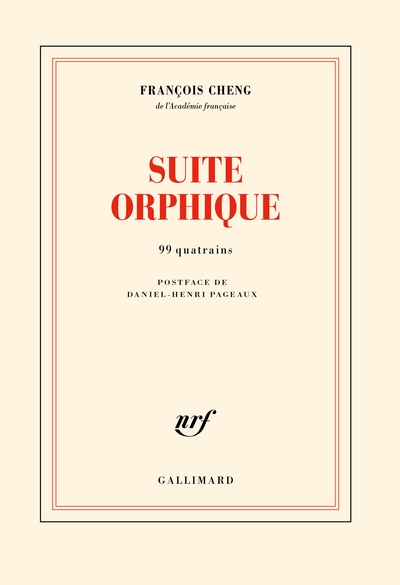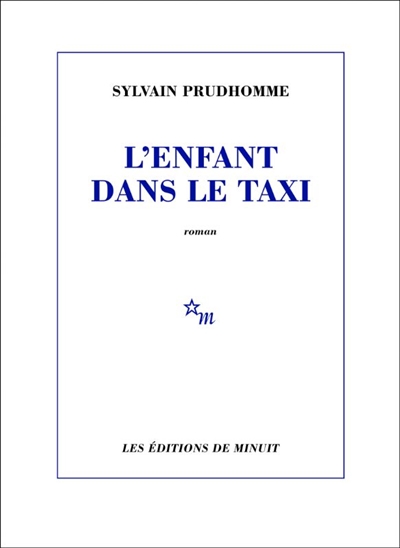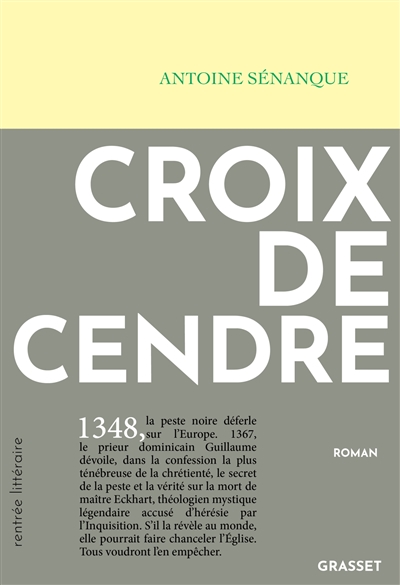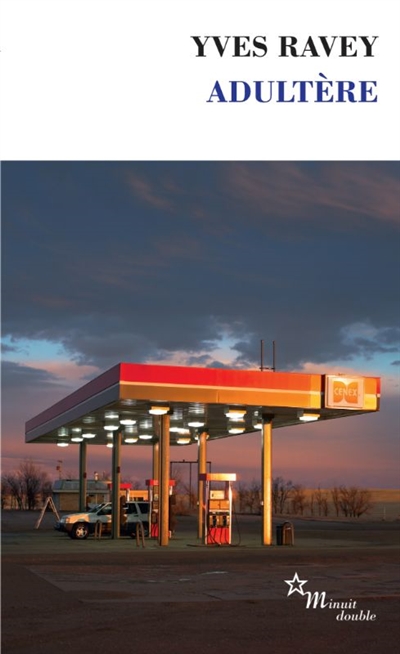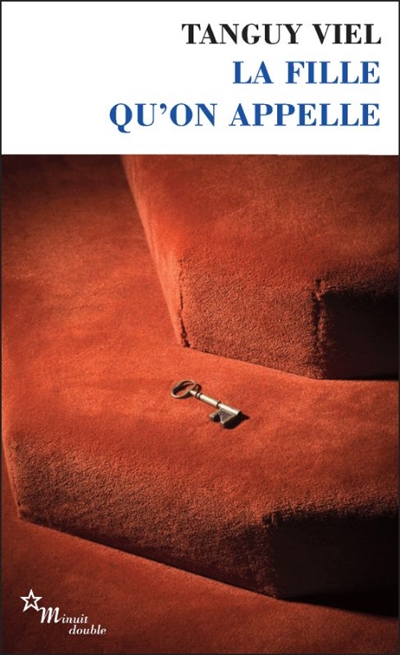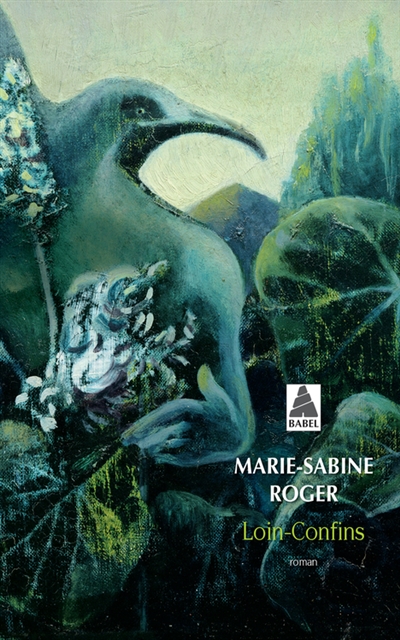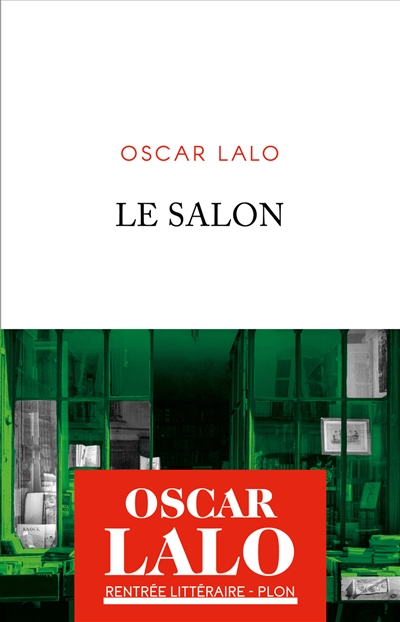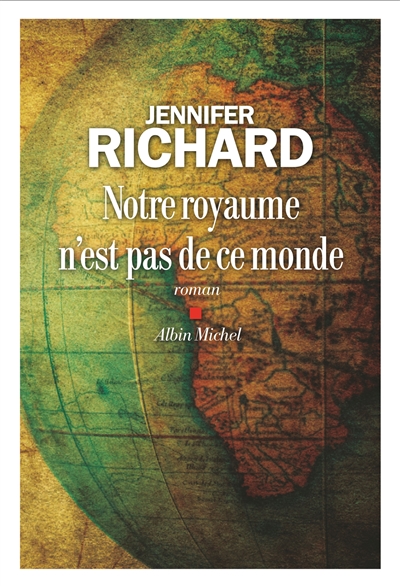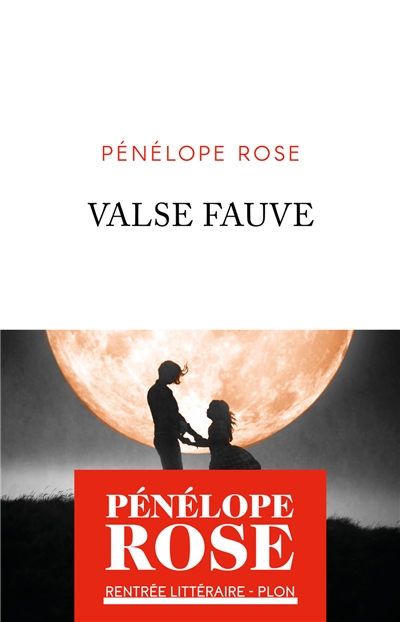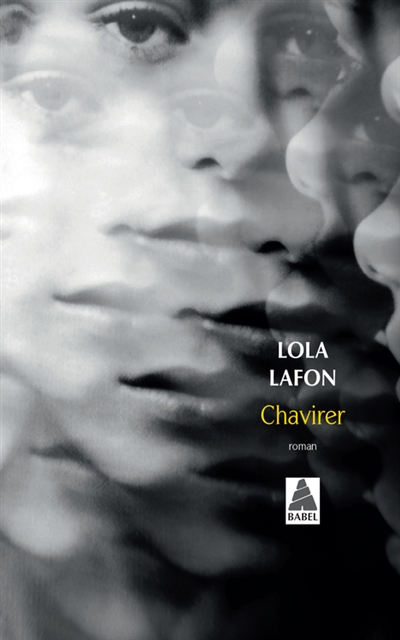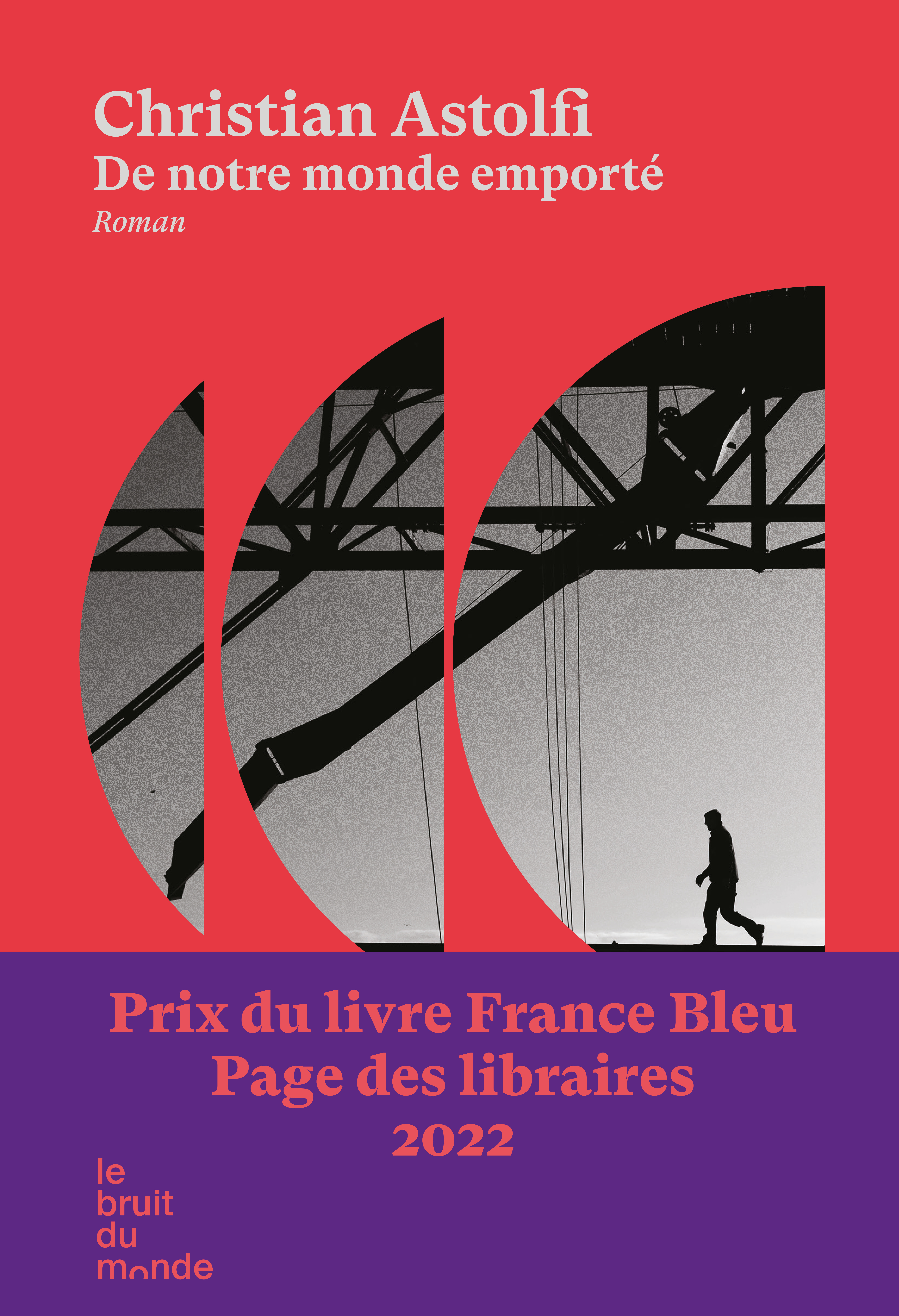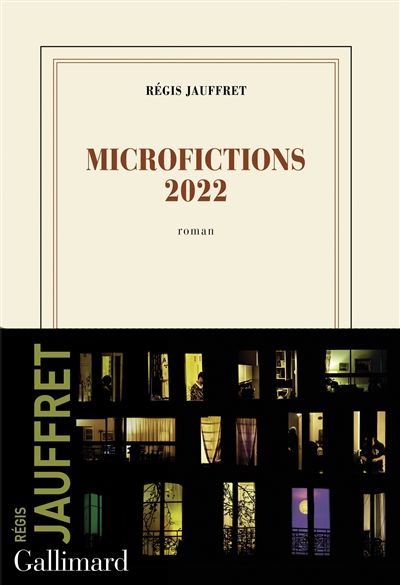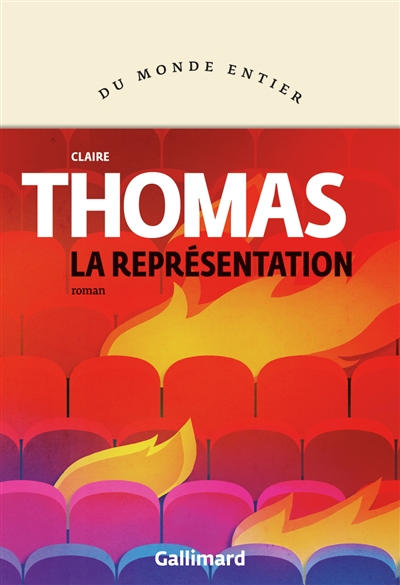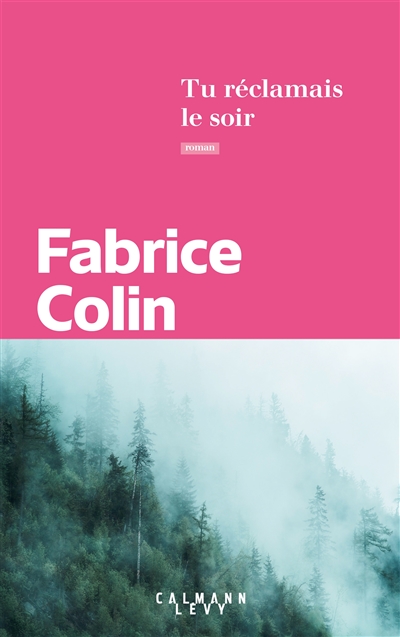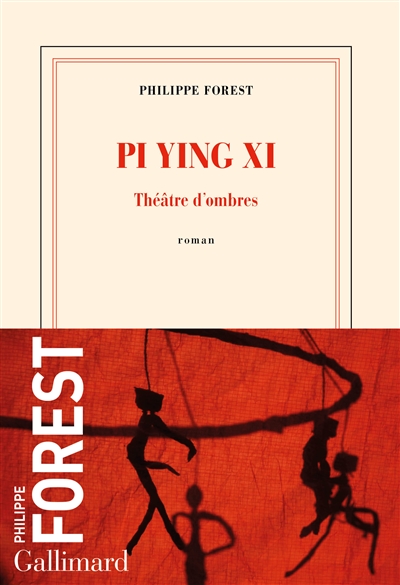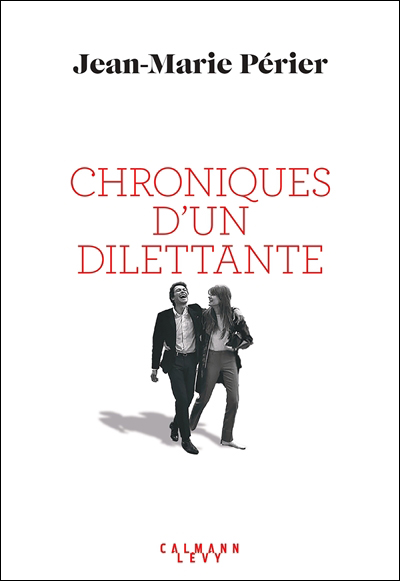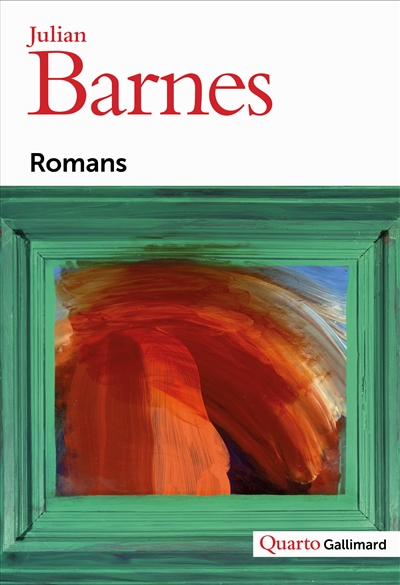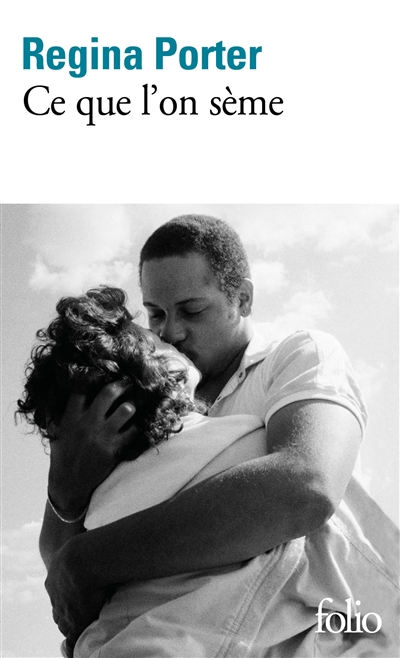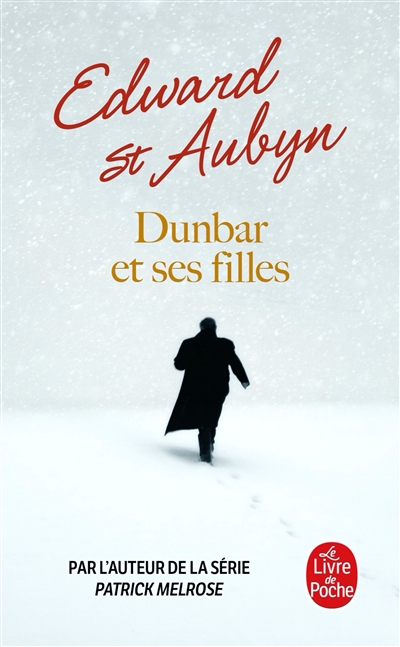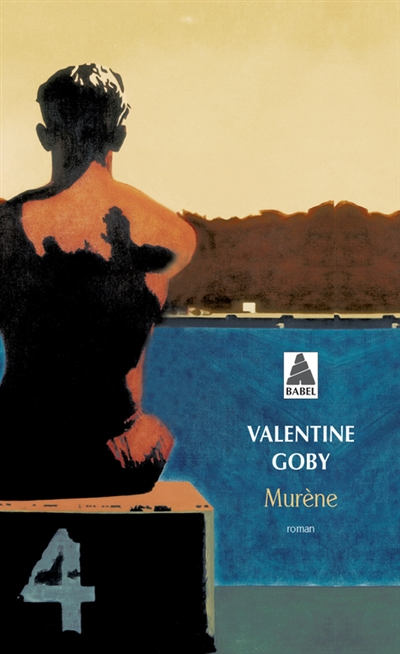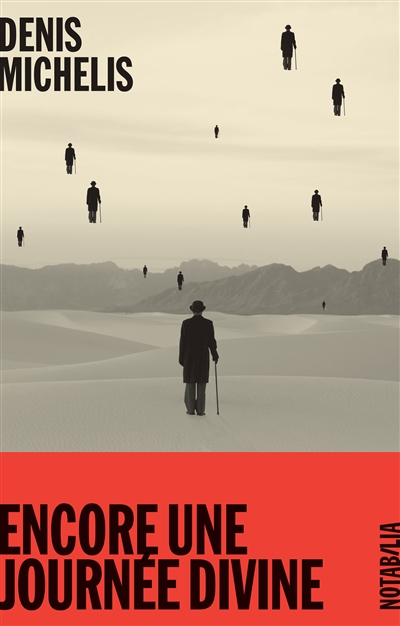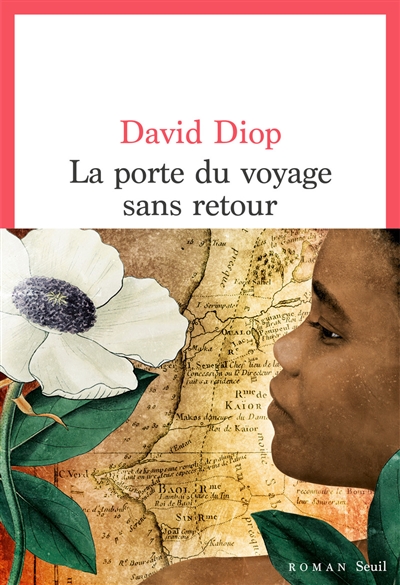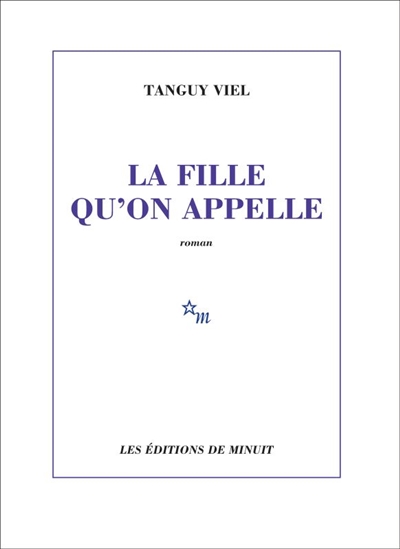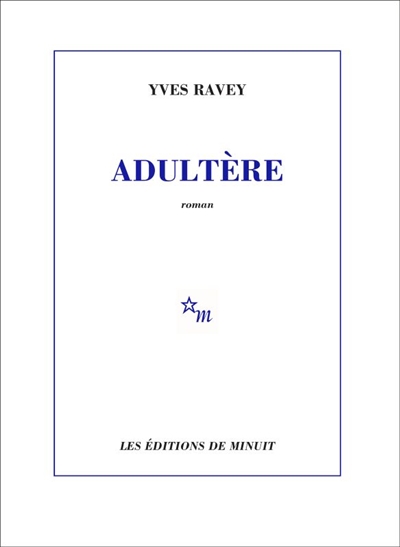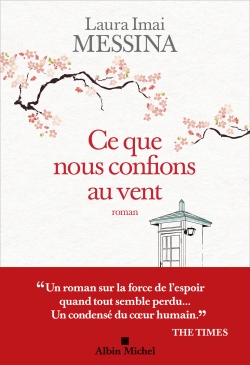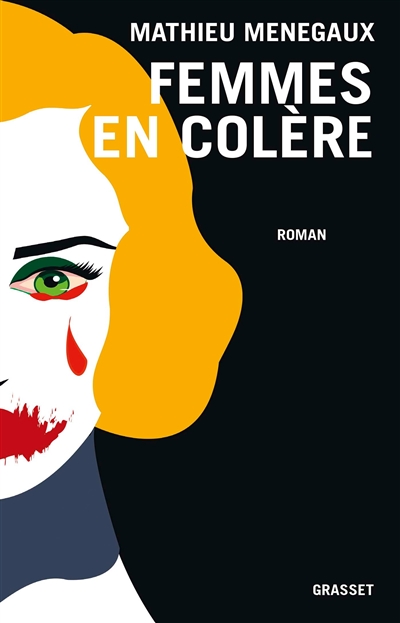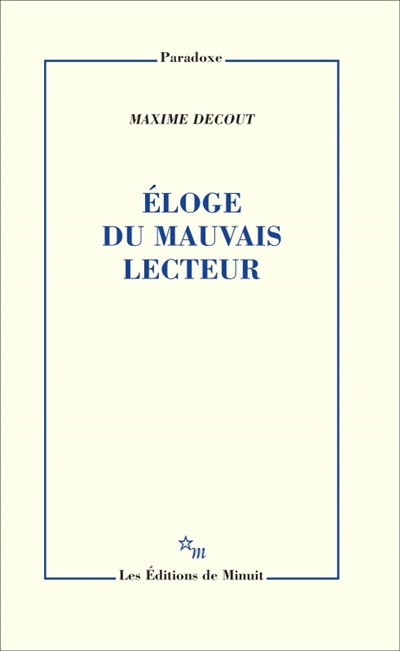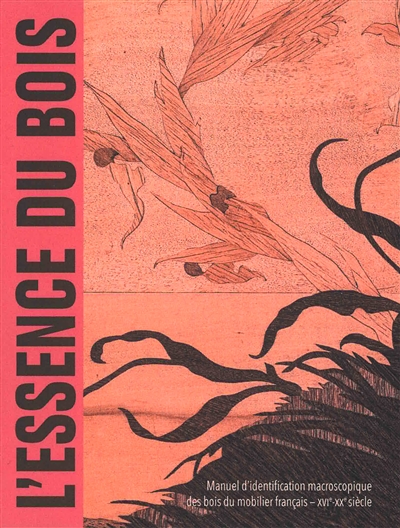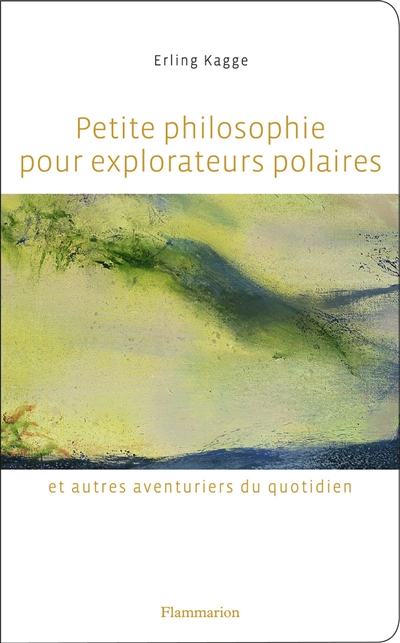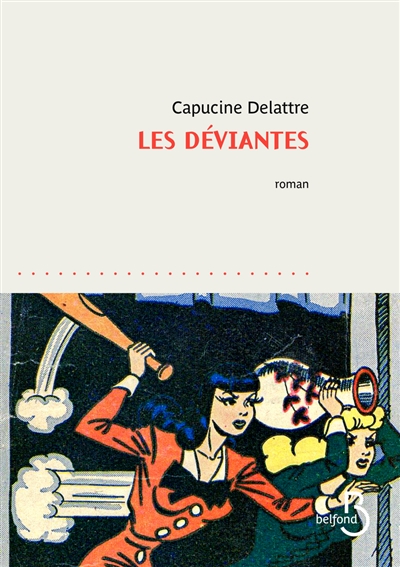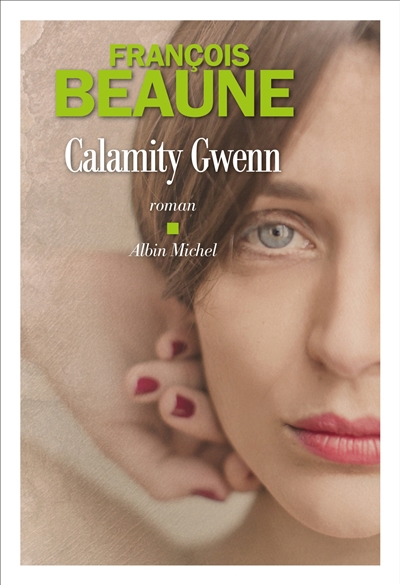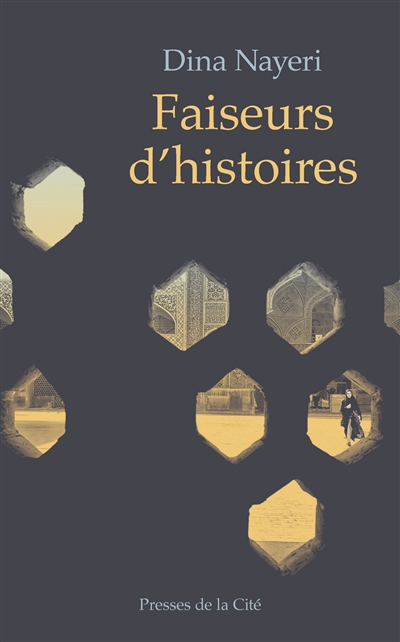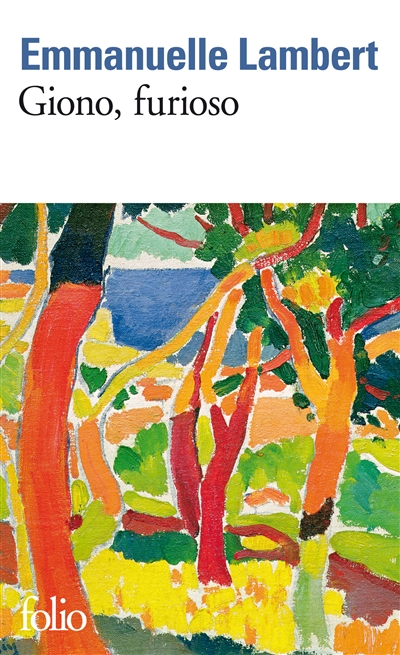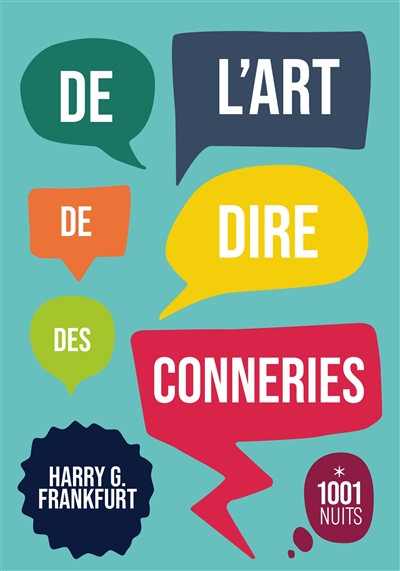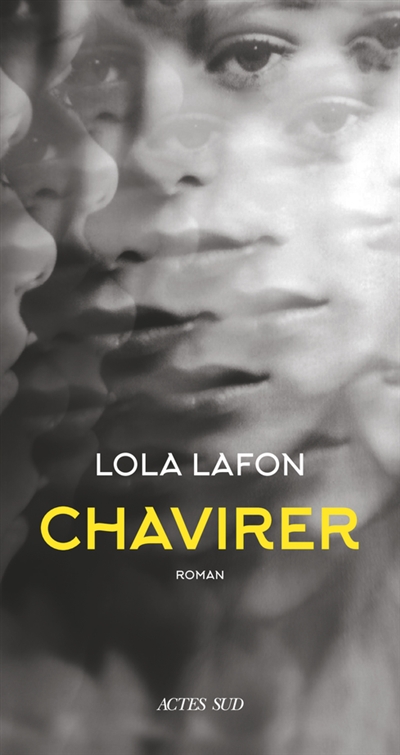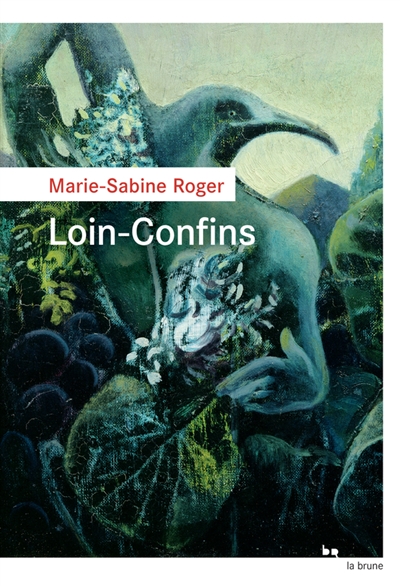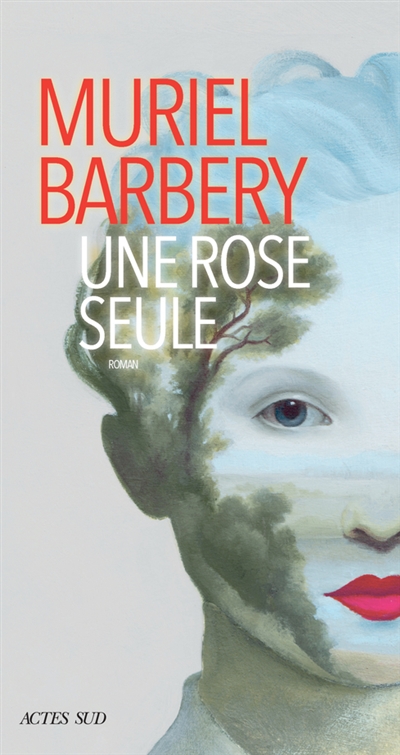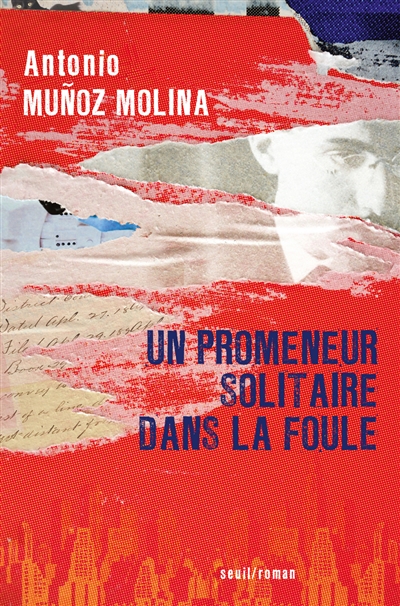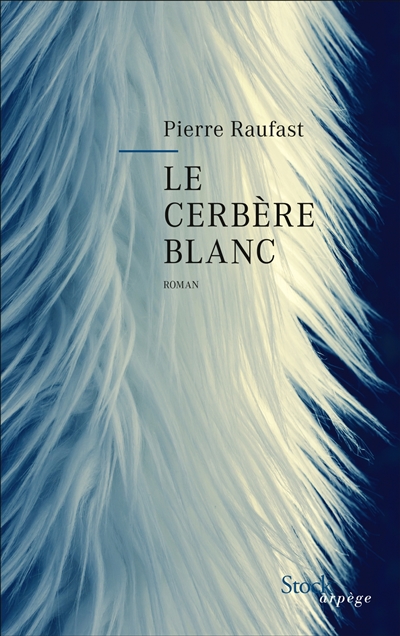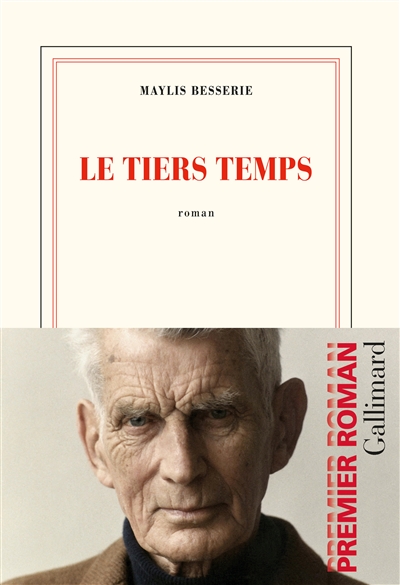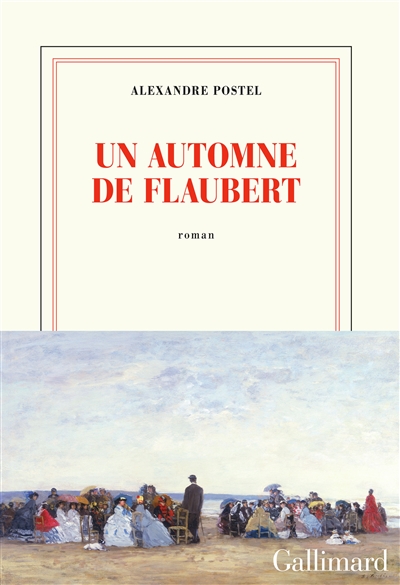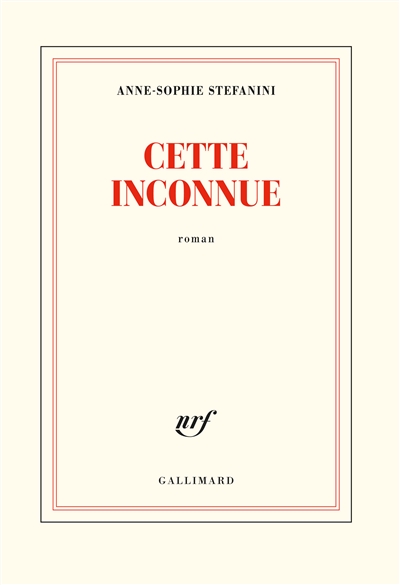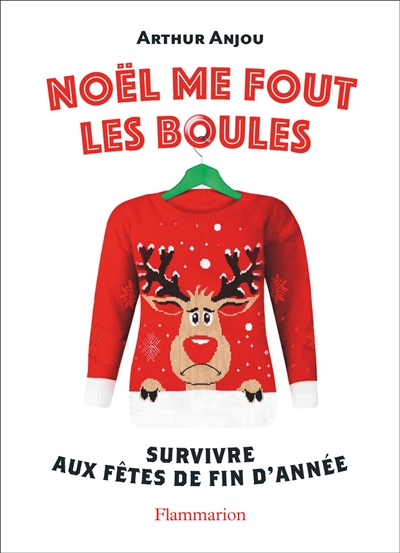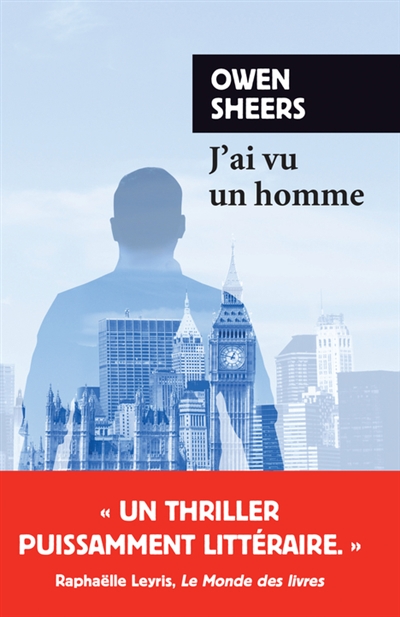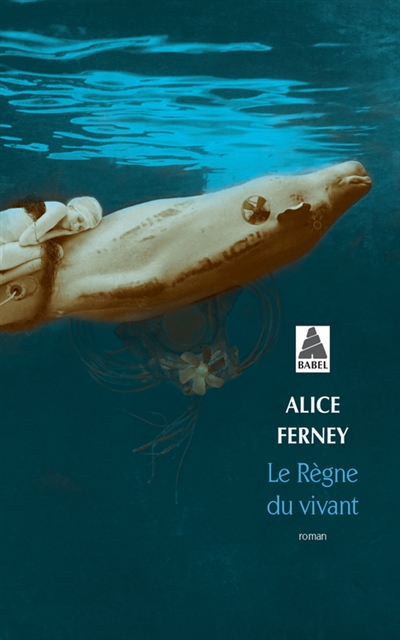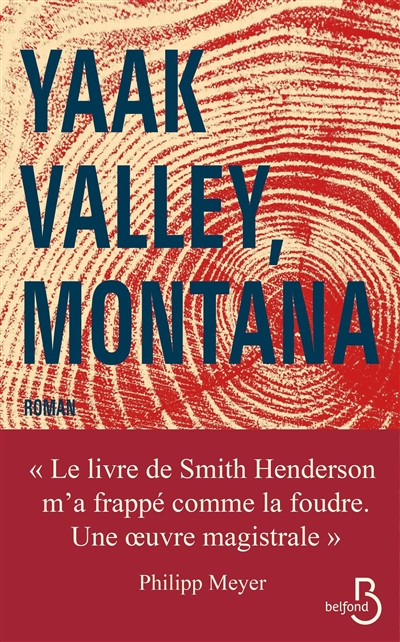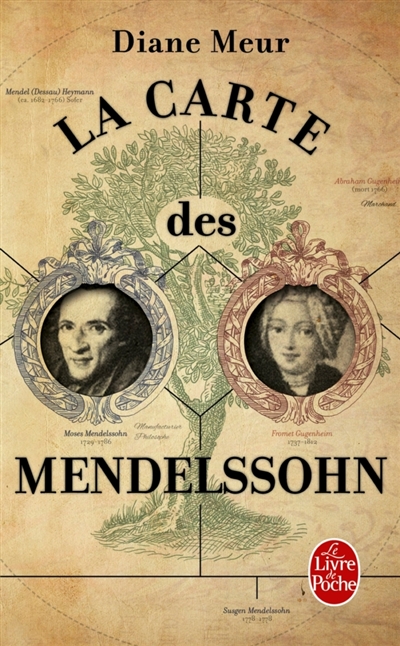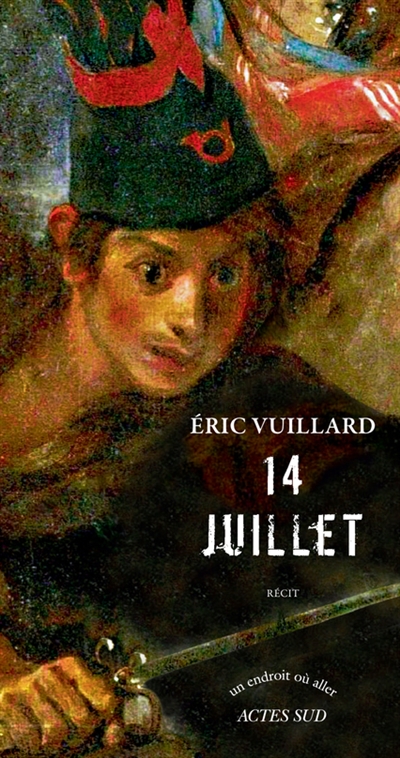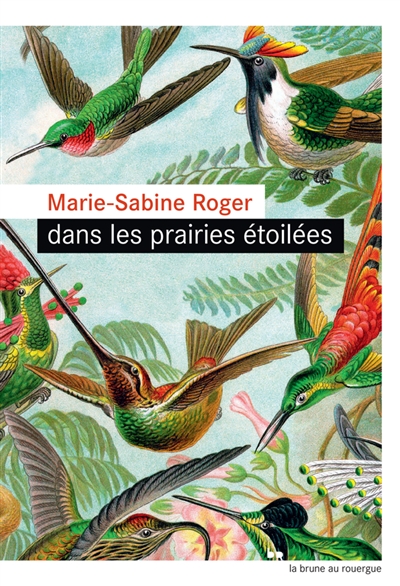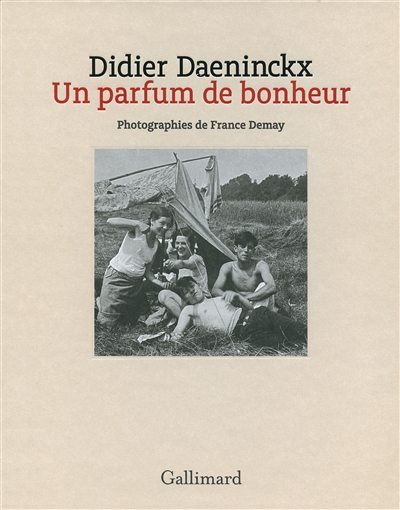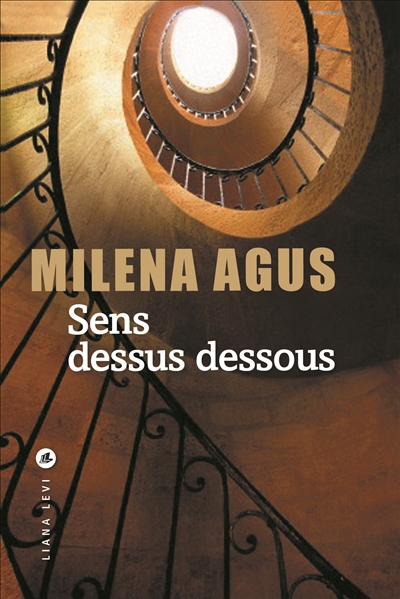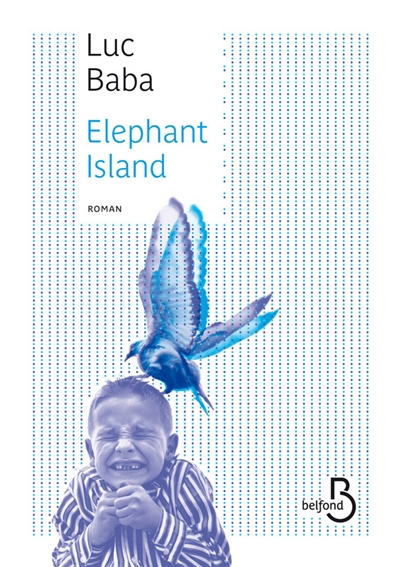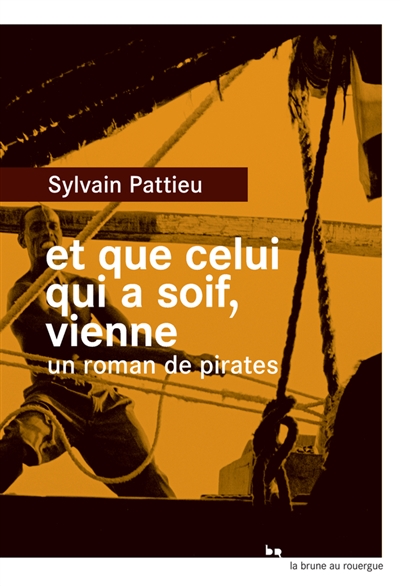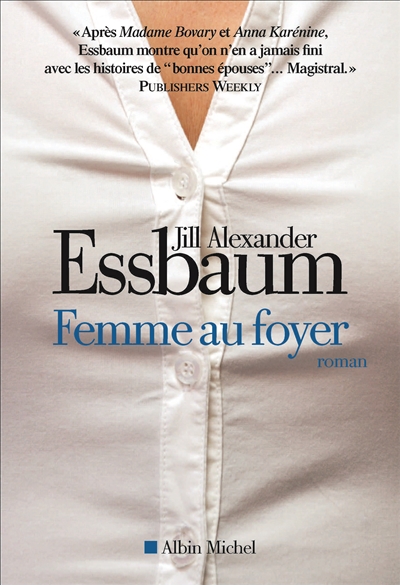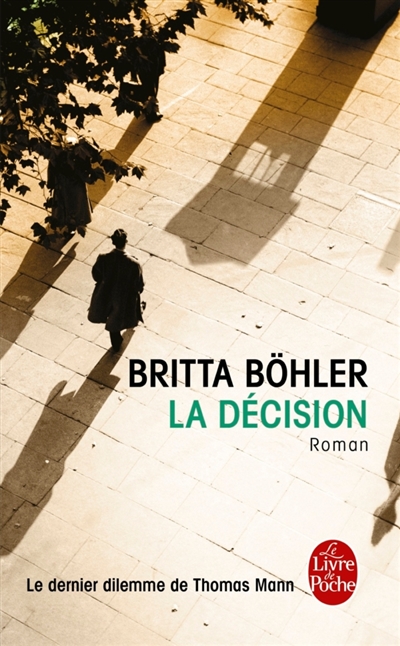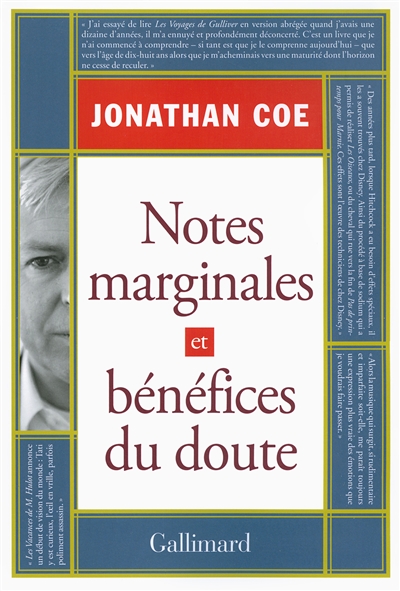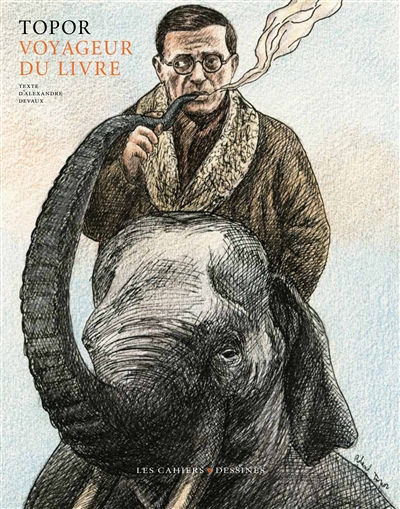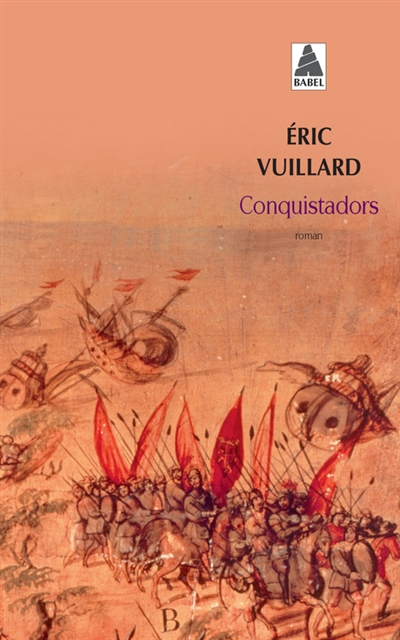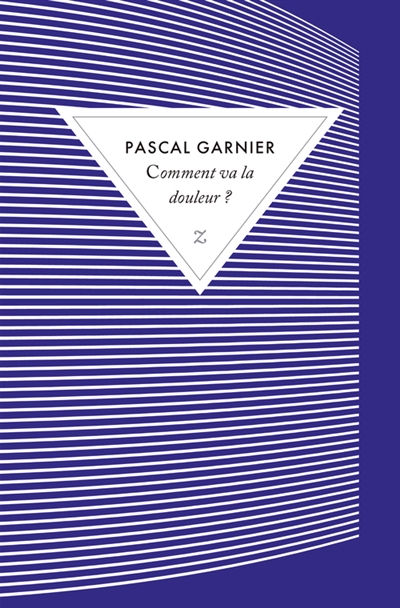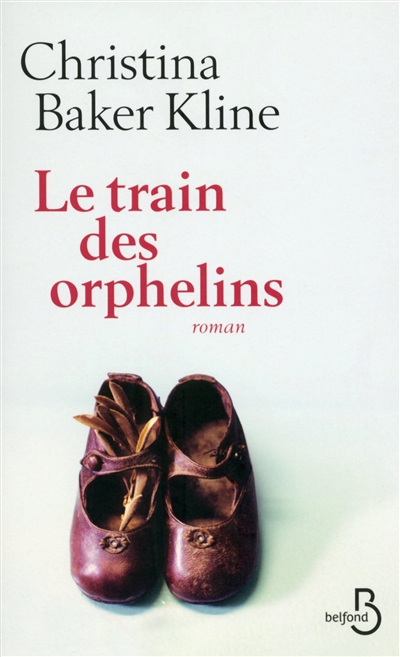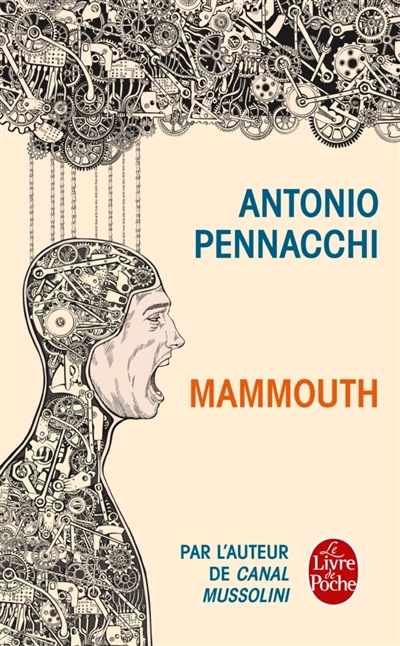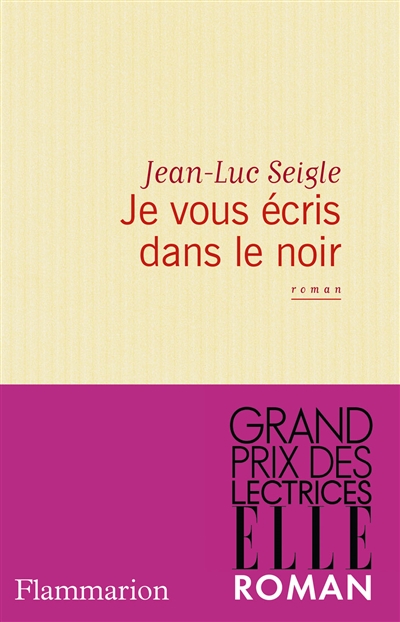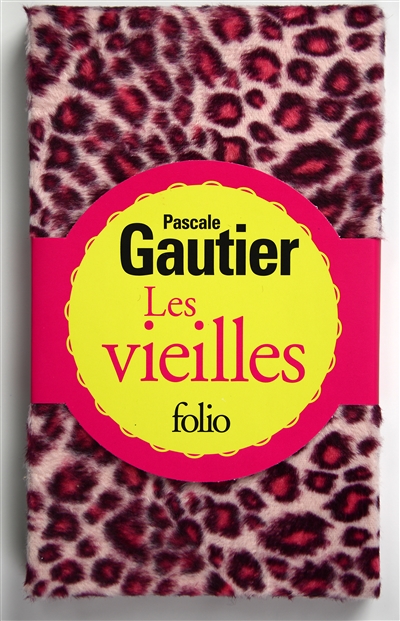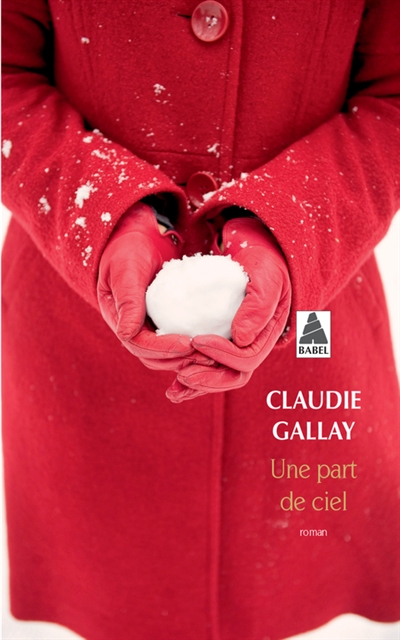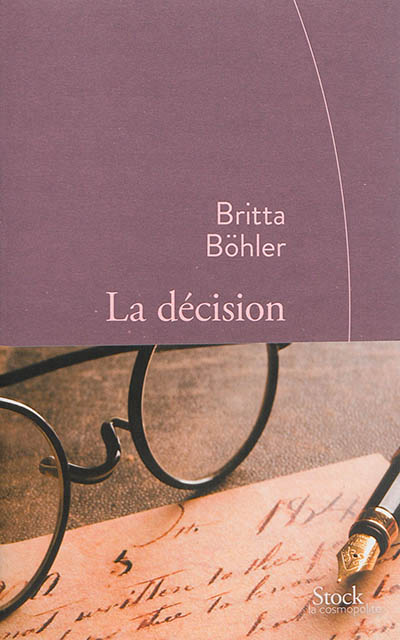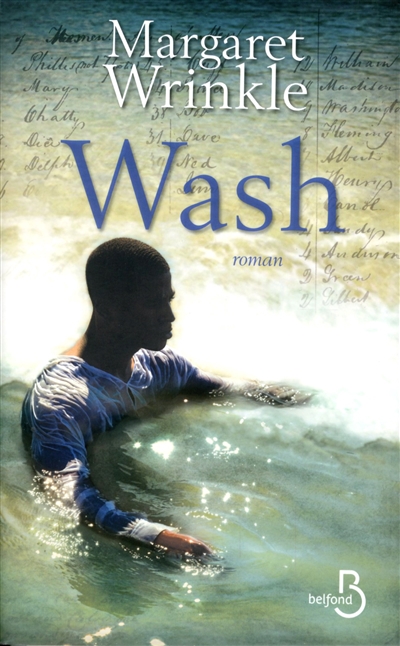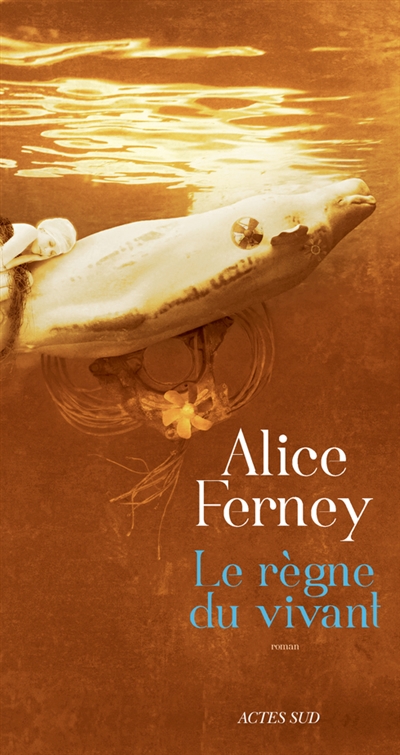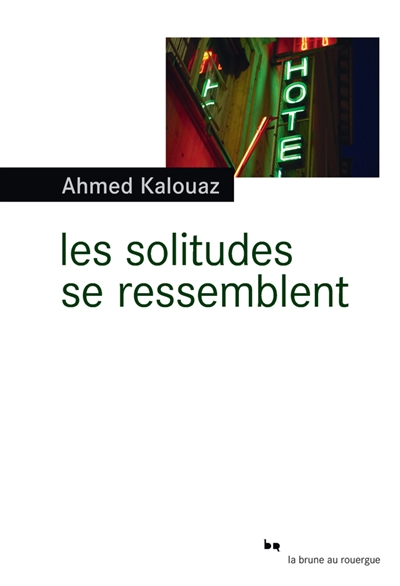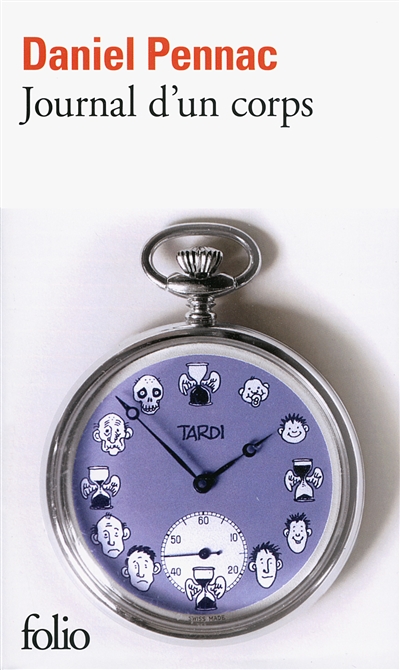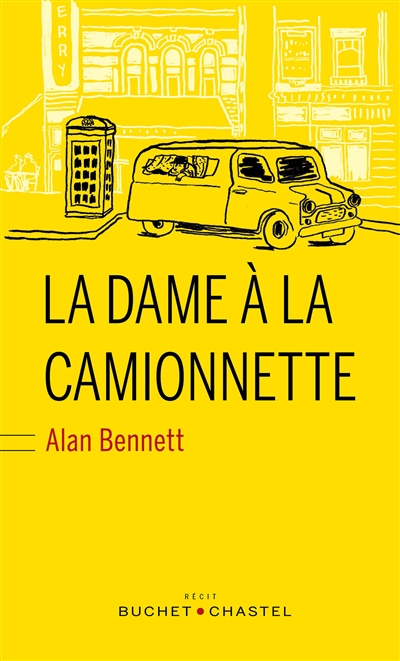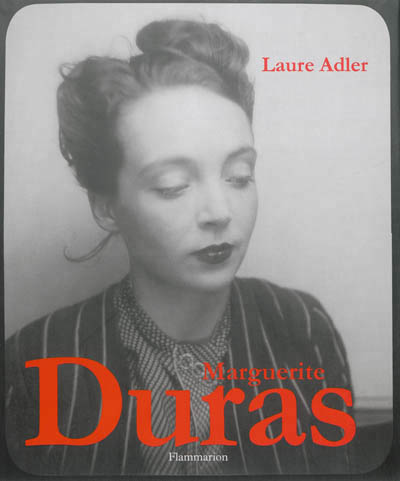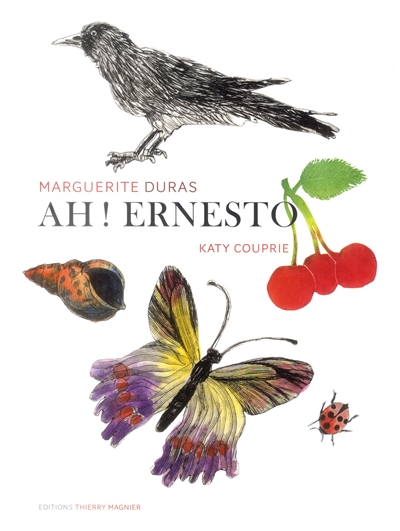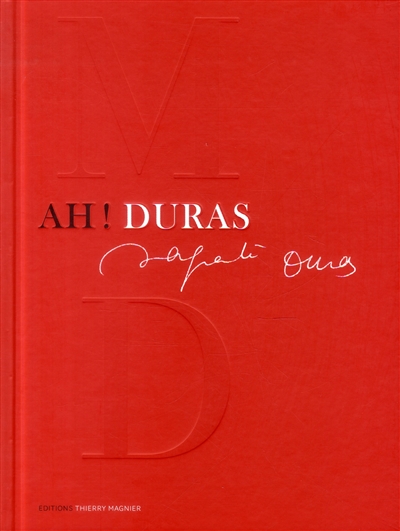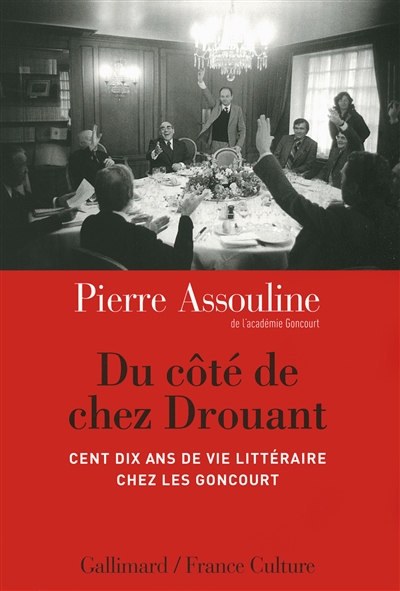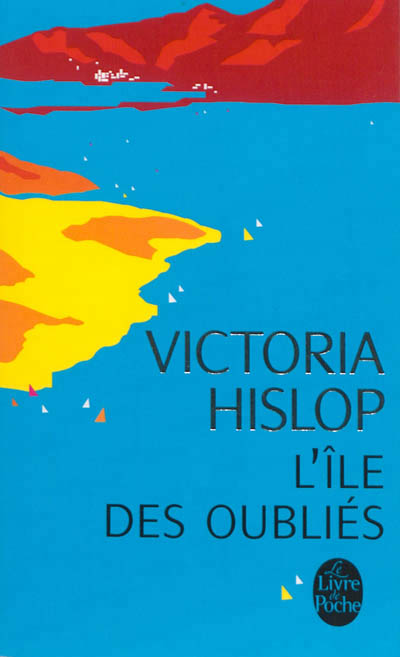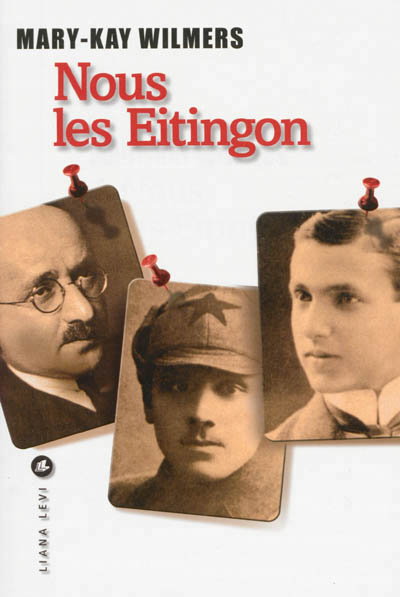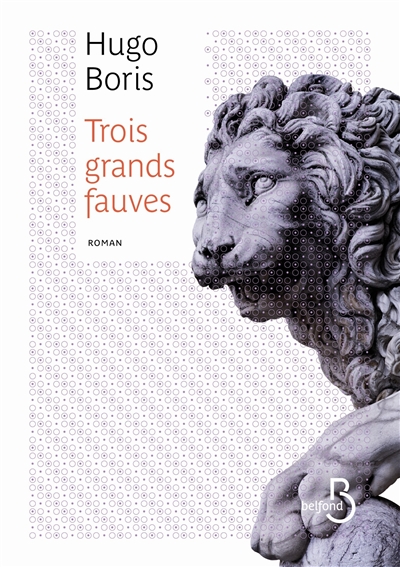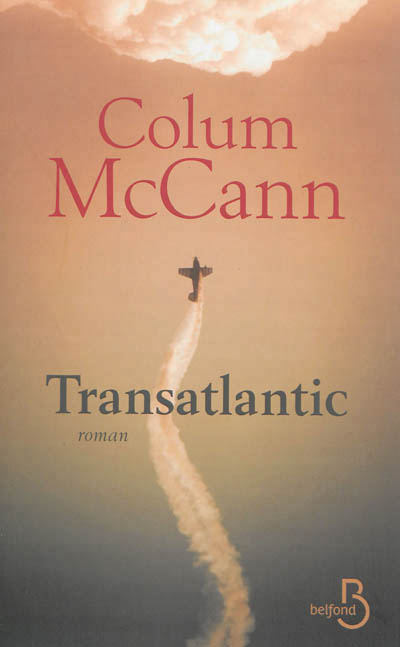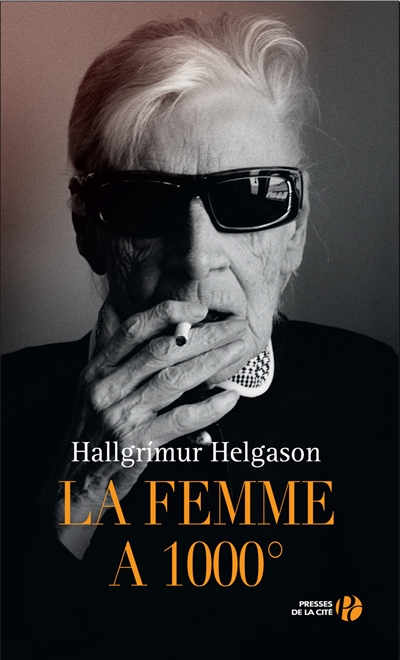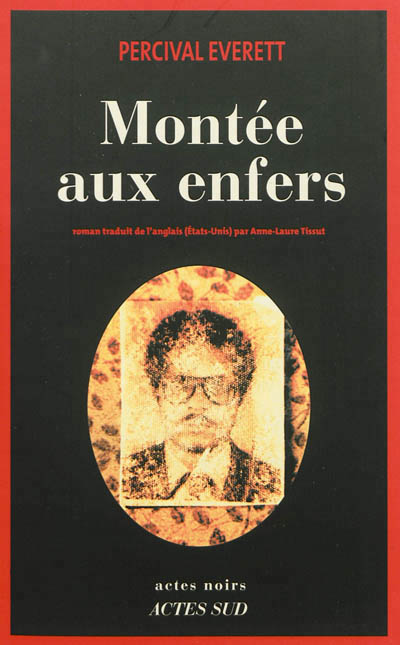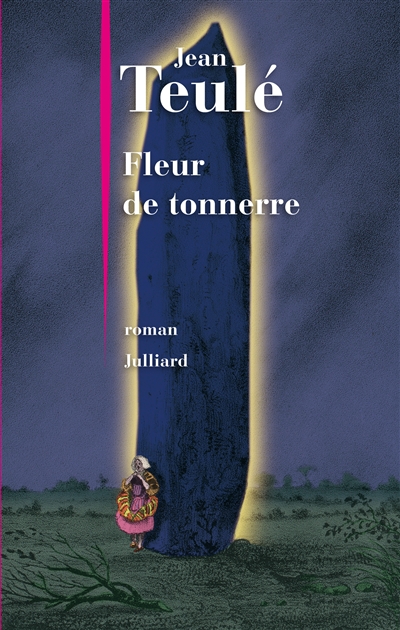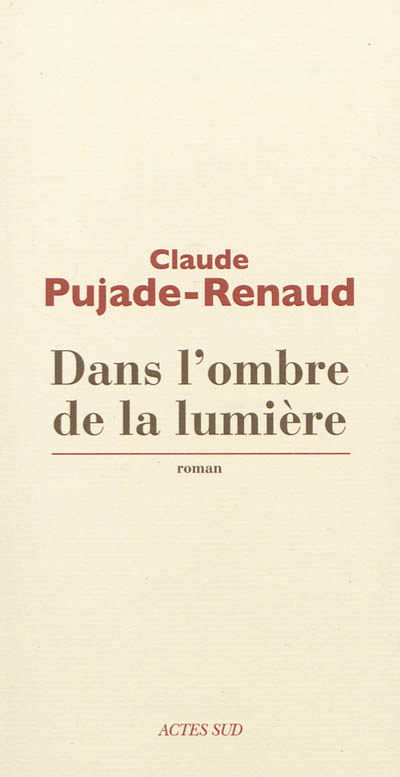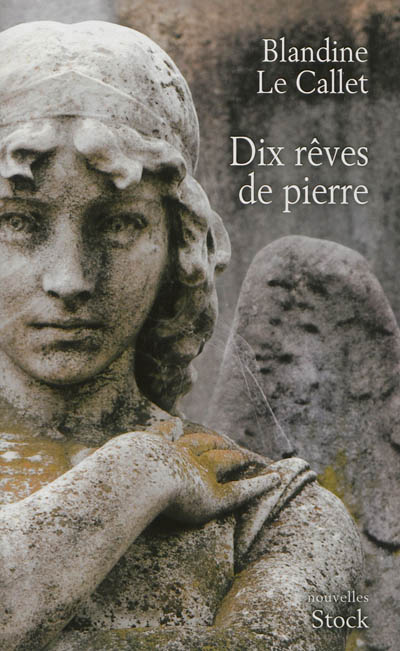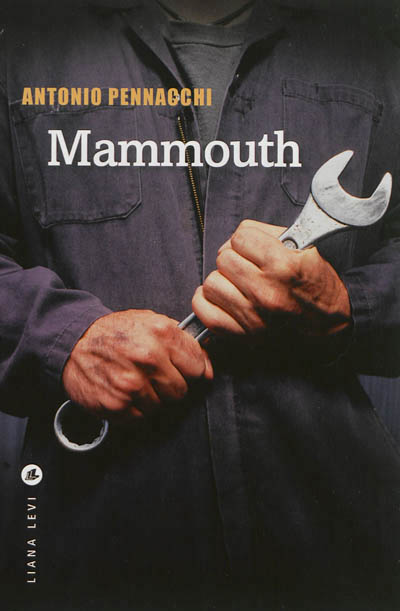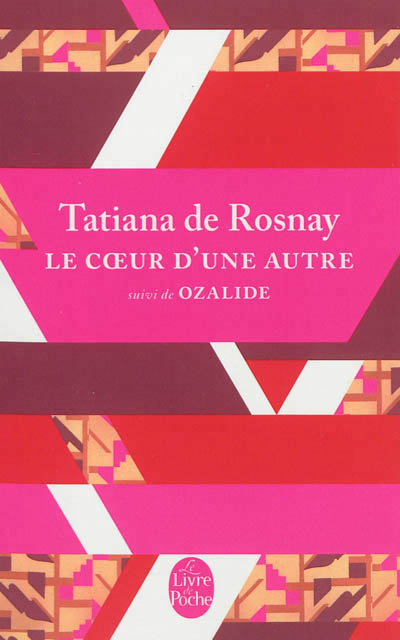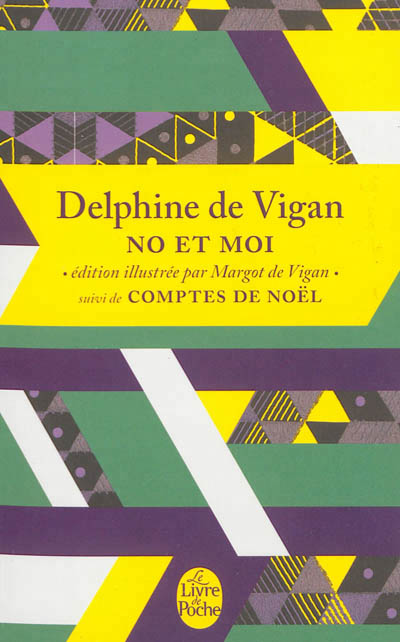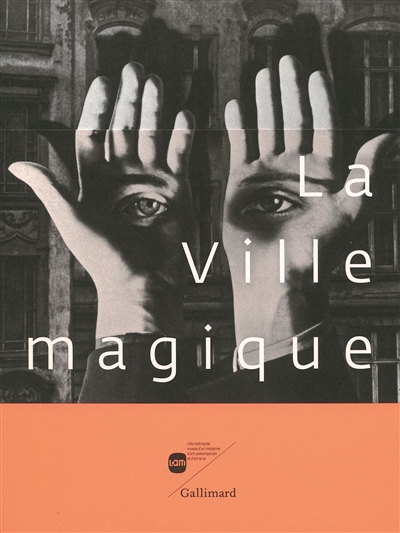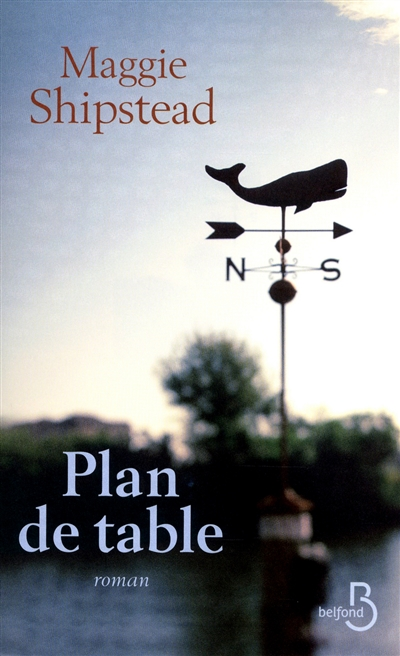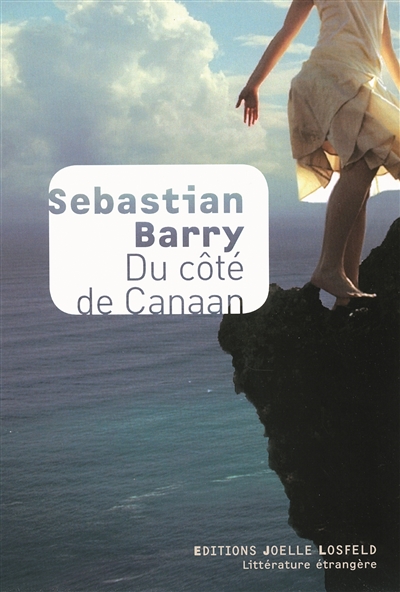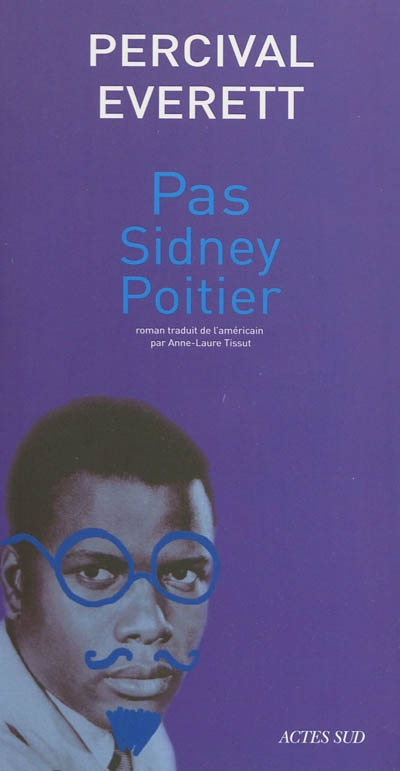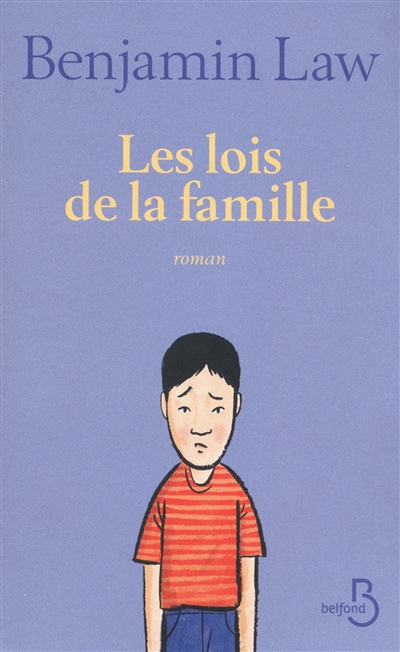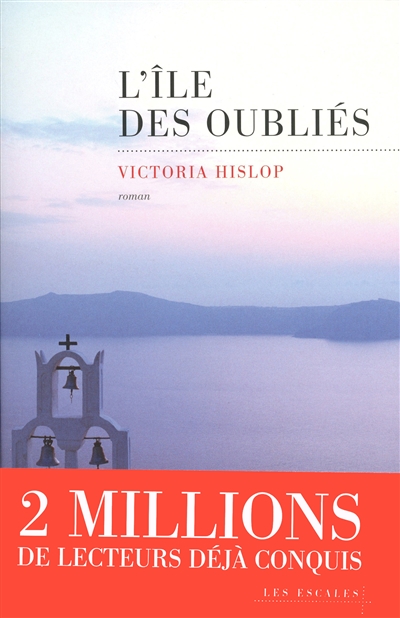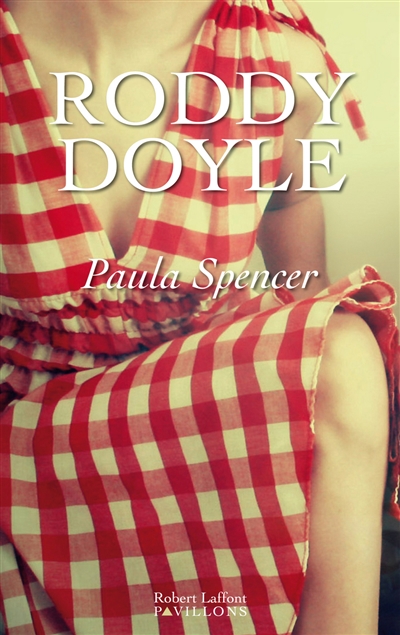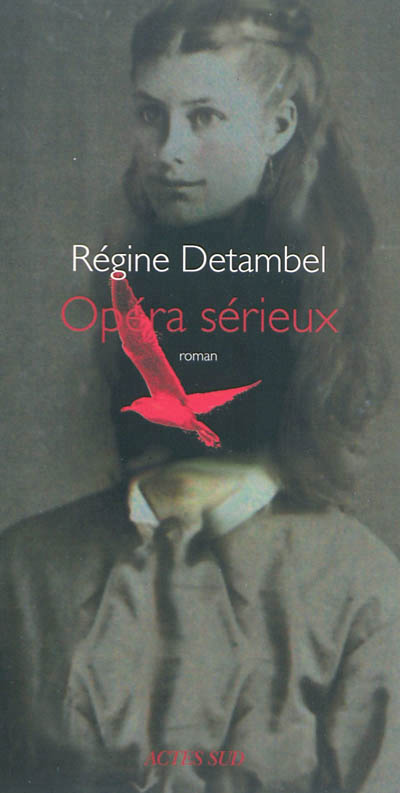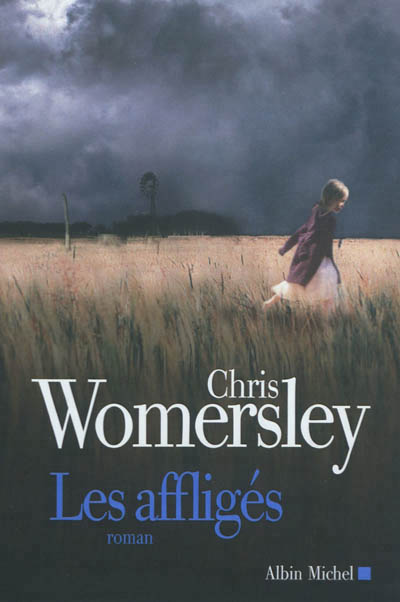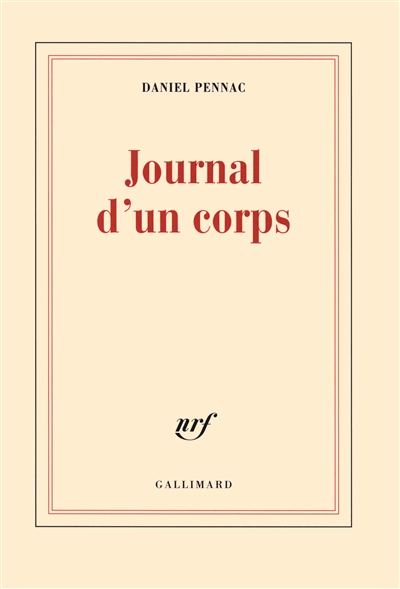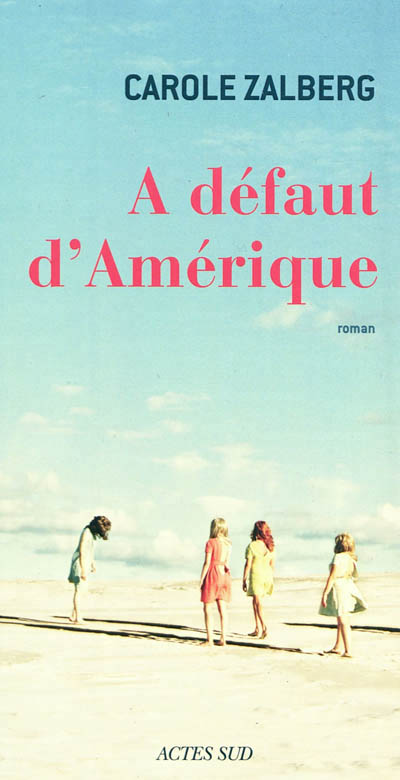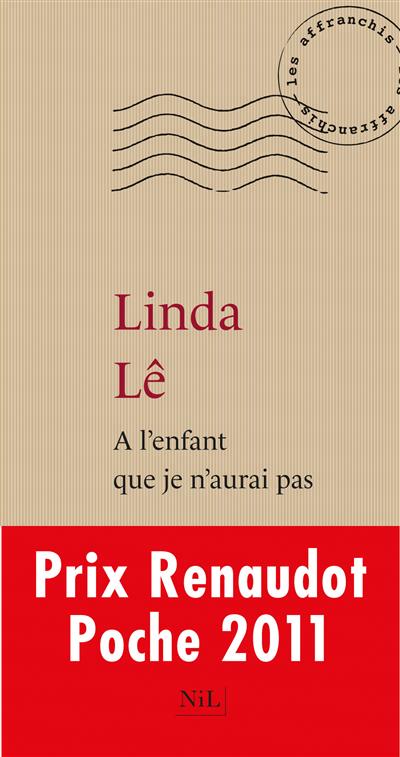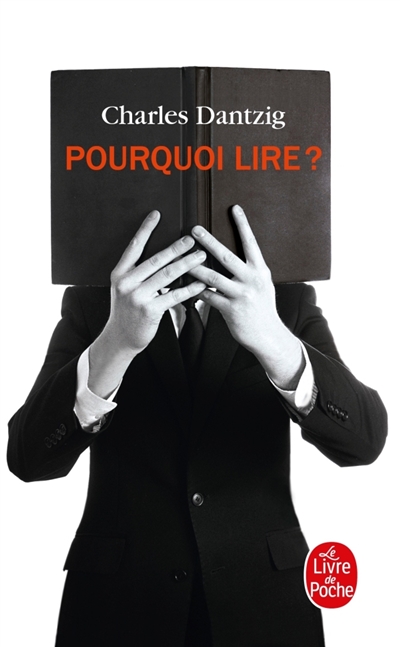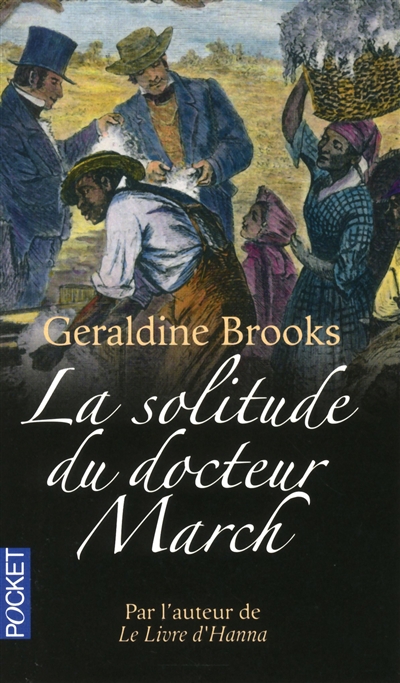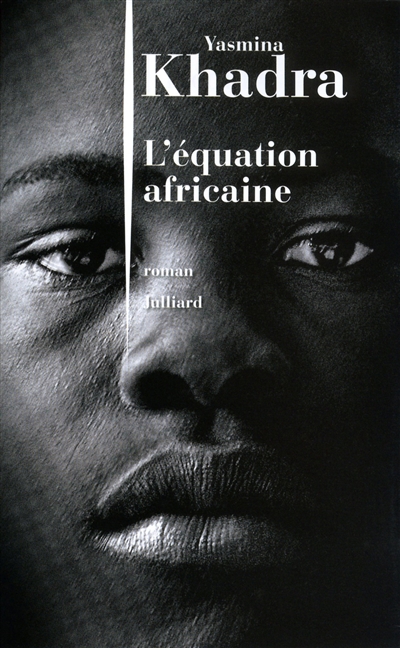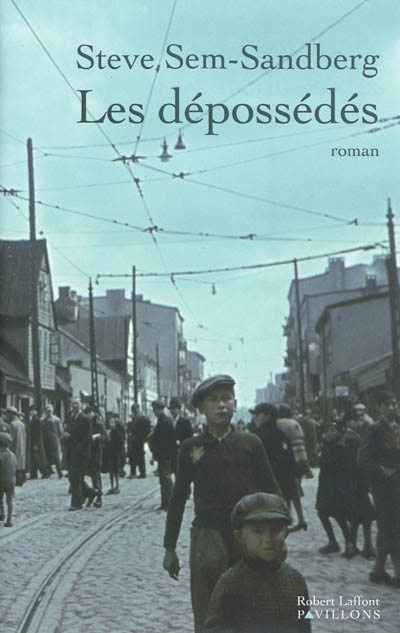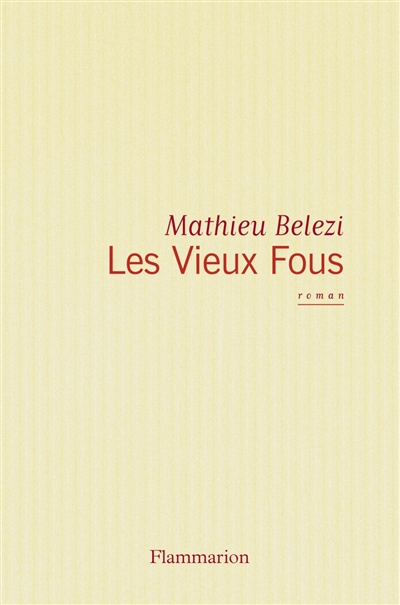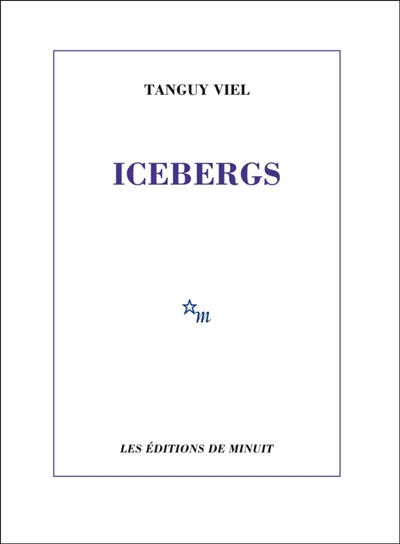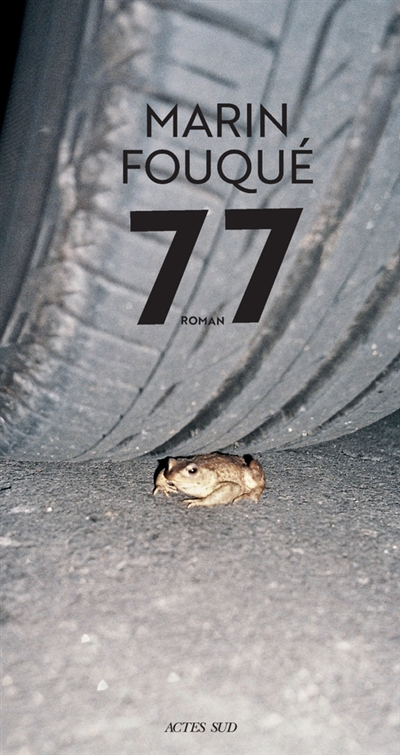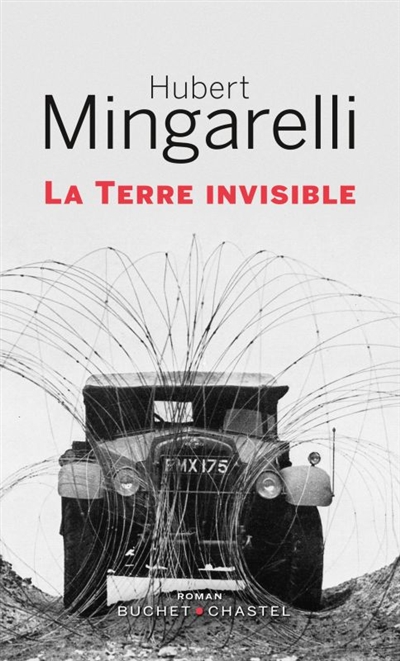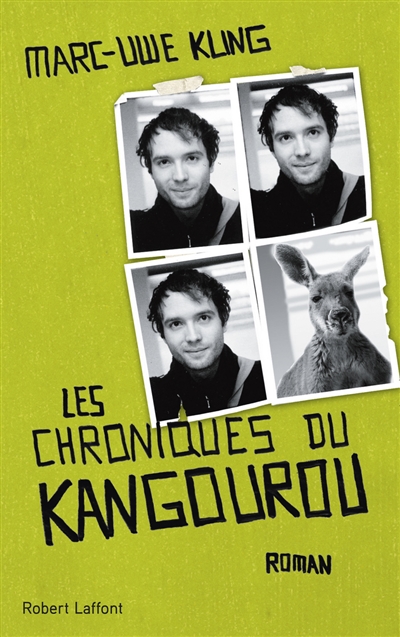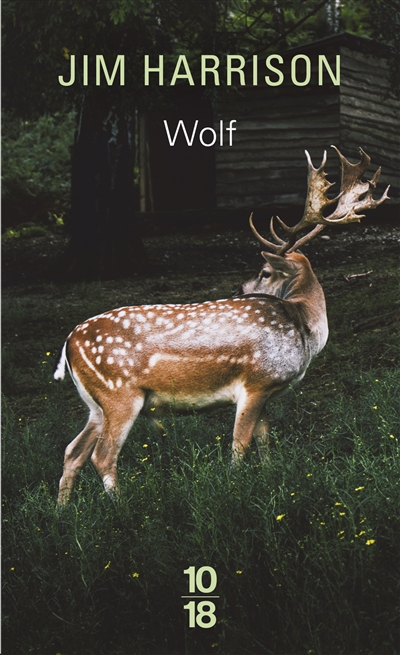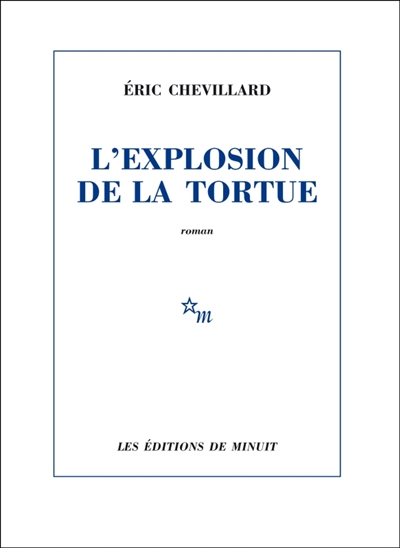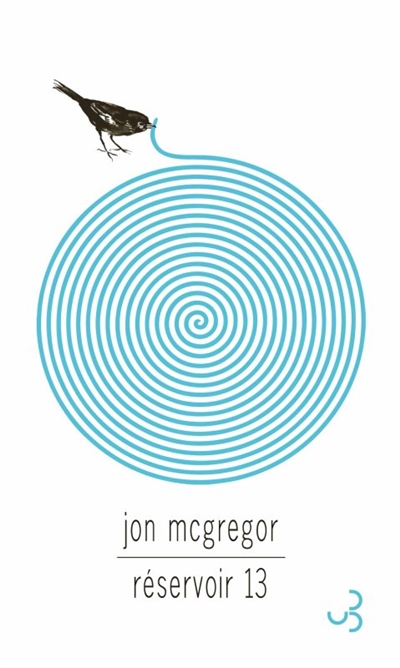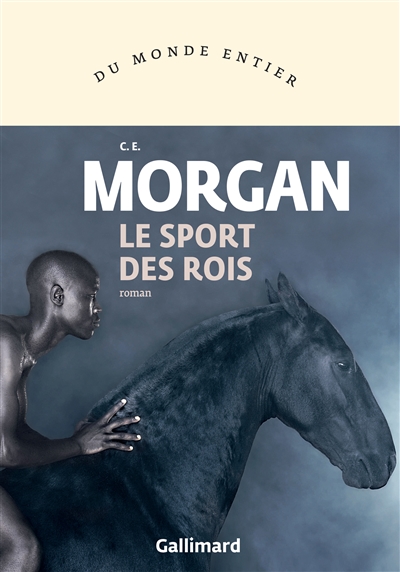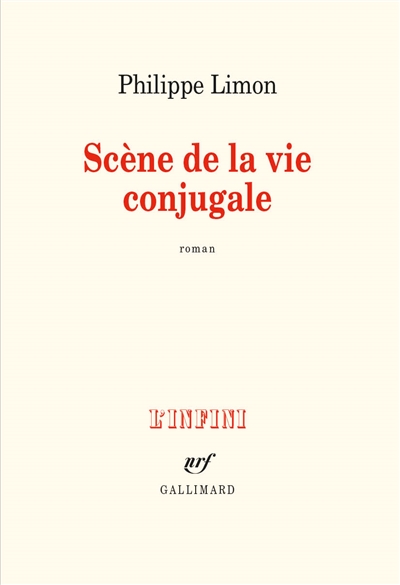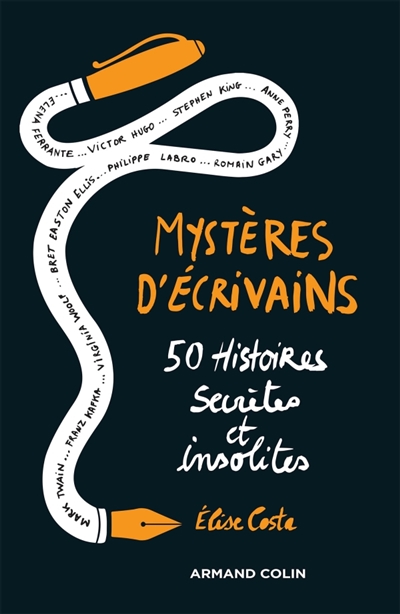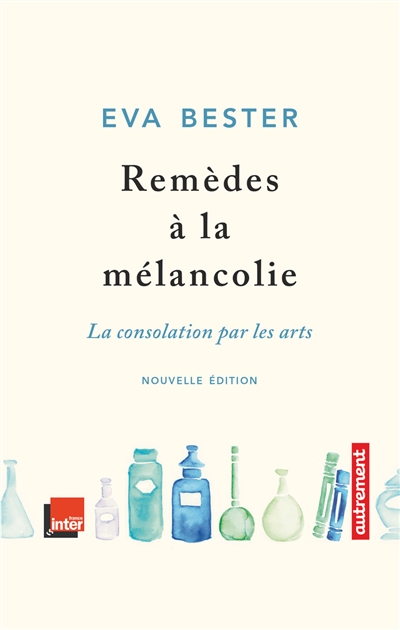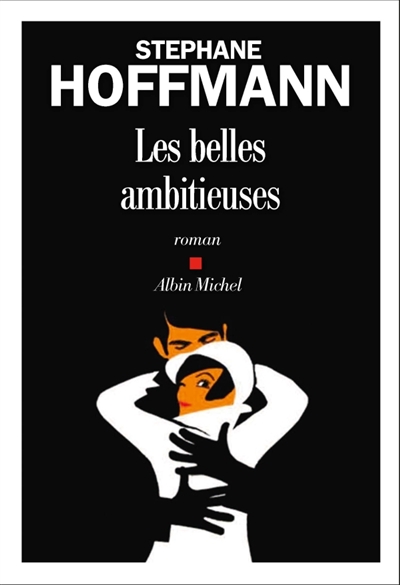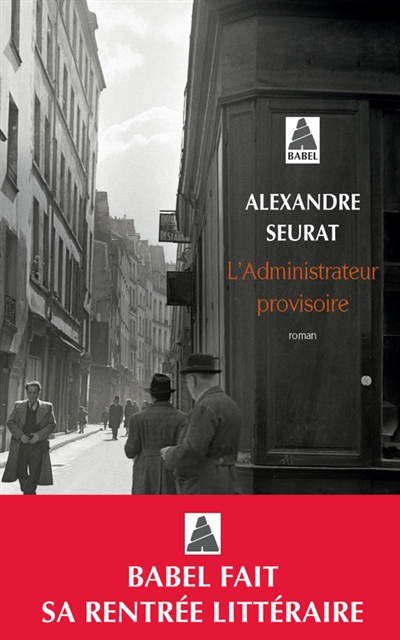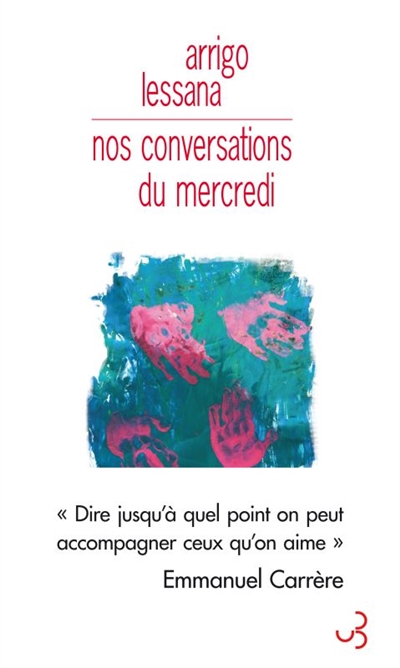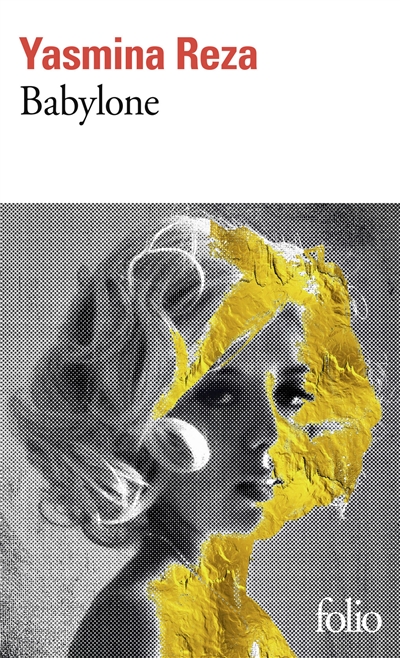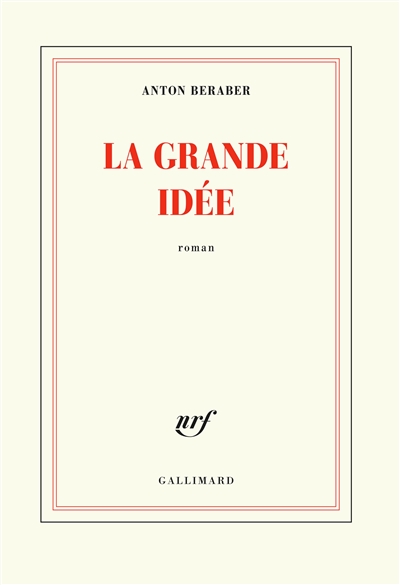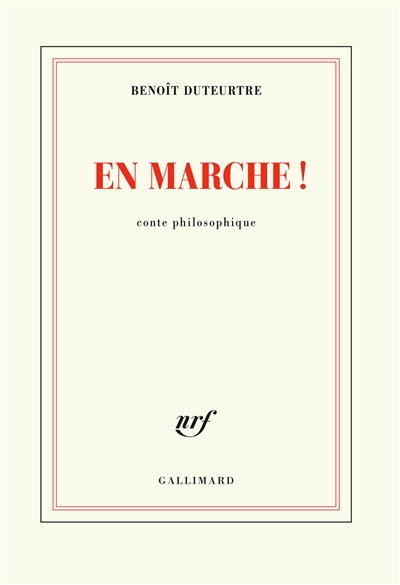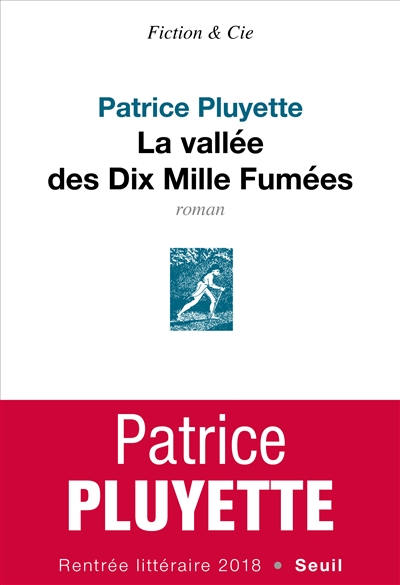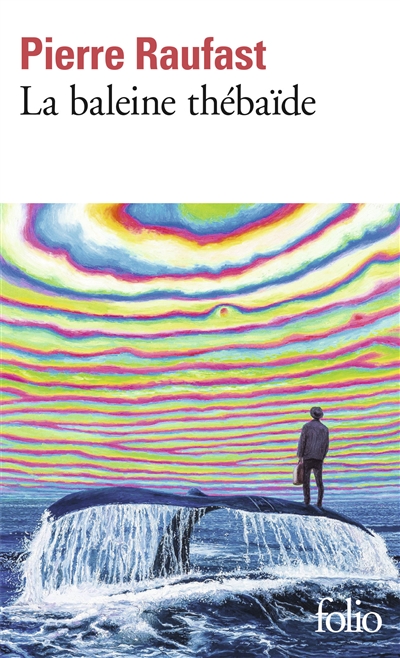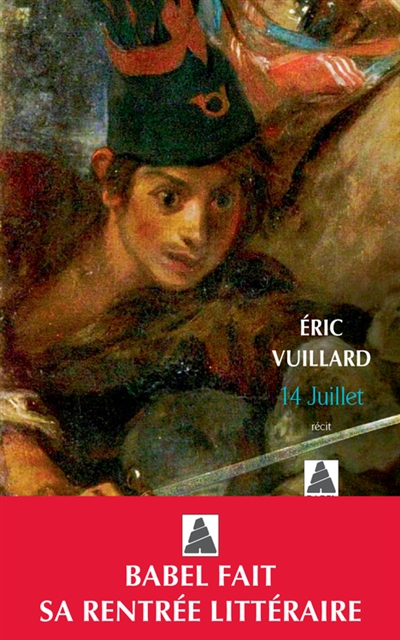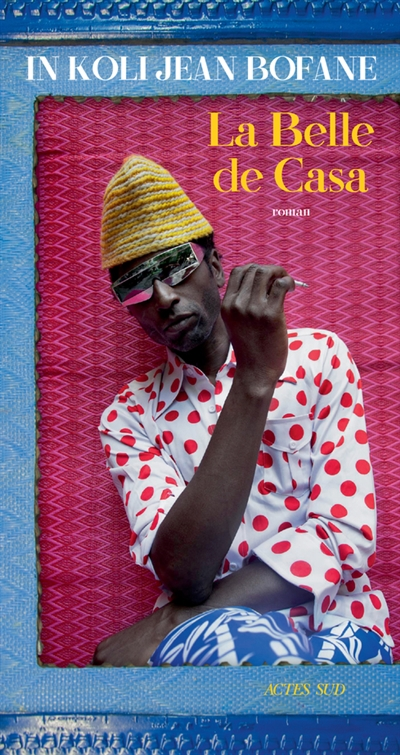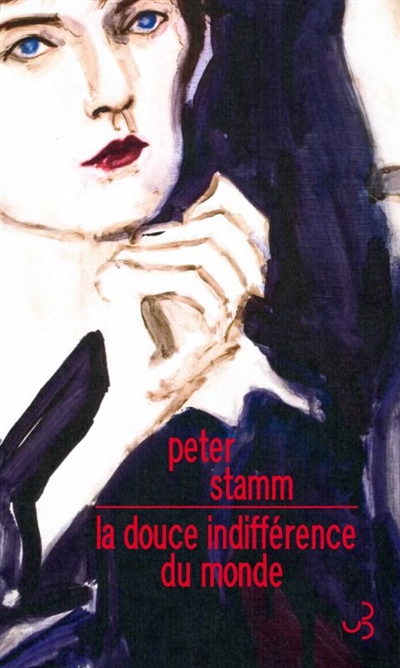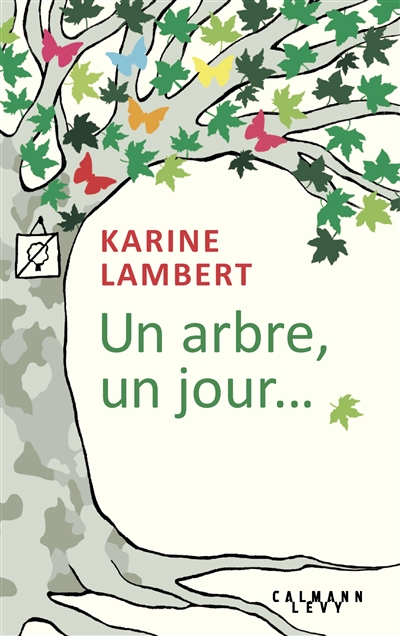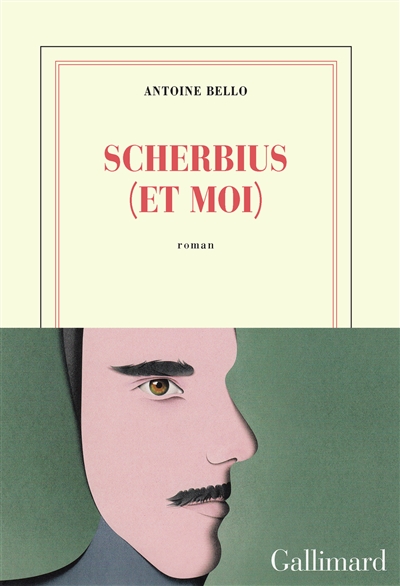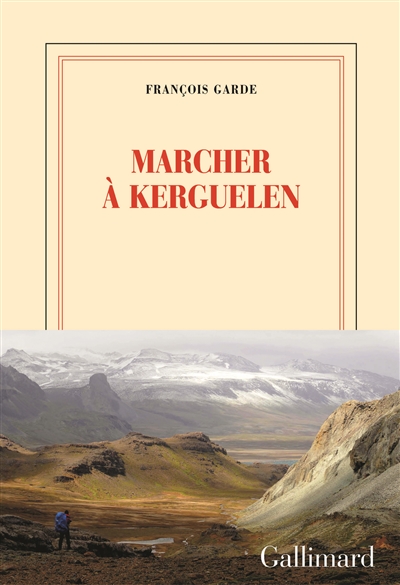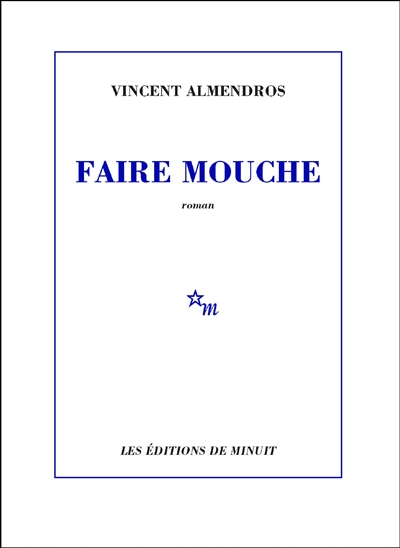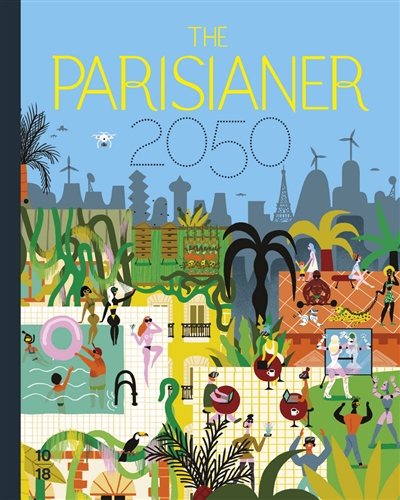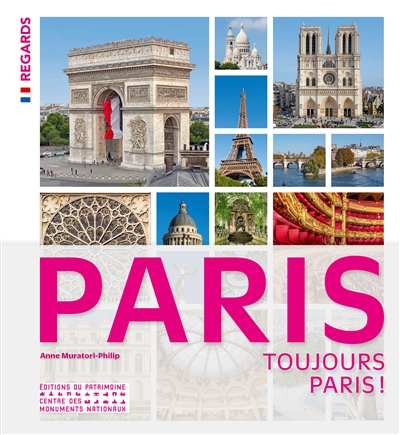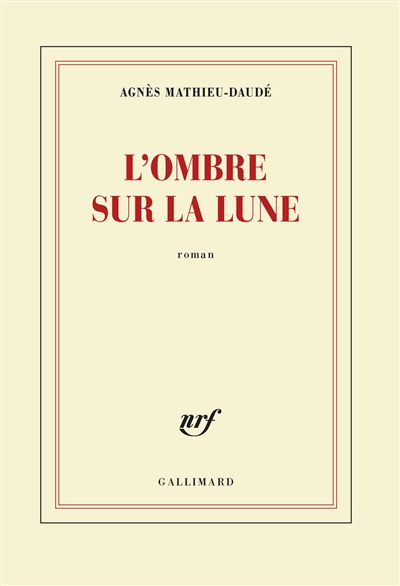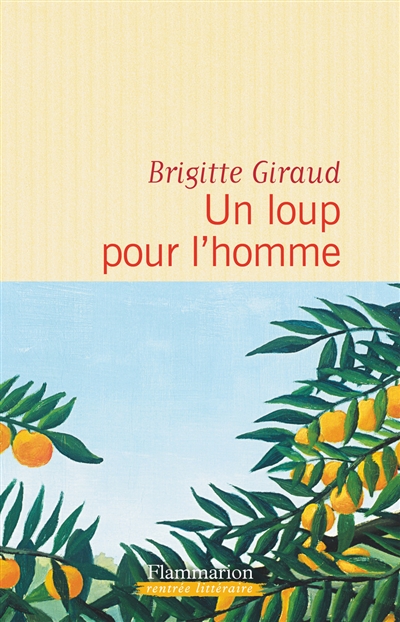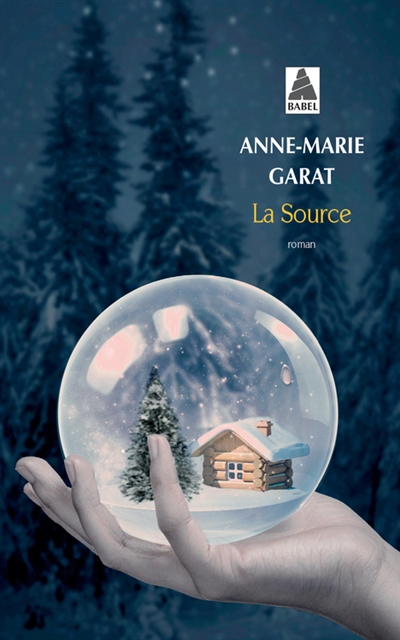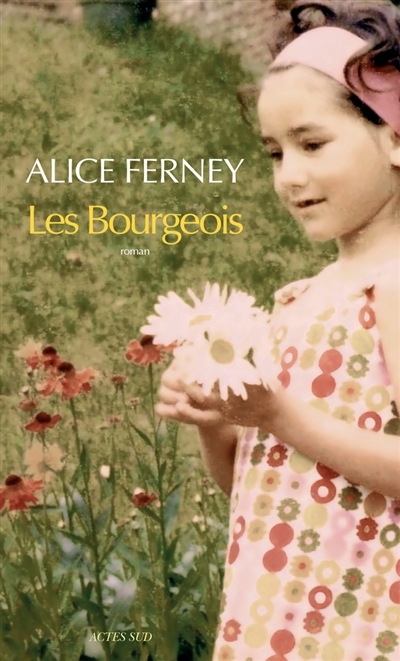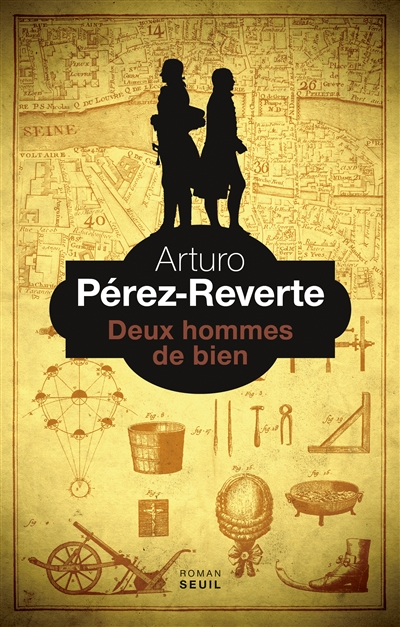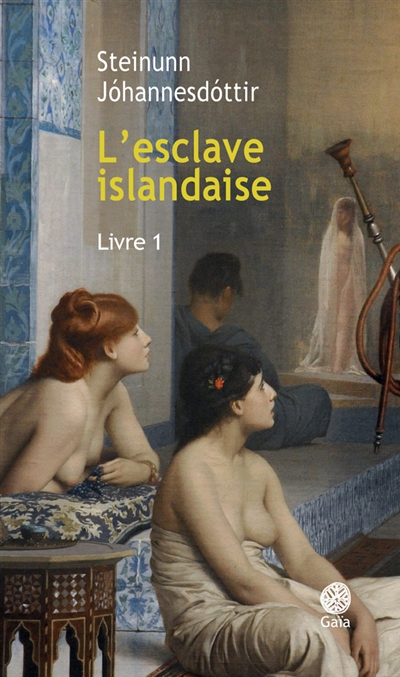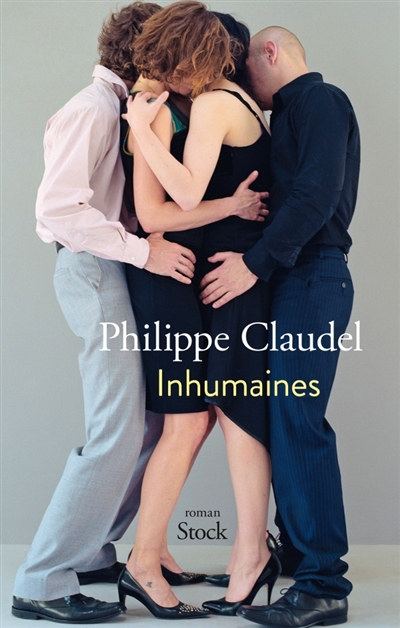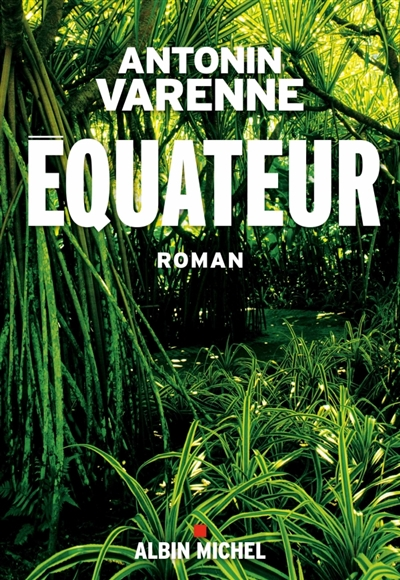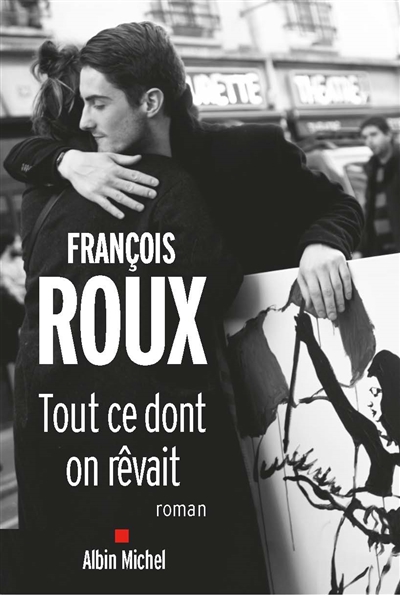Littérature française
Alexandre Seurat
L'administrateur provisoire

-
Alexandre Seurat
L'administrateur provisoire
Le Rouergue
17/08/2016
192 pages, 18,50 €
-
Chronique de
Emmanuelle George
Librairie Gwalarn (Lannion) - ❤ Lu et conseillé par 18 libraire(s)

✒ Emmanuelle George
(Librairie Gwalarn, Lannion)
Un secret de famille, une fonction administrative sous Vichy, un roman entre documentaire et fiction. Comme dans La Maladroite (Le Rouergue), Alexandre Seurat nous convie, sans pathos ni emphase, dans un espace littéraire intermédiaire rare et singulier. Ici, toutes les pièces d’archives sont authentiques et glaçantes. La force du réel et de l’imaginaire nous saisit.
Découvrant au début du récit que la mort de son frère résonne avec un secret de famille, un jeune homme interroge ses proches. Face à leur silence, il mène sa recherche aux Archives nationales. Il découvre que son arrière-grand-père a participé à la confiscation des biens juifs durant l'Occupation en tant qu'administrateur provisoire, et qu’il ne s'est pas contenté de « gérer en bon père de famille » les entreprises de ses « administrés ». Là où tous les documents sont authentiques, cette enquête familiale et historique dévoile ce que fut cette fonction « provisoire » sous Vichy. En portant un regard original sur la Collaboration, focalisé sur le processus de spoliation, Alexandre Seurat confirme son talent dans un roman bouleversant, écheveau littéraire remarquablement tissé de fiction et de réalité. Un roman en mouvement, tel un espace intermédiaire rare et nécessaire (que l'on n'a pas spécialement envie d'élucider), et qui donne tout son sens à l'acte d'écriture. Secret de famille, enquête historique, mensonges et rumeurs, entre rêves éveillés et cauchemars obsédants de la petite et grande Histoire, tout sonne juste. La voix de ce jeune auteur est singulière.
Que raconte votre deuxième roman ?
Alexandre Seurat — L’Administrateur provisoire, c’est d’abord l’histoire d’un secret de famille. Un narrateur apprend par son oncle, de façon évasive, que son arrière-grand-père a eu des responsabilités sous Vichy. Il le lui révèle dans des circonstances familiales complexes, dramatiques, dont on ne saura pas grand-chose d’ailleurs, mais qui donnent le contexte initial au roman. Ce narrateur décide d’enquêter. C’est d’abord une enquête familiale, puis, très vite, comme personne ne sait rien, cela devient une enquête historique. Aux Archives, il découvre ce qu’était un administrateur provisoire sous Vichy : quelqu’un qui, tel un rouage dans le processus de spoliation, était chargé (sans faire partie du gouvernement) d’administrer les biens d’une quinzaine de petites entreprises ou les biens immobiliers de personnes juives. Non seulement il découvre le dossier de cet administrateur, mais aussi sa personnalité très cassante, très avide de s’enrichir sur le dos de ces petits artisans pourtant peu fortunés. Ainsi, très vite, on passe du dossier de l’administrateur aux dossiers de ses victimes. Évidemment, cette enquête historique résonne avec les événements dramatiques de la famille du narrateur. On comprend que ce sombre passé n’a pas été sans conséquences sur sa vie familiale.
Ici, beaucoup de choses réelles résonnent encore douloureusement à nos mémoires. Pourtant, c’est un roman. Ce rapport entre fiction et réalité est important pour vous ?
A. S. — Assurément et c’était déjà le cas dans La Maladroite, mon précédent roman. Ici, ce qui relève du réel, c’est le dossier que j’ai retrouvé aux Archives. J’aurais été incapable d’inventer toutes les pièces que je recopie pour ensuite essayer de me projeter dans ce qu’avait dû être la vie de cet homme. C’est donc un texte qui est entrelardé de citations extrêmement froides, administratives, et qui donne sans doute un reflet de ce qu’était cette période et de ce que fut vraiment le régime de Vichy dans ses aspects les moins cinématographiques. La spoliation des entreprises juives est connue par les historiens depuis des années, bien que ce ne soit pas l’aspect le plus spectaculaire de cette période. Ce qui relève de la fiction et du roman, c’est le mouvement que j’essaie de donner à cette enquête en prêtant au narrateur une histoire familiale complexe et en créant ce secret de famille ; une façon d’explorer les résonances de la grande Histoire dans les histoires individuelles.
Dans cette famille, un personnage est très emblématique et énigmatique. D’emblée physiquement absent puisqu’il vient de mourir, le frère du narrateur se promène au détour de son enquête tel un fantôme de la petite et grande Histoire. Pourquoi lui avoir laissé cette voix ?
A. S. — La question de la fraternité est importante pour moi (déjà dans La Maladroite, le personnage principal était le frère de Diana, le témoin de celle qui sera assassinée). À nouveau ici, le motif principal de l’enquête, le mobile qui donne au narrateur le désir d’enquêter, c’est son frère disparu dont il a le sentiment que la vie a été gâchée par ce non-dit. Je voulais que les souvenirs de ce frère ne soient pas totalement explicites : on ne saura pas de quoi il est mort, on ne pourra pas reconstituer une histoire complète et c’est important pour moi. En effet, je pense que ce qu’il y a de plus fort ne peut être que suggéré. C’est très important pour moi que ce soit comme un iceberg : une histoire qui essaie de tourner autour d’un centre qui restera mystérieux. Ce frère est comme le réacteur de l’histoire et en même temps il reste très elliptique. On comprend simplement qu’il s’est autodétruit et qu’il était obsédé par la Shoah ; et donc que la grande Histoire résonne sans doute avec la sienne.
Au-delà de la Collaboration, de la spoliation, vous racontez comment cet administrateur provisoire a mis en péril ses administrés…
A. S. — En me documentant sur cette période, j’ai lu des travaux d’historiens qui montrent que les administrateurs provisoires étaient environ 10 000 et qu’il y en avait de toutes sortes. Certains administraient de façon, si je puis dire, respectueuse des règlements vichystes, sans chercher à s’enrichir – et dire cela c’est considérer que la spoliation était un processus légal et là c’est vertigineux ! En tout cas, ce personnage, ce Raoul H., en plus d’être un administrateur provisoire respectant les consignes, met une hargne particulière à s’en prendre à ses victimes, à leur soutirer le plus d’argent possible. Dans mon texte, j’essaie d’aller le plus loin possible dans l’enquête, c’est-à-dire dans l’exploration du destin de ceux qui ont été spoliés, déportés et tués à la suite de ce processus. L’administrateur n’est pas le bourreau direct, mais la spoliation participe de ce qui va mener à la déportation. Cela est attesté dans les dossiers que j’ai consultés. Les victimes étaient souvent des immigrés de fraîche date arrivés en France dans les années d’entre-deux-guerres. Il y avait très peu de solidarité autour d’eux. C’est aussi à leur parcours que mon texte tente de rendre hommage, sans que je puisse en savoir plus que ce que j’ai trouvé dans les archives.
Vous racontez le destin tragique de deux de ces hommes, morts en déportation. Ils ont existé. Leurs noms sont fictifs, pourquoi ?
A. S. — Effectivement, j’ai changé le nom des victimes, contrairement à d’autres auteurs, comme Modiano pour Dora Bruder (Folio). Et j’y ai beaucoup réfléchi. Pourquoi changer le nom des victimes si on veut leur rendre hommage ? Les scènes sont fictionnelles car j’essaie de me projeter dans ces existences. Et c’est mon narrateur qui retrace leur parcours à partir des bribes d’éléments trouvées aux Archives. Puis il reconstitue des scènes, évidemment fictives. Conserver le nom des victimes, cela aurait constitué pour moi une forme de transgression. Je voulais assumer cette dimension fictionnelle du texte, cette dimension projective, et me tenir un peu en retrait, ne pas créer d’interférences entre la réalité et la fiction, même si en effet tout cela est question de nuances.