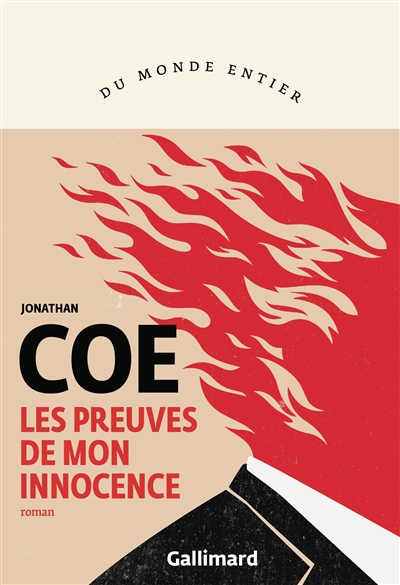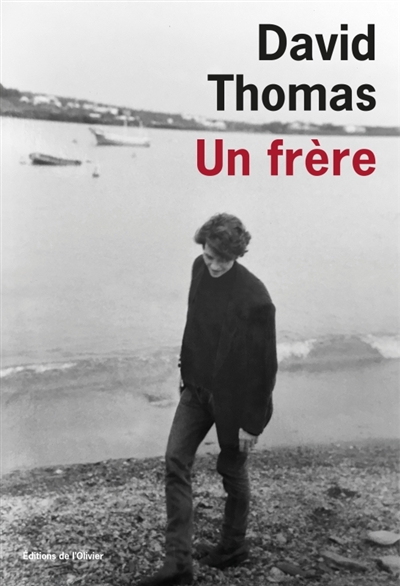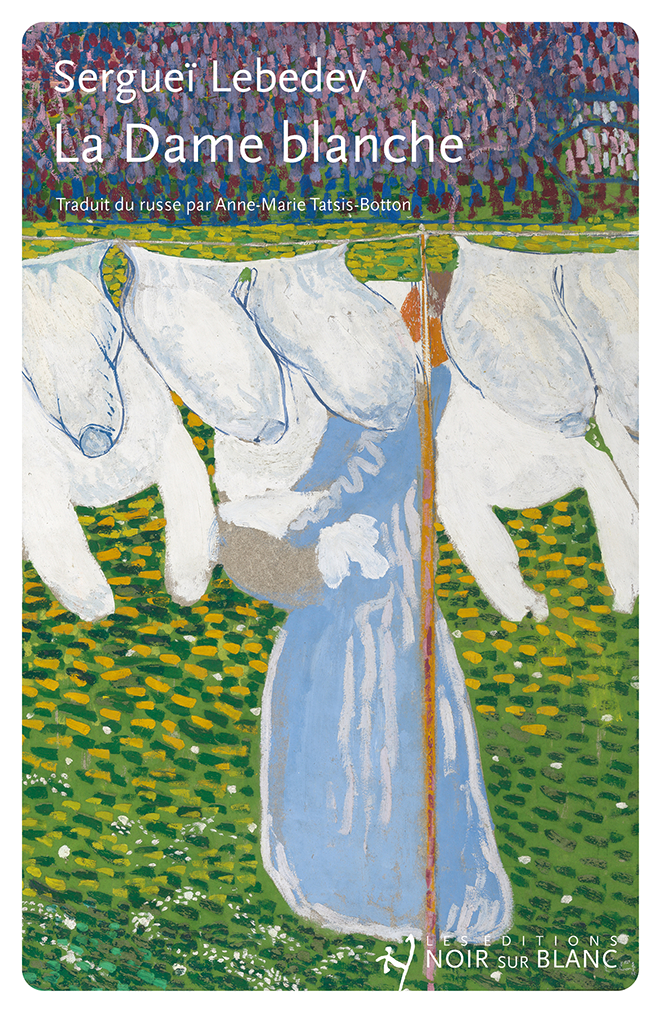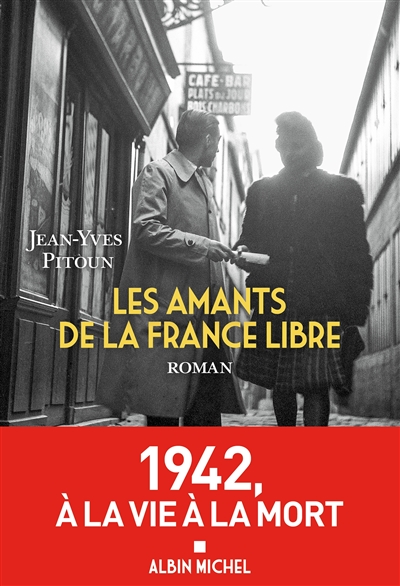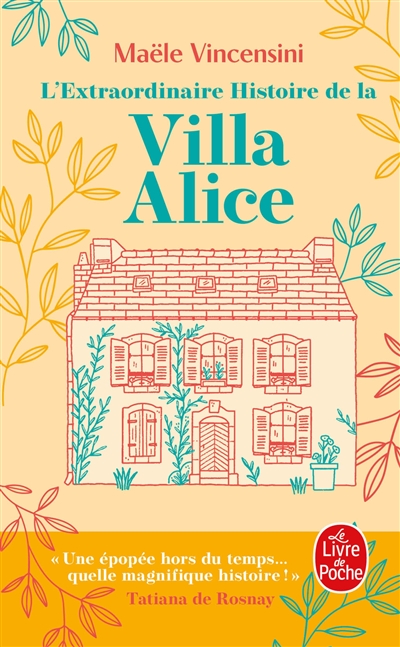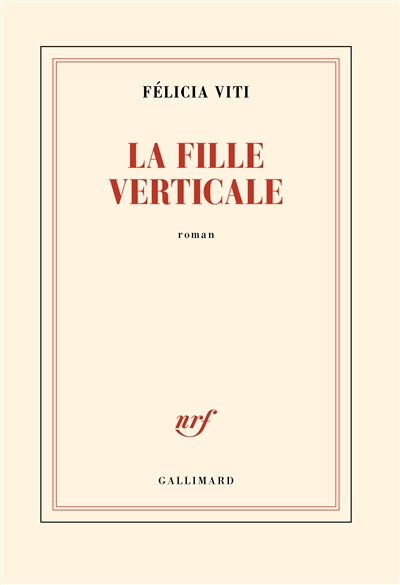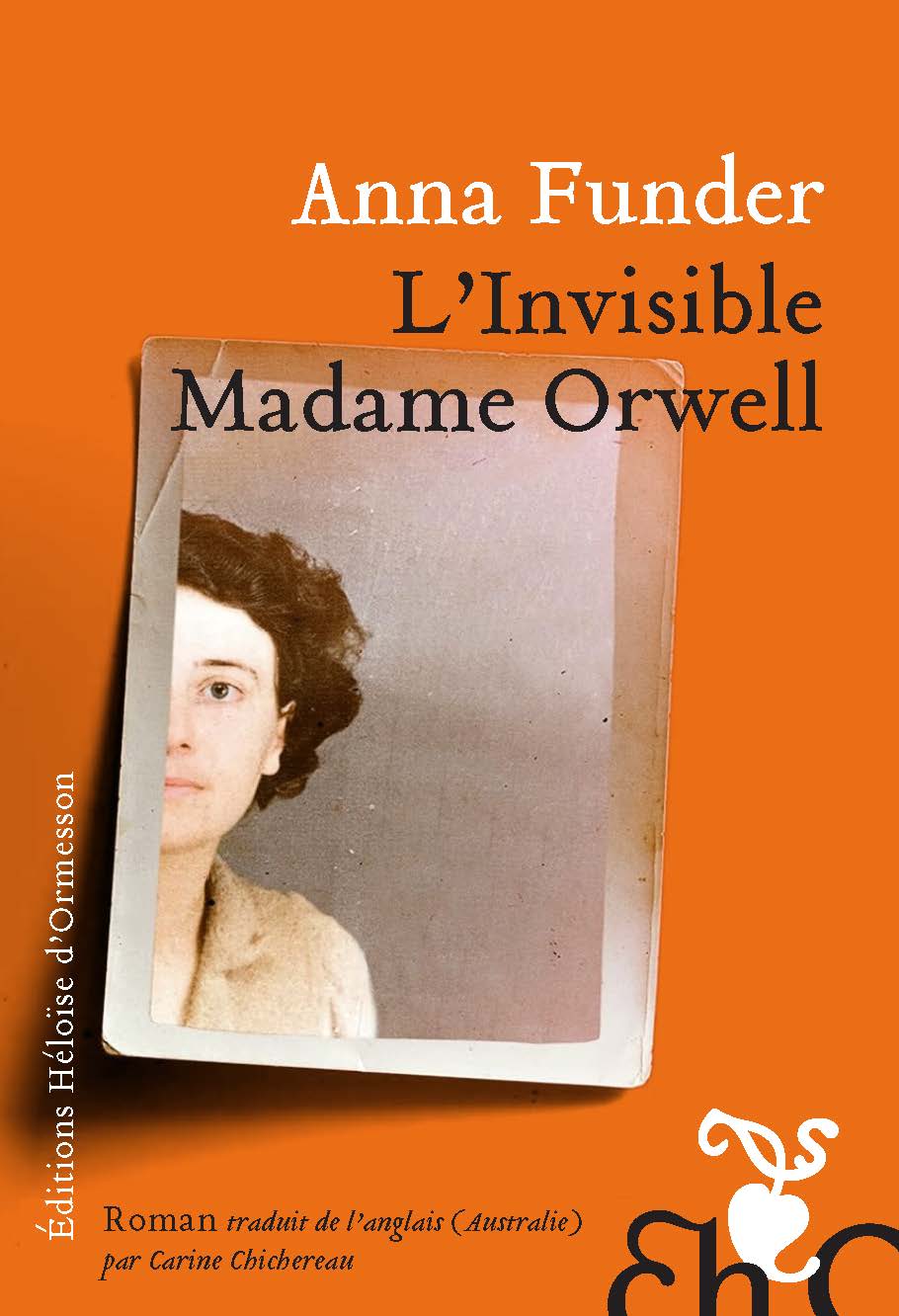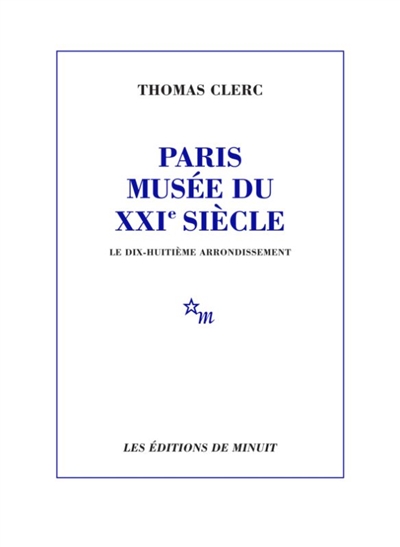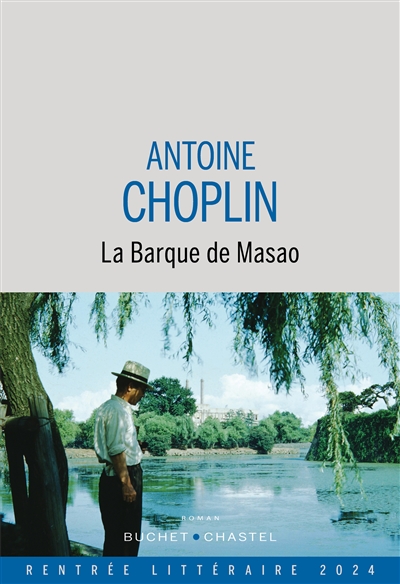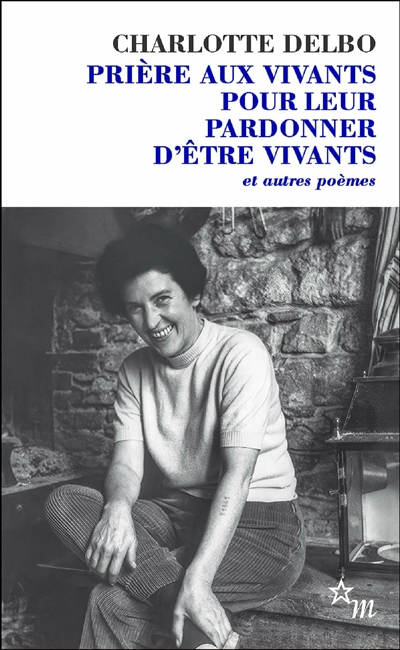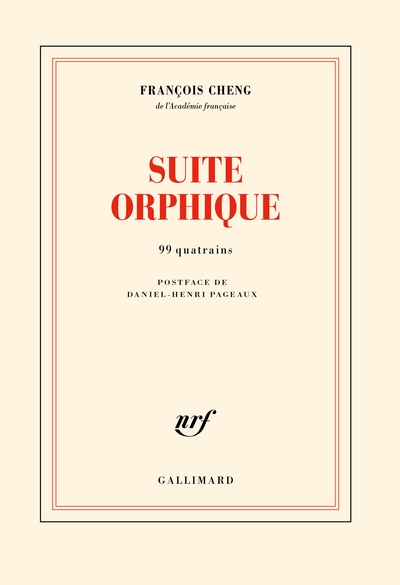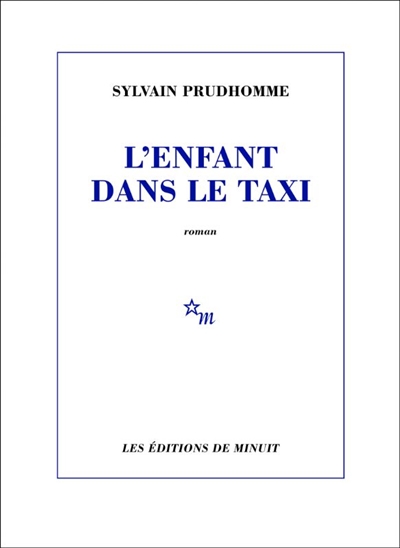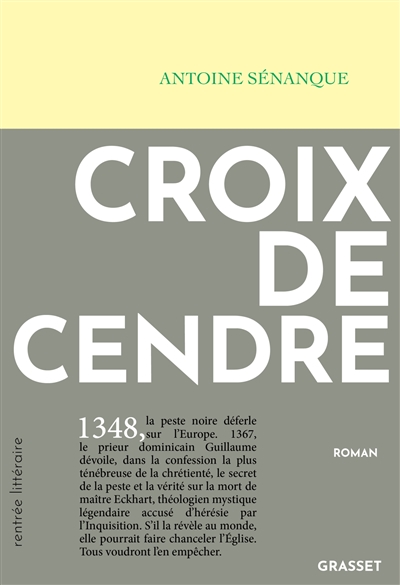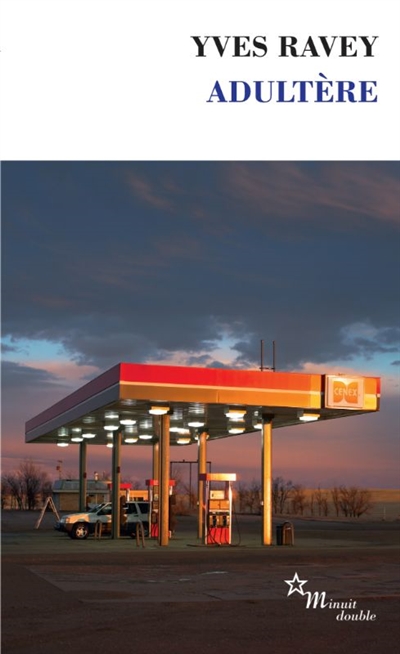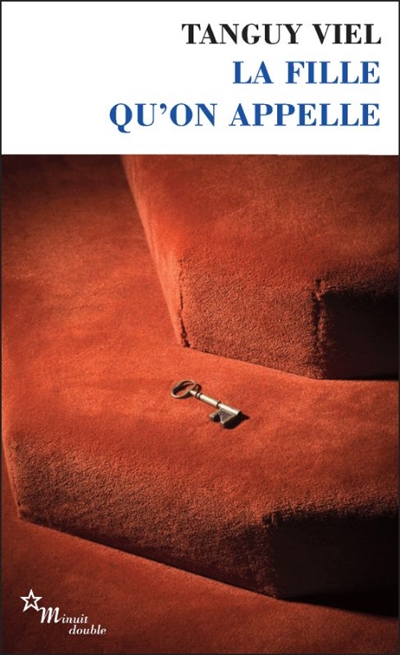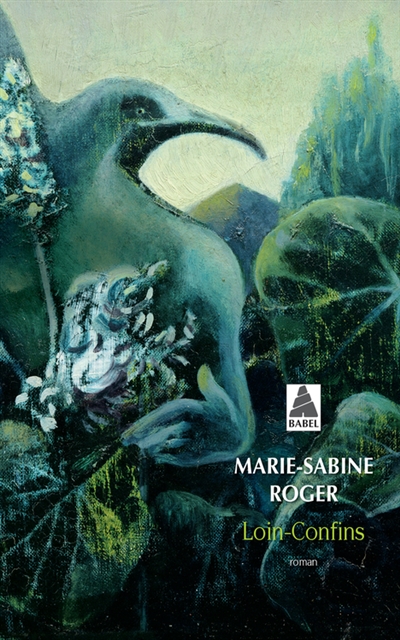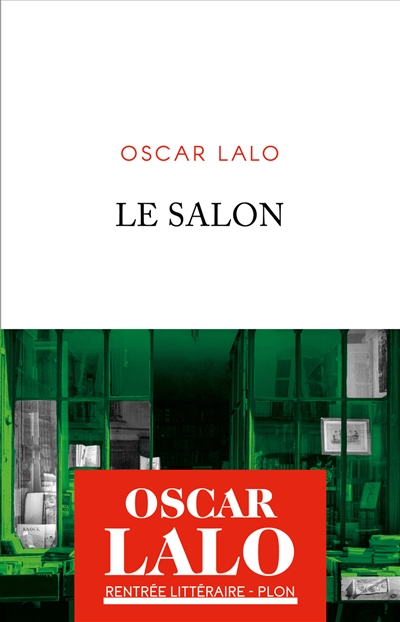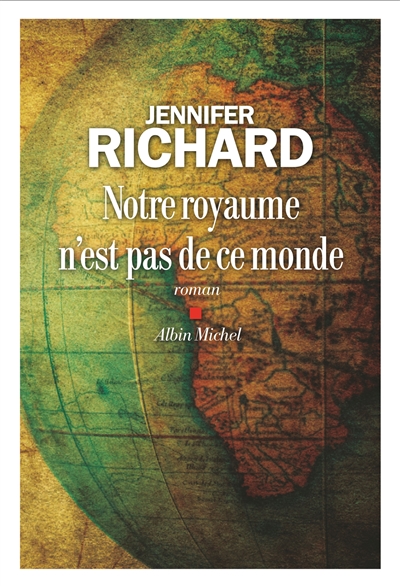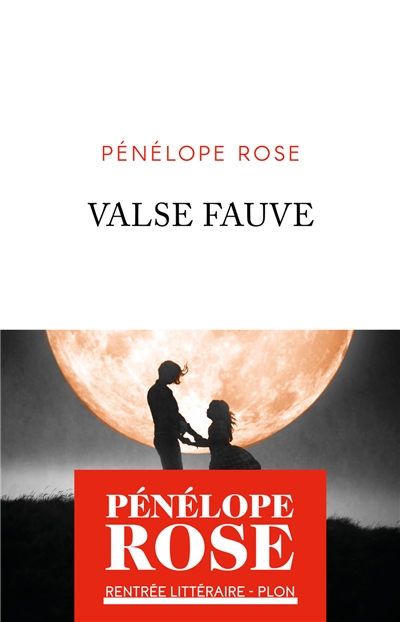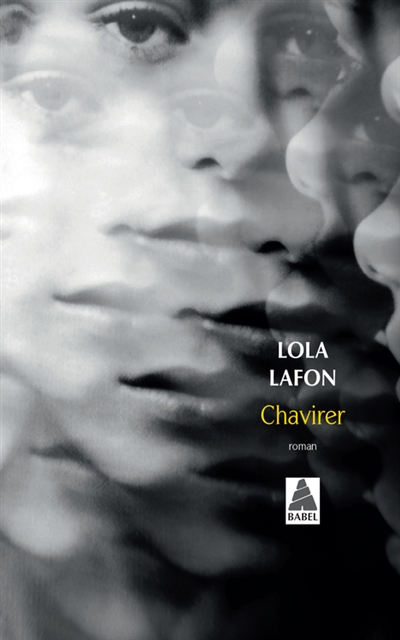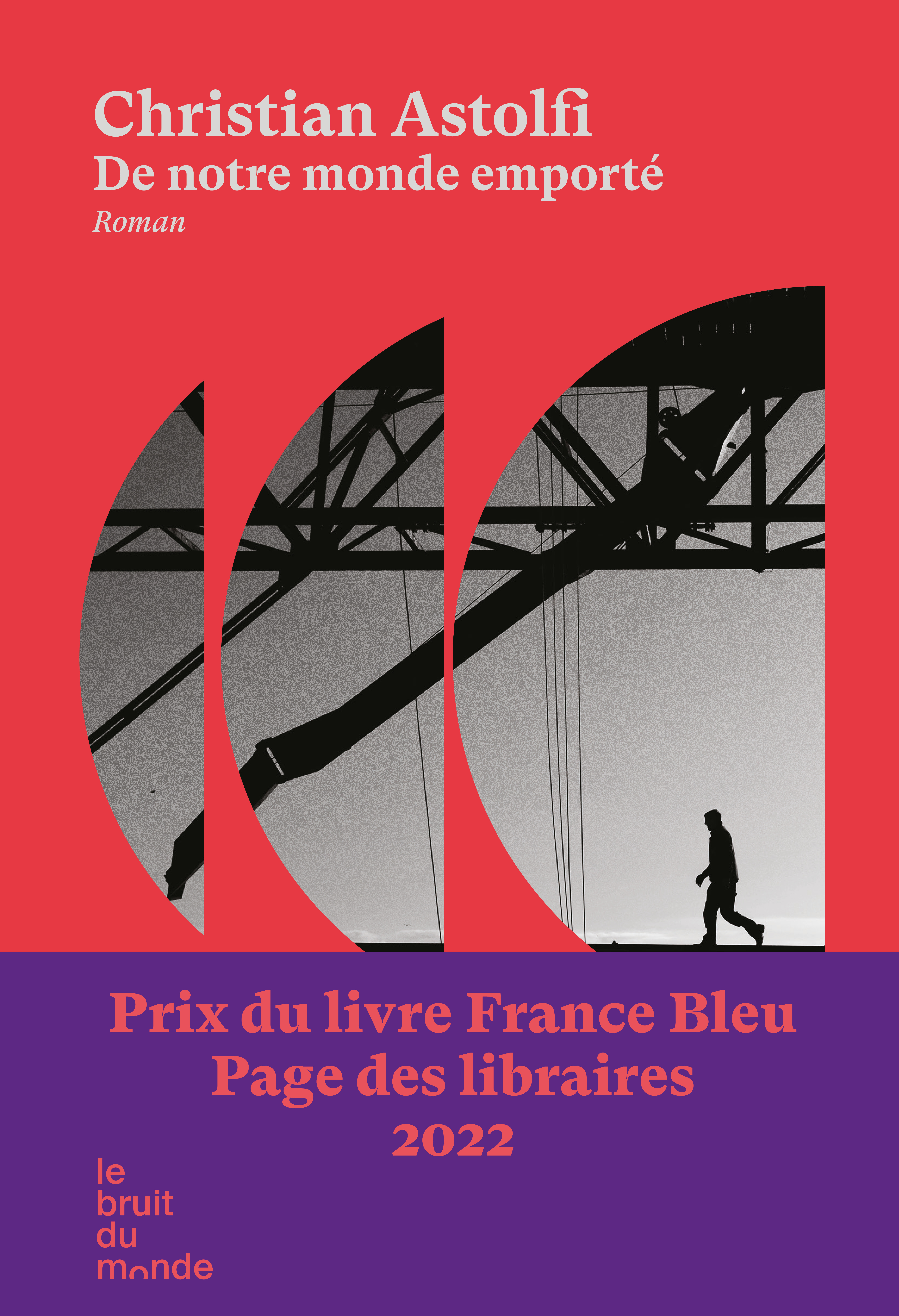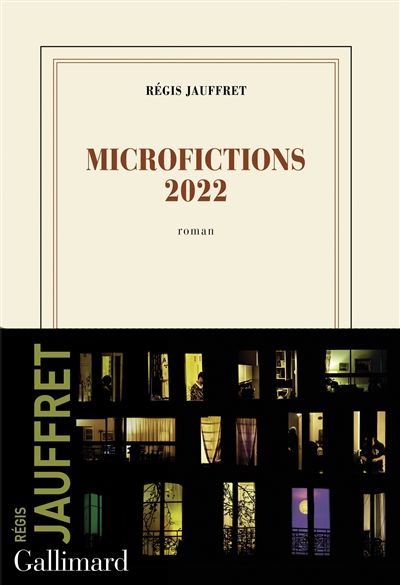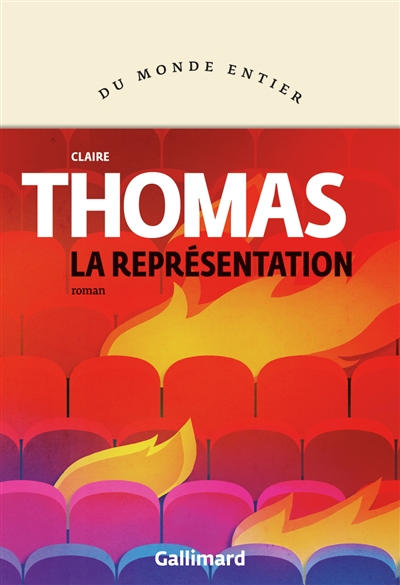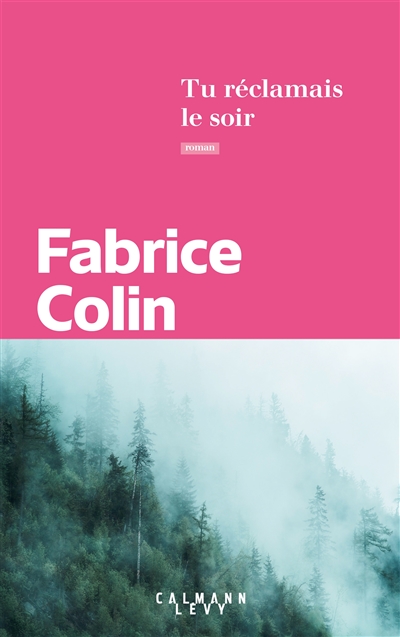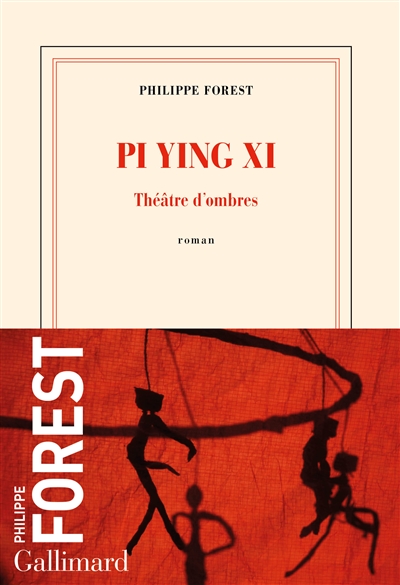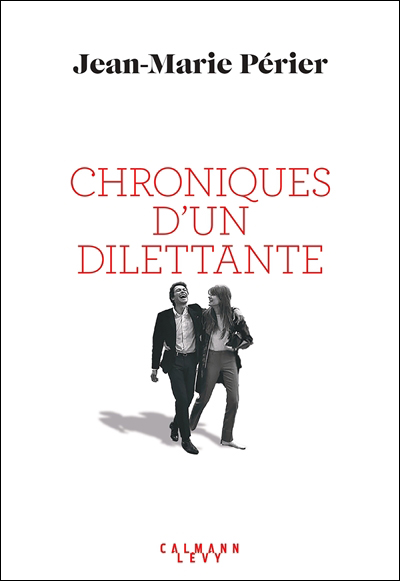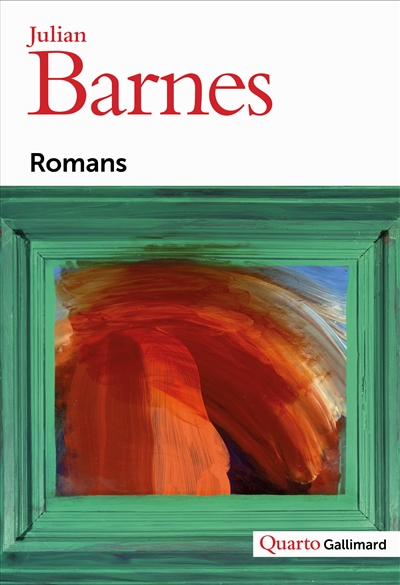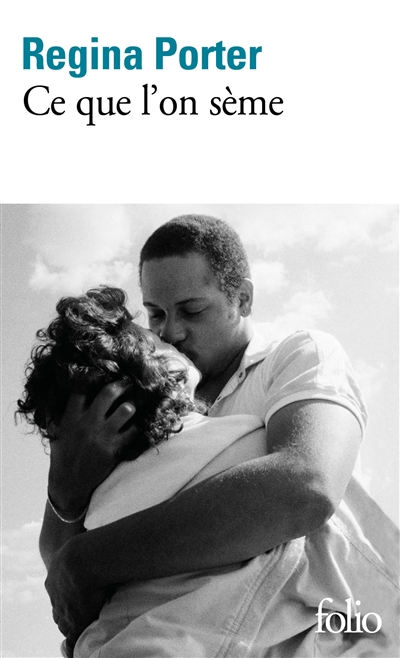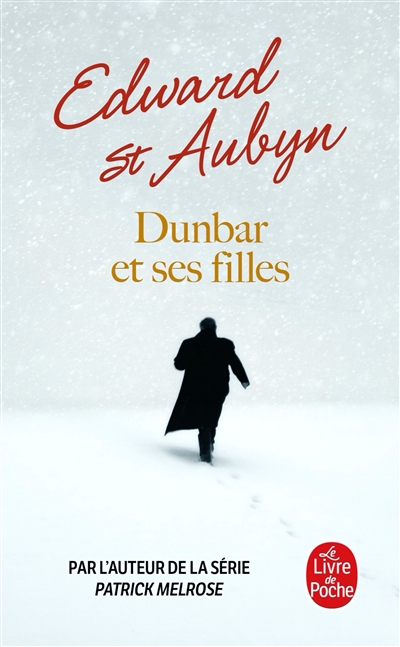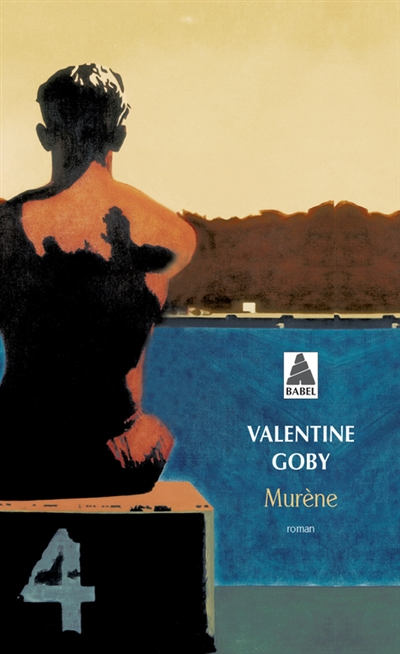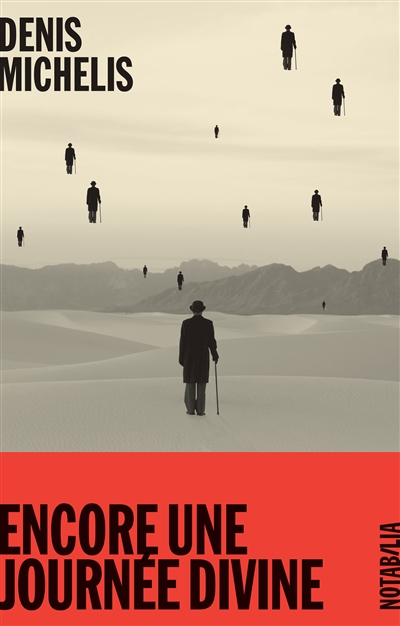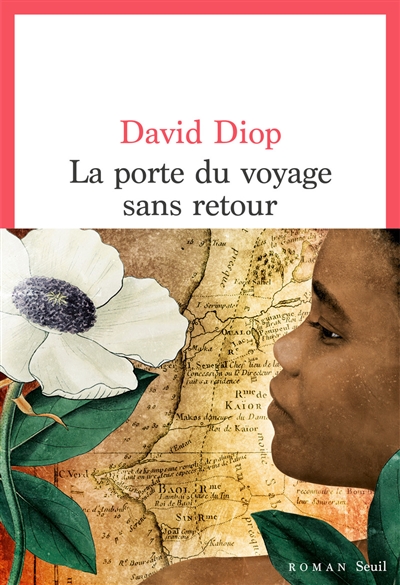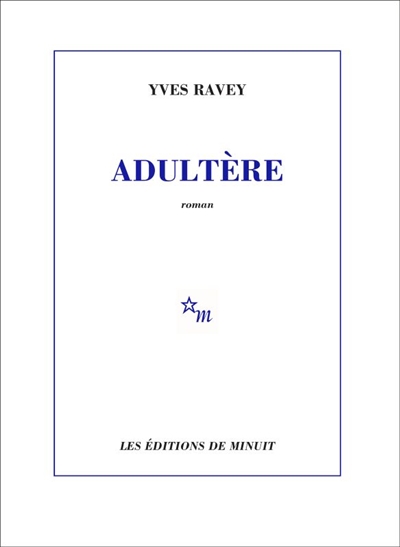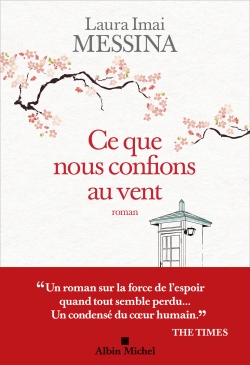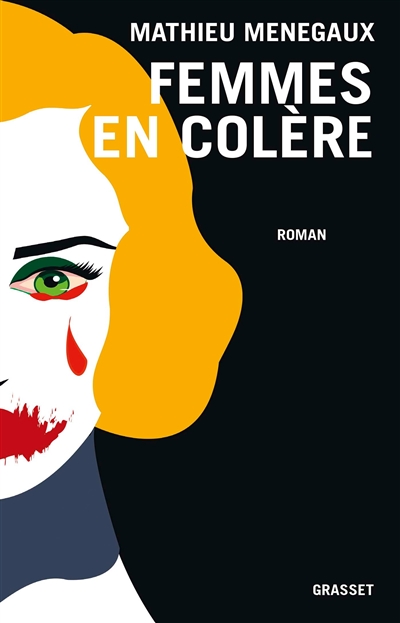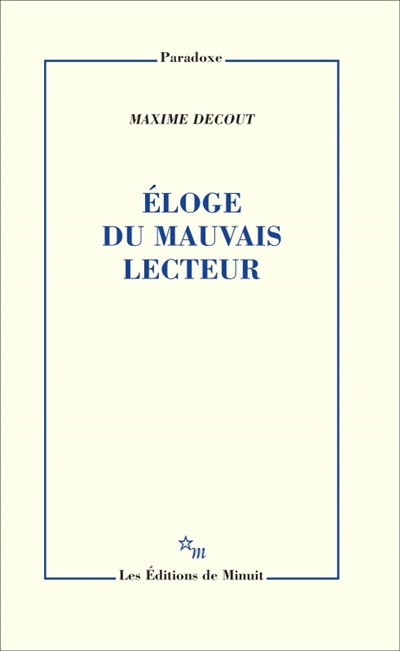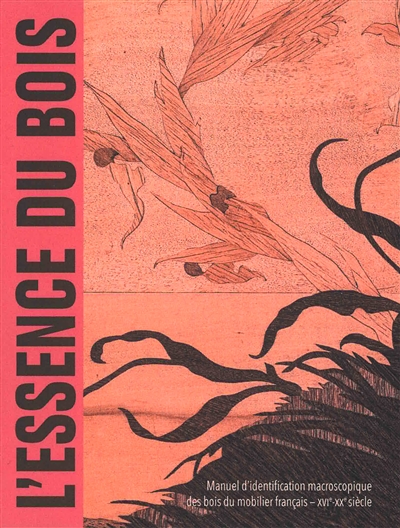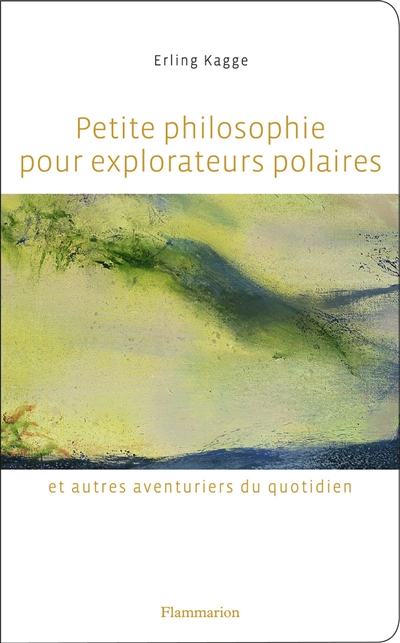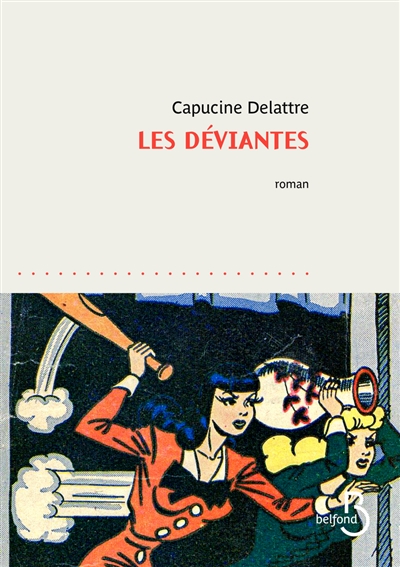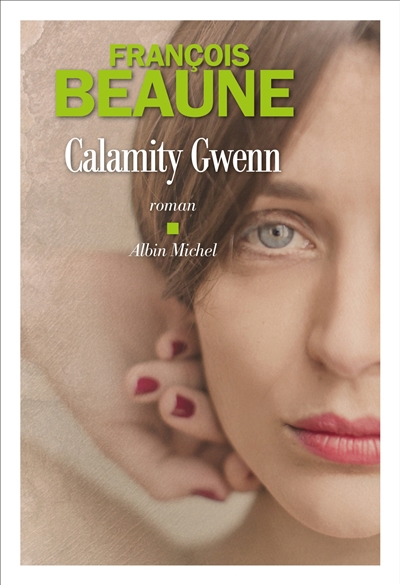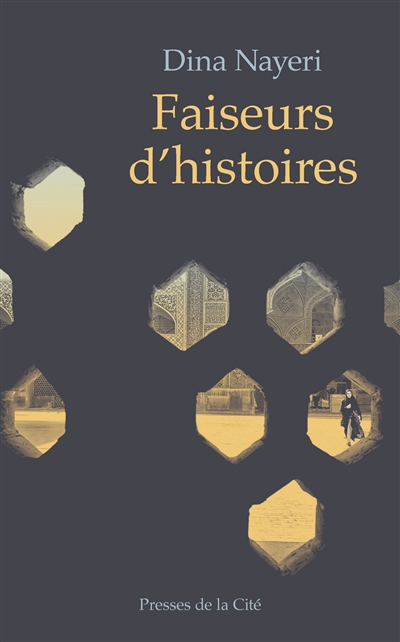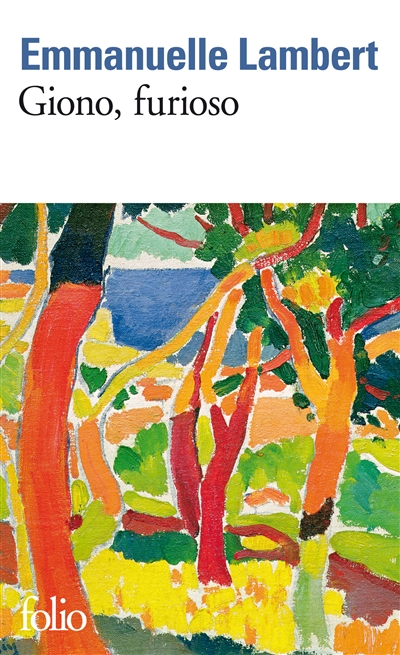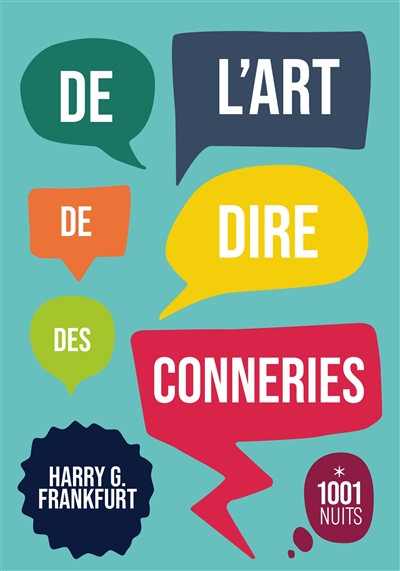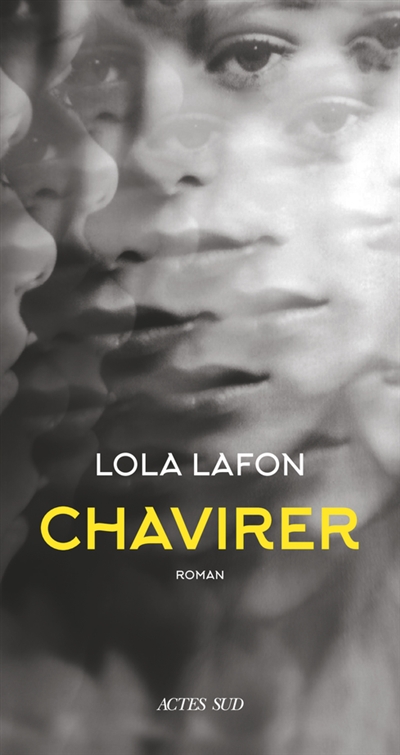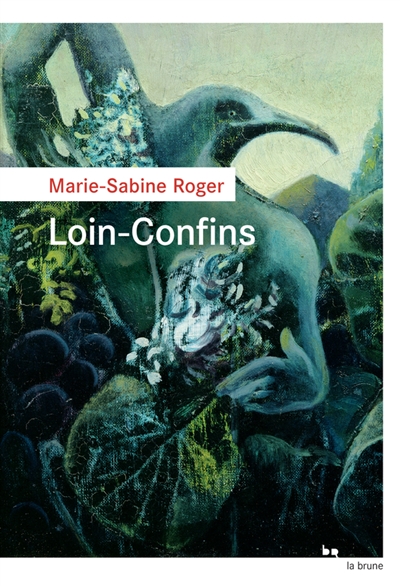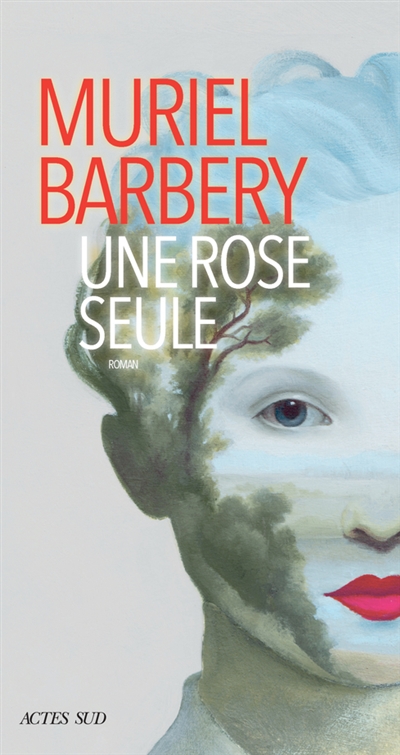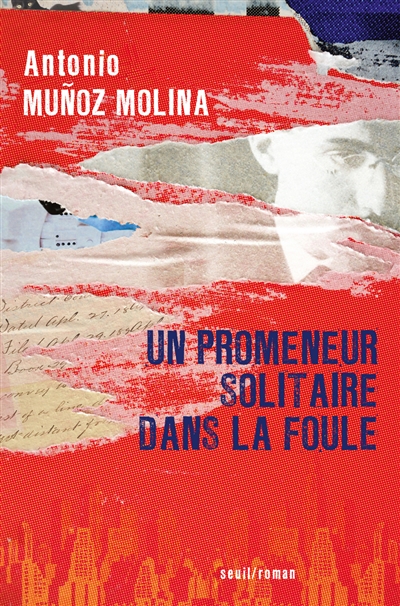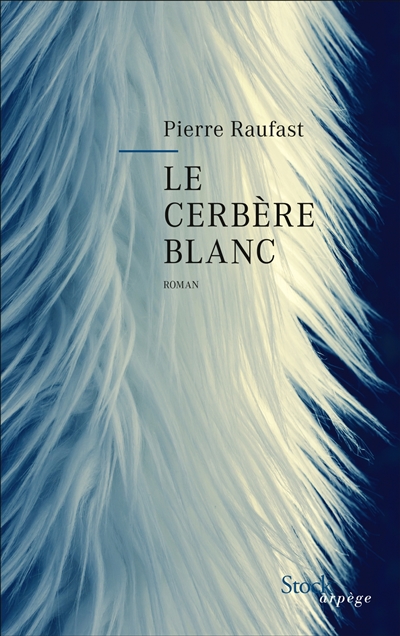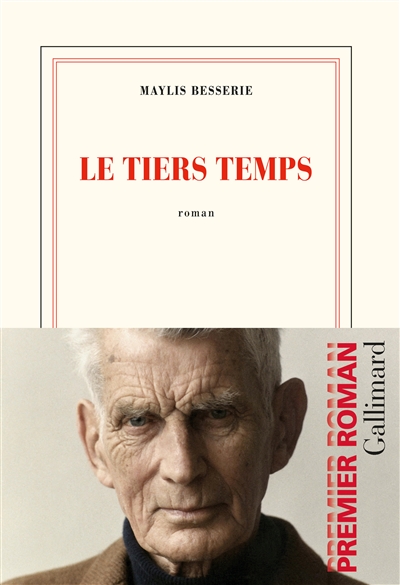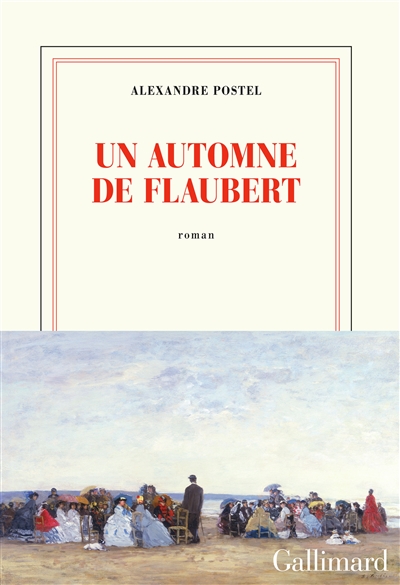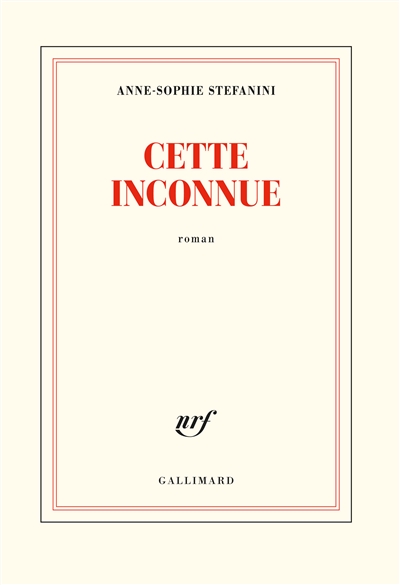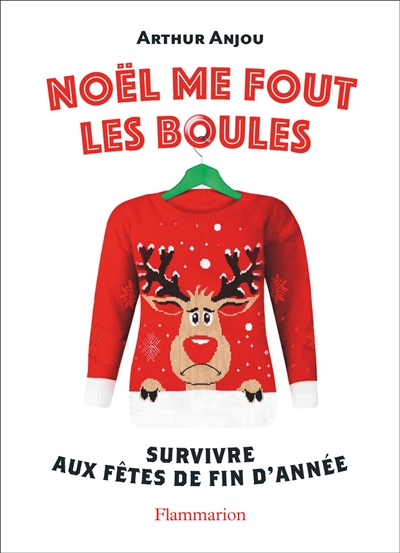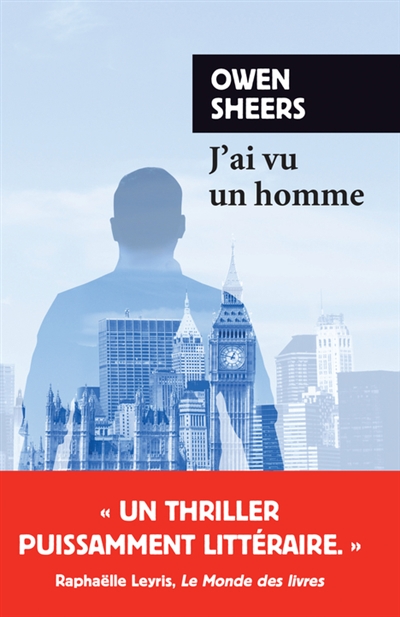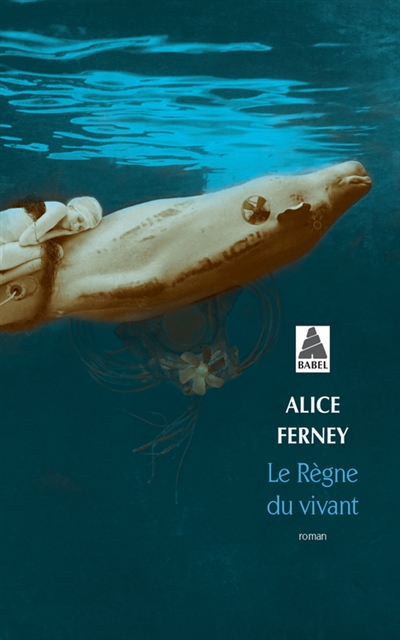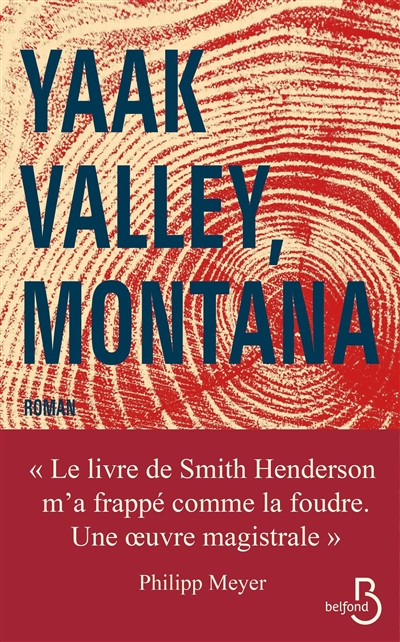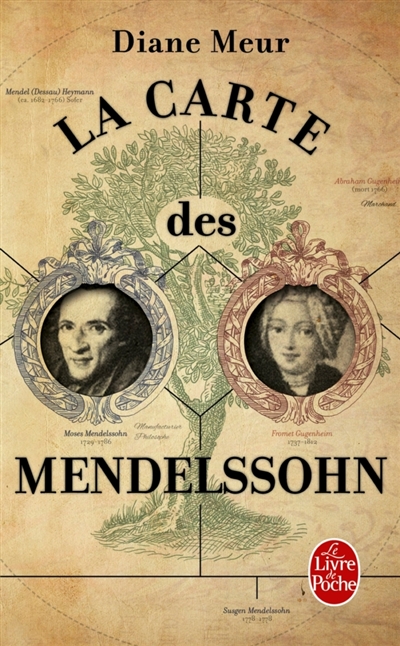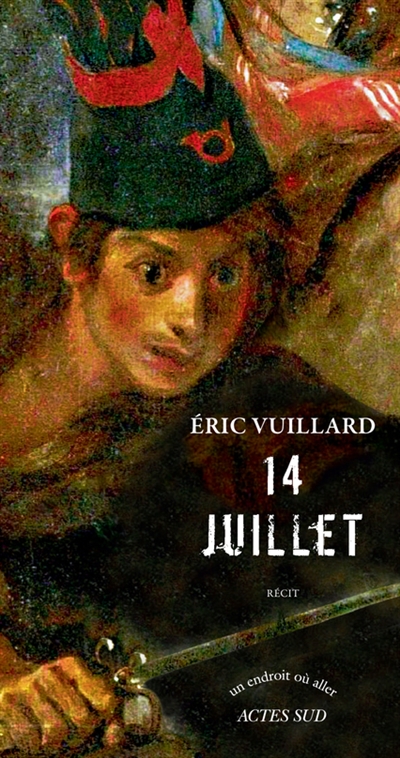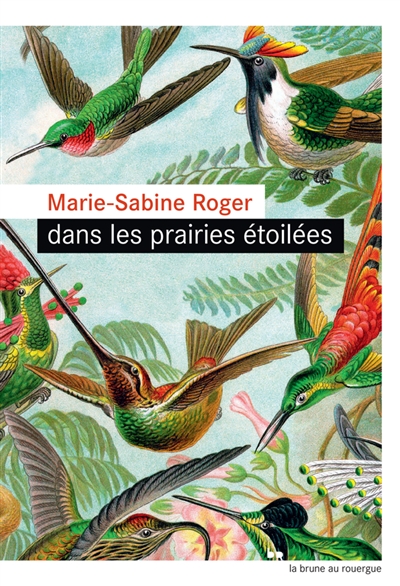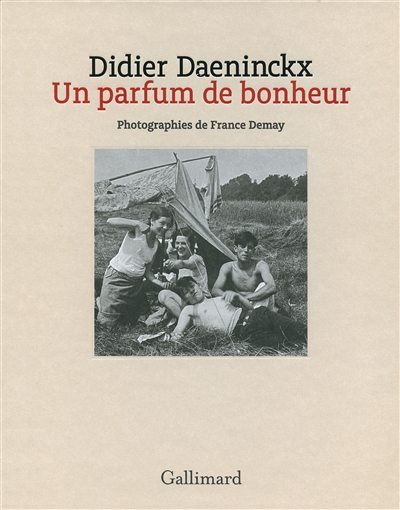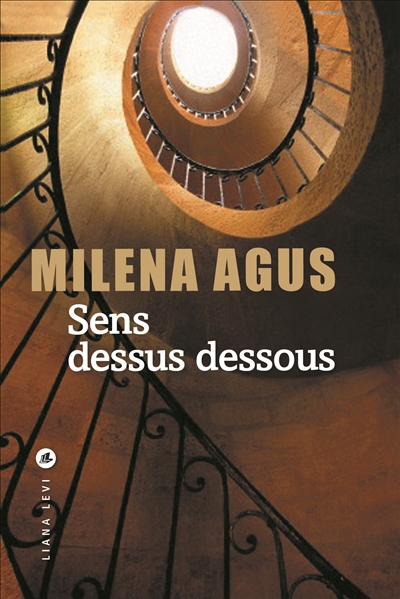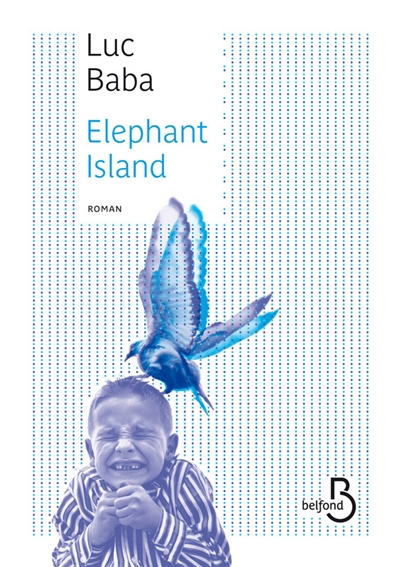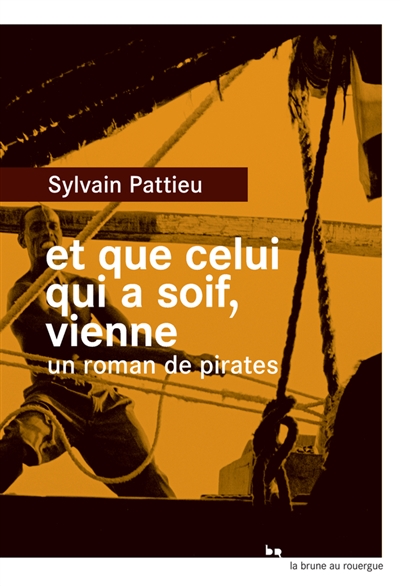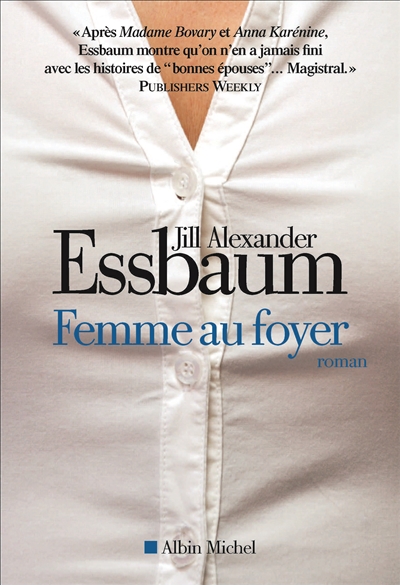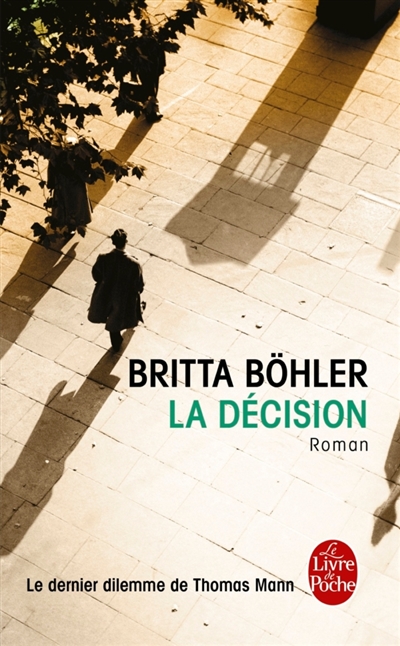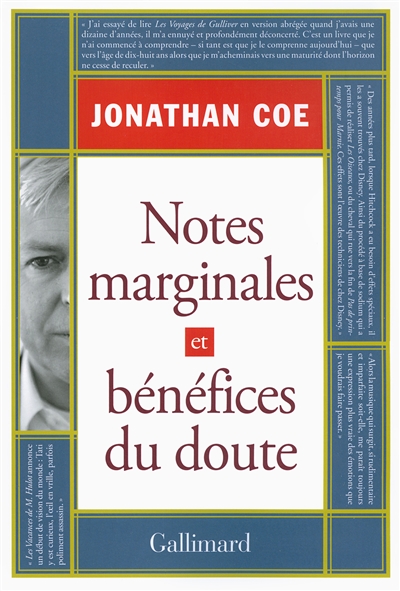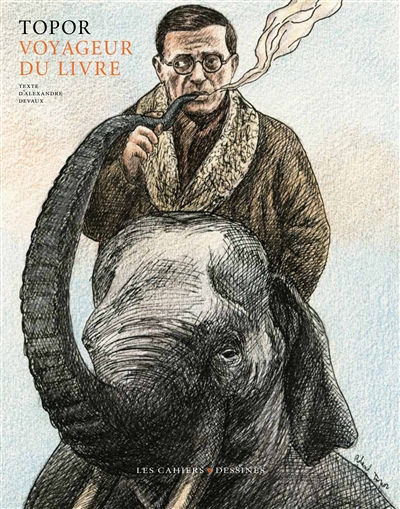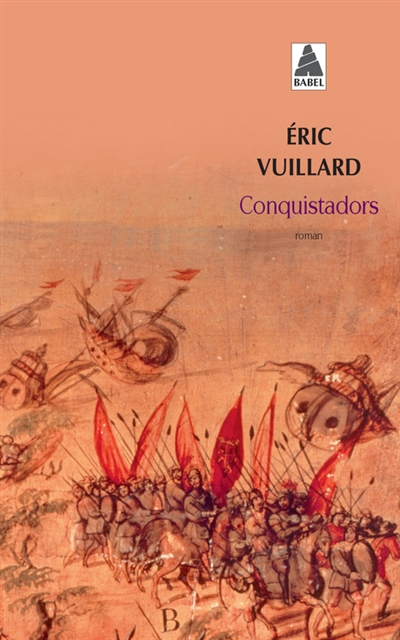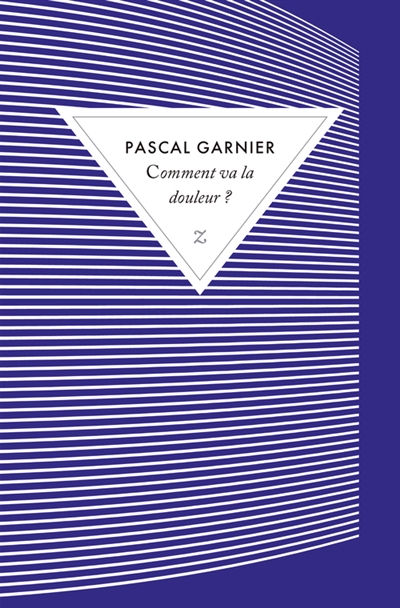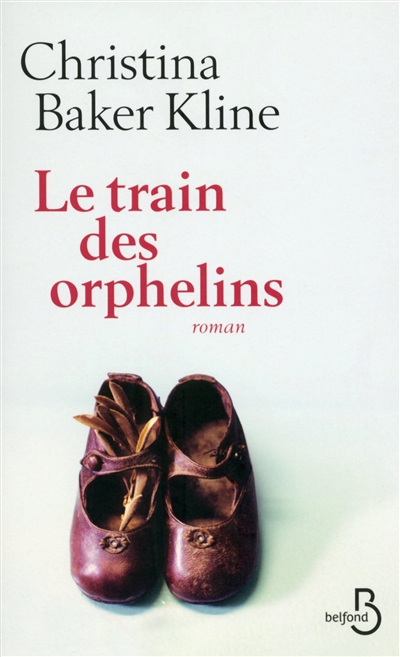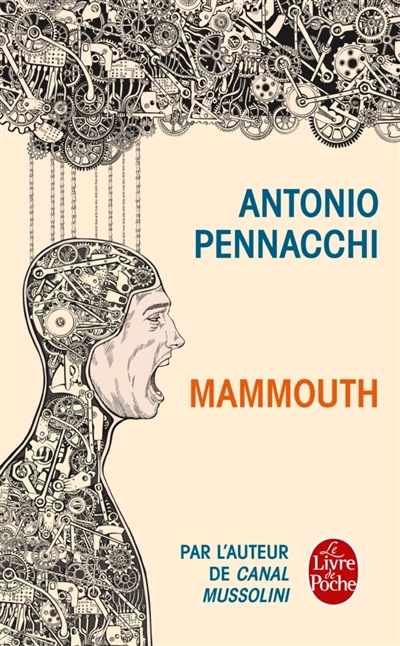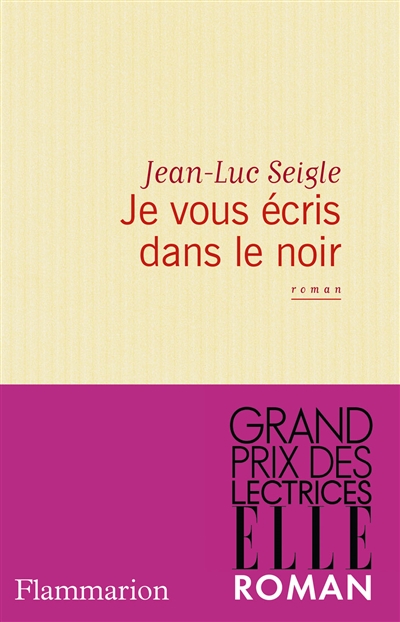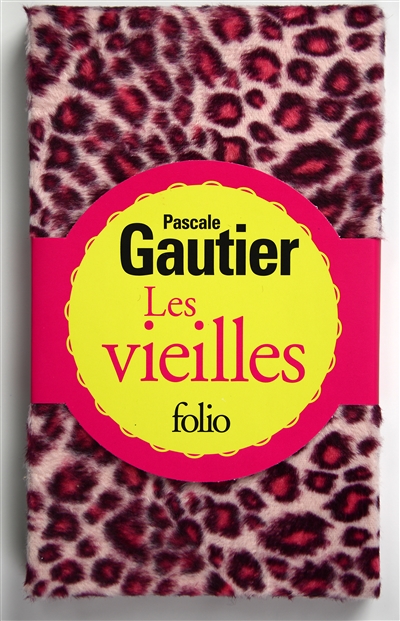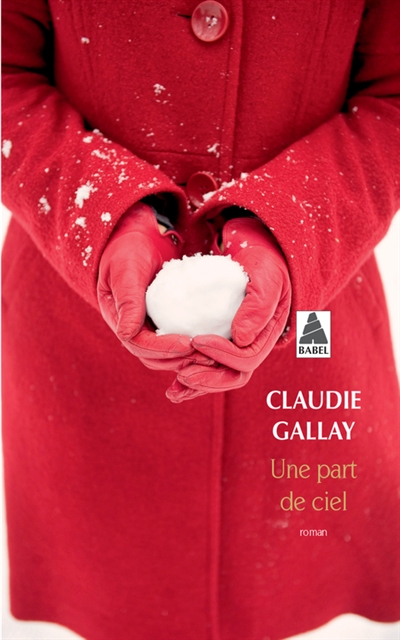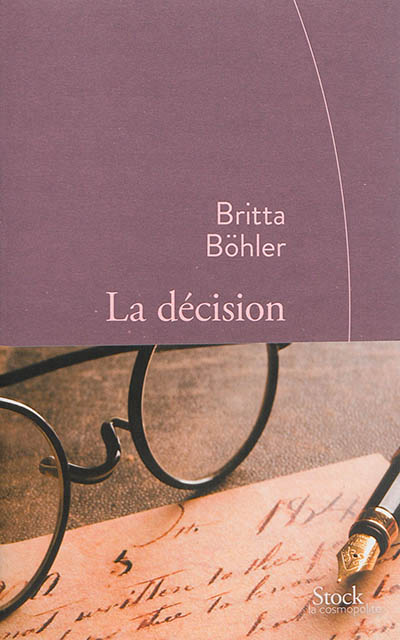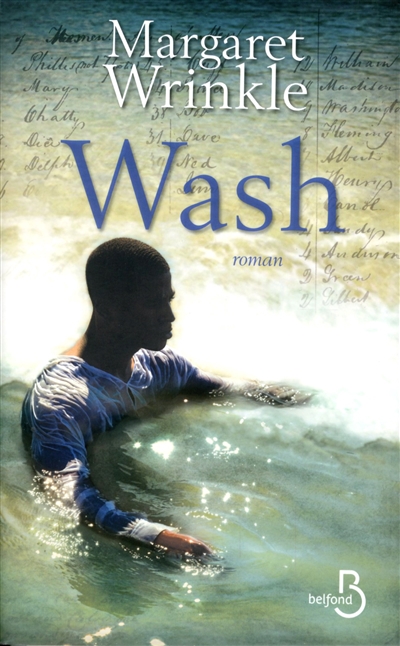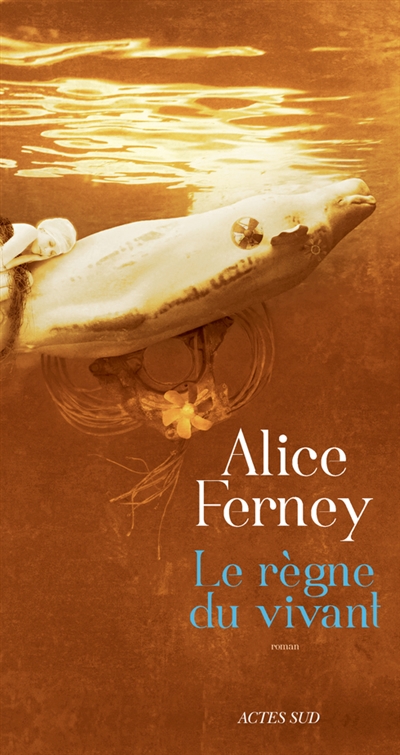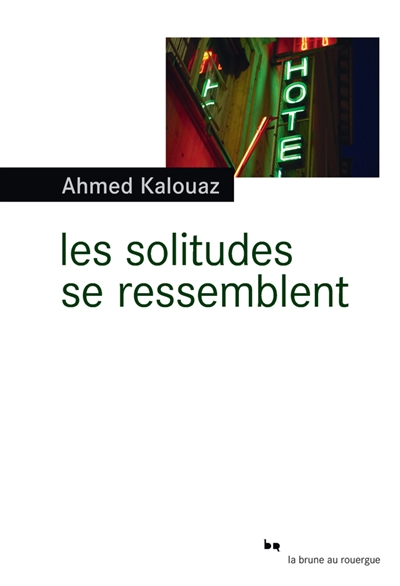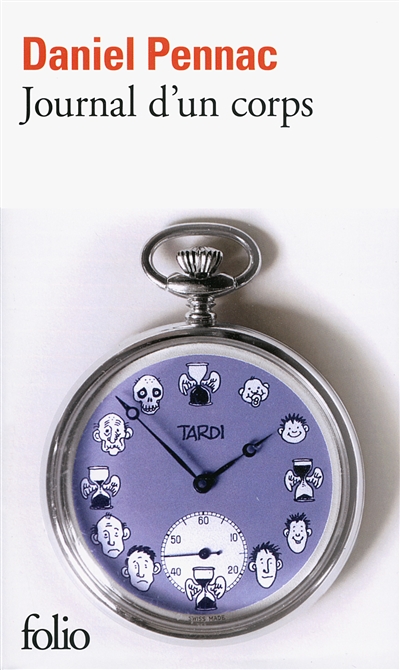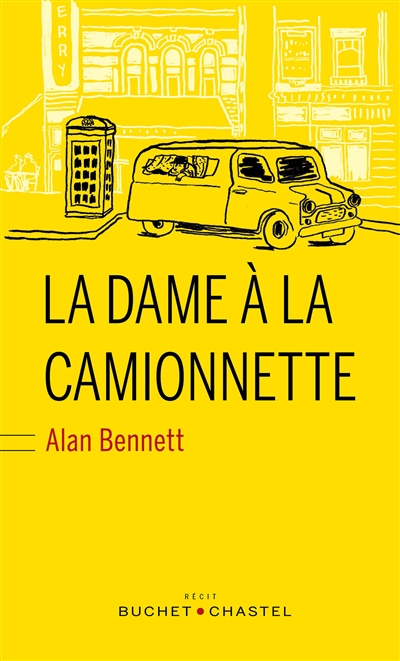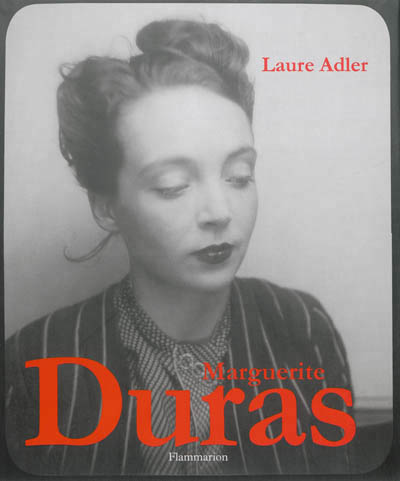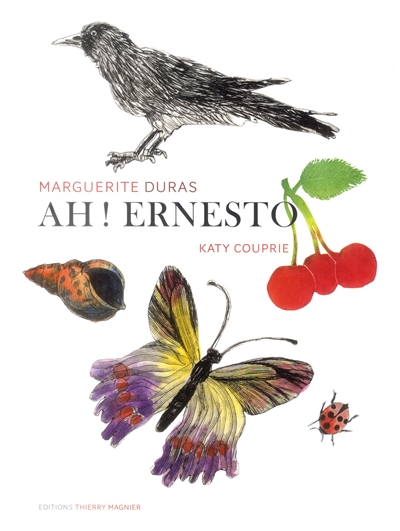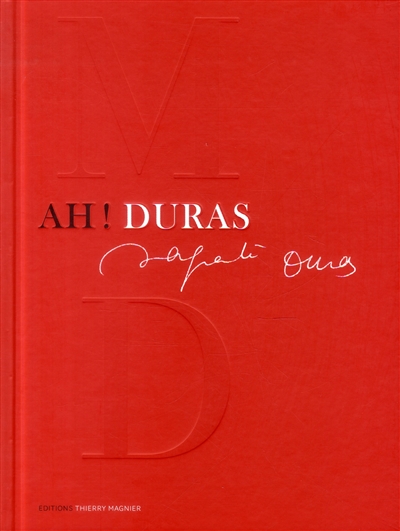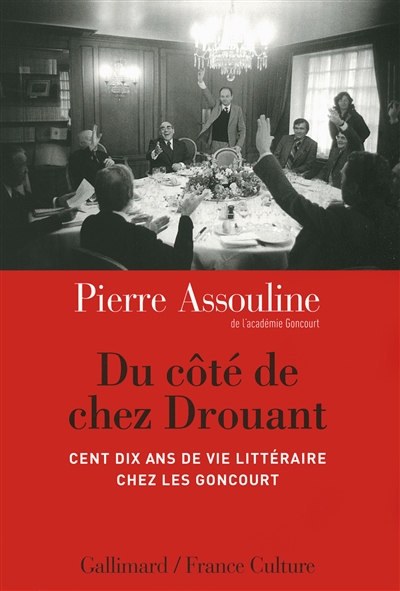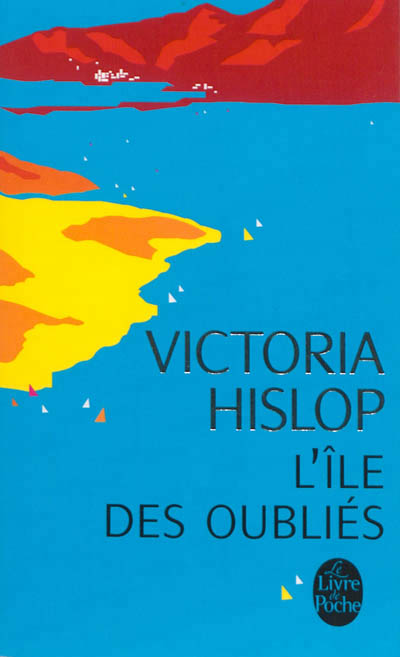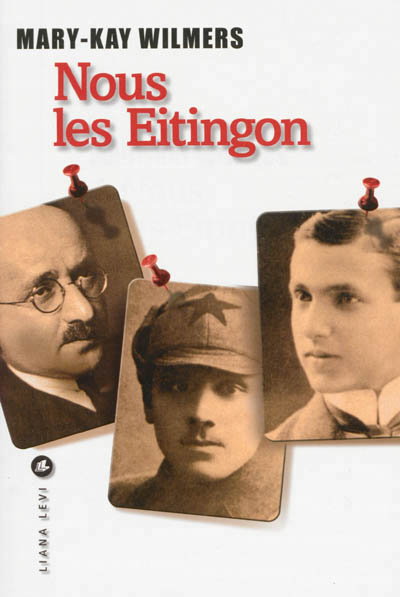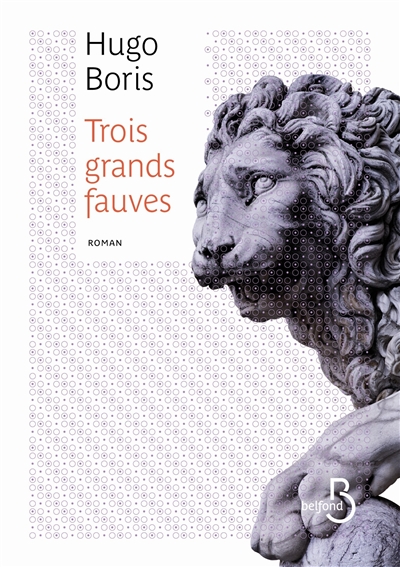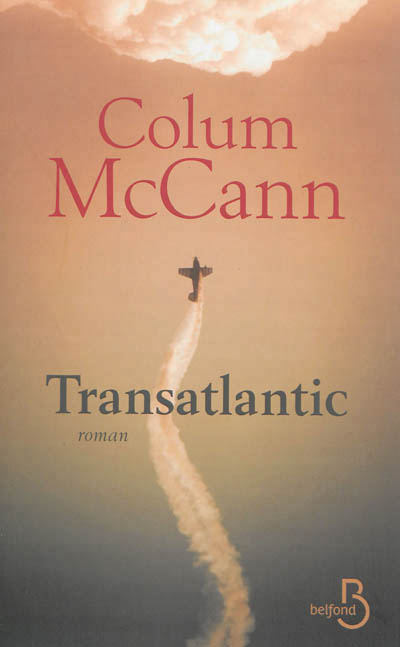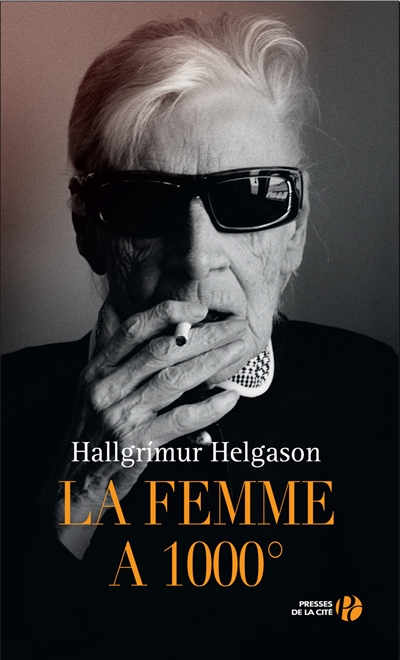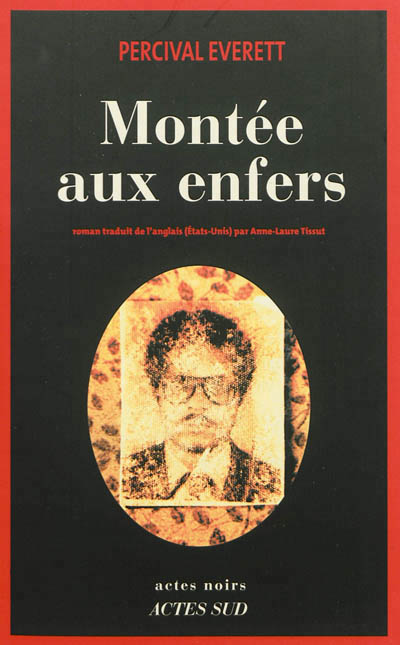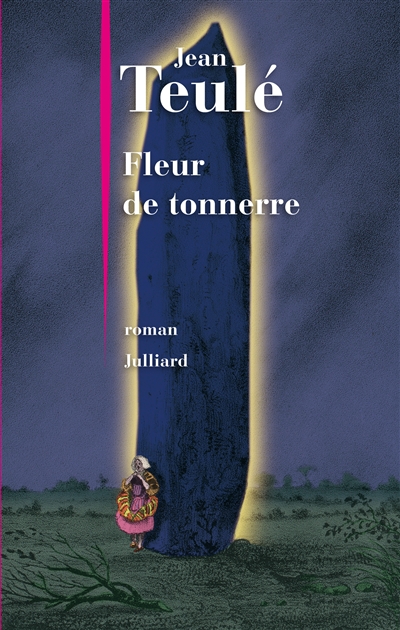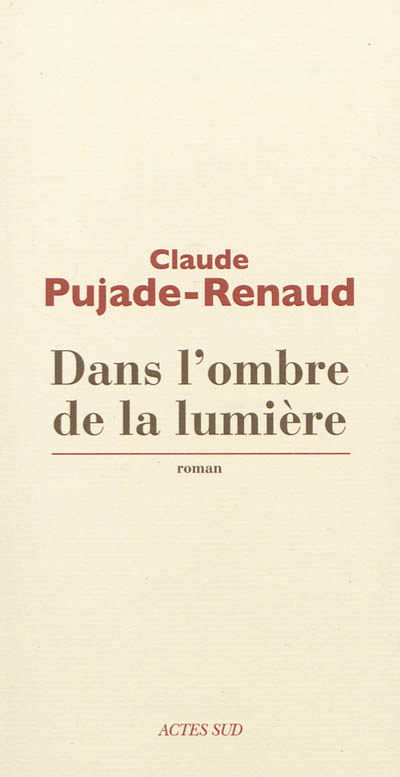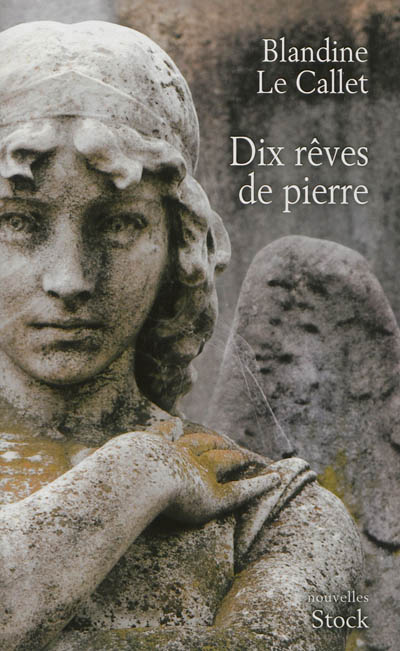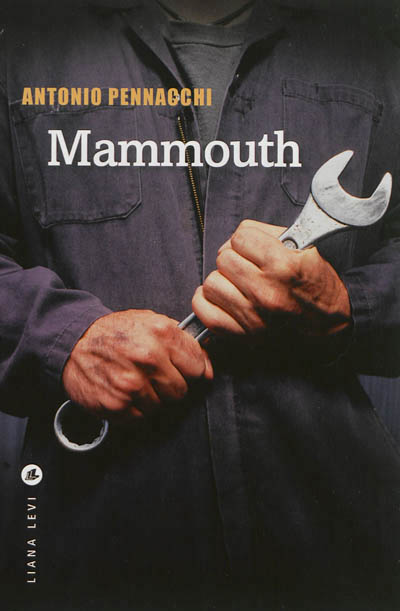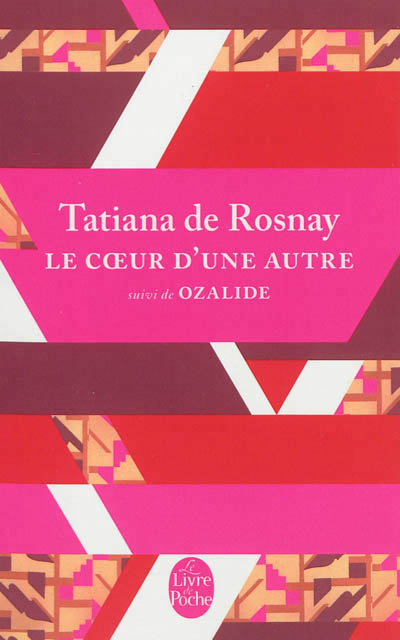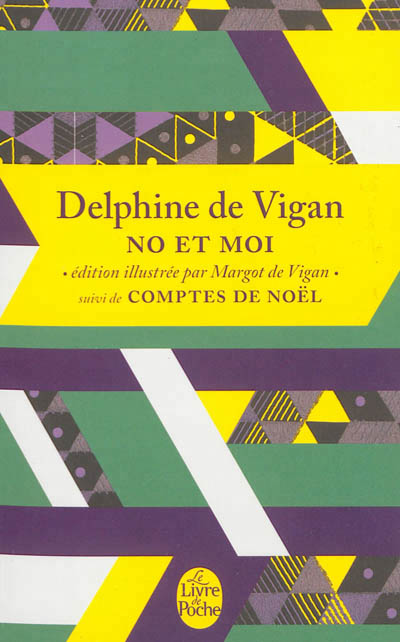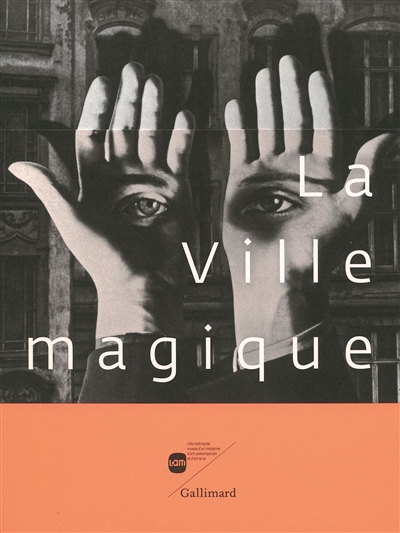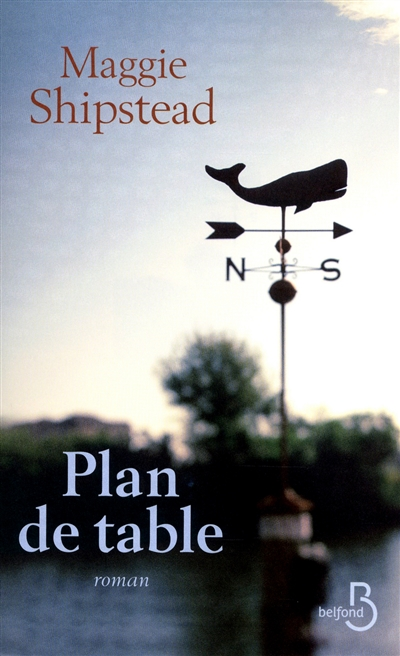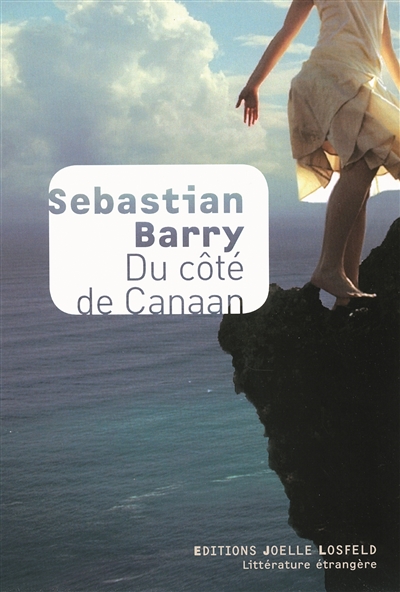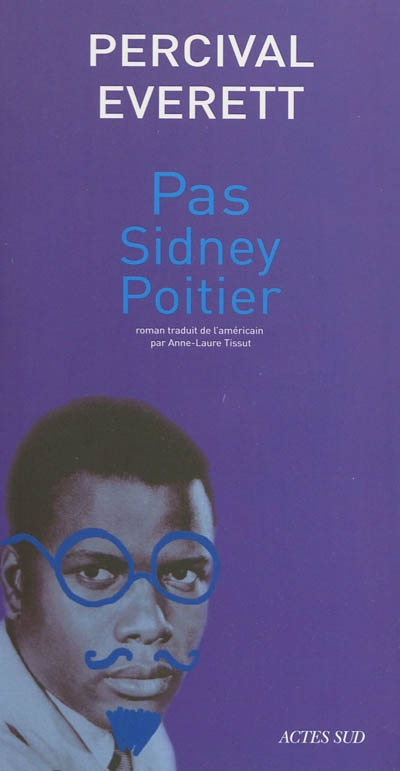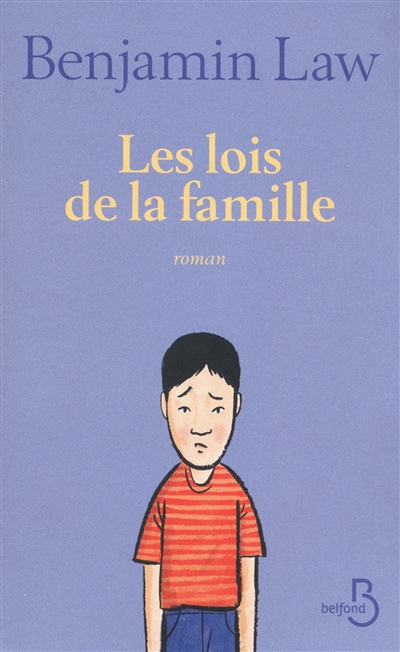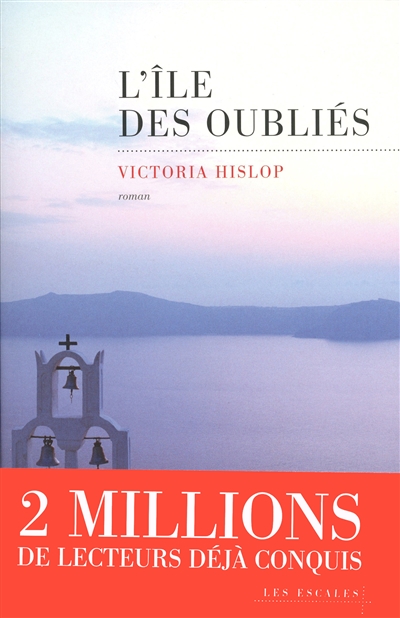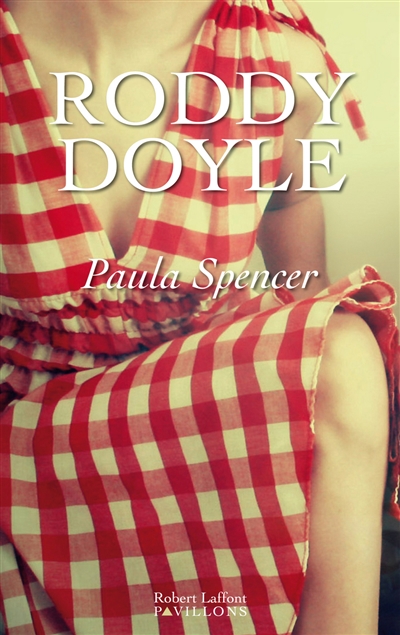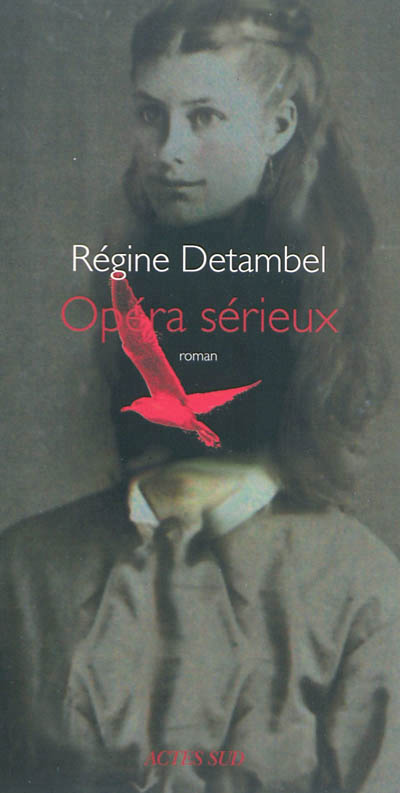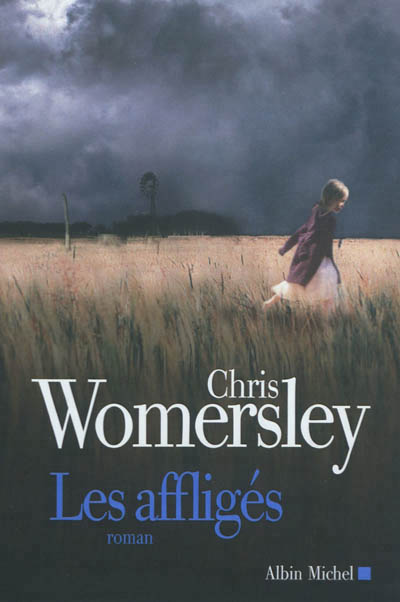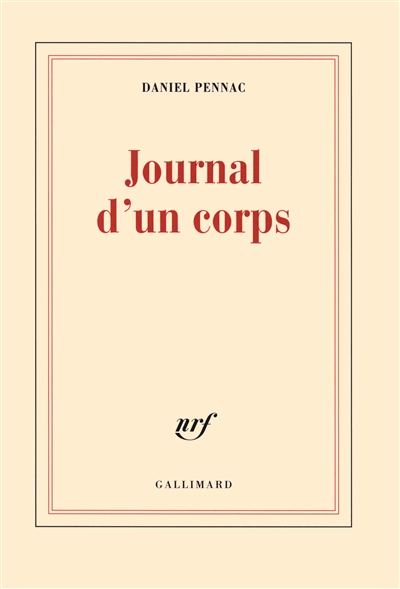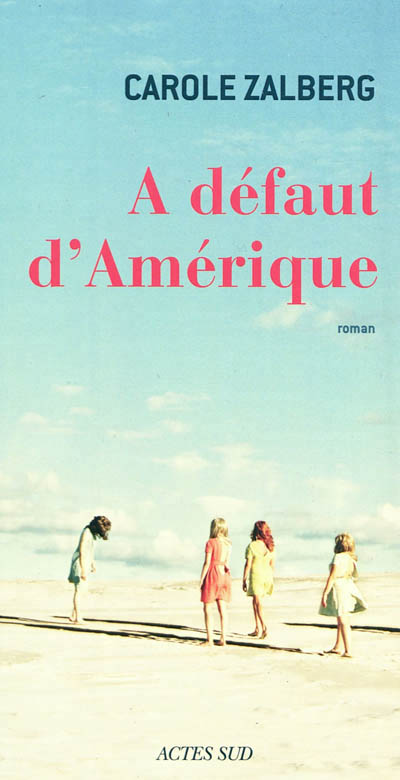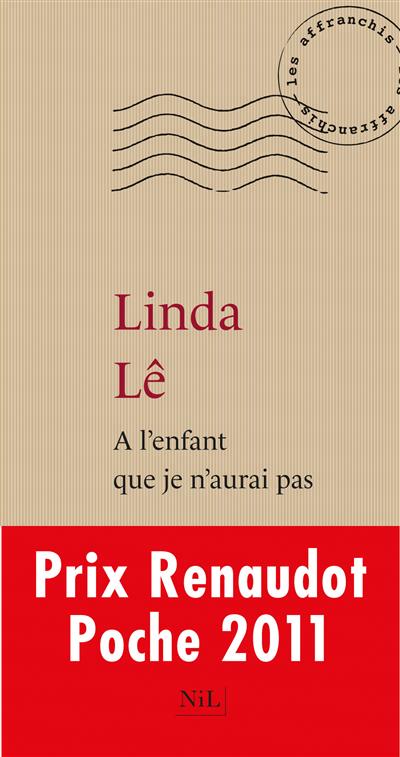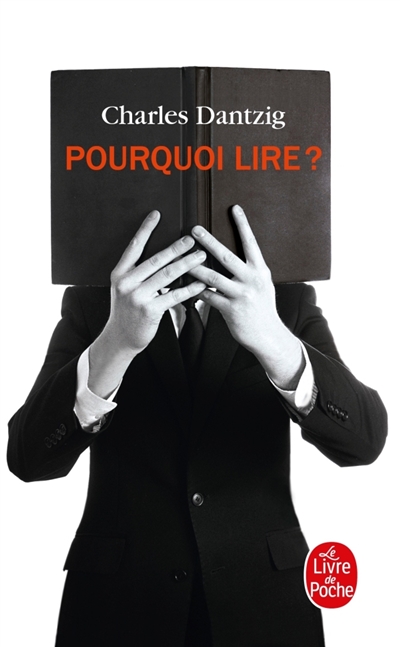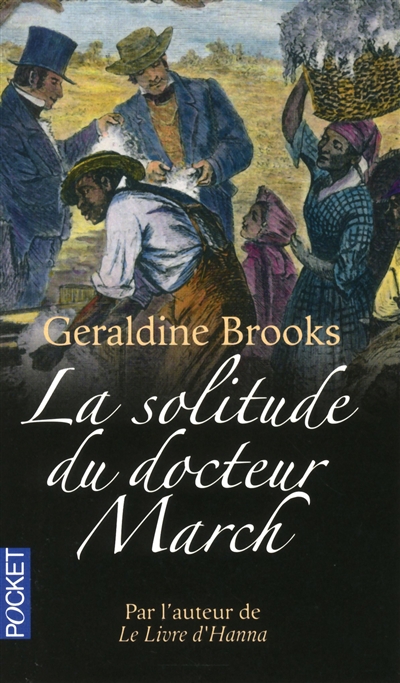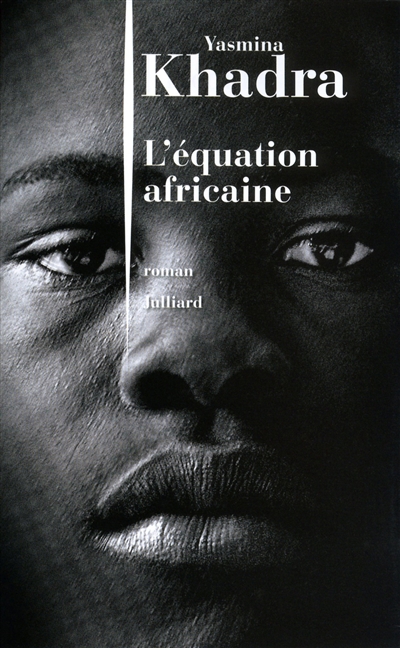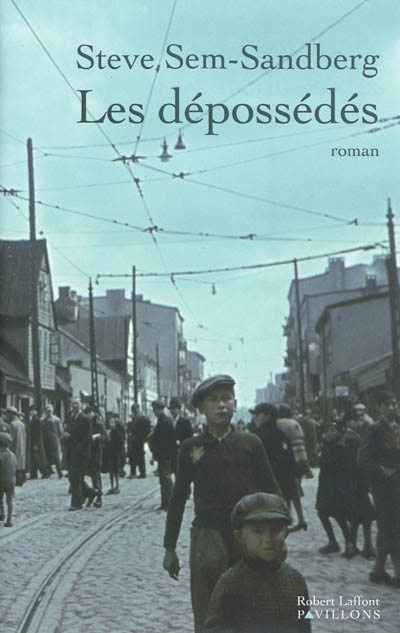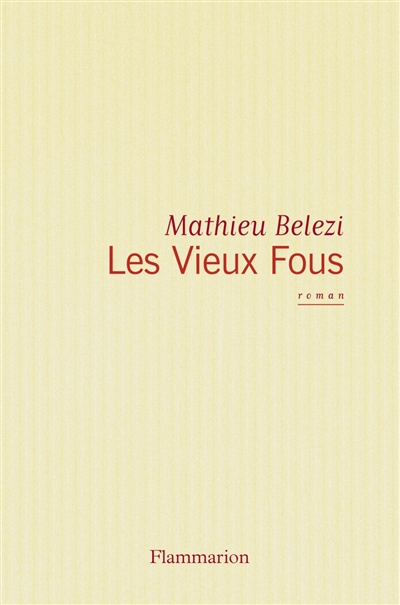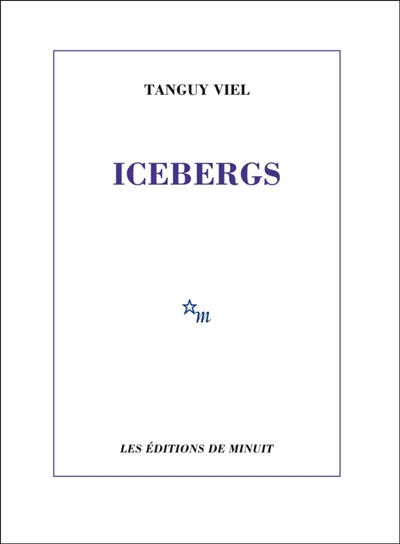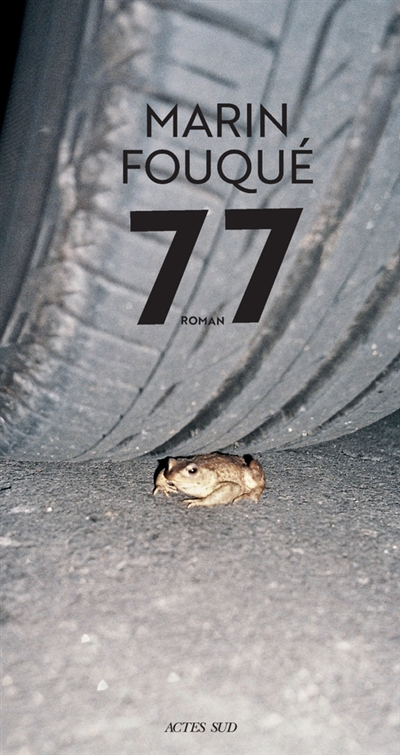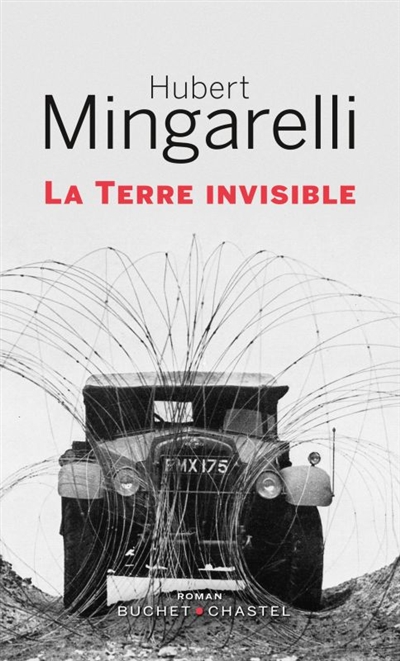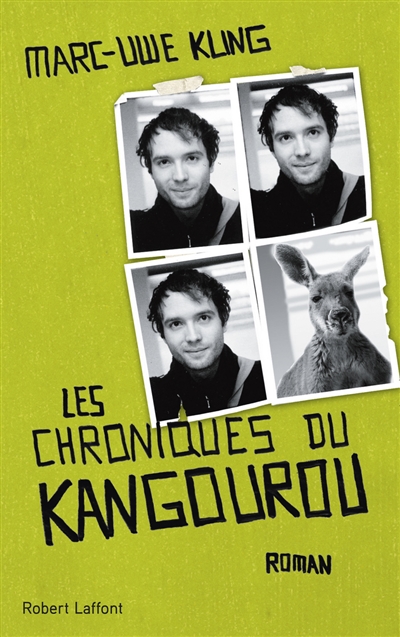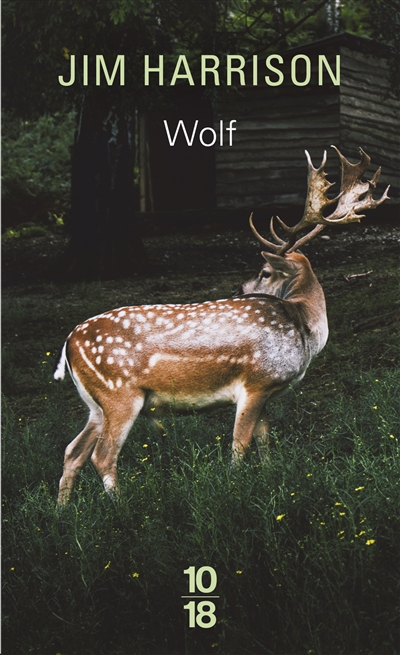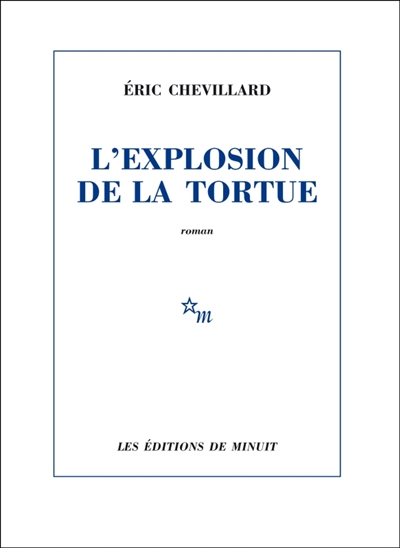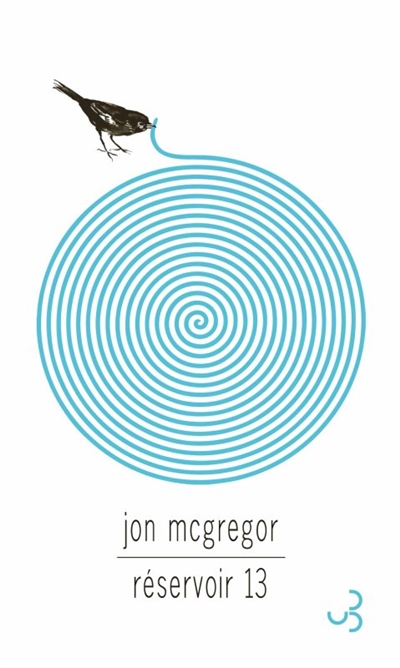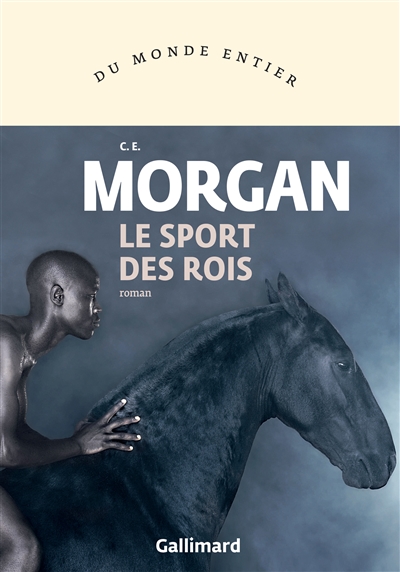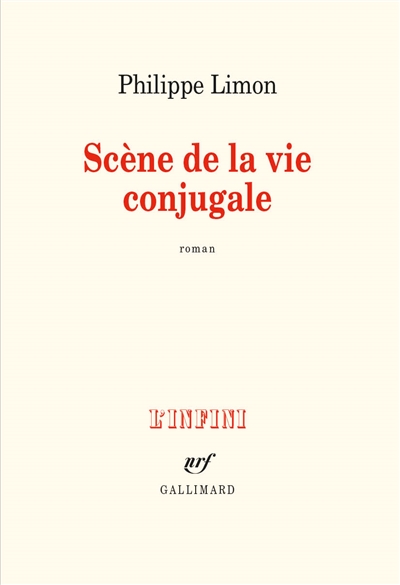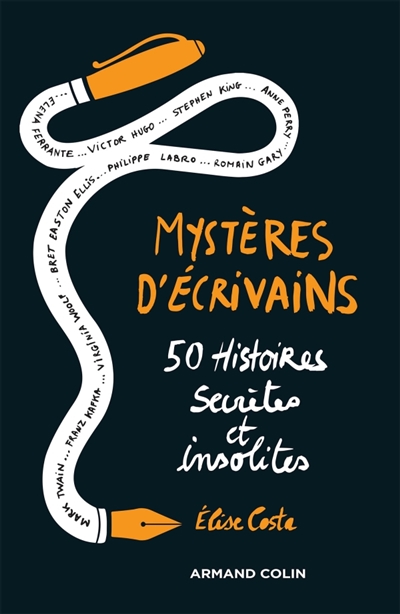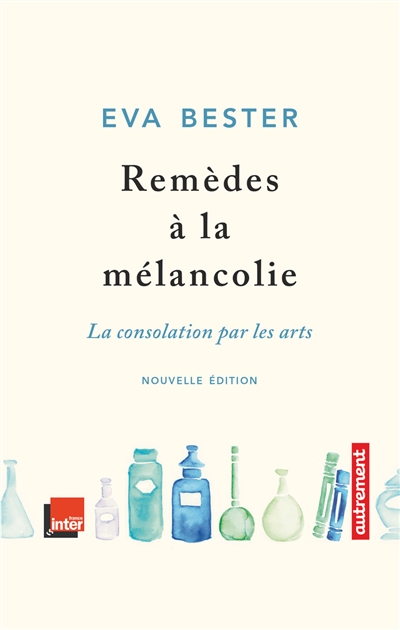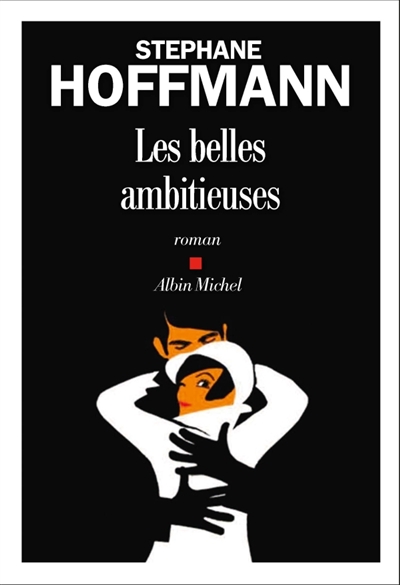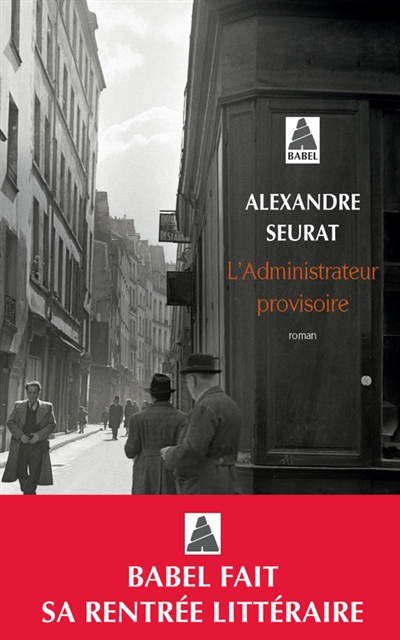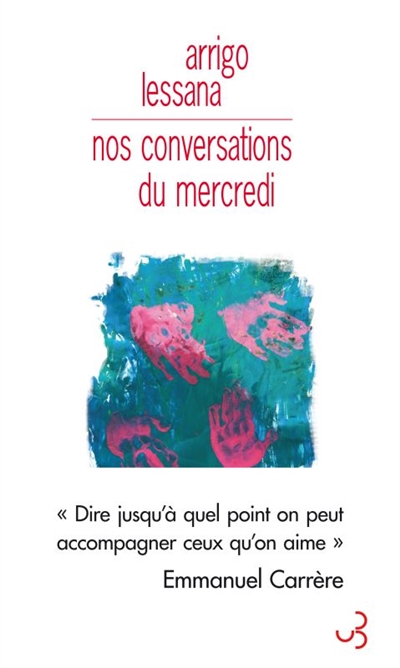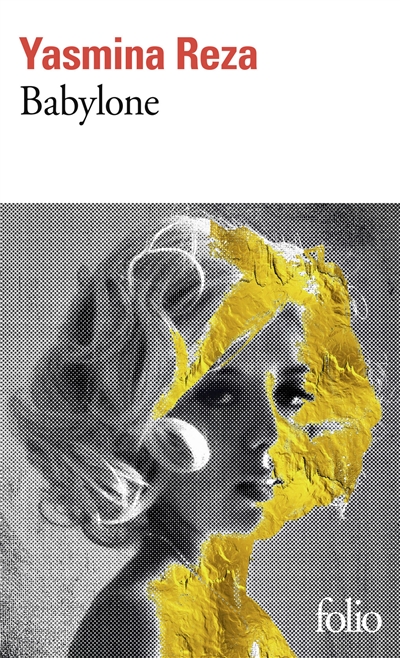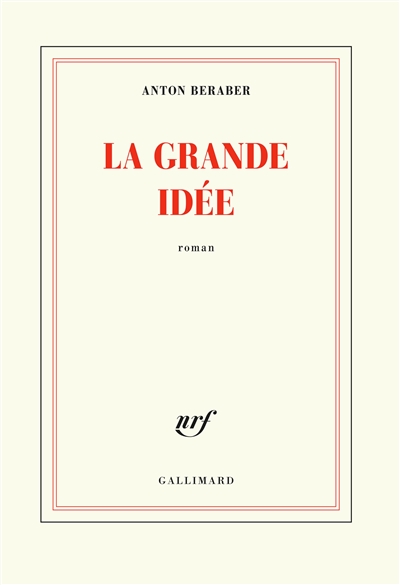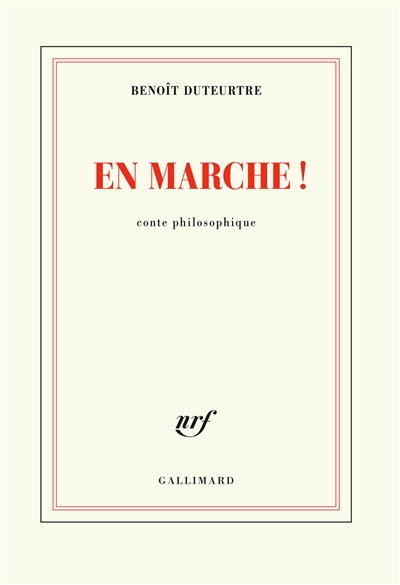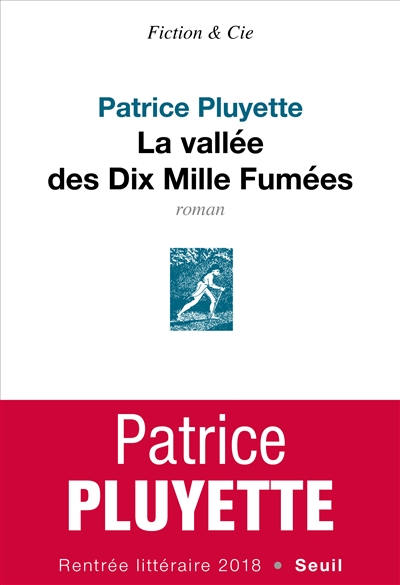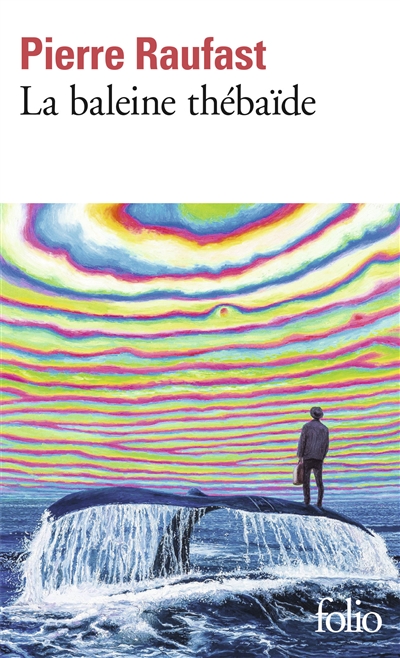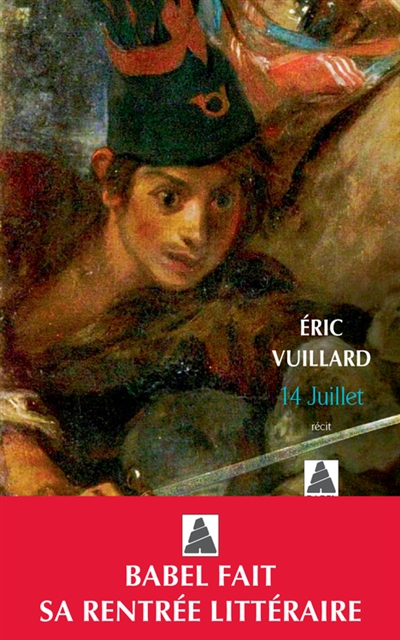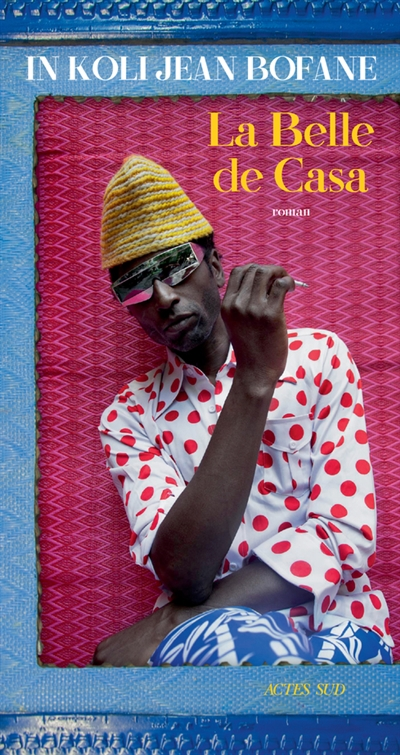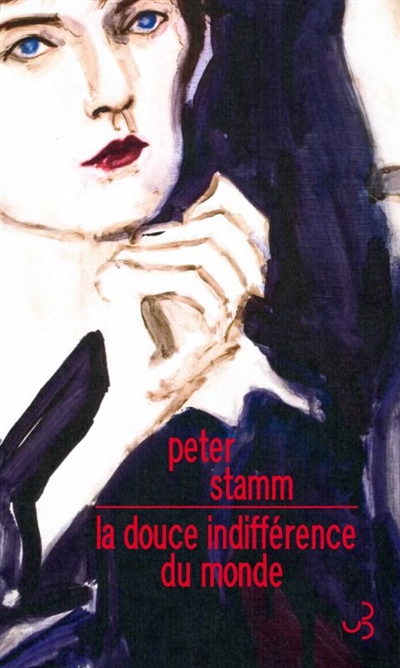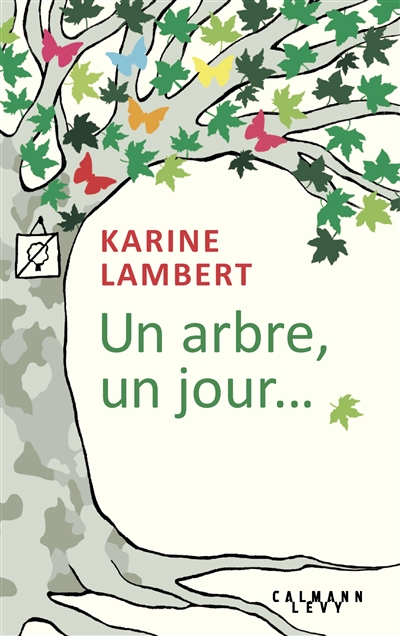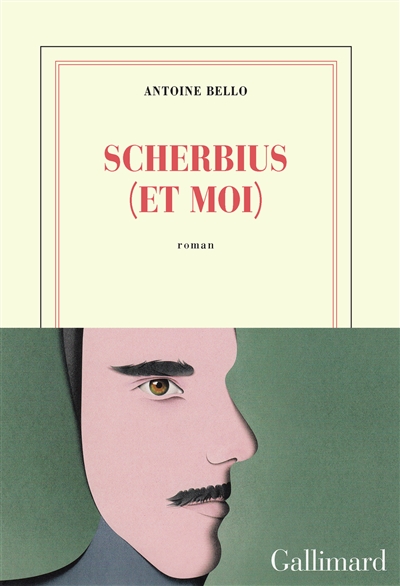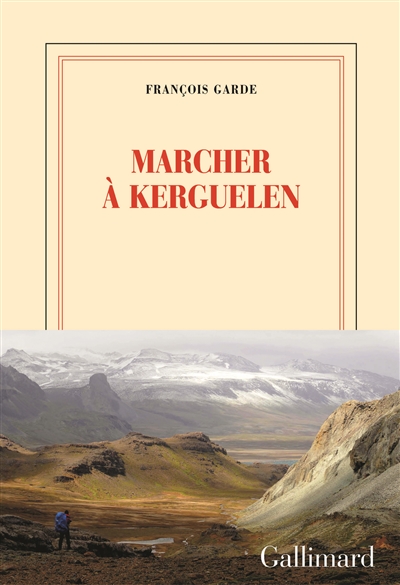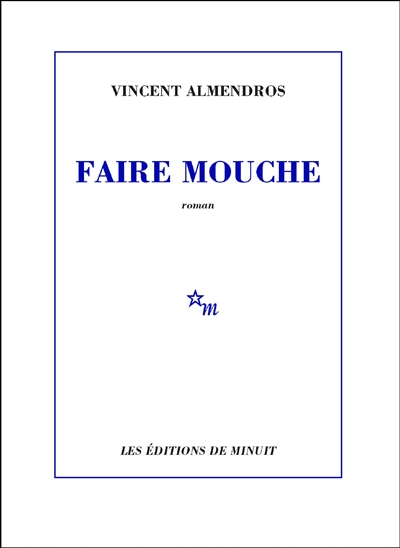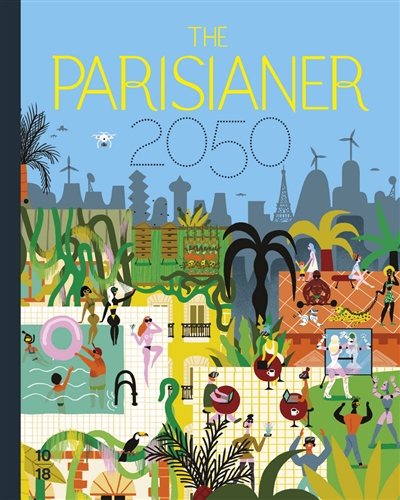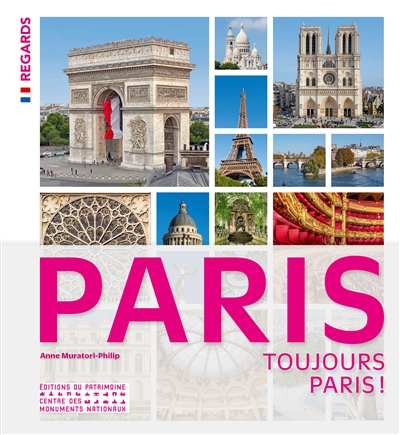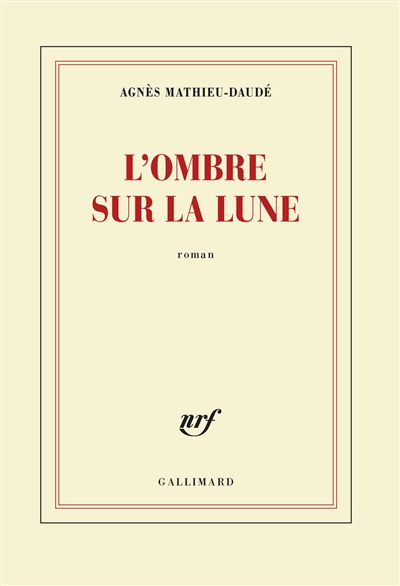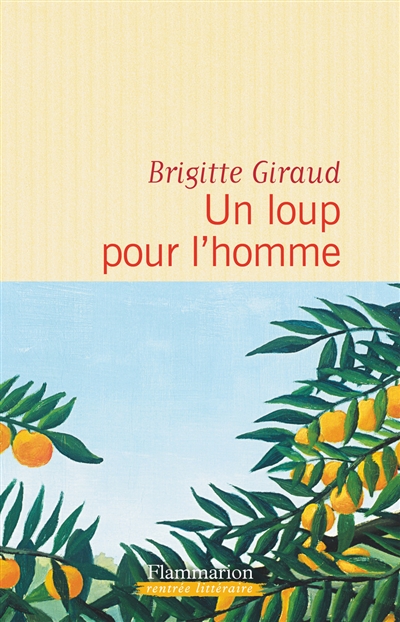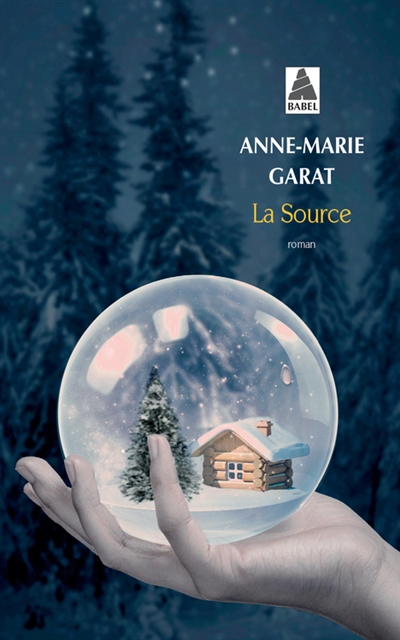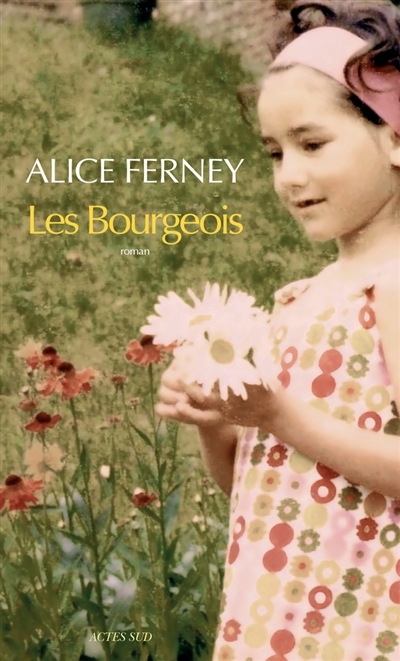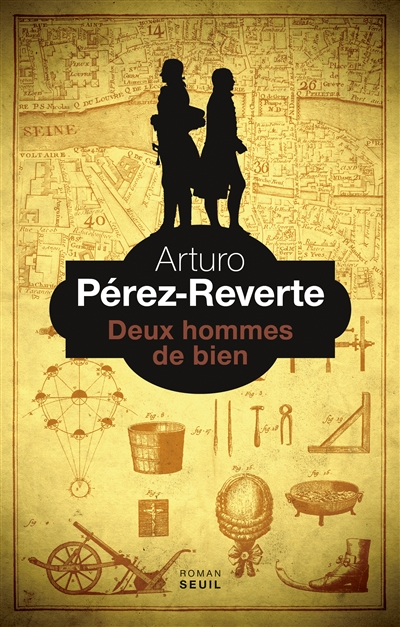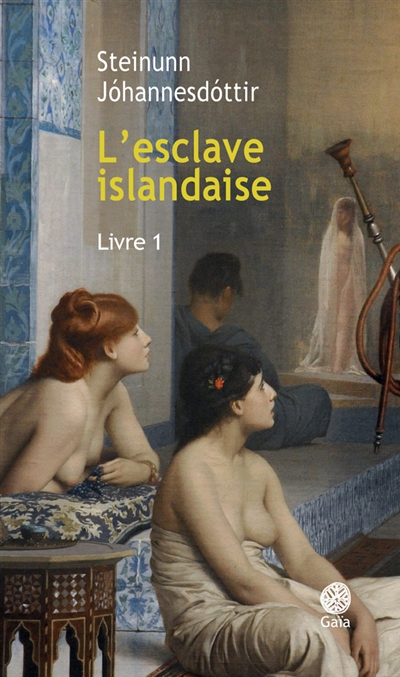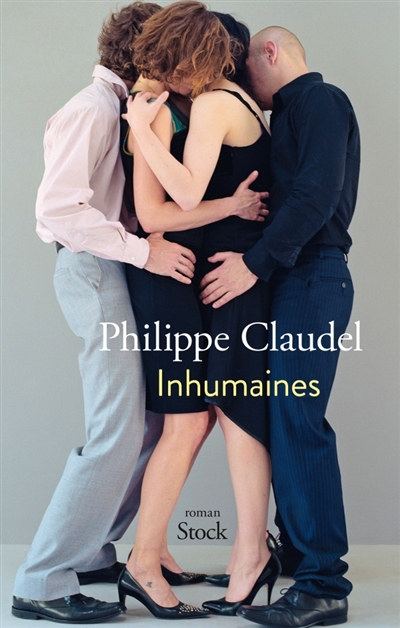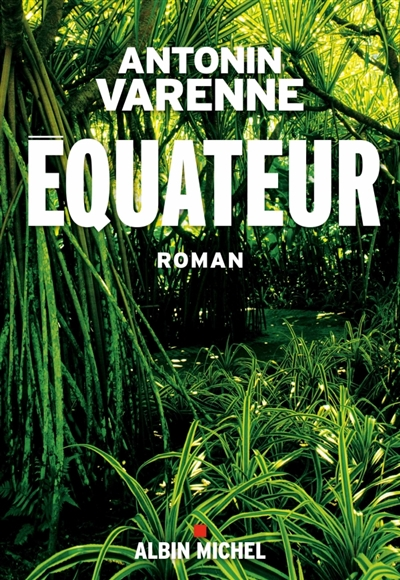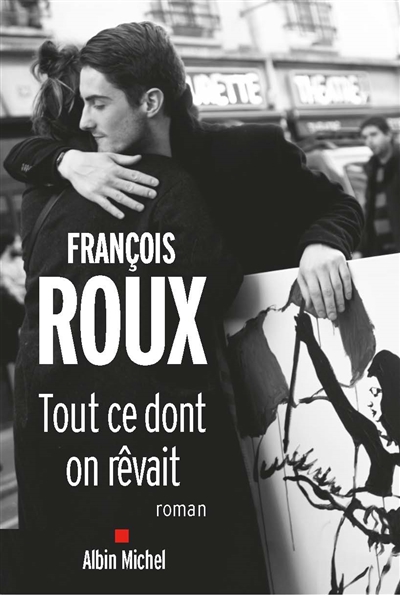Littérature française
Tanguy Viel
La fille qu’on appelle
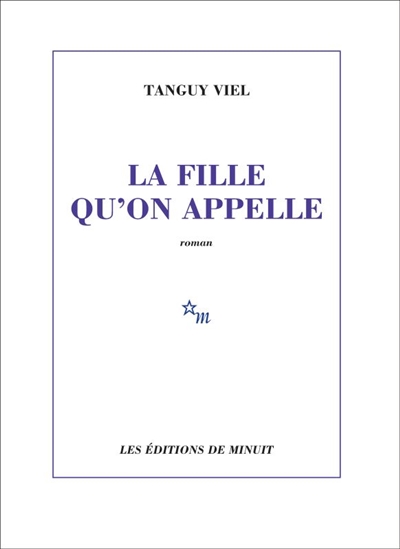
-
Tanguy Viel
La fille qu’on appelle
Minuit
02/09/2021
173 pages, 16 €
-
Chronique de
Emmanuelle George
Librairie Gwalarn (Lannion) - ❤ Lu et conseillé par 34 libraire(s)

✒ Emmanuelle George
(Librairie Gwalarn, Lannion)
Quel point commun entre Max Le Corre, boxeur et chauffeur, Laura, sa fille de 20 ans à la beauté renversante et Quentin Le Bars, le maire d’une petite ville bretonne ? Un drame mis en scène par Tanguy Viel dans un roman noir, social, psychologique et véritable joyau littéraire.
Comment est né ce texte ?
Tanguy Viel - J’ai d’abord écrit un roman sur la boxe, puis voulu mettre en scène une femme aux prises avec un homme de pouvoir. Ce texte, né de la rencontre de ces deux projets, porte sur un trio de personnages : une très belle fille de 20 ans, un maire qui peut éventuellement, moyennant petit service, lui proposer un logement et un père boxeur, lui-même chauffeur du maire. C’est dans ce rapport de forces que l’histoire se développe et explore un front psychologique, des tensions, des rapports de domination sociale. Ce livre, qui tient sur peu d’événements à l’intérieur desquels je zoome, pourrait se résumer en quelques phrases, tenir dans un titre de faits divers. Puis, comme on regarde au microscope, tout se met à trembler : les identités deviennent instables, on s’interroge sur les ambivalences. Qui domine, qui se soumet et pourquoi ?
Sans rien dévoiler, de quoi est-il question ?
T. V. - De consentement. Même si c’est un sujet à la mode ou plutôt parce que c’en est un. Alors que je n’ai pas le sentiment d’écrire des livres indexés sur la société, il y a l’envie d’en fabriquer la théâtralité, c’est-à-dire la scène littéraire sur laquelle essayer de la déployer autrement. Je ne dirai pas qu’ici ce sont Créon (le méchant) et Antigone (la gentille). Mais on sait ce qui se passe. Après avoir vu la pièce, beaucoup de choses font qu’on peut réinterroger les rapports et les voir avec l’épaisseur de chaque scène. Ici aussi, je l’espère, avec un peu d’inquiétude et de plaisir à la fois.
Vous explorez aussi le rapport au corps.
T. V. - Père et fille ont un problème avec leur corps, une manière de négocier avec, en étant soumis à des plus forts qu’eux. Ils n’arrivent pas à habiter complètement leur corps, puis apprennent. Peut-être est-ce un roman d’initiation, d’émancipation à partir des corps. Cette fille, très belle, débarque du monde du mannequinat où des agences de mode peuvent embarquer une lycéenne dans un univers qui n’est pas le sien. Ce roman parle de cette manière d’être habité, conquis, entravé par d'autres. L’idée du boxeur m’a aidé à incarner mes pulsions littéraires. Le boxeur, c’est l’incarnation absolue. Plus de différence entre penser et agir. Le cerveau est dans les mains, cela me fascine. Pourtant, on peut être boxeur et aussi le pantin de tout un monde.
Comme sur un ring, il s'agit de face à face, une sorte de huis clos.
T. V. - Je n’évolue pas beaucoup de livre en livre, cela se passe à nouveau dans une ville bretonne, pas nommée mais reconnaissable, dans un univers de petits pouvoirs de province, entre un maire et un directeur de casino. Avec un côté « club » qui s’arrange avec la morale, le pouvoir, l’argent. J’ai tendance à penser « scènes de théâtre » : ces villes me servent de maquettes où je déplace des personnages, des forces, des mouvements qui trouvent leur ancrage dans un réalisme qu’on pourrait qualifier de social.
Peut-on établir un parallèle avec un précédent roman ?
T. V. - J’ai l’impression que c’est un peu la version féminine d’Article 353 du code pénal, où le rapport entre dominant et dominé est à la fois clair et trouble. Il y a le méchant et le gentil. Malgré tout, à l’intérieur de cette bipartition, il y a des zones d’instabilité et d’ambiguïté. Ici, entre le maire et Laura, il y a aussi un rapport de domination où j’ai tenté d’explorer tout un mécanisme qui fait qu’il n’y a pas besoin de violence physique pour que les dominations s’installent. Tout se joue dans les interstices, les fascinations. Différence importante : c’est mon premier roman à la troisième personne. Jusqu’ici, j’ai toujours écrit à la première personne, en caméra subjective. Ici, parce que c’est un personnage féminin et que peut-être je ne me suis pas senti la légitimité ou bien que je n’ai pas assez senti en moi la voix du féminin, j’ai eu besoin d’un narrateur extérieur qui soutient les discours des personnages.
Vous parlez de caméra, de point de vue. Diriez-vous « faire du cinéma en littérature » ?
T. V. - Dans mes livres plus anciens, j’étais obsédé par la question de fabriquer de l’image et des scènes où l’on pouvait jouir visuellement. Là, j'ai l’impression de plus explorer l’intériorité de mes personnages et l’analyse psychologique. Mais pour que le lecteur puisse rentrer dans ces méandres, il lui faut des cadres et des appuis visuels forts et simples. Si on ne voit pas, on ne peut pas lire. Or c’est difficile de voir : dans le cerveau on ne voit pas, ce sont des mouvements. Cette conversion des flux vers le cadre fait que j’ai tendance à user des outils cinématographiques.
À propos du livre
« Demander de l’aide à son employeur n’est pas toujours sans conséquence. » Un peu rapide pour présenter le propos de l’excellent nouveau roman de Tanguy Viel ? Soit. Il n’empêche que ce texte est du grand art littéraire. Son intrigue, campée dans une ville bretonne où la mer assiste à une comédie humaine, repose sur de petits arrangements avec la morale, l’argent, le pouvoir. Sa mise en scène, subtile d’intériorités tourmentées et de corps entravés, s’accompagne d’un condensé de tension narrative et de maîtrise stylistique pour donner à voir, entendre, ressentir, une histoire tragique, scabreuse et réaliste, une exploration des tensions et des rapports de domination sociale. Du grand art !