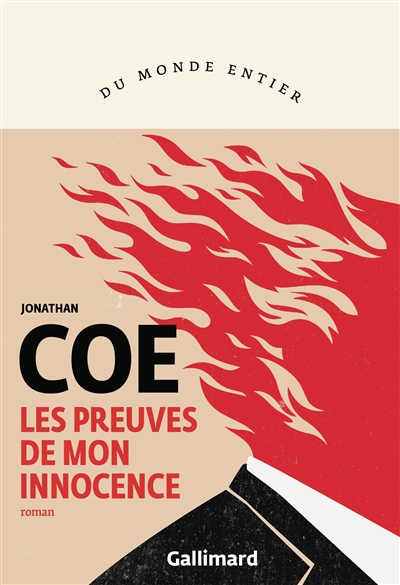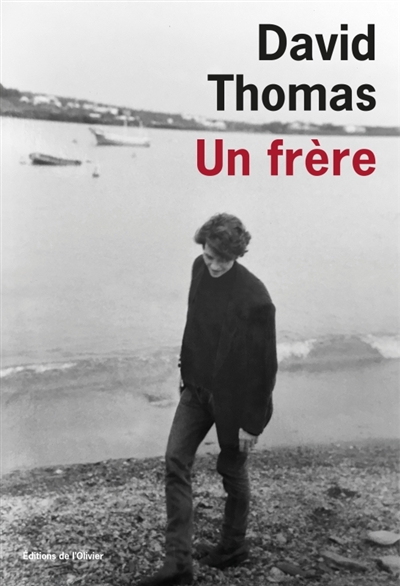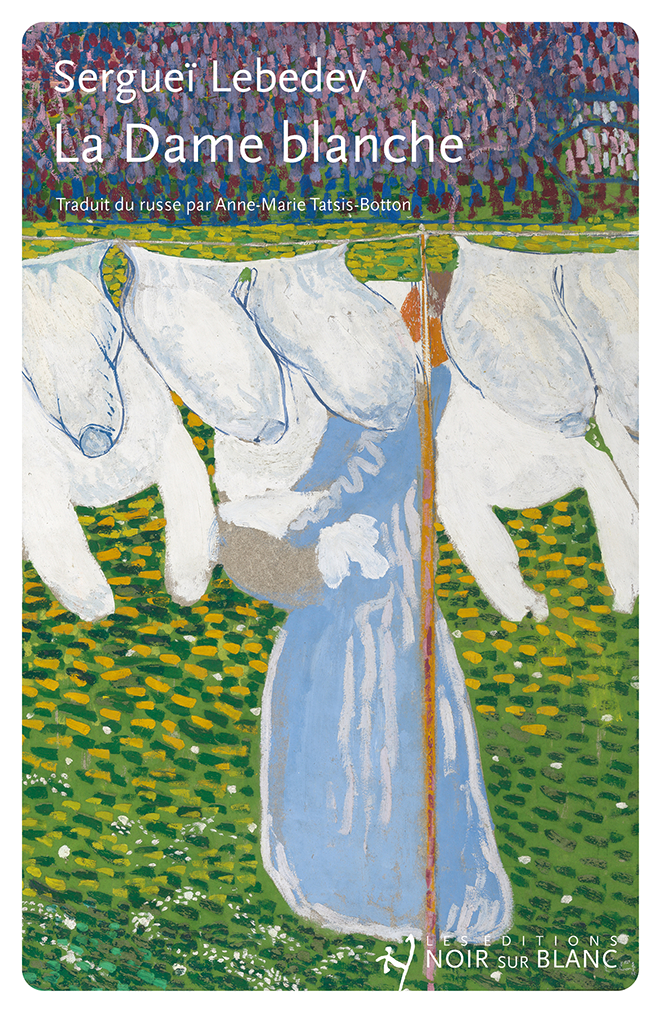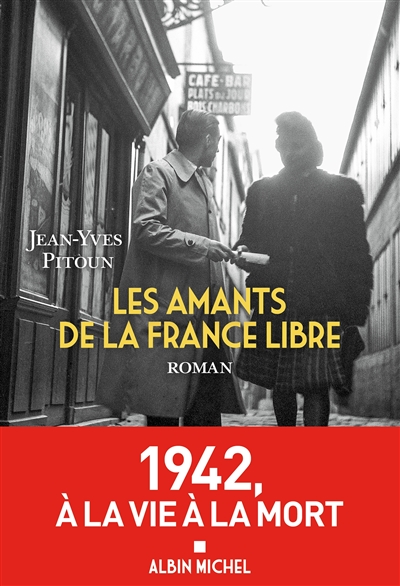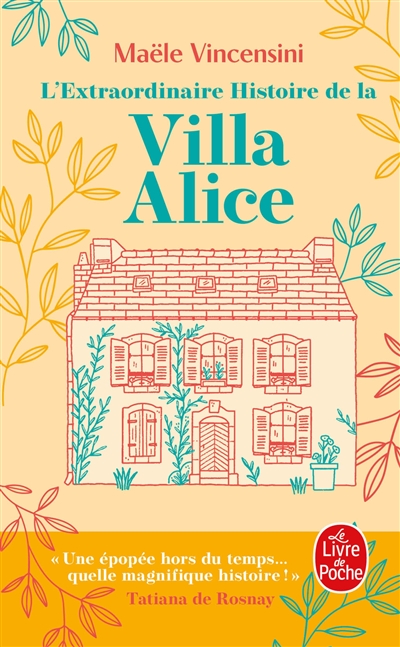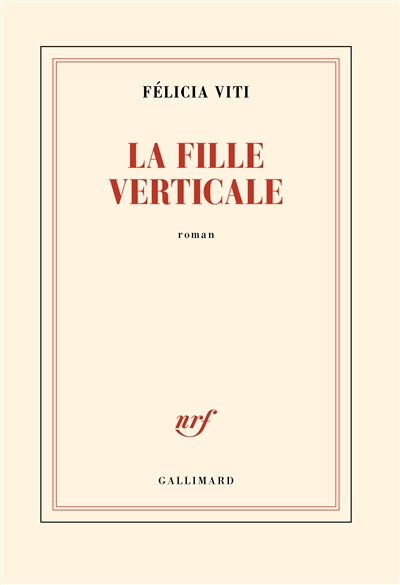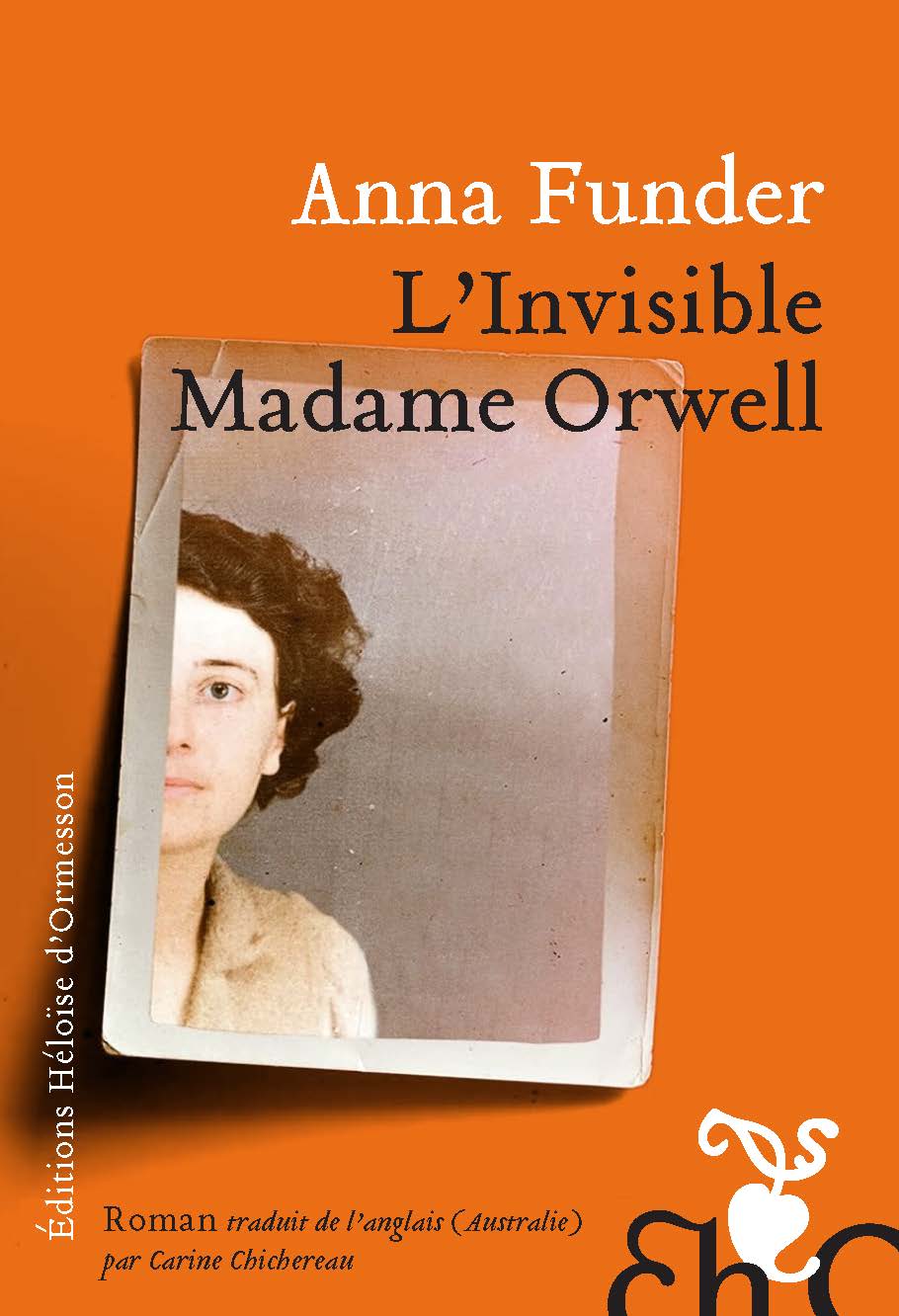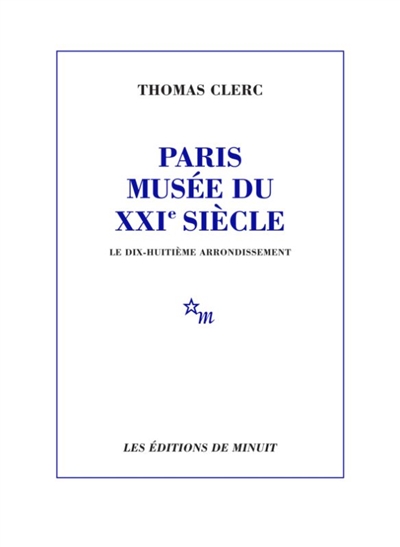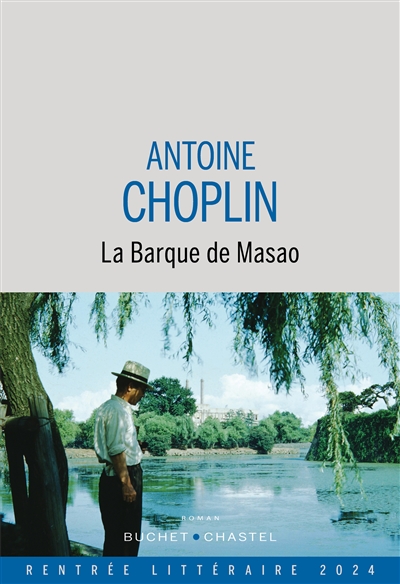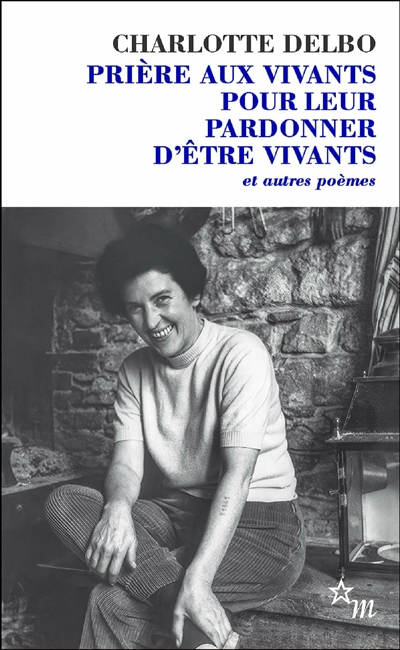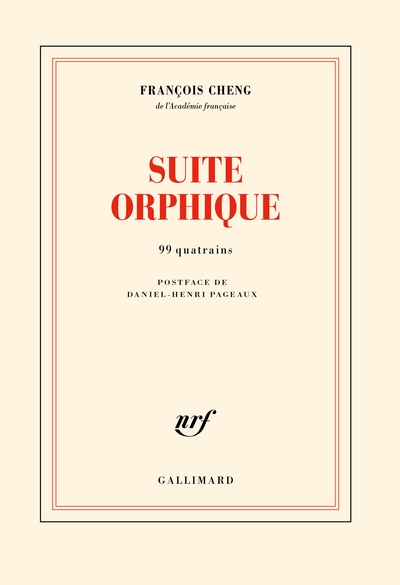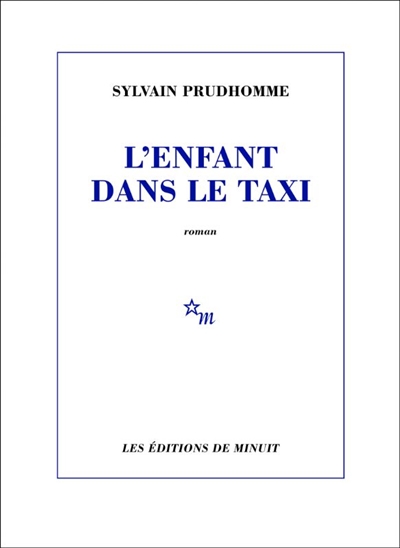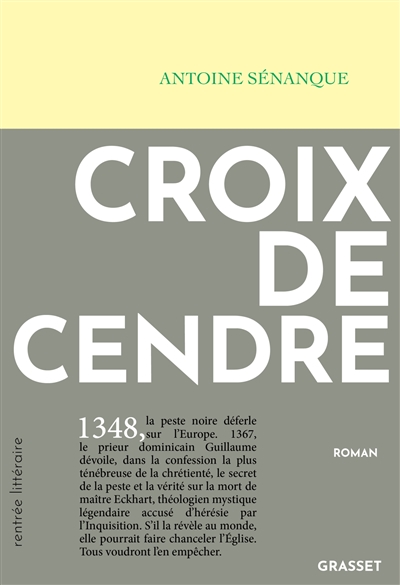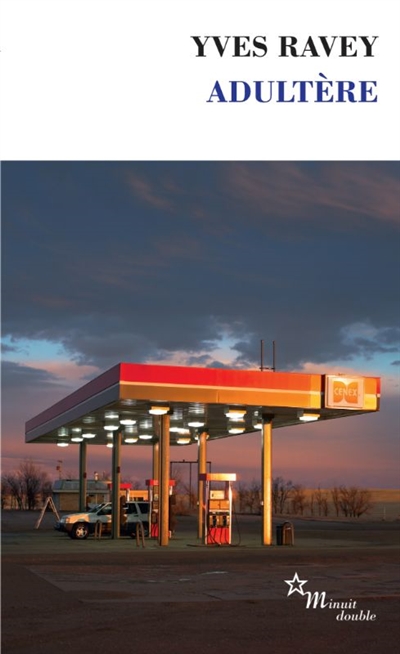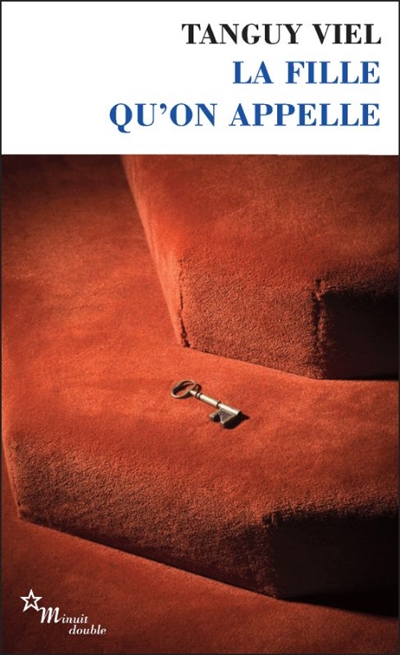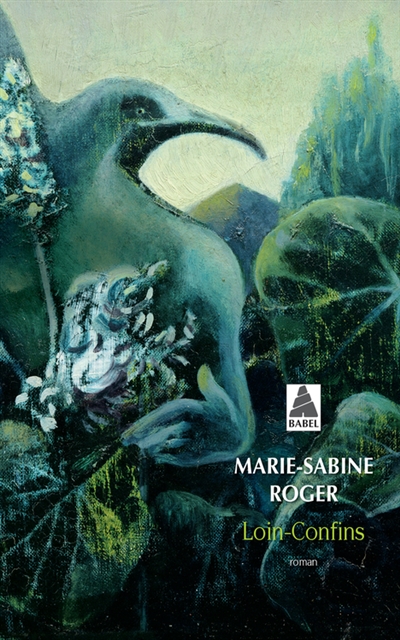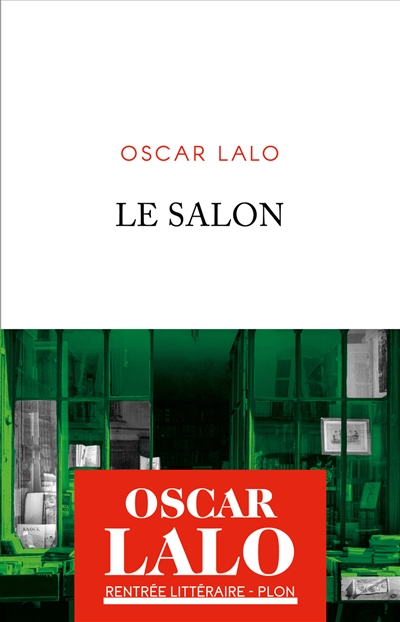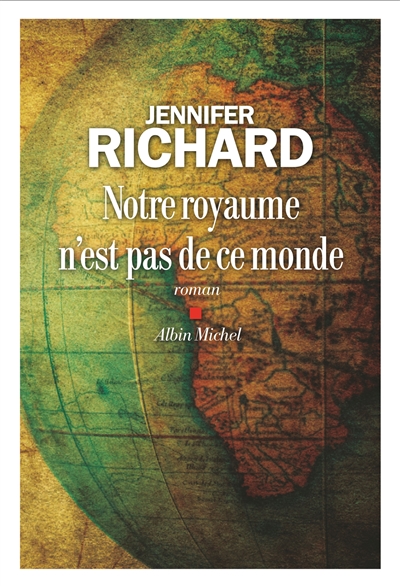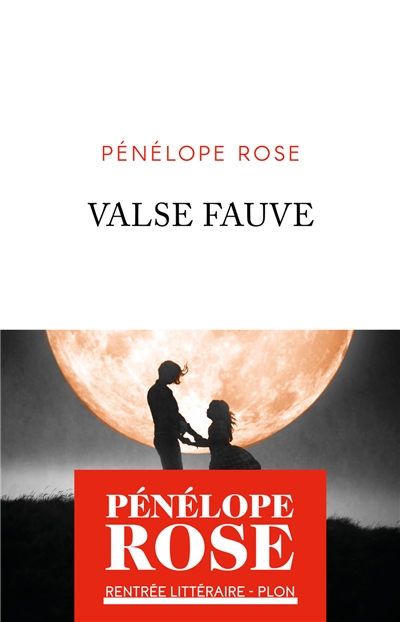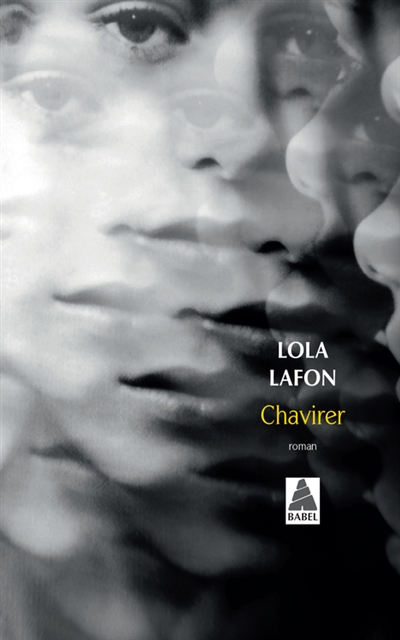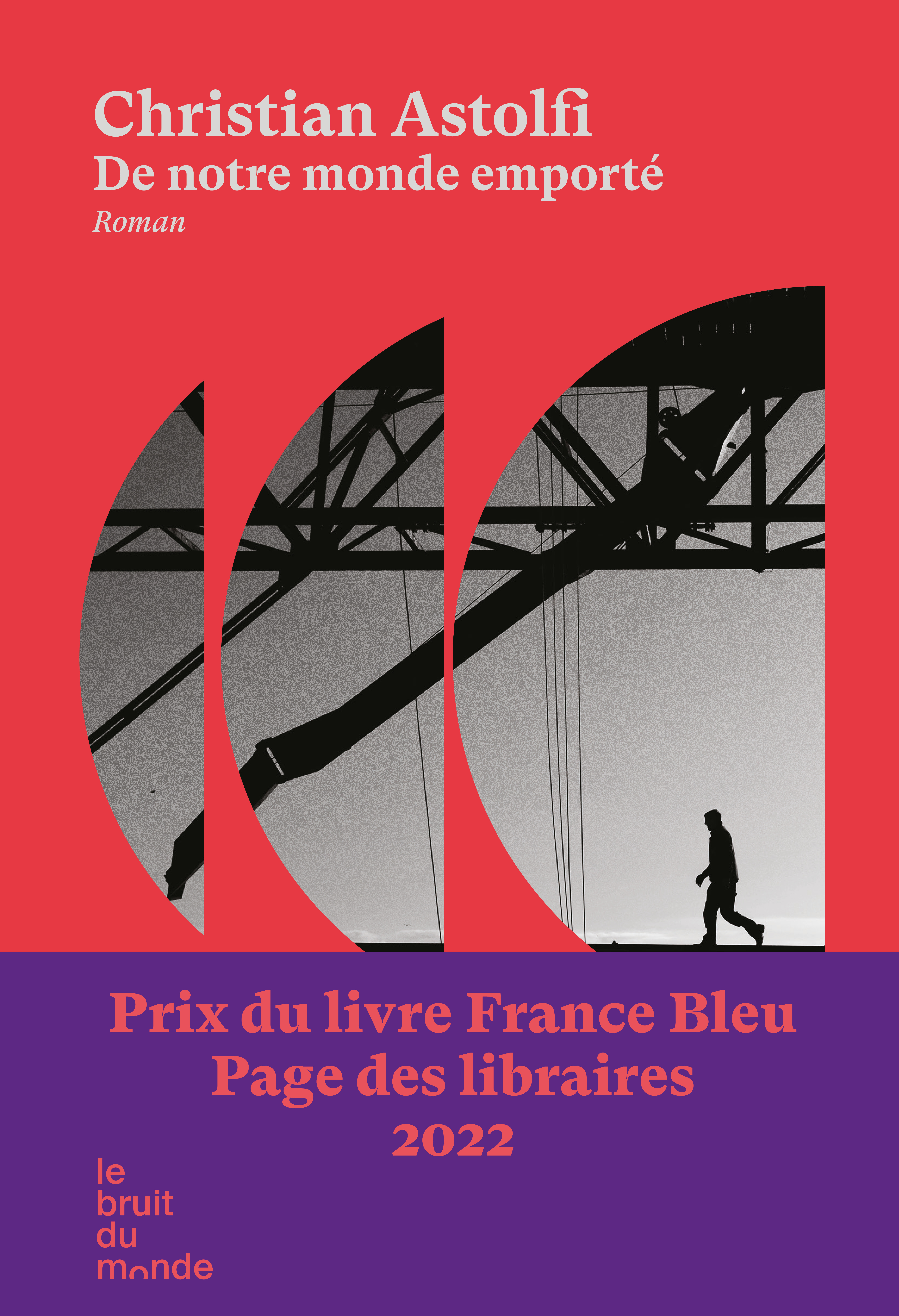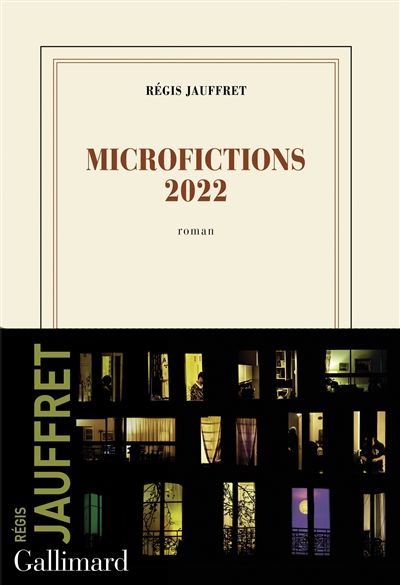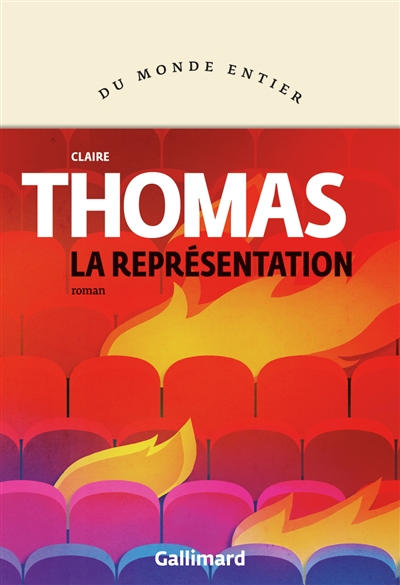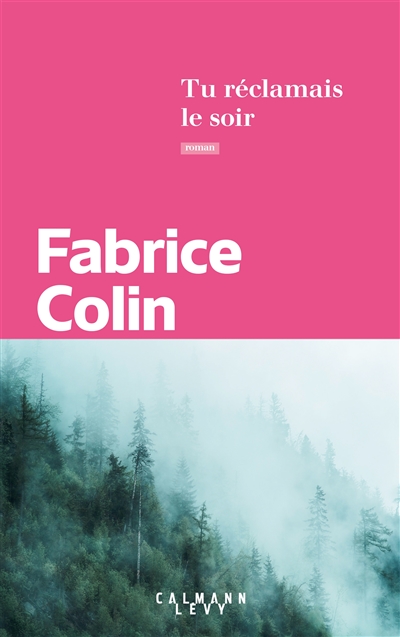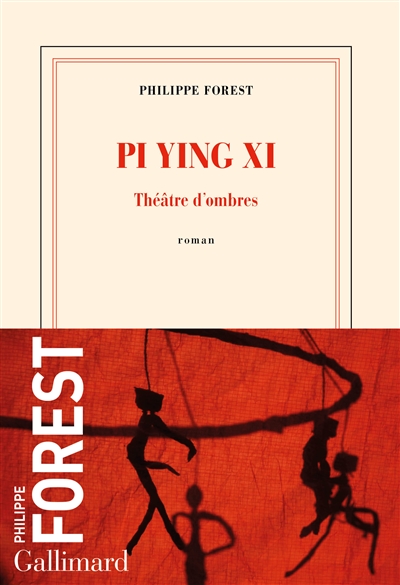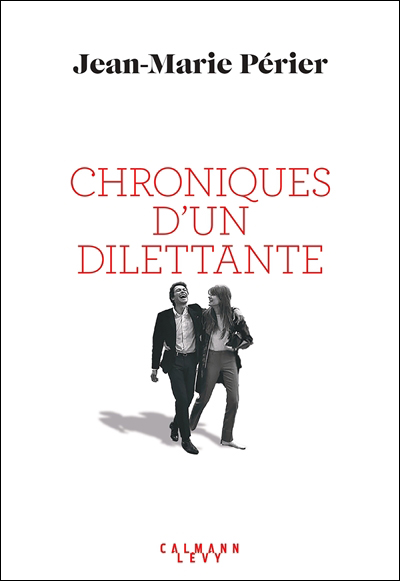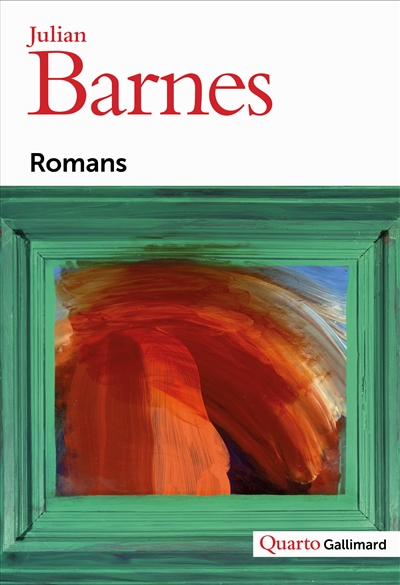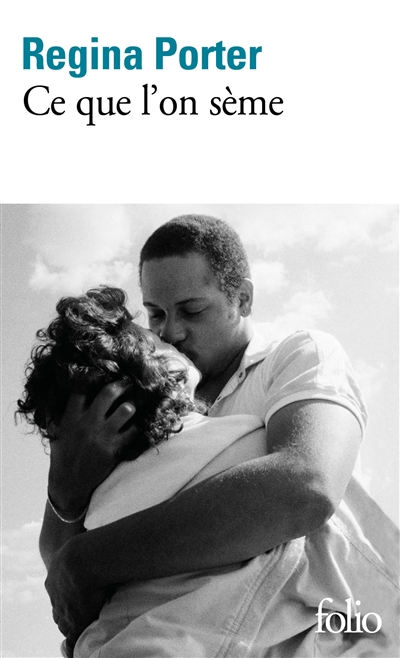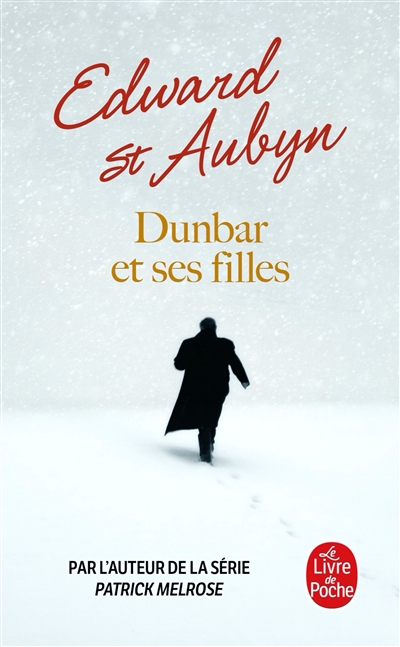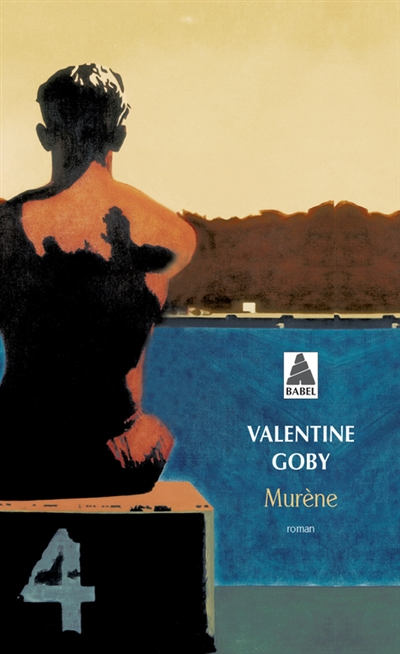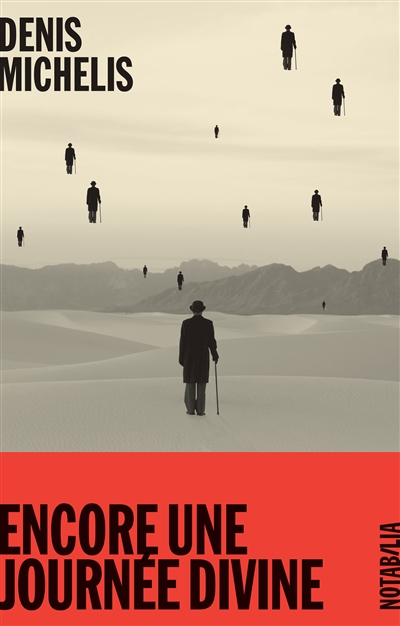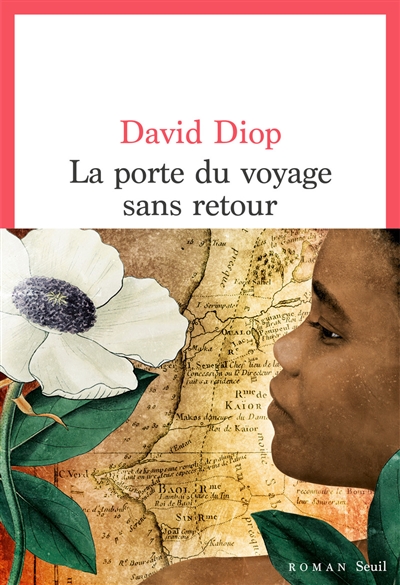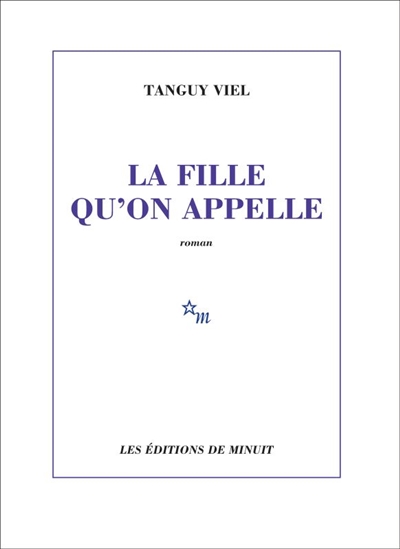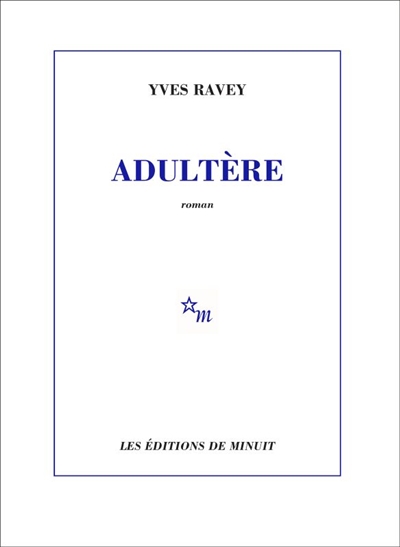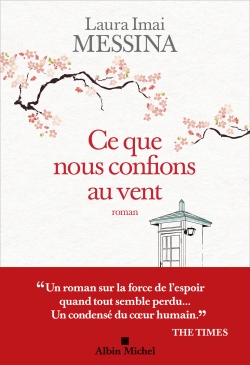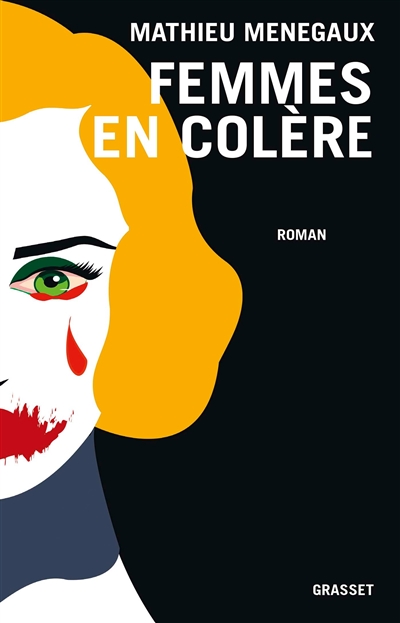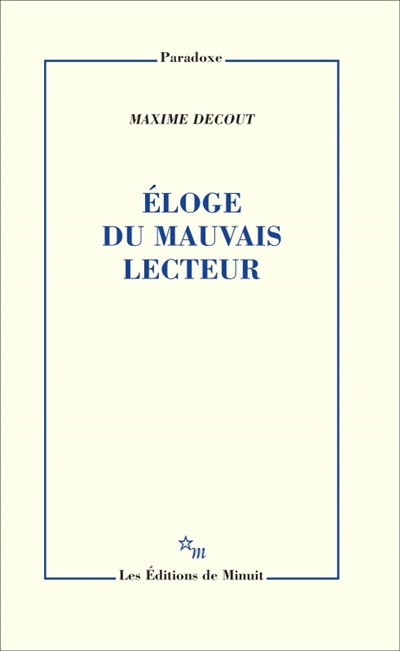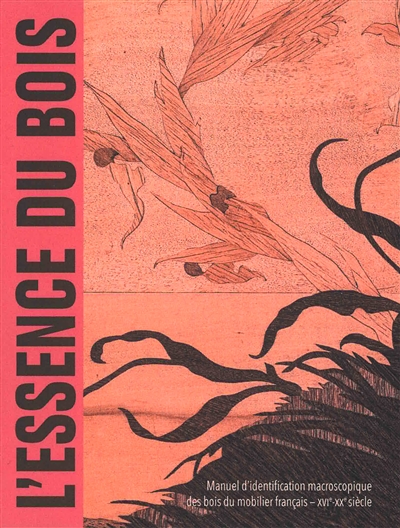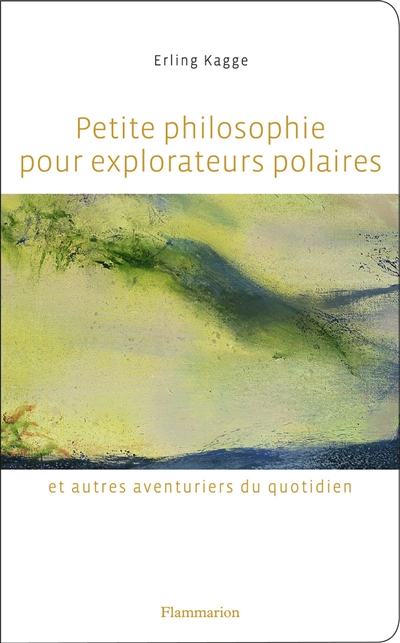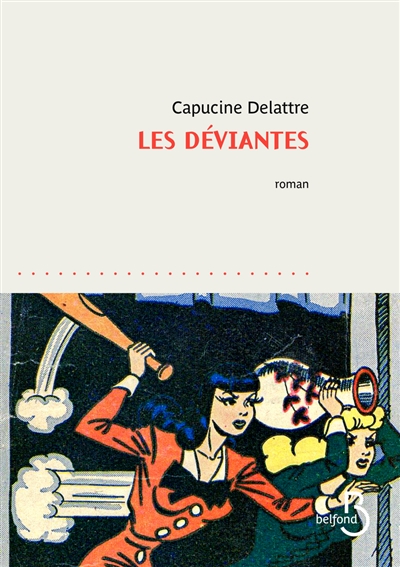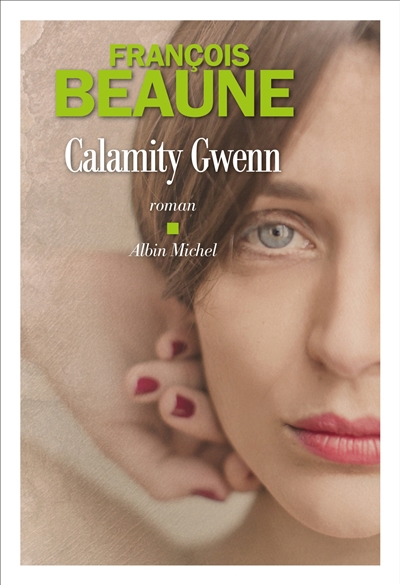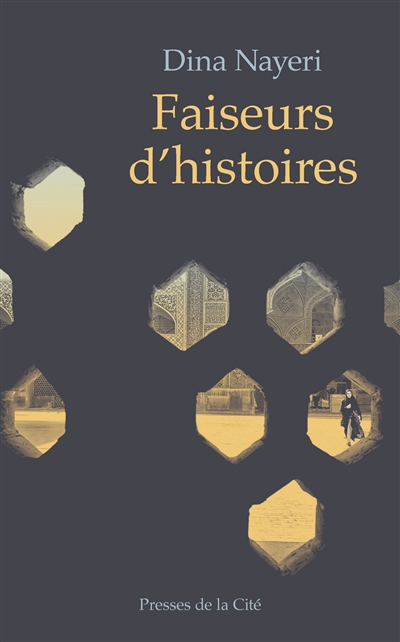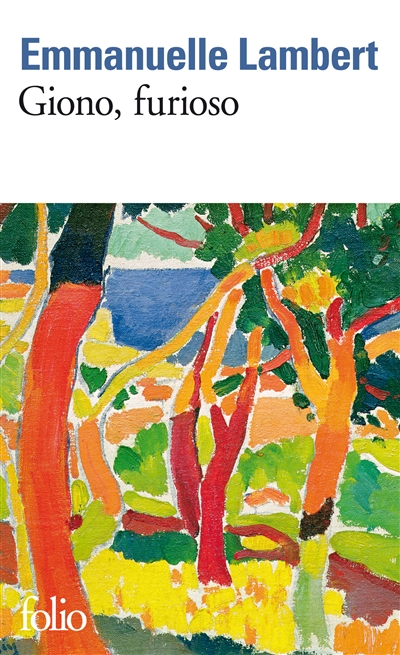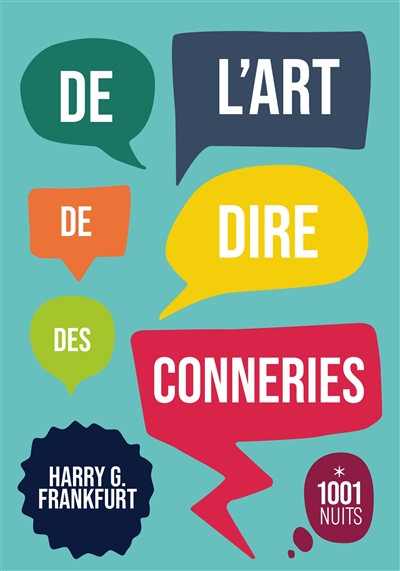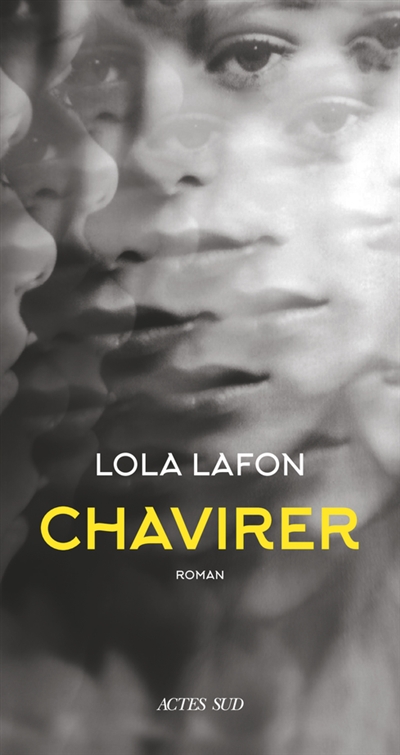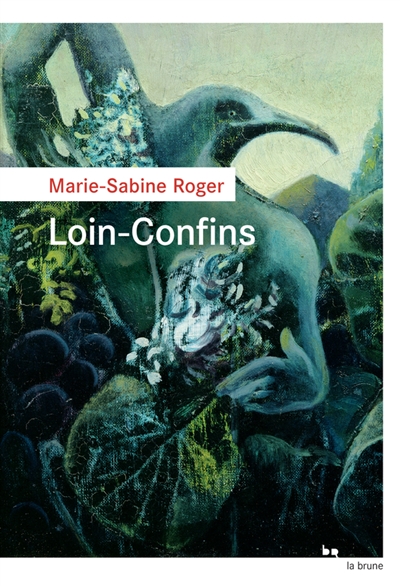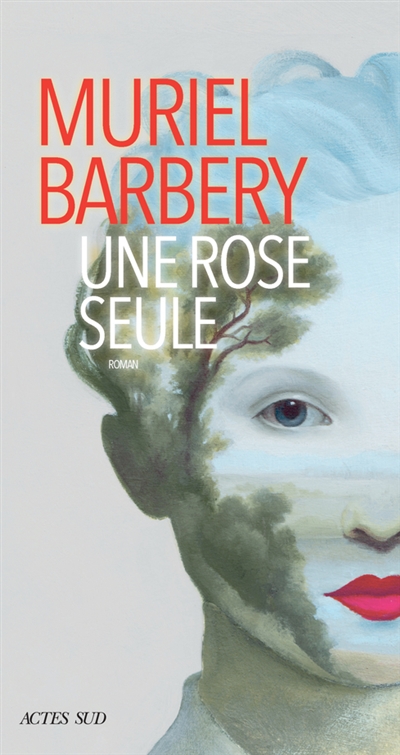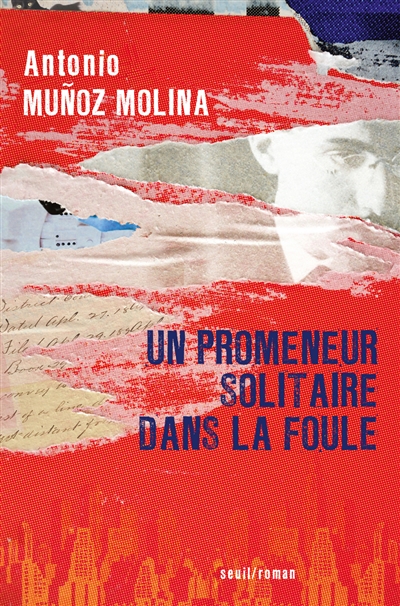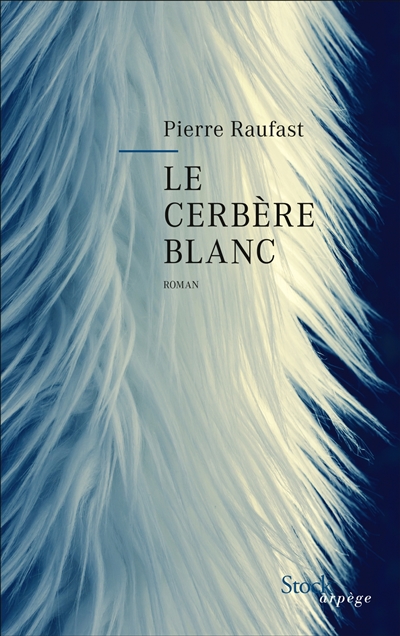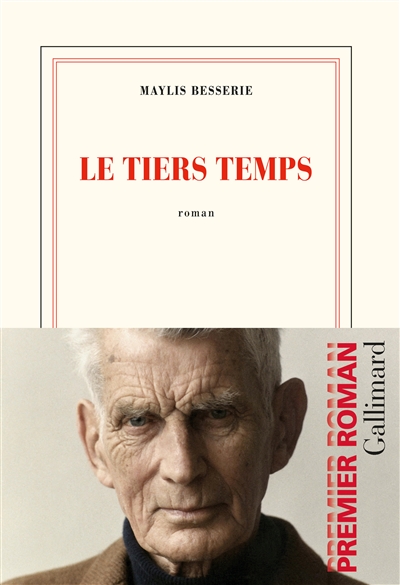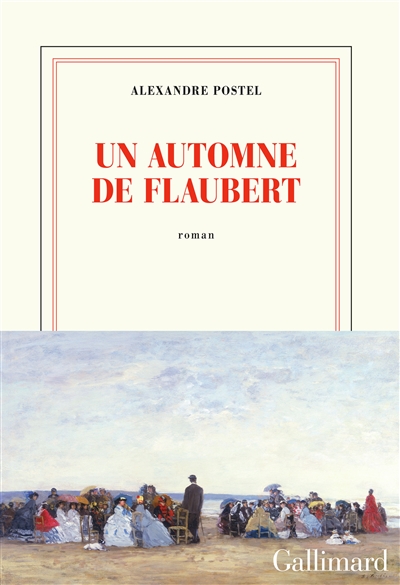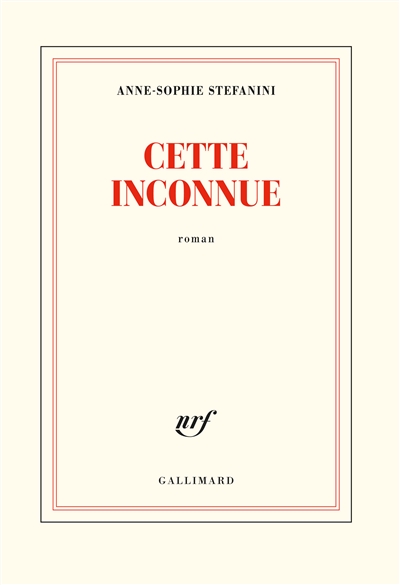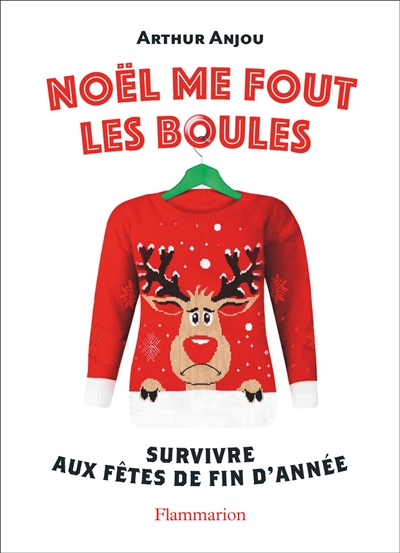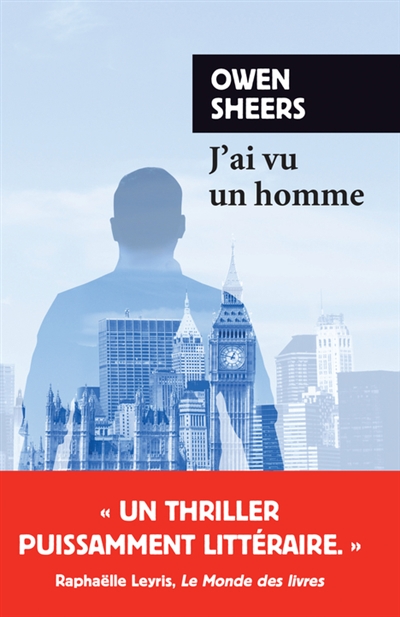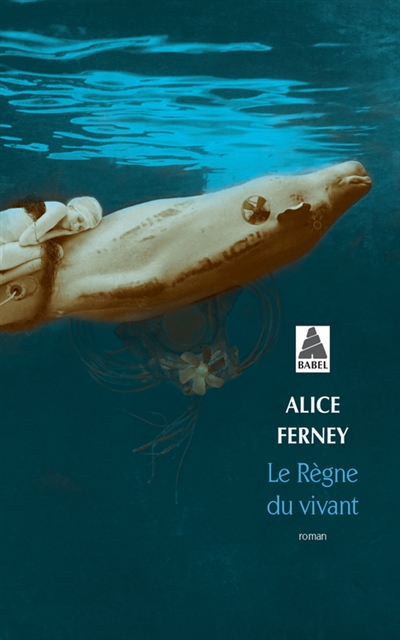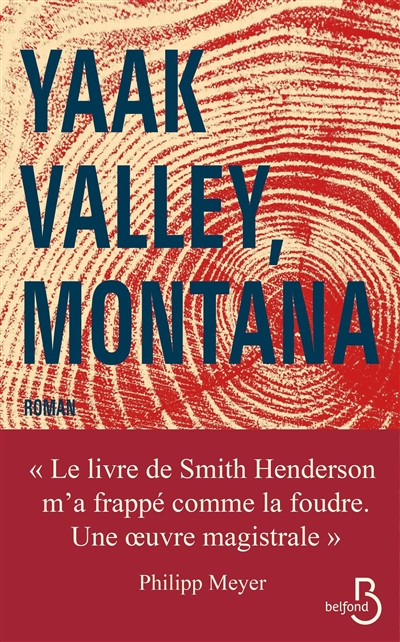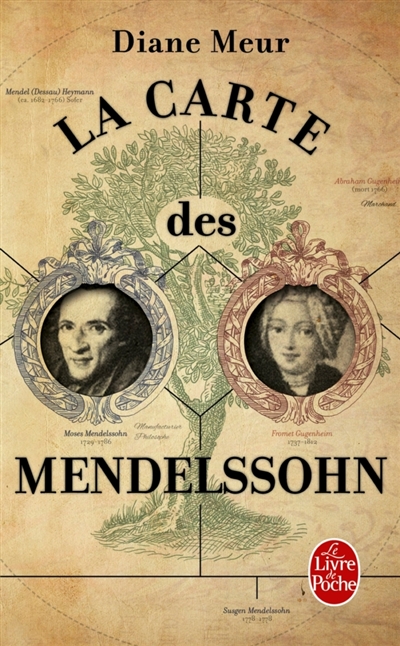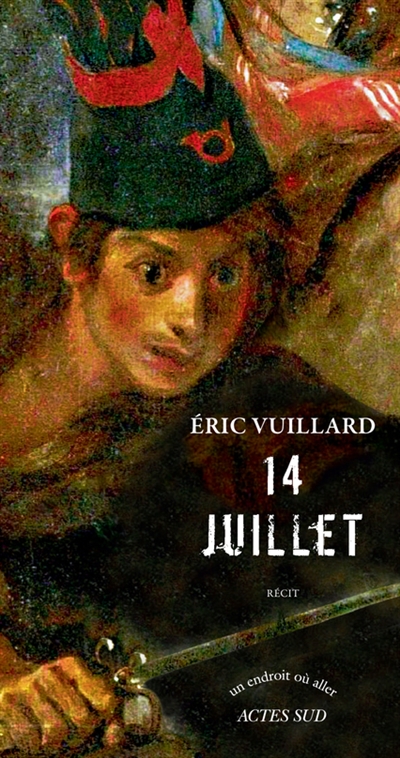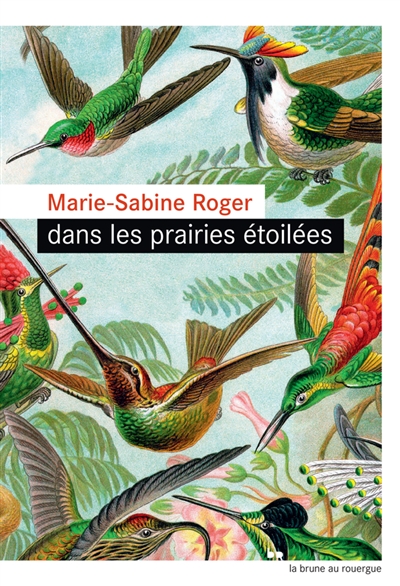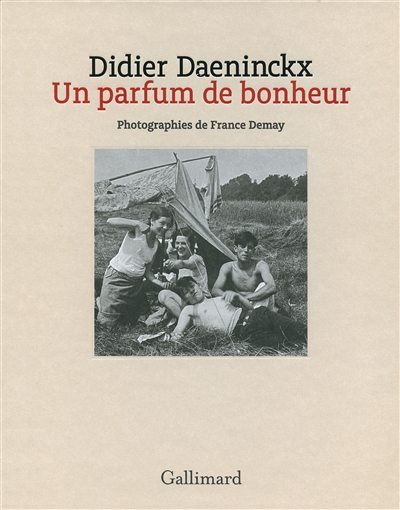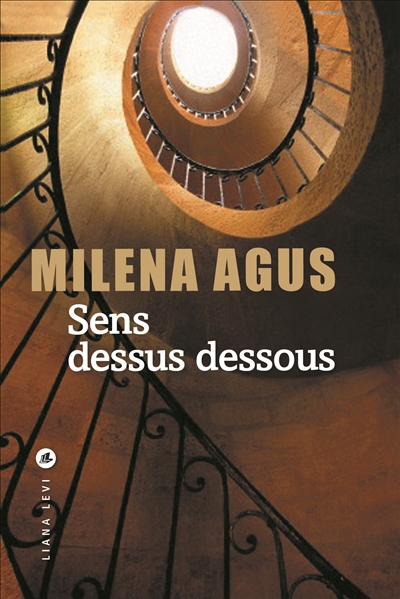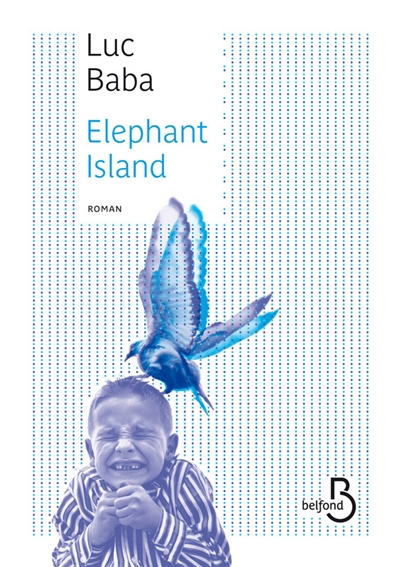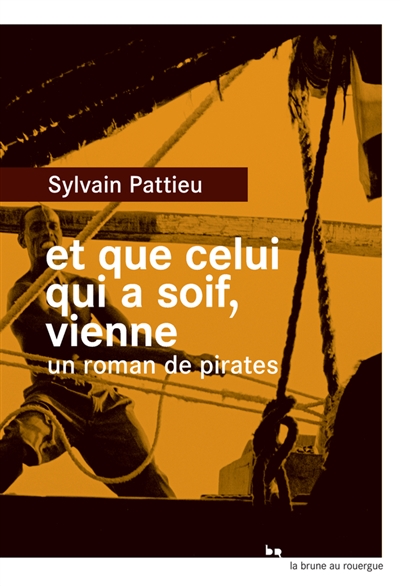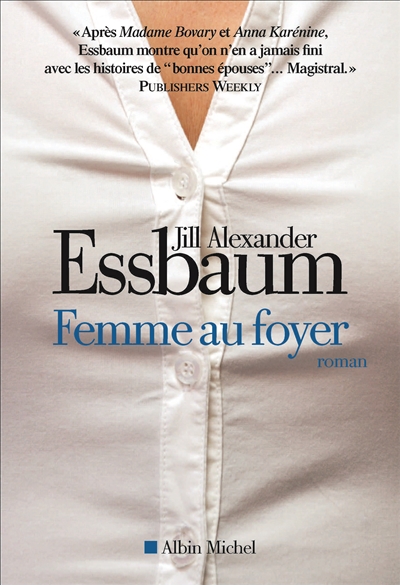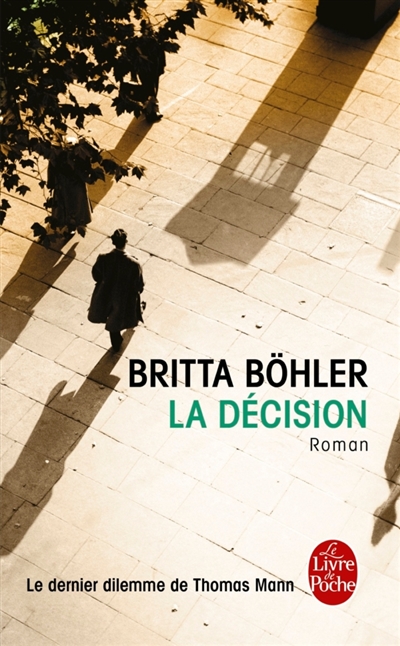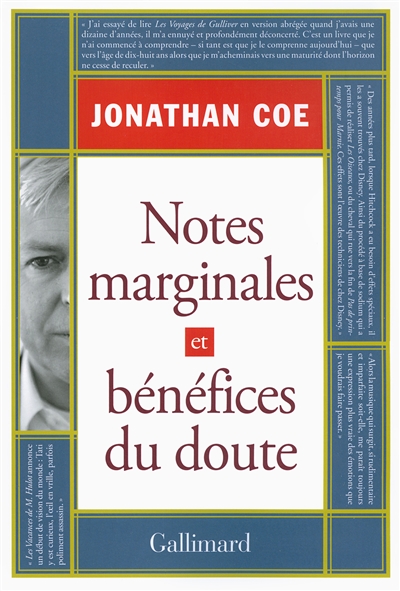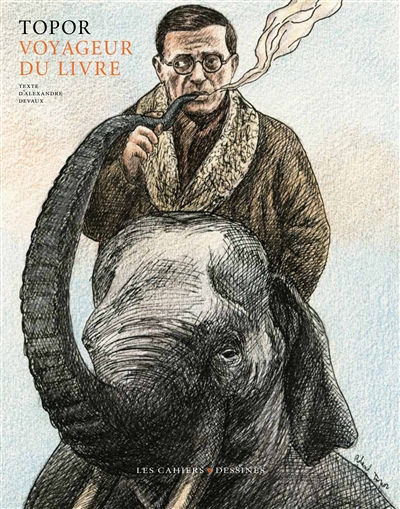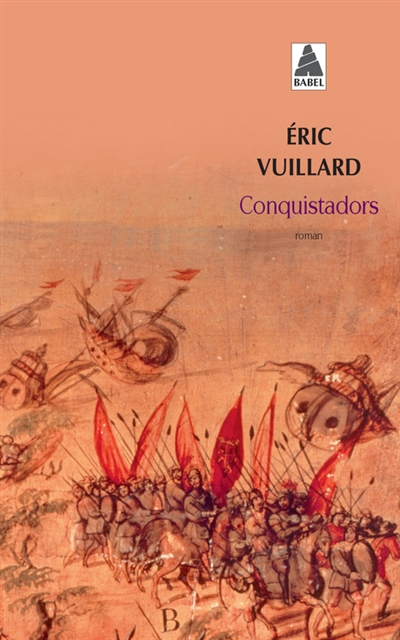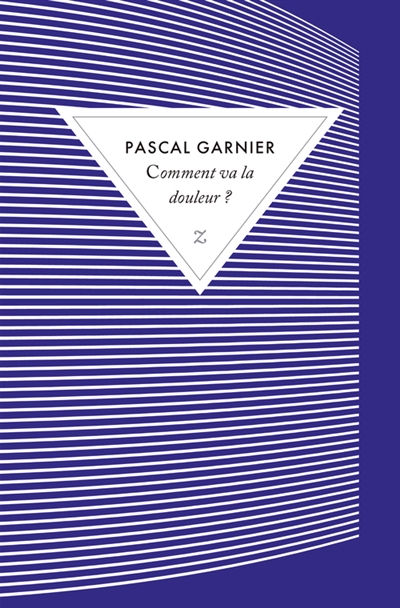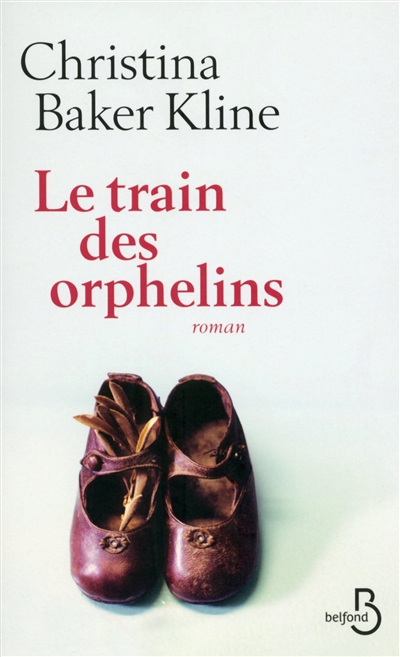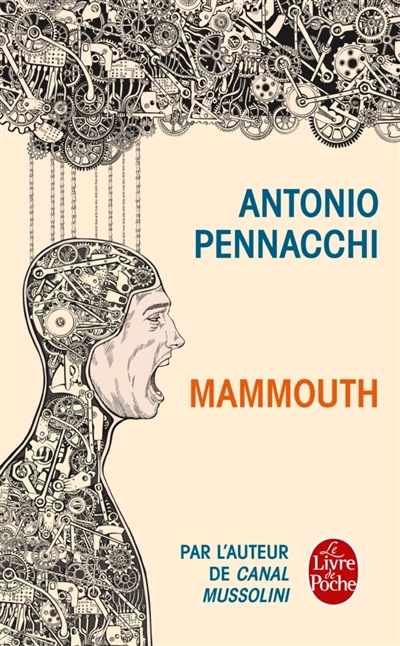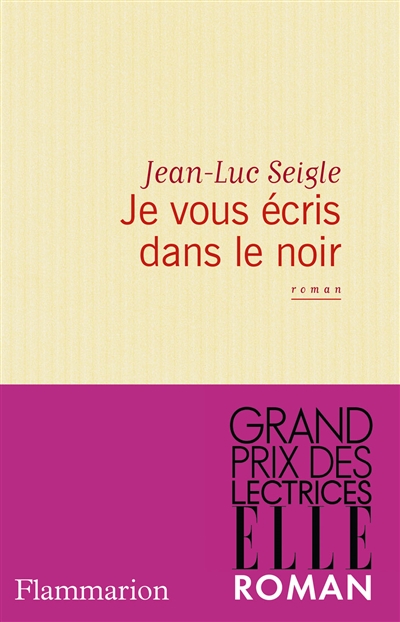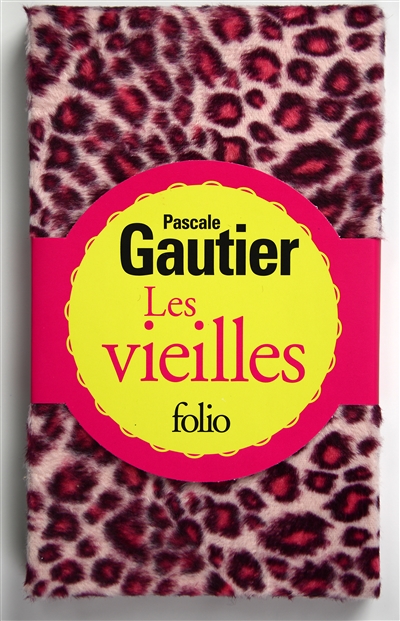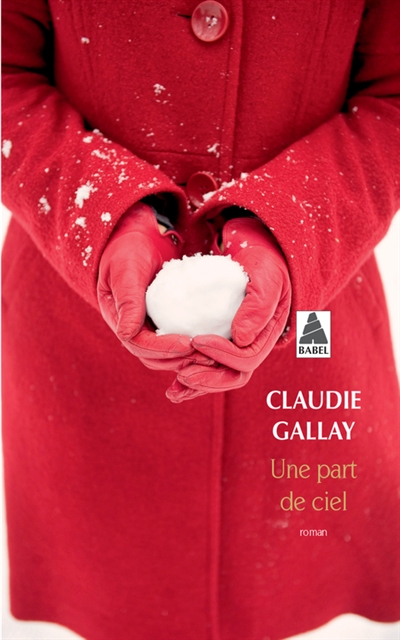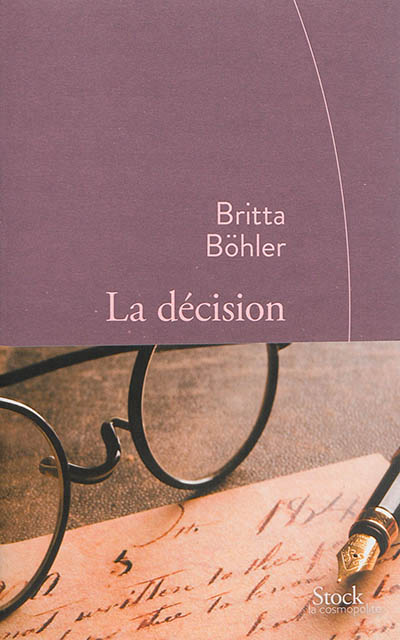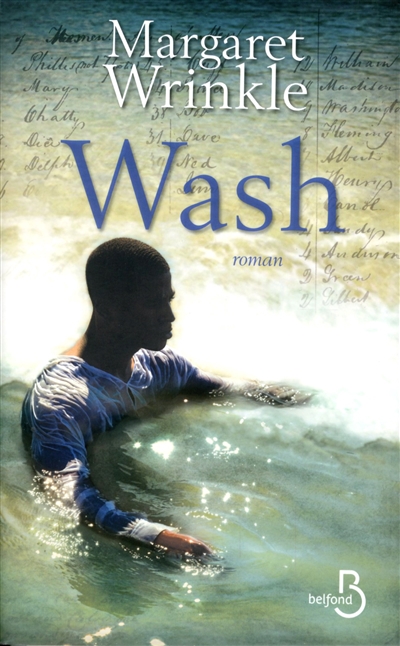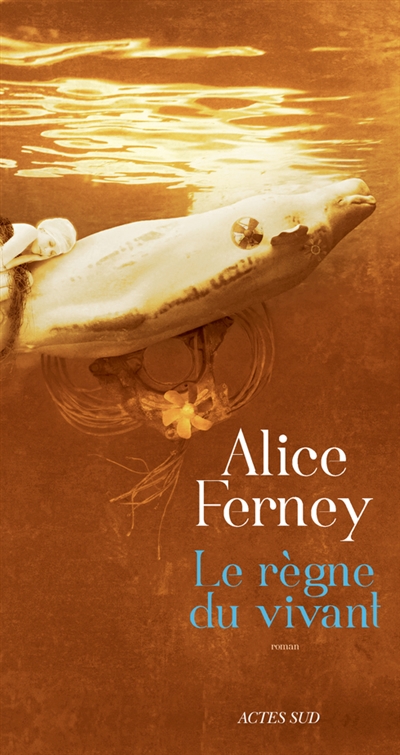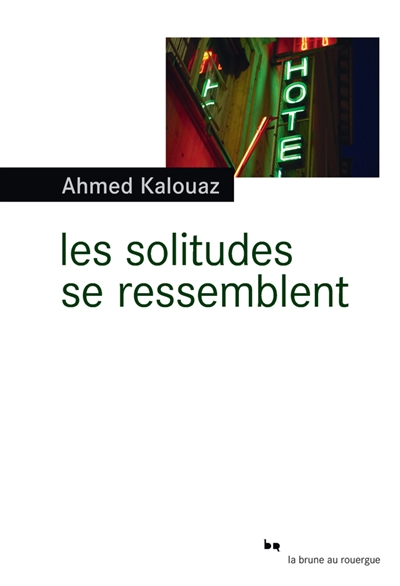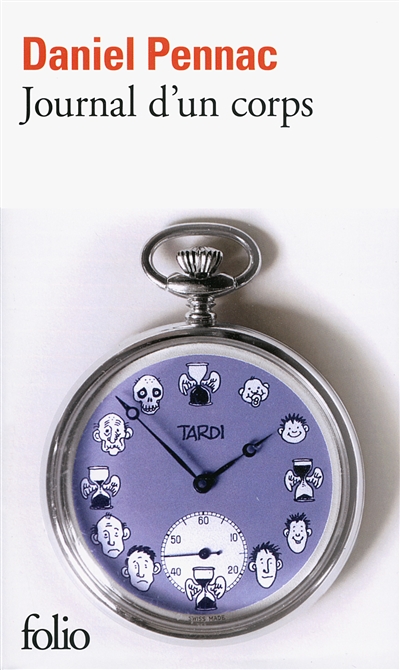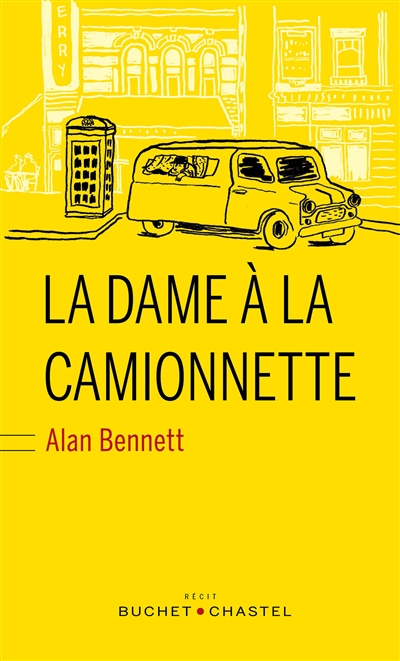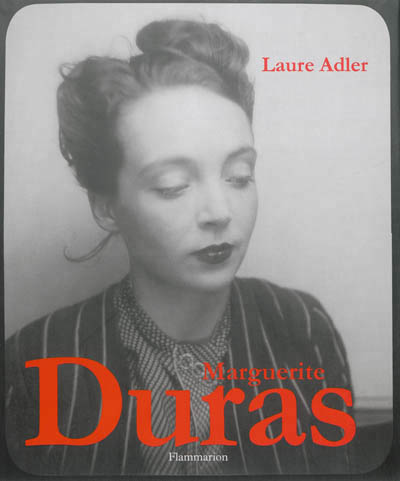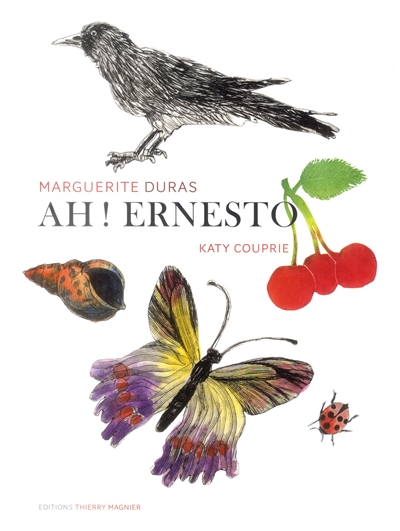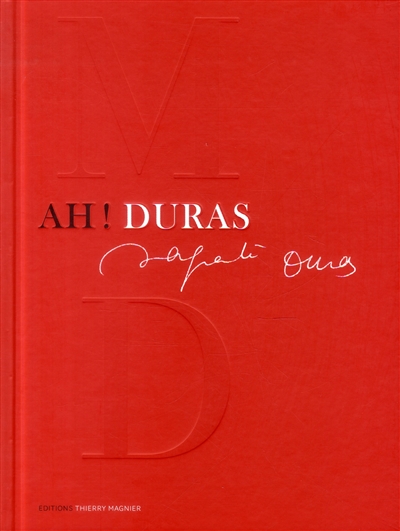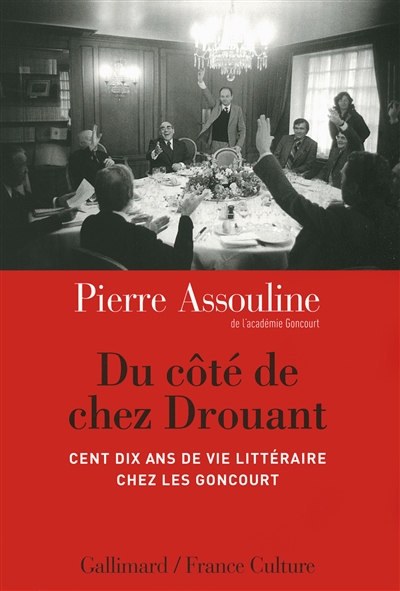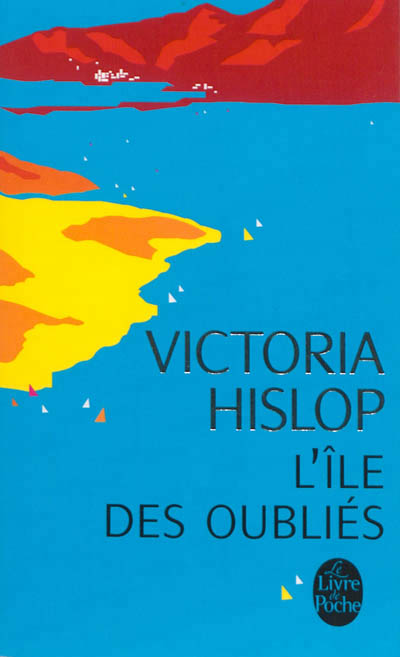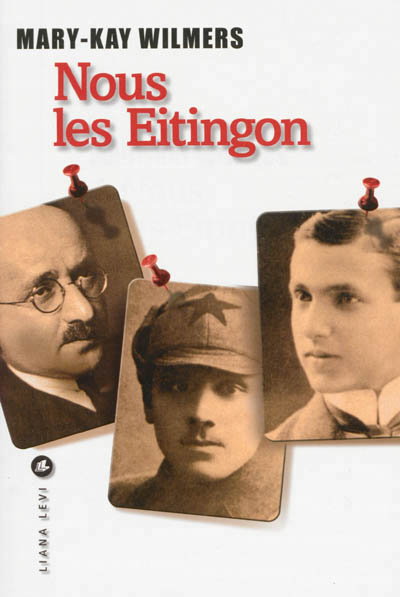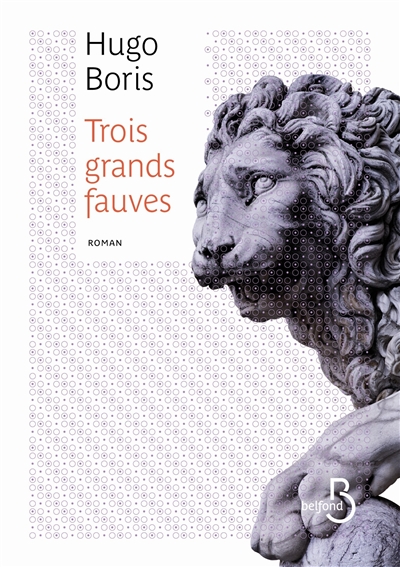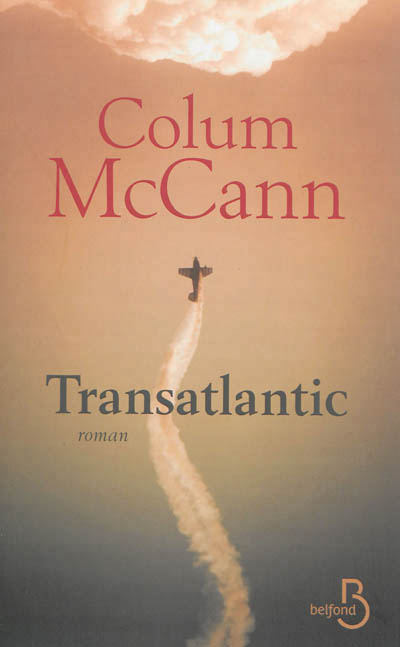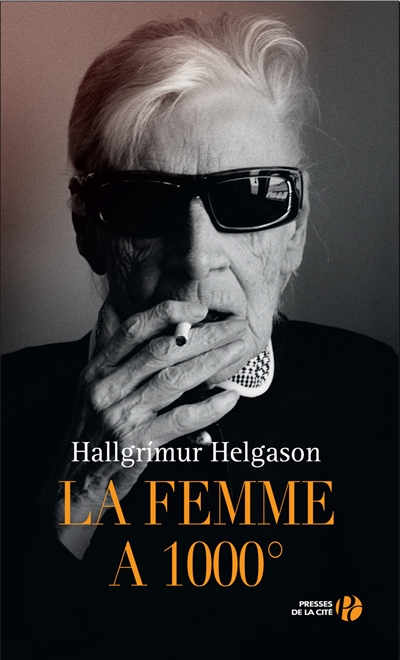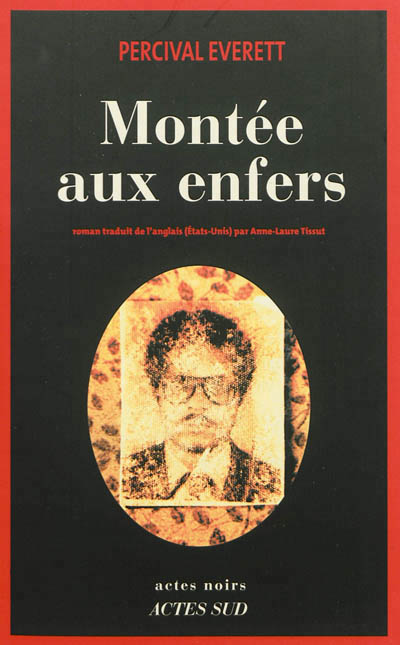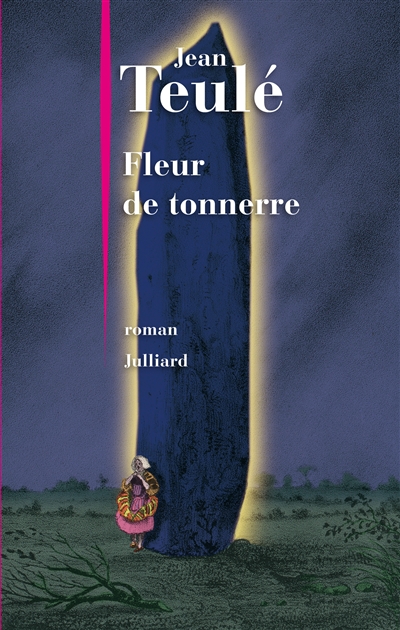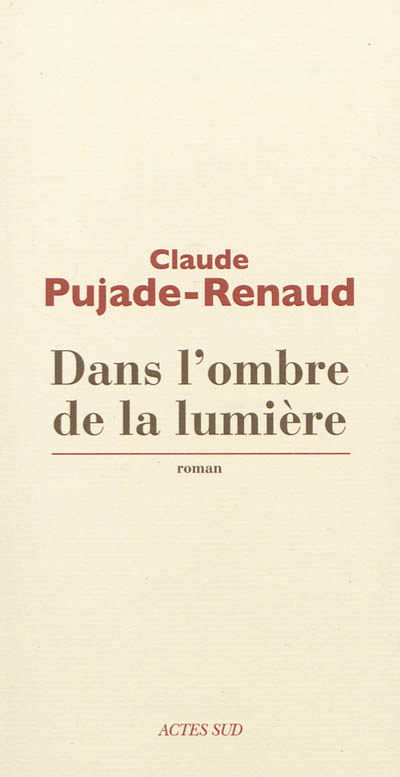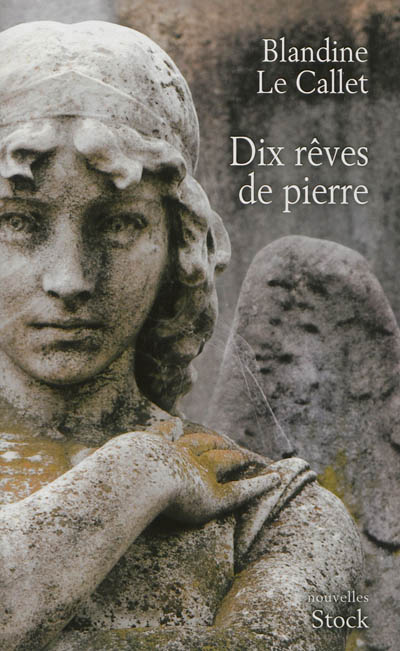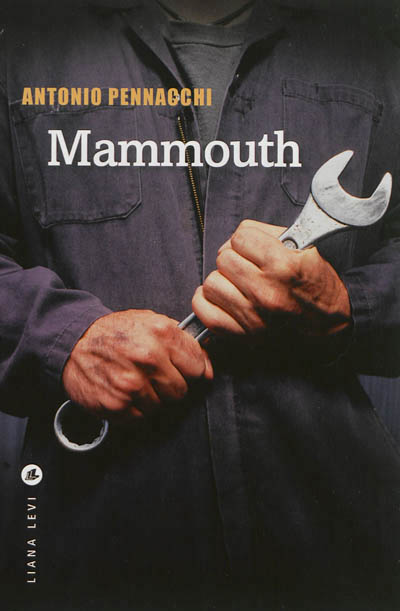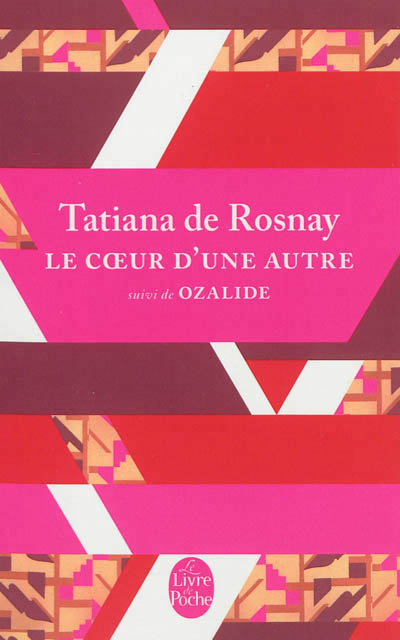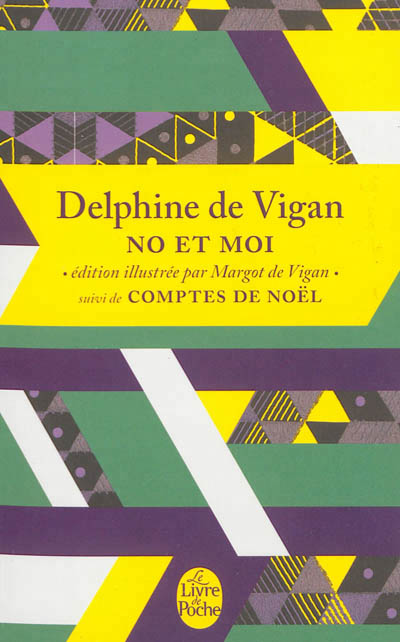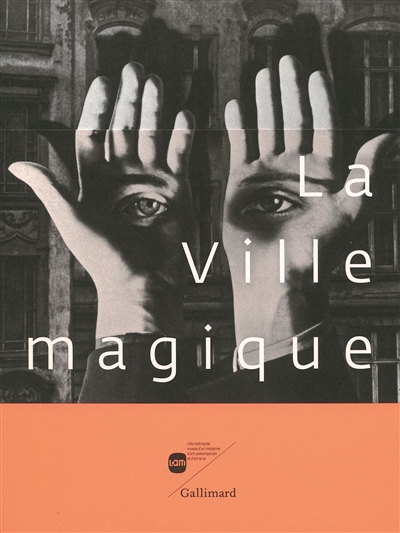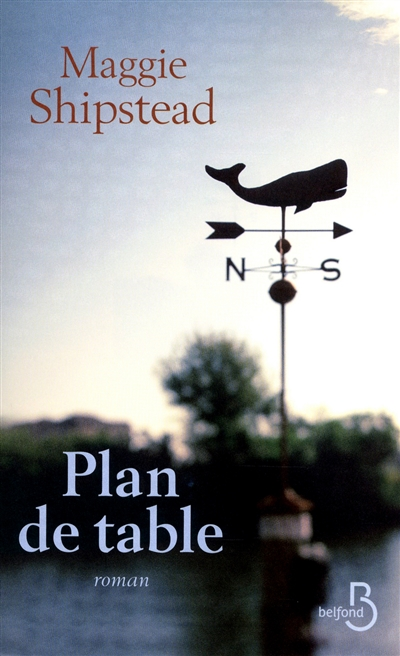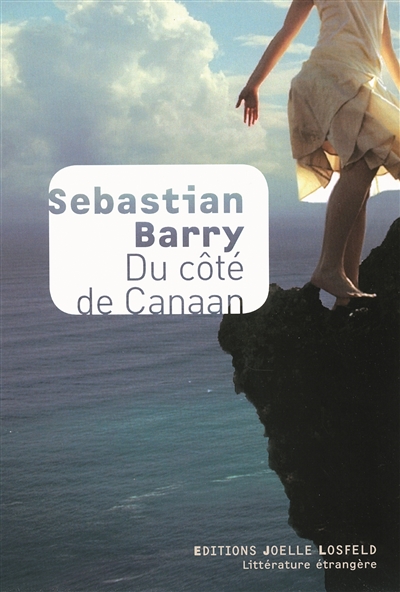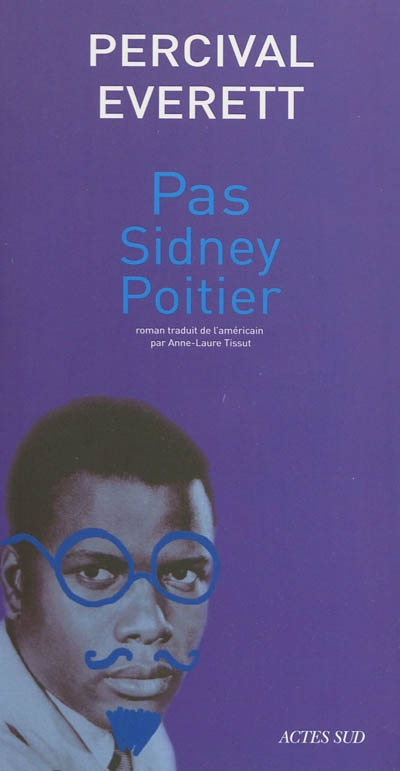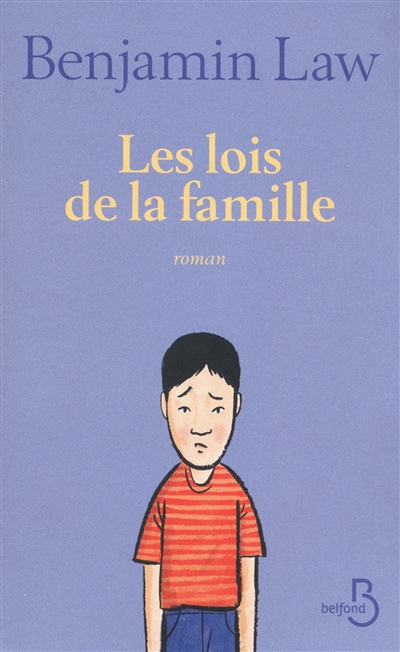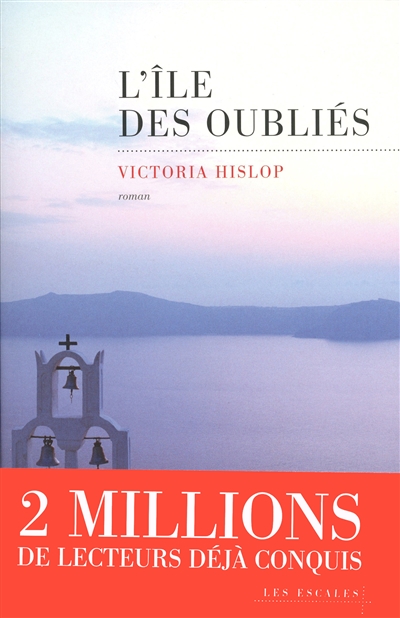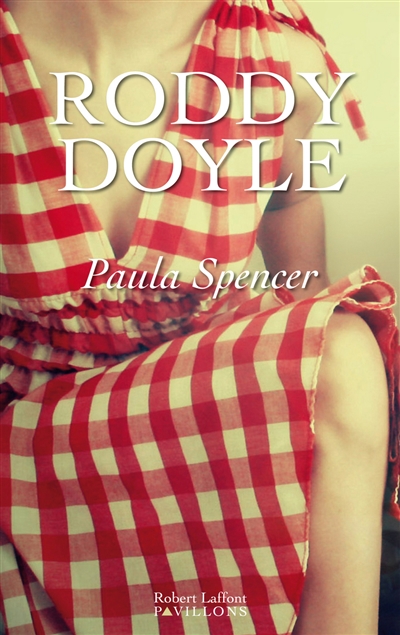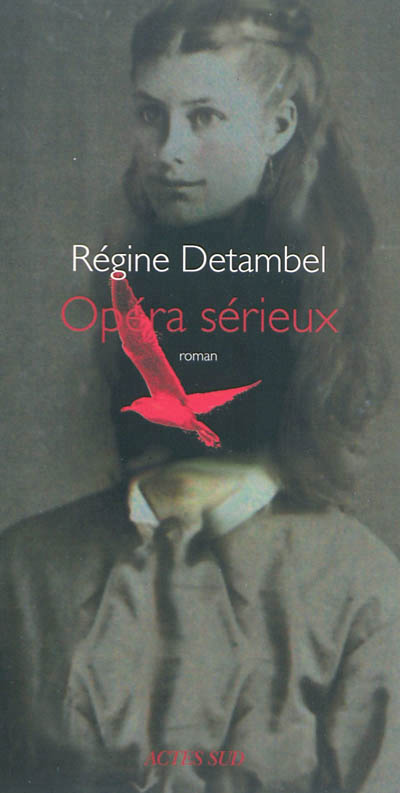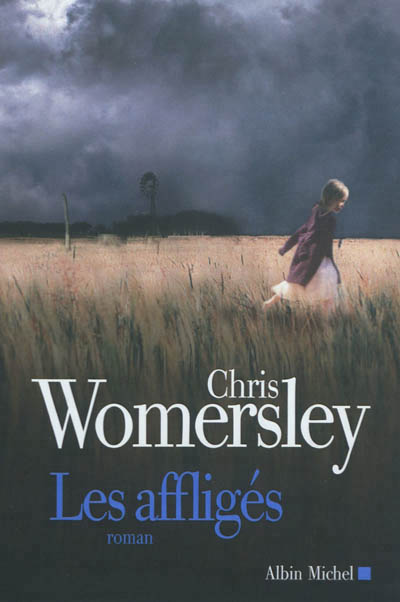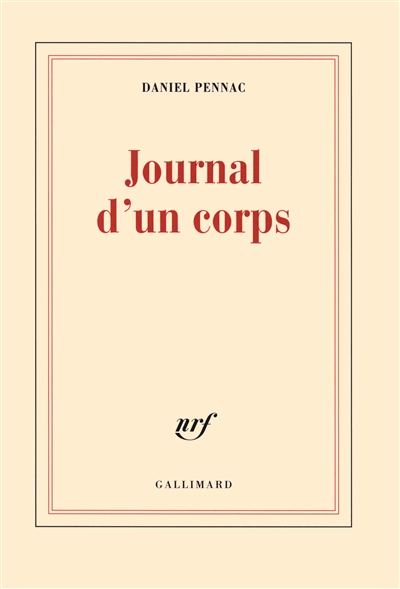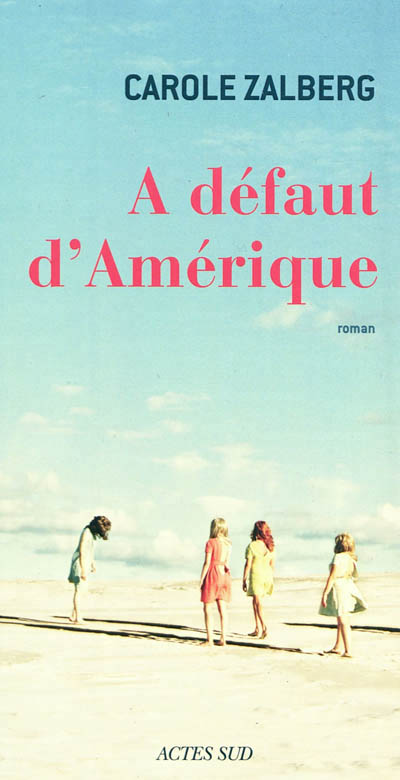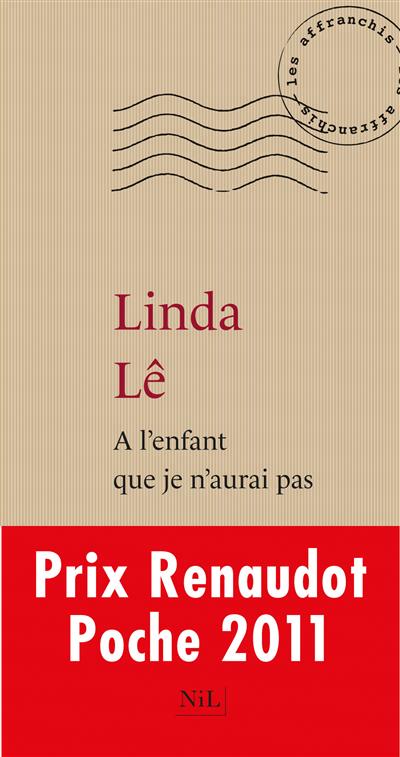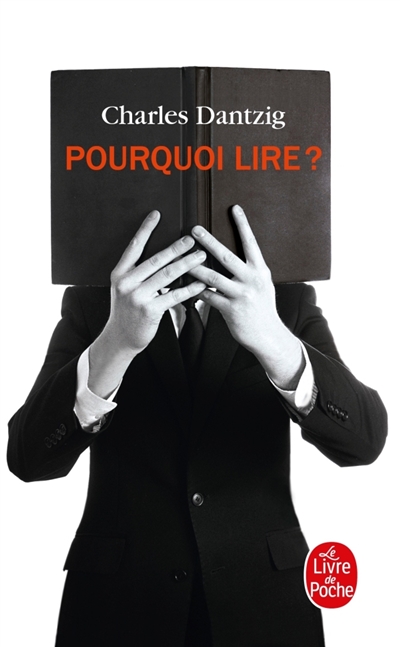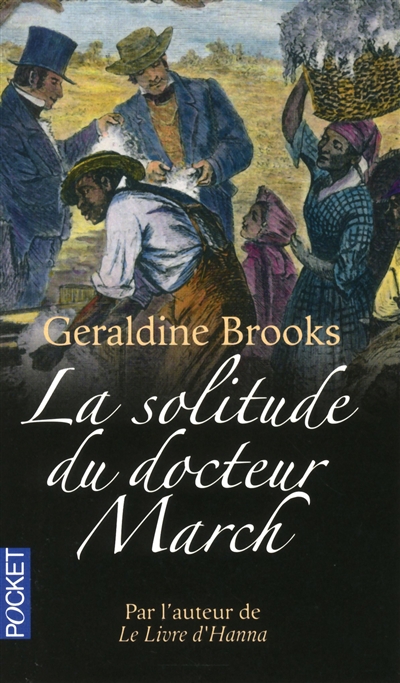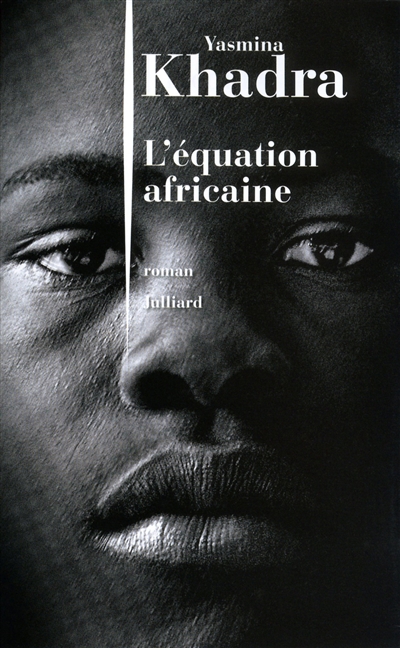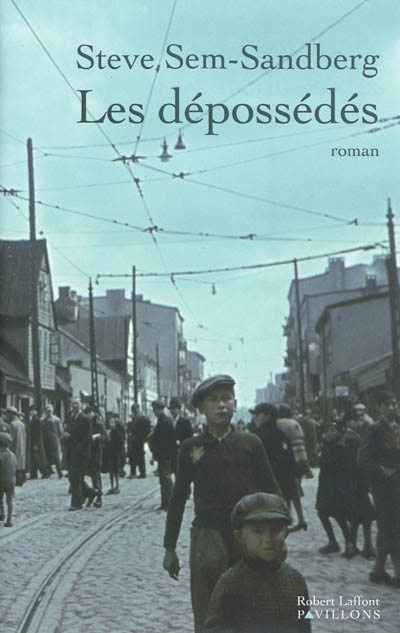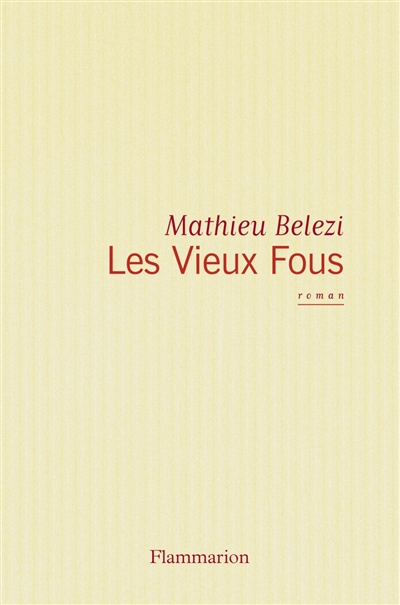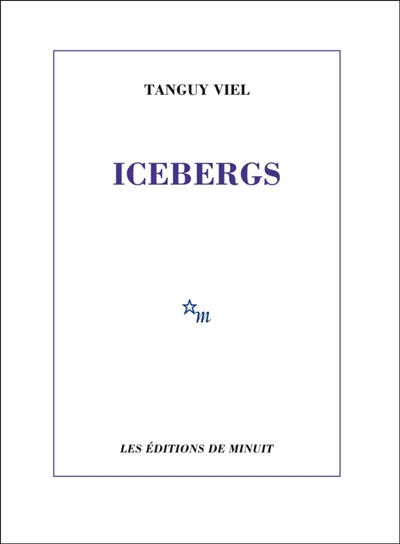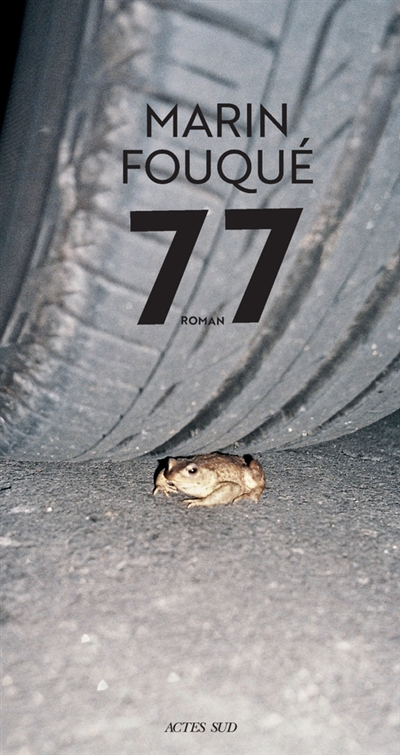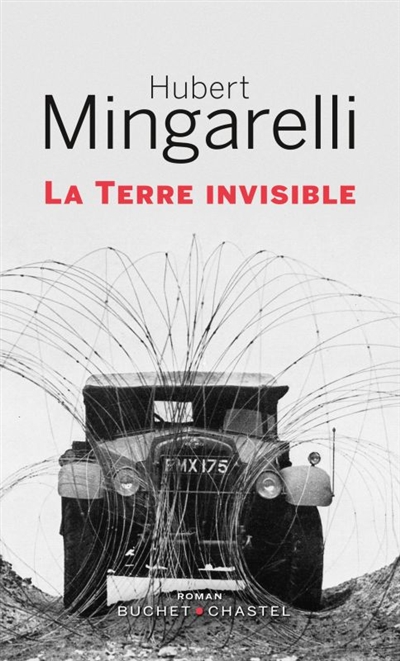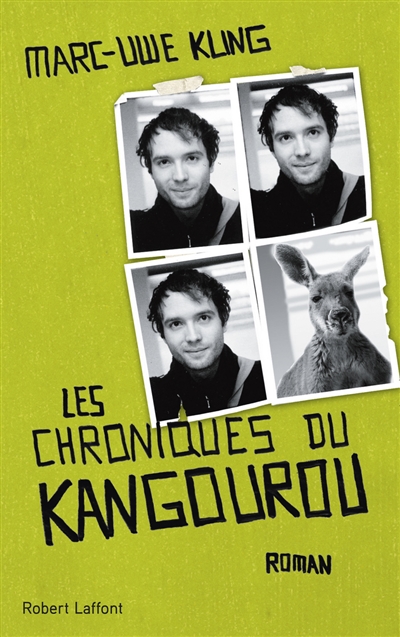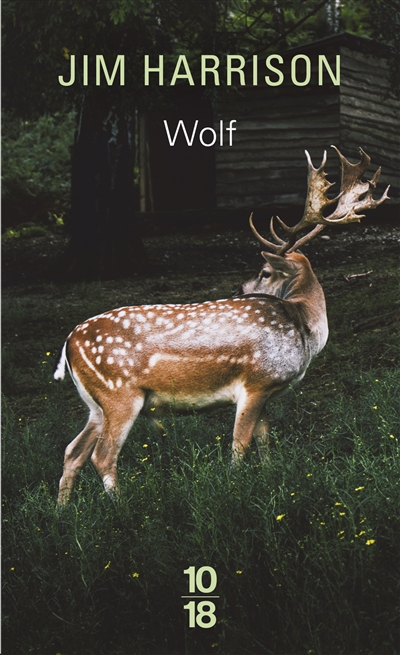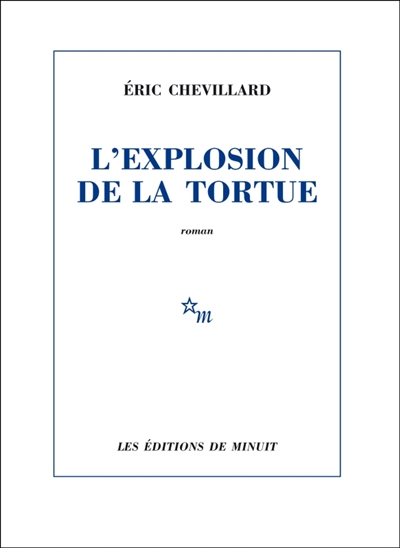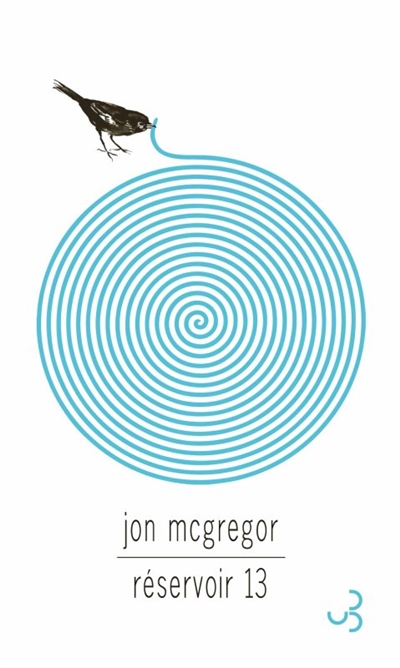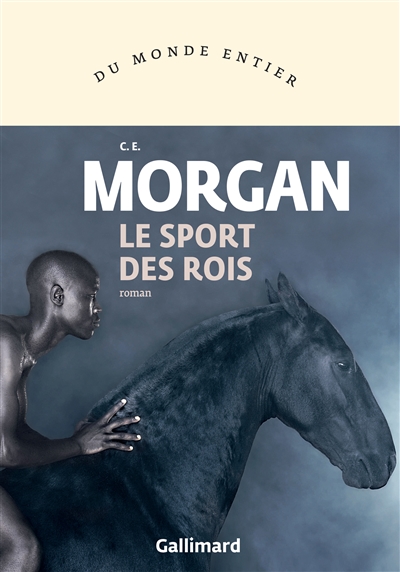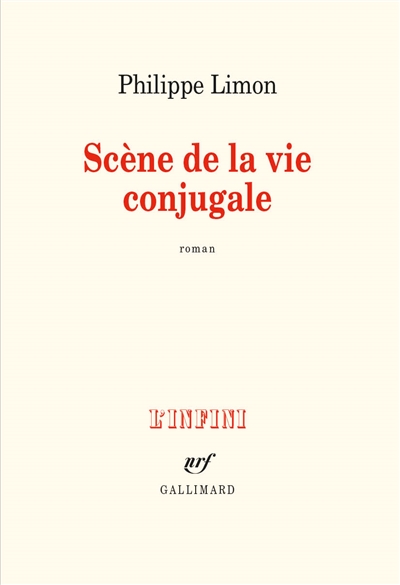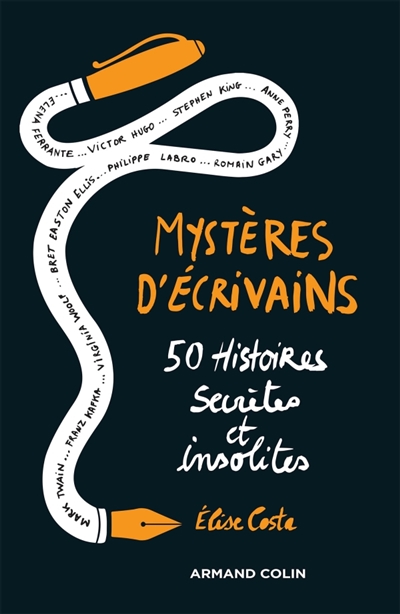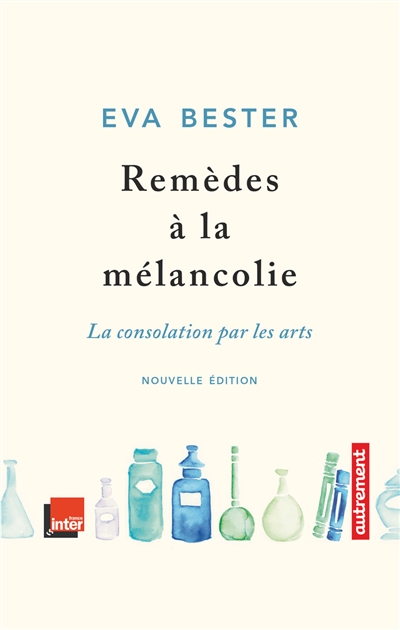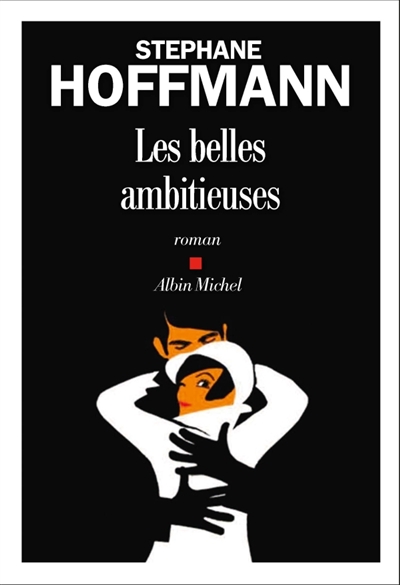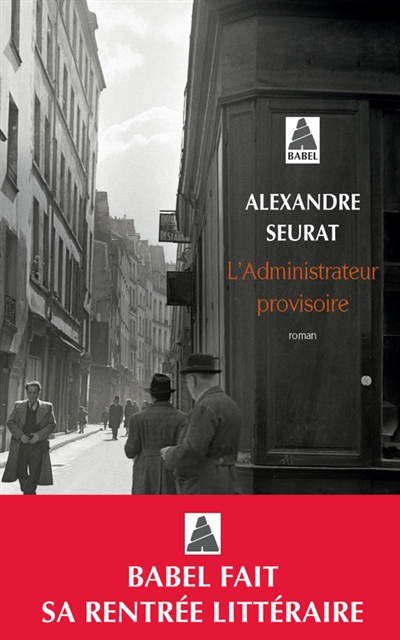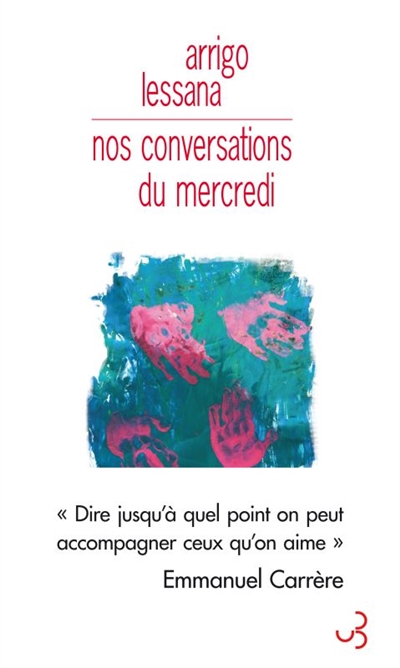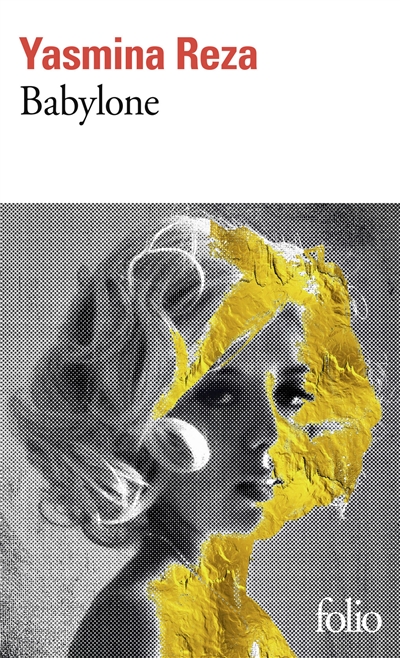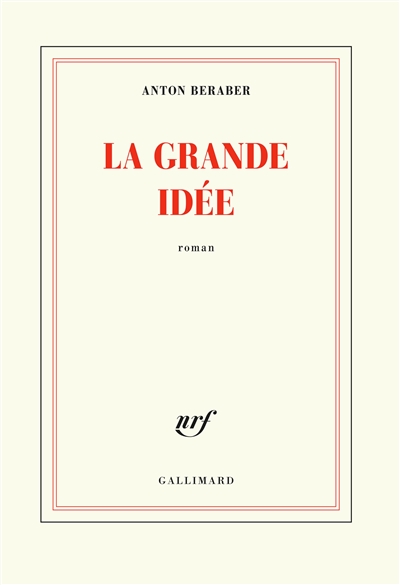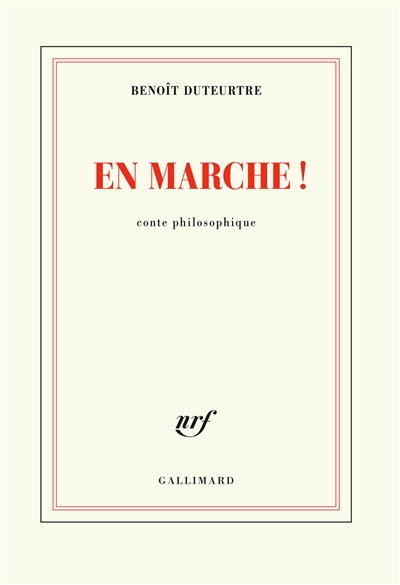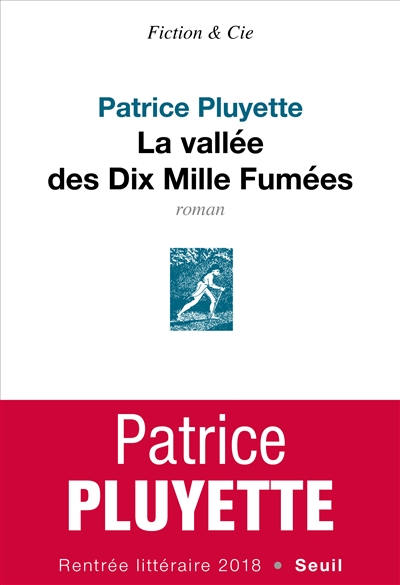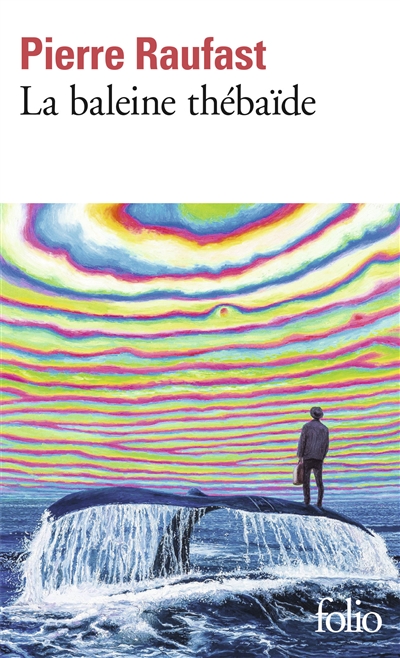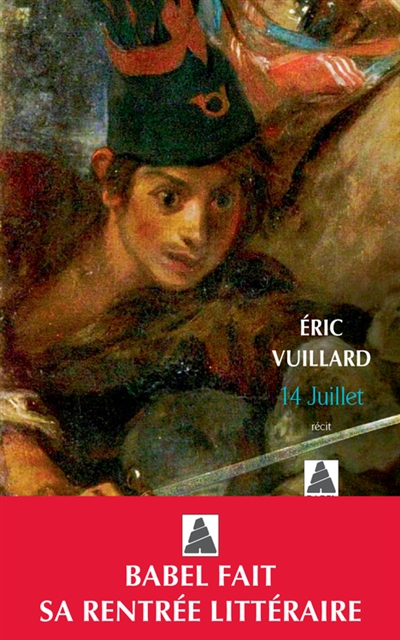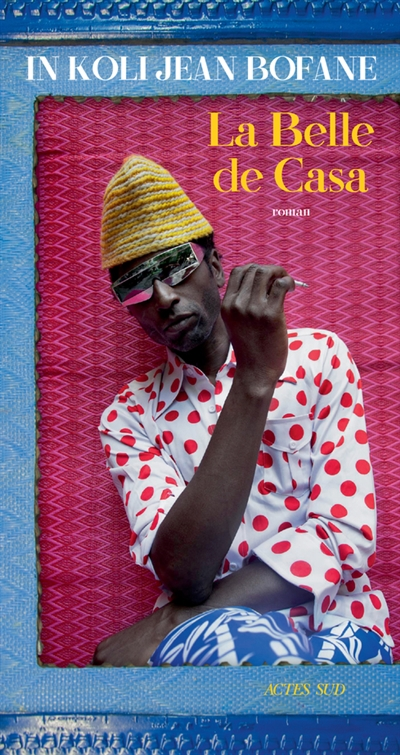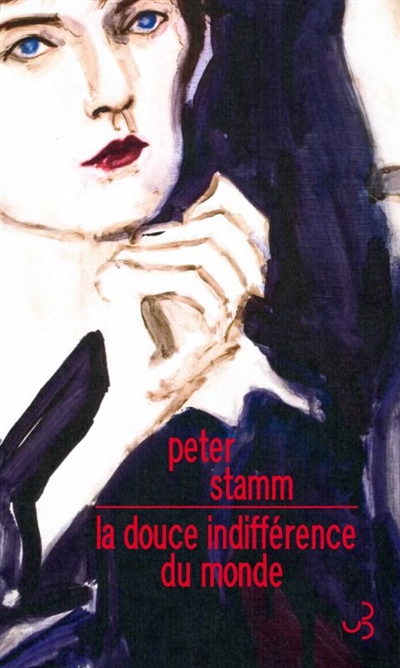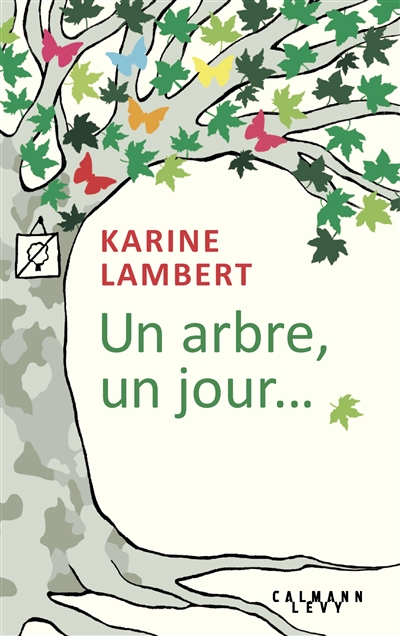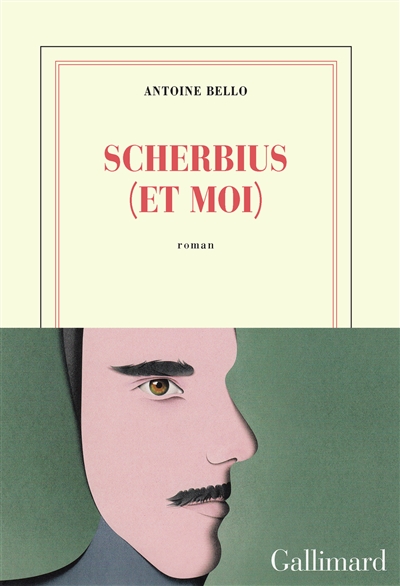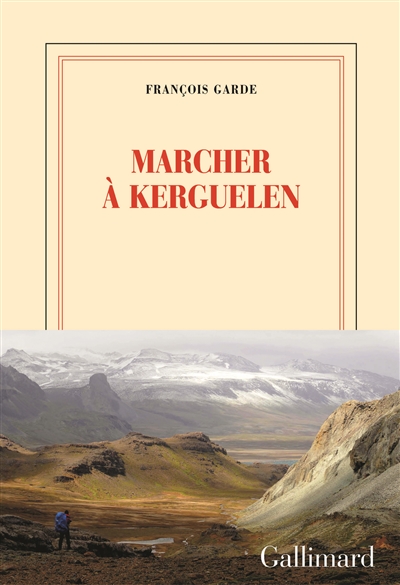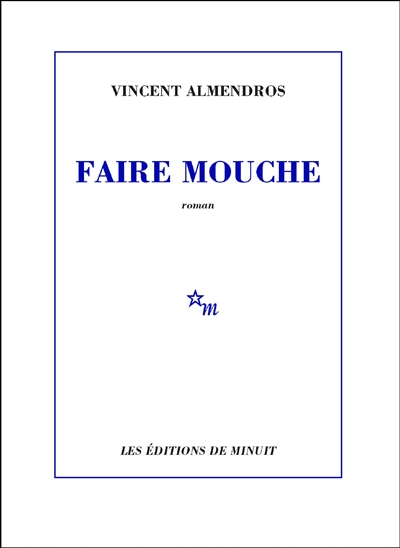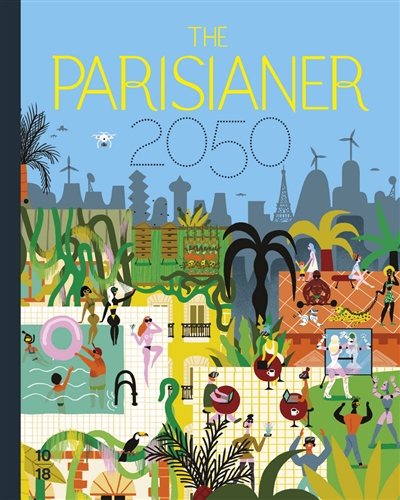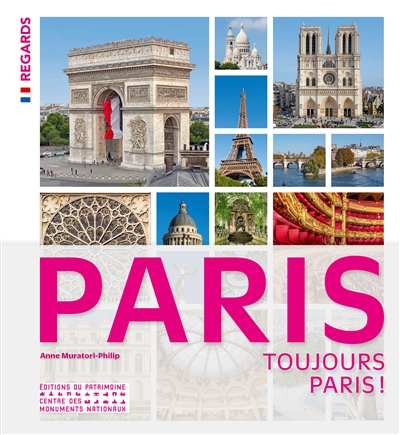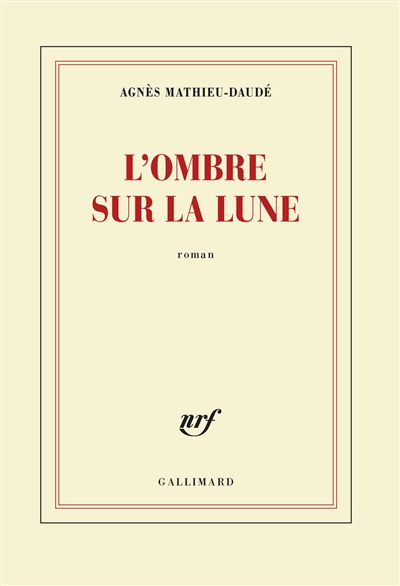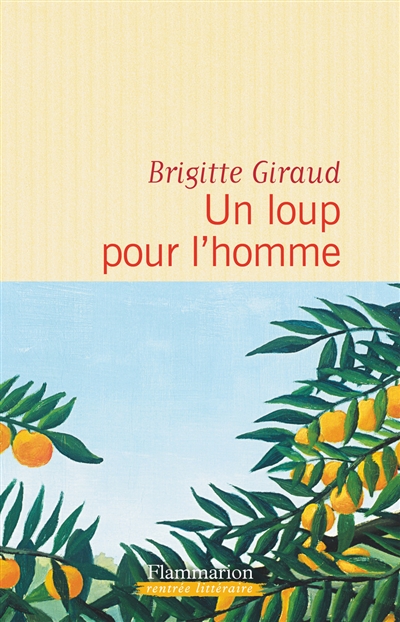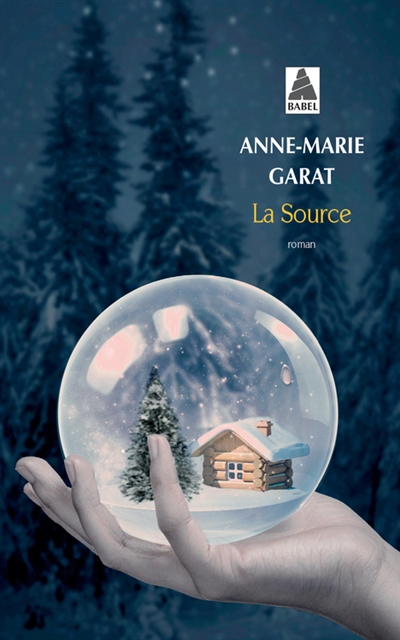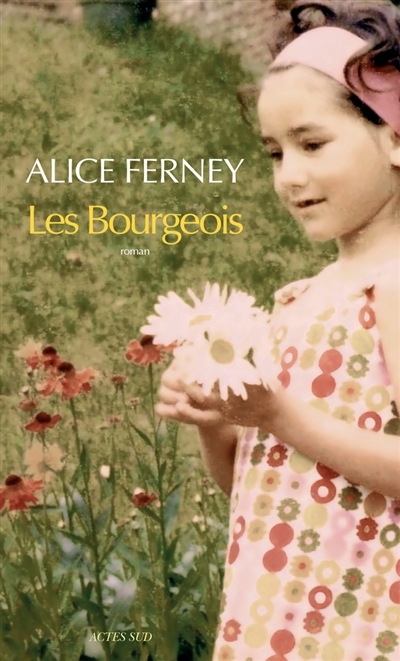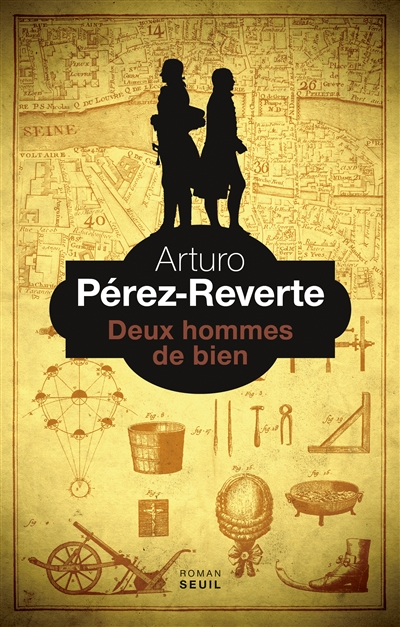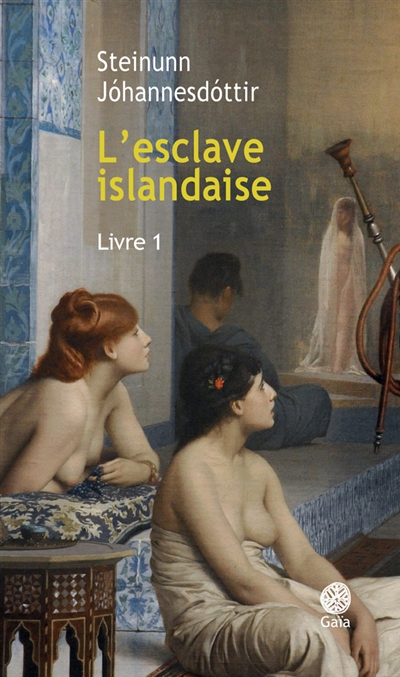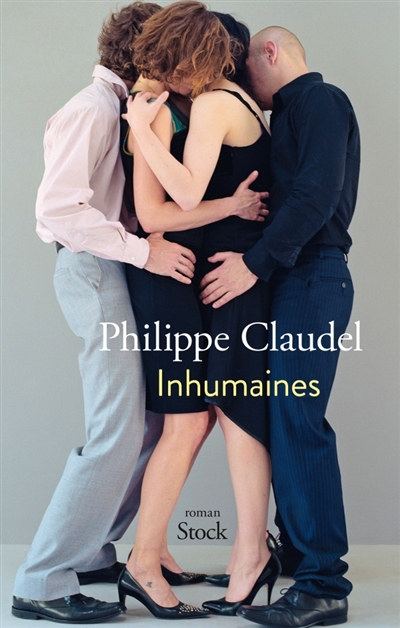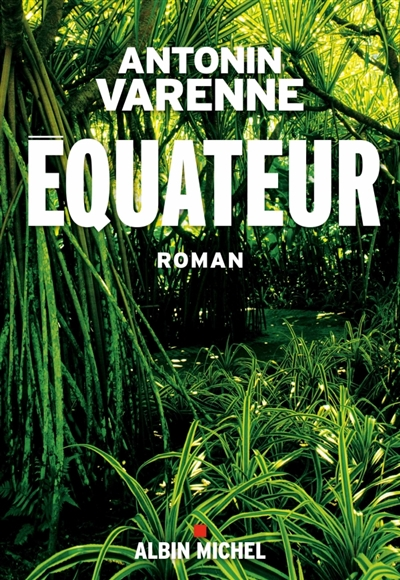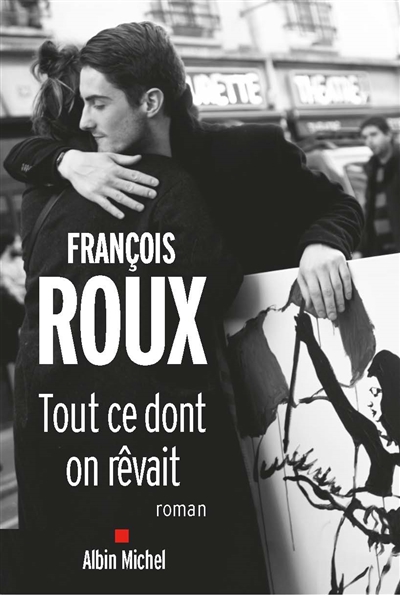Littérature étrangère
Regina Porter
Ce que l’on sème

-
Regina Porter
Ce que l’on sème
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laura Derajinski
Gallimard
22/08/2019
368 pages, 22 €
-
Chronique de
Emmanuelle George
Librairie Gwalarn (Lannion) - ❤ Lu et conseillé par 12 libraire(s)

✒ Emmanuelle George
(Librairie Gwalarn, Lannion)
Fabuleuse saga familiale, plongée dans les coulisses de l’Histoire des USA à partir des années 1950, le premier roman de Regina Porter est à la fois ambitieux et ludique dans sa construction et son propos. Elle signe un incontournable voyage littéraire, vif, parfois triste, souvent drôle, et terriblement addictif.
Comme on parcourt les albums de photos familiales avec curiosité et frénésie, comme on suit une série dans un état addictif assumé, on savoure chaque chapitre de ce premier roman avec exaltation. Voici une fresque familiale, amoureuse et historique, à la construction fragmentaire magistrale qui fonctionne comme une machine à explorer le temps et l'espace. Un voyage du milieu des années 1950 jusqu'aux débuts de la présidence d'Obama auprès de deux familles américaines dont les destins s'entrecroisent. Entre la Géorgie, New York, le Vietnam et l'Europe, on y suit un casting copieux de «°héros du quotidien°» : noirs, blancs, métisses, avocat, soldat, femme au foyer ou pilote, jeunes ou vieux, qu'importe, ces «°voyageurs°» sont liés par l'amour, l'amitié, l'humour et l'Histoire des USA. Imparfaits souvent, libres et heureux parfois. Vive, triste et drôle, cette saga intergénérationnelle de la vie américaine est captivante, inventive et mémorable.
PAGE — Votre roman raconte la vie de deux familles américaines à travers les continents et les générations. Qui sont les deux personnages qui se sont imposés en premier ?
Regina Porter — Tout d’abord James Samuel Vincent, le patriarche d’une famille irlando-américaine du Nord, puis Agnès Miller Christie, la matriarche d’une famille noire américaine du Sud. Tous deux s’émancipent d’un milieu modeste et veulent le meilleur pour leurs familles. Leurs vies se croisent quand leurs enfants se marient. Je crois bien que nous ne voyons jamais Agnès et James Samuel dans une même scène car l’histoire que je raconte n’est pas linéaire. Elle s’étend à travers le temps avec des sauts entre les époques, mais il y a un fil conducteur : tous les personnages sont liés et se croisent tout au long du roman. Je voulais que cette histoire soit comme la vie, imprévisible !
P. — Eloise, un de vos personnages féminins principaux et grande amie d’Agnès, est étonnante. Qui est-elle ?
R. P. — Je pense qu’Agnès et Eloise sont toutes les deux des personnages attachants parce qu’ils sont très différents. L’idée des héros du quotidien m’intrigue et je pense qu’ils peuvent être imparfaits. Je pense même qu’ils devraient être imparfaits. Eloise est une lesbienne sans complexes. Je voulais qu’elle sache qui elle était dès son plus jeune âge en dépit des conventions sociales. Je voulais aussi montrer, avec le personnage d’Agnès, à quel point la sexualité est fluctuante et à quel point nous sommes parfois enclins au déni comme au besoin d’épanouissement. Le fait qu’Agnès se lève tous les jours et aille travailler, élève ses enfants et aime son mari et d’autres, de manière si subtile, est important pour moi. Je ne l’ai pas pensée comme une victime, une rescapée au risque du cliché. C’est une femme magistrale pour se réinventer et tenir bon.
P. — Les références au théâtre sont fréquentes dans votre roman, pourquoi ?
R. P. — J’ai étudié l’écriture dramaturgique à New York et j’ai travaillé pour le théâtre et la télévision. Quand j’ai vu la pièce de Tom Stoppard, Arcadia, j’ai eu le coup de foudre. Il y a tant de richesses, de subtilités dans ce texte ! Je me suis dit : « un jour, je veux écrire une pièce ou un roman comme ça ! » Une autre de ses pièces, Rosencrantz et Guildenstern sont morts, m’a aussi beaucoup interpellée. Je ne sais pas pourquoi. L’humour peut-être. C’est donc tout naturellement que j’ai fait en sorte qu’un des personnages, Eddie Christie, le mari d’Agnès, ancien combattant dans la Navy, soit un passionné de théâtre, notamment de cette pièce.
P. — Les chapitres de votre roman, certains passages aussi, sont introduits, présentés ou illustrés par des photographies et des dessins. Pourquoi ?
R. P. — Deux raisons. Primo, très franchement, je dois beaucoup à W. G. Sebald dont j’ai lu et étudié plusieurs œuvres dans la classe de Paul Harding. Secundo, je me souviens que j’achetais des bandes dessinées pour motiver ma fille cadette à la lecture quand elle n’accrochait pas, au début. Elle est désormais une excellente lectrice et une grande fan de mangas. Je pense que la combinaison entre la démarche de Sebald et l’amour de ma fille pour les BD et les romans graphiques m’ont fait réfléchir à la façon dont des images et un texte entrent en conversation. Dans l’œuvre de Sebald, les photos, ce sont des regards en arrière, des souvenirs. Dans mon roman, c’est une façon de faire le lien avec l’Histoire, une question qui me fascine. Les photos sont aussi un outil émotionnel important pour inviter le lecteur à s’arrêter. Elles ajoutent des pauses dans le roman et invitent à la réflexion sur la trace, c’est-à-dire ce qu’il reste de l’Histoire et sur ce qu’on laisse derrière soi.
P. — Il y a aussi beaucoup d’amour et d’humour dans votre roman, quel bonheur !
R. P. — Il y a beaucoup d’amour et d’humour dans la vie, mais parfois nous l’oublions. Ce monde n’est pas facile. Ce roman, je pense, a l’étoffe des contes de fées et des contes populaires. Une des questions qu’il pose est de savoir : comment pouvons-nous trouver notre voie, avancer, manœuvrer notre barque dans un monde à risques ? Je n’ai pas de réponses faciles pas plus que mes personnages. Mais ce que j’ai, ce sont des amis, partout dans le monde. Des amis qui étaient partis de chez eux et puis sont rentrés. Nous nous sommes rencontrés tels des voyageurs à New York et sommes devenus des amis, des membres d’une même famille parce que les liens qui nous unissent sont en fin de compte plus solides que ceux qui se brisent.