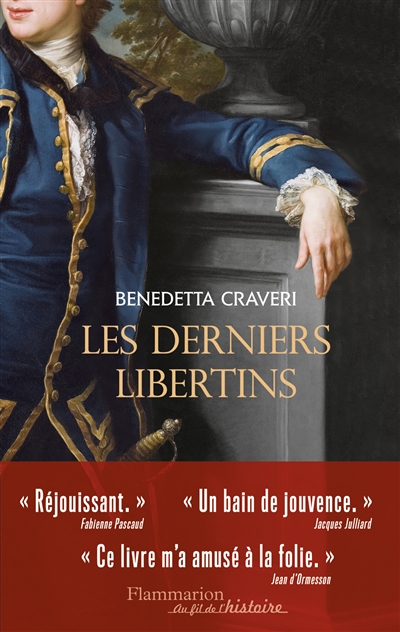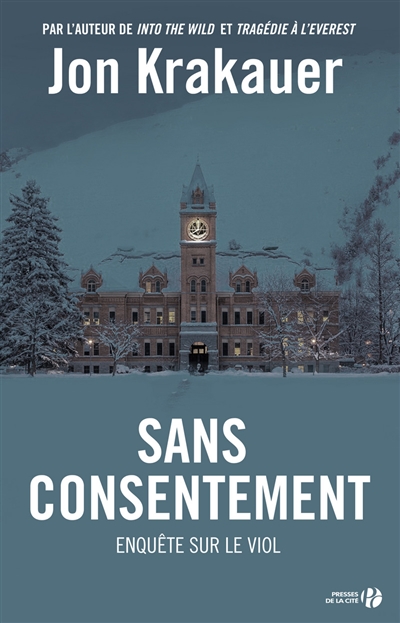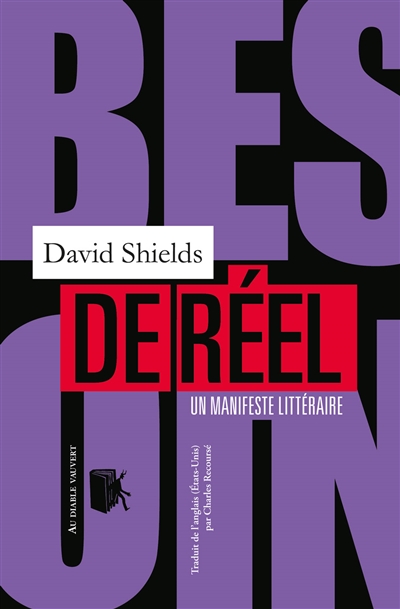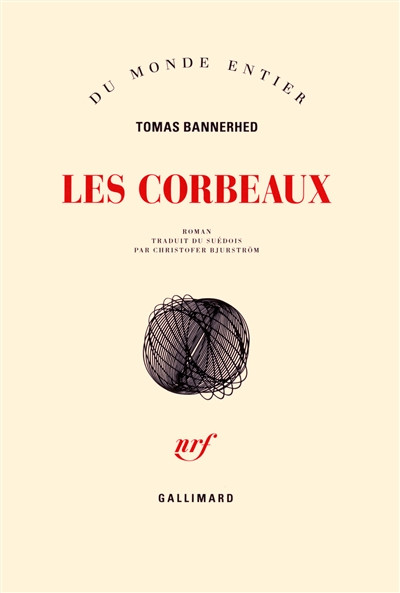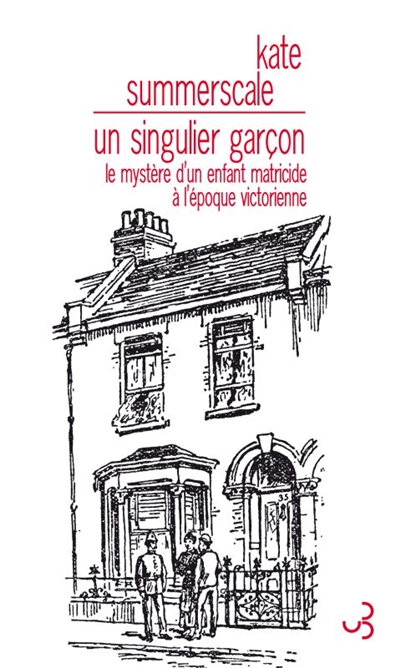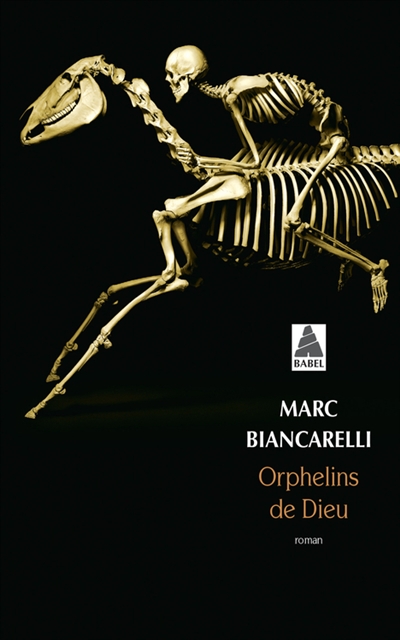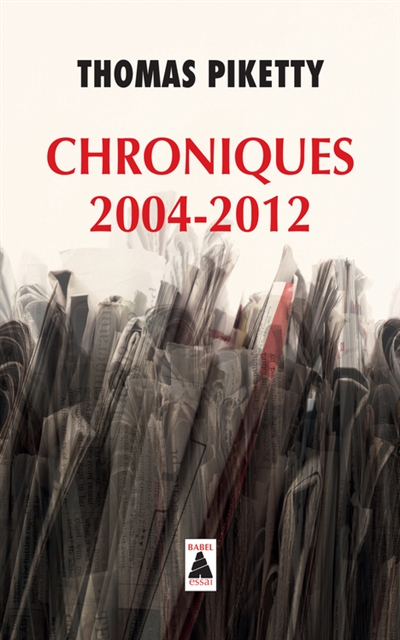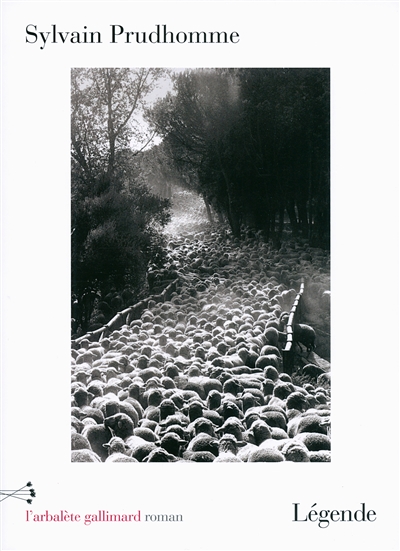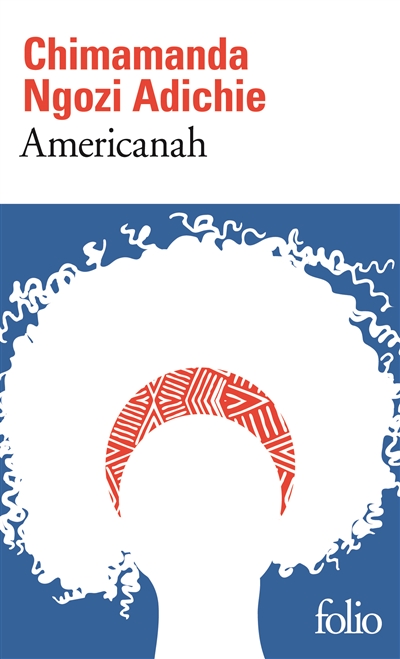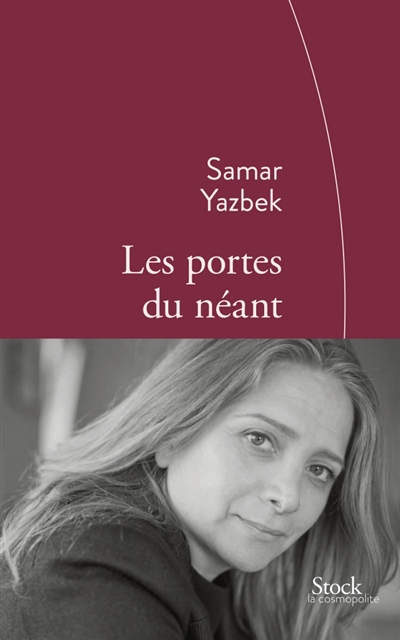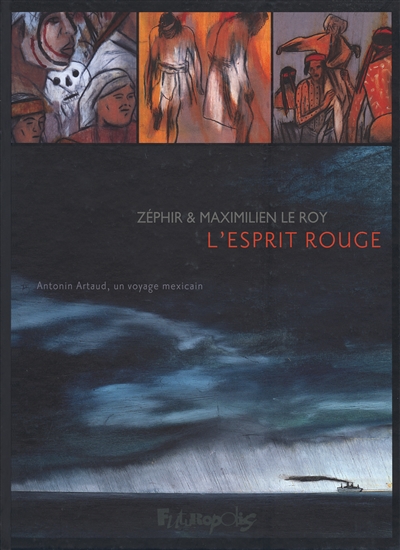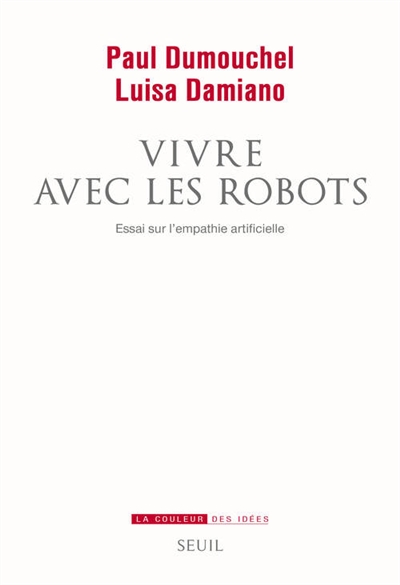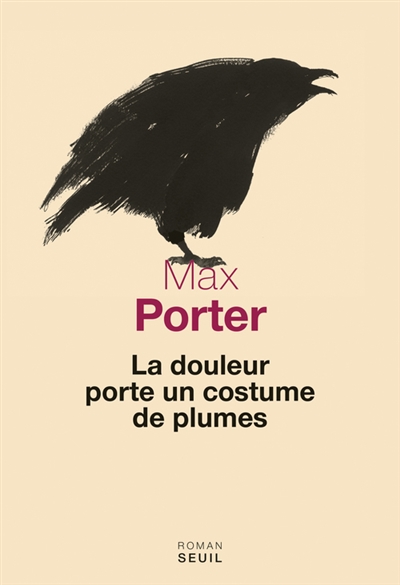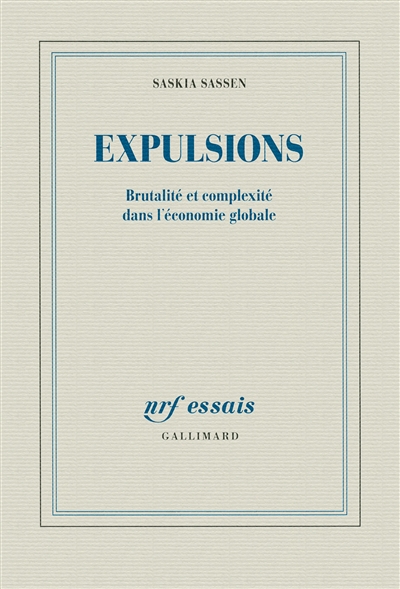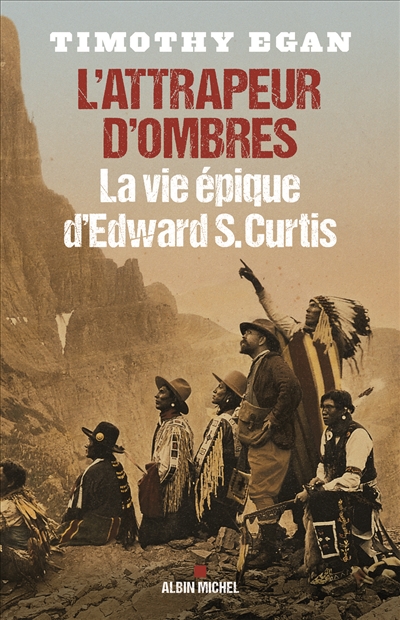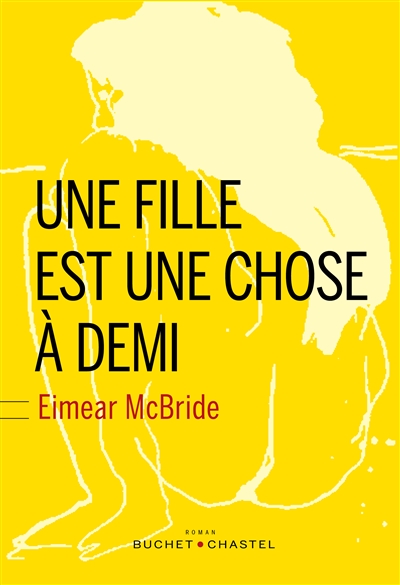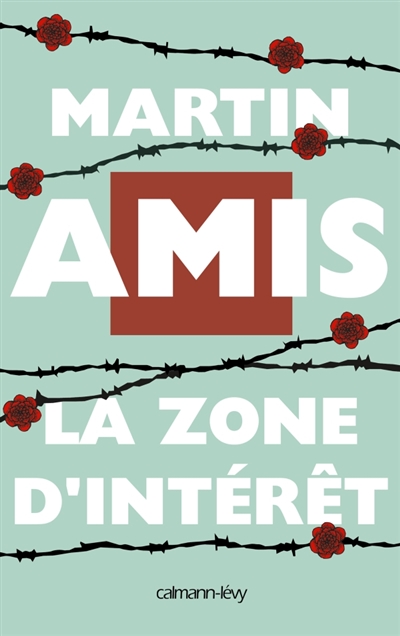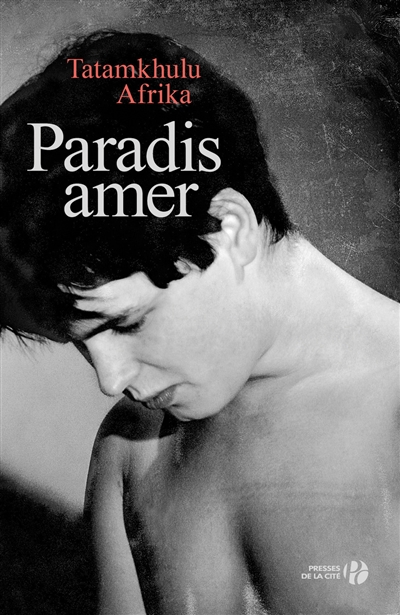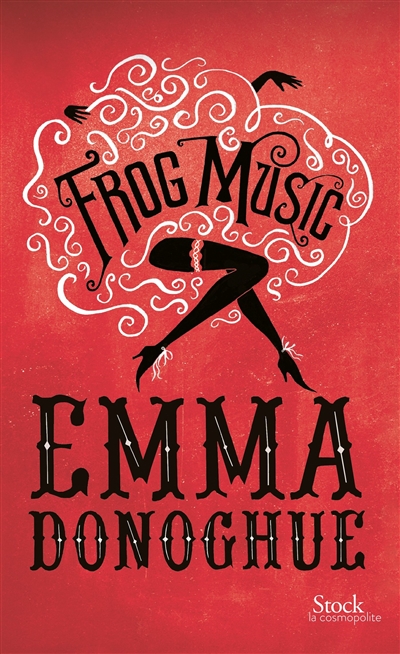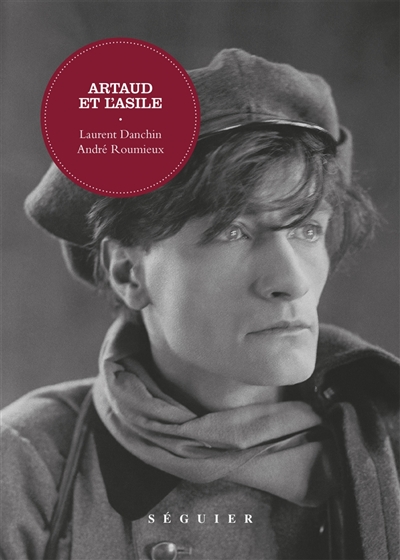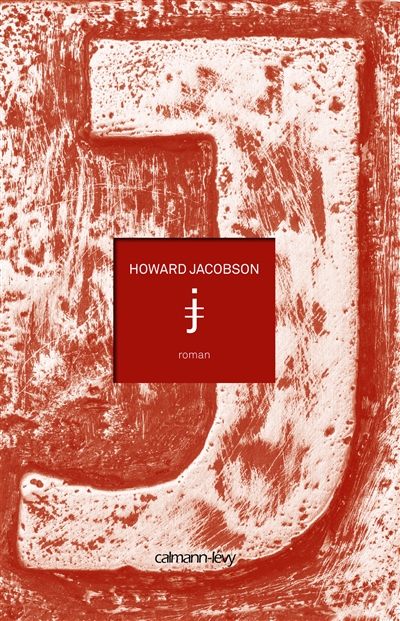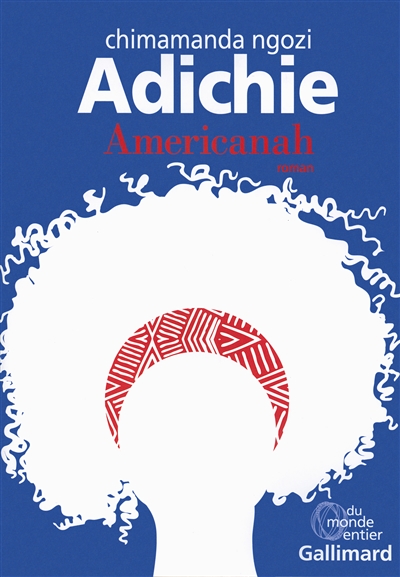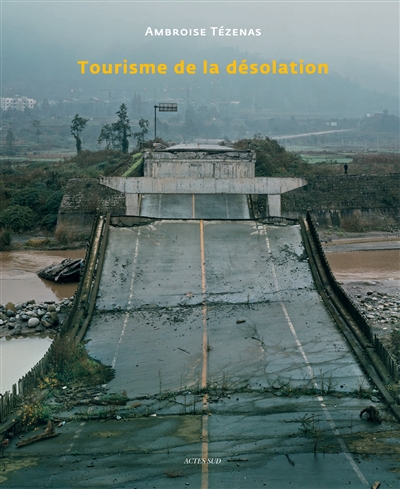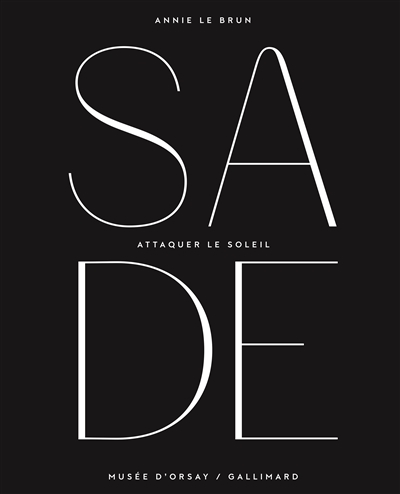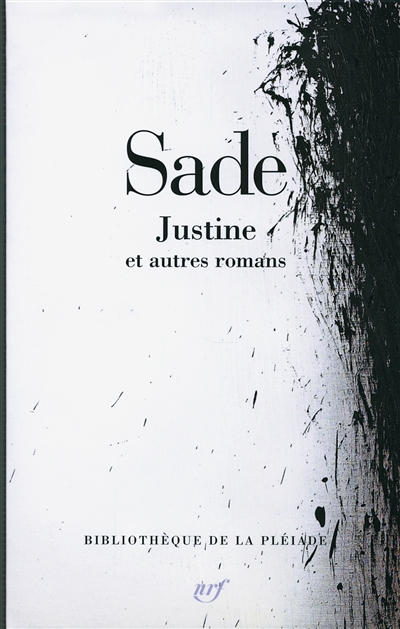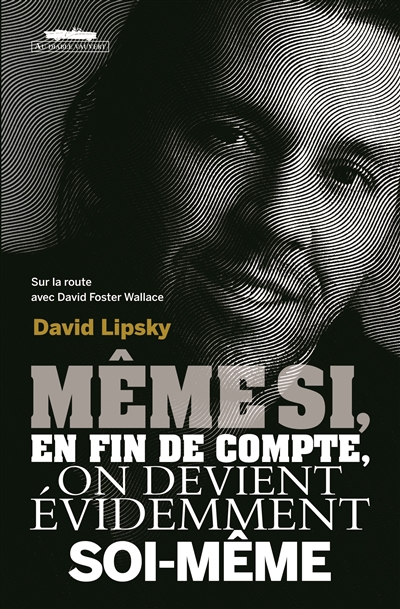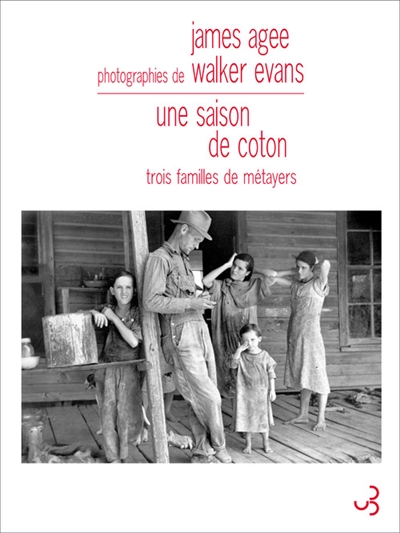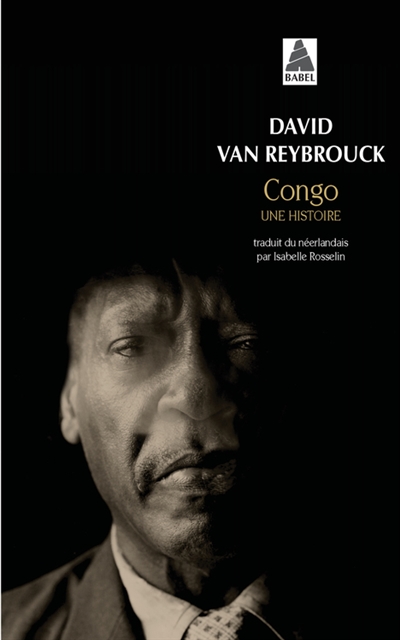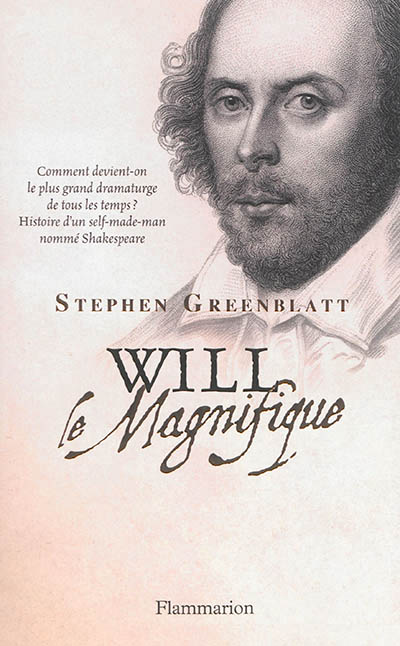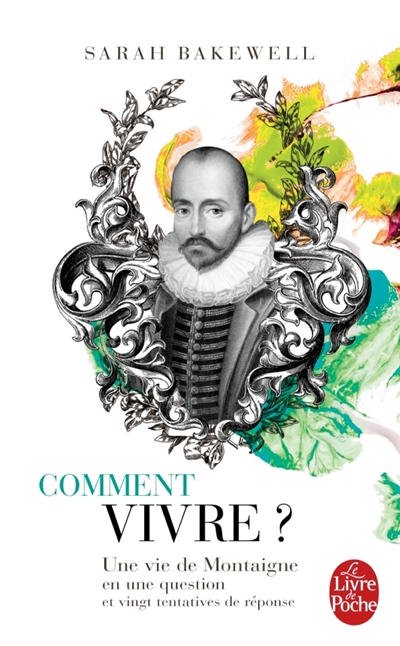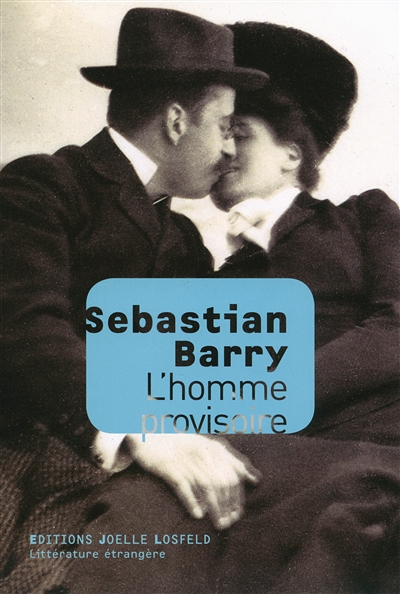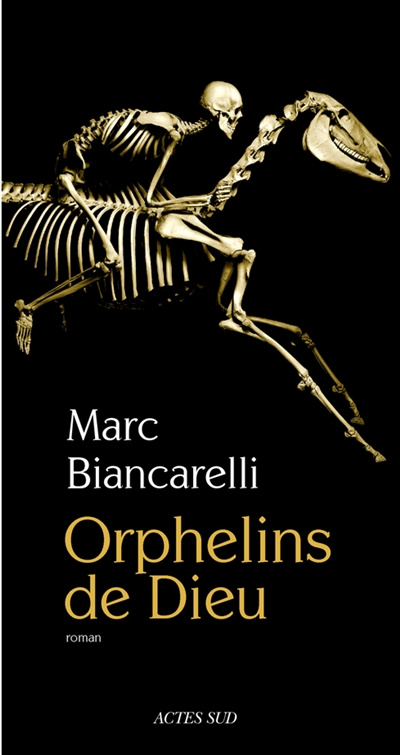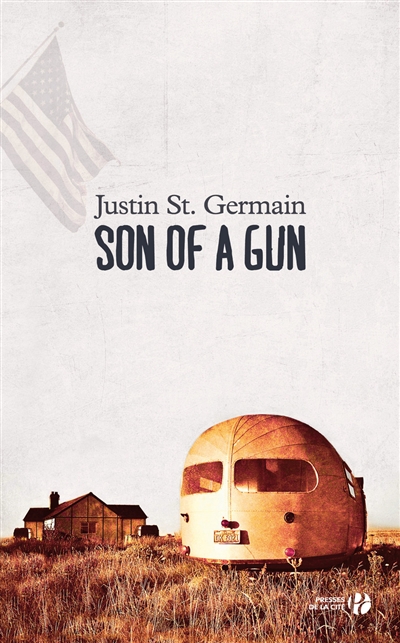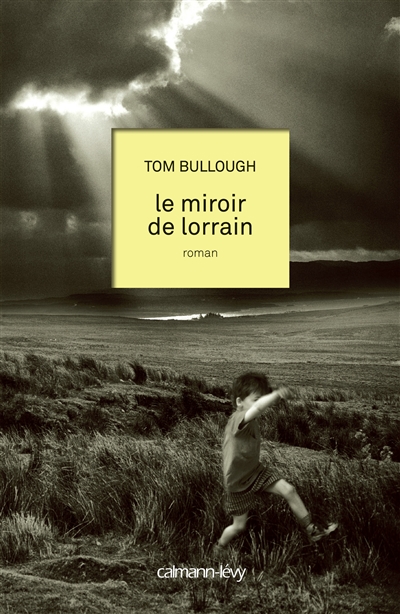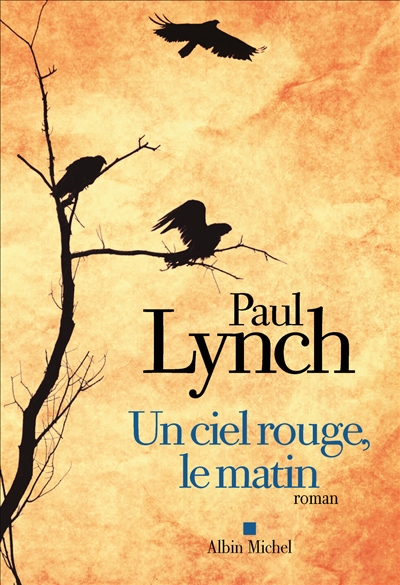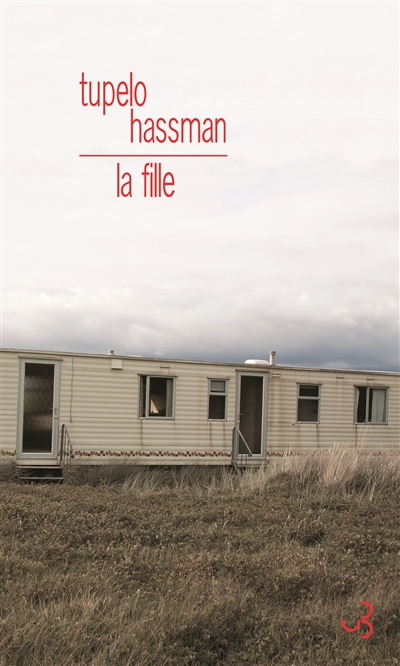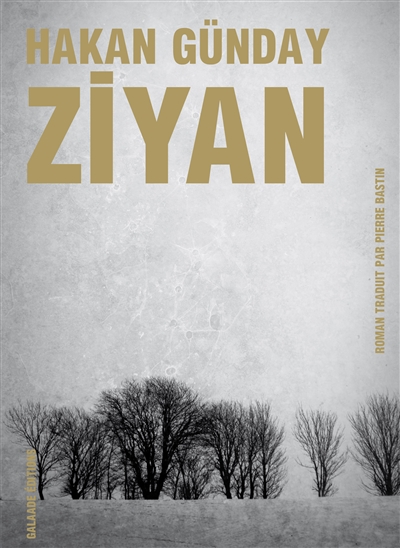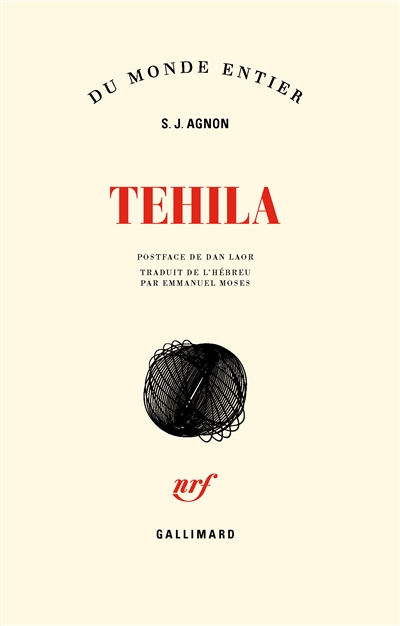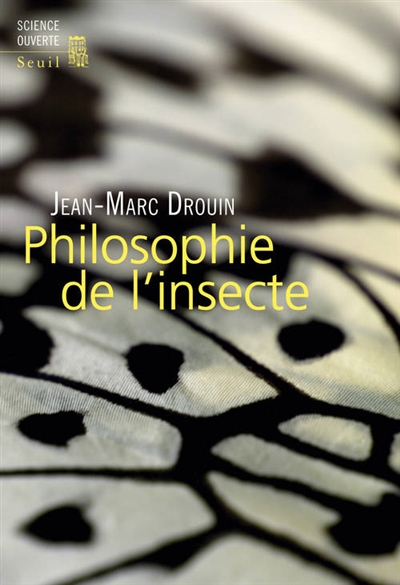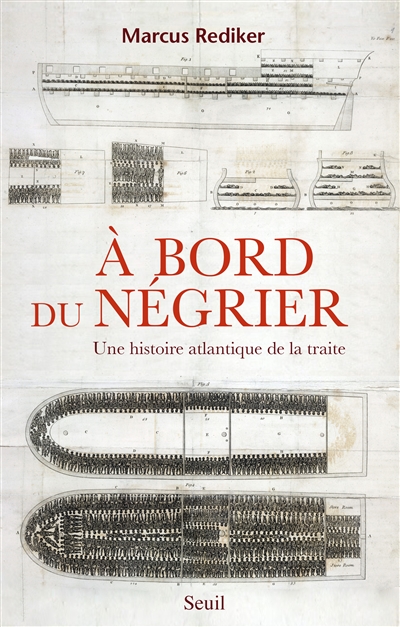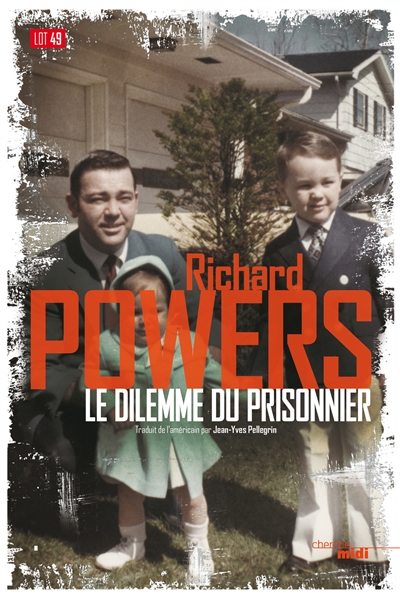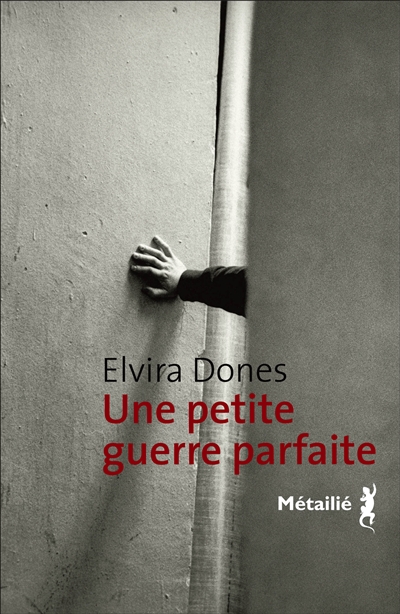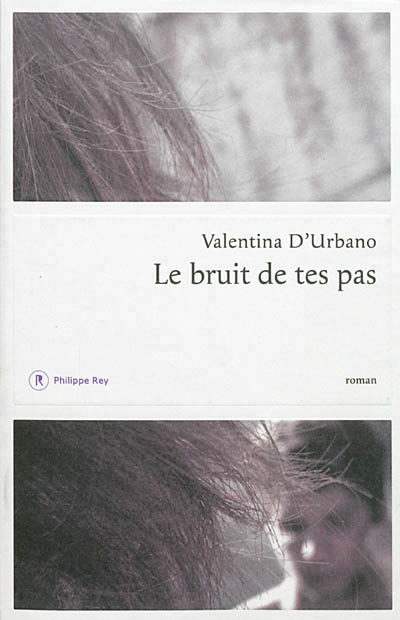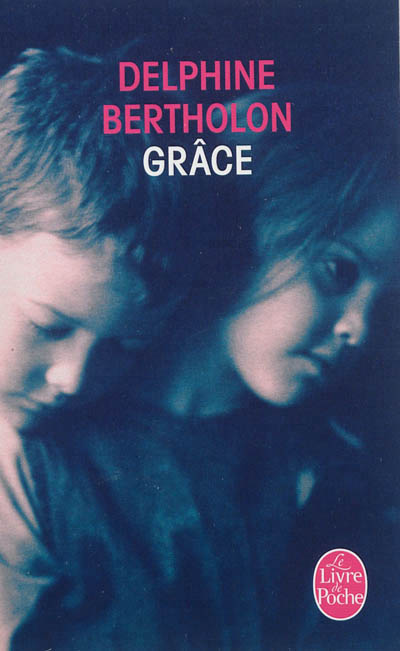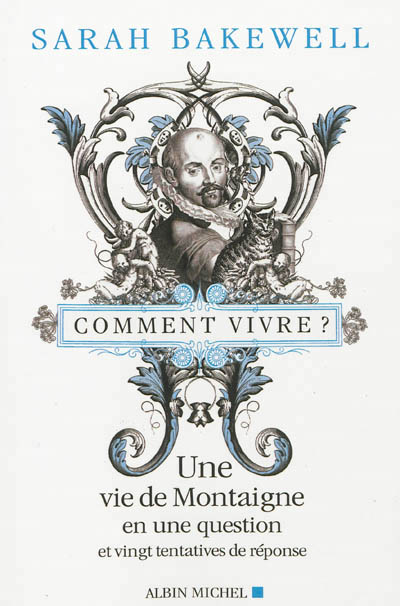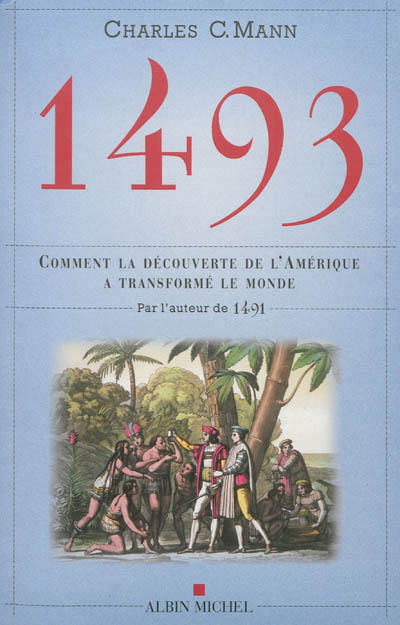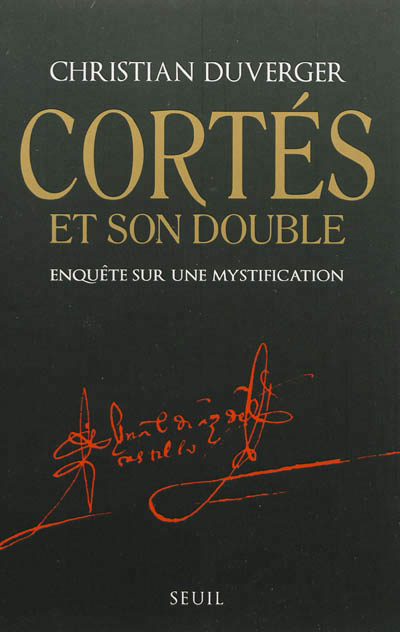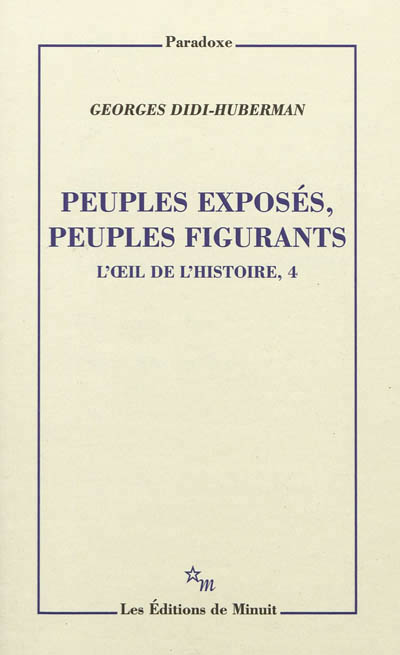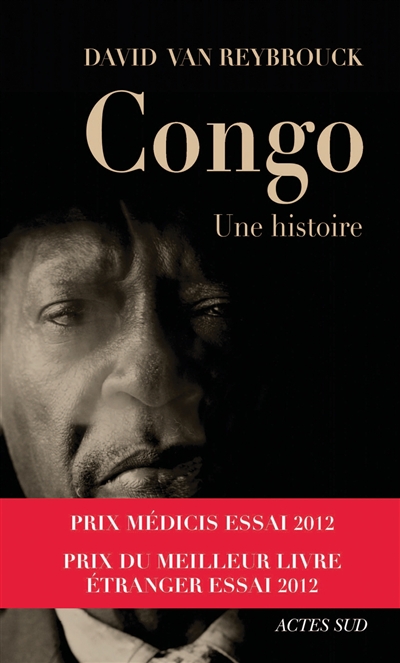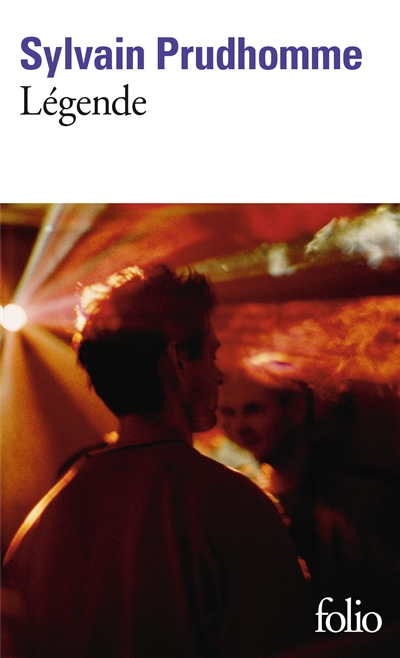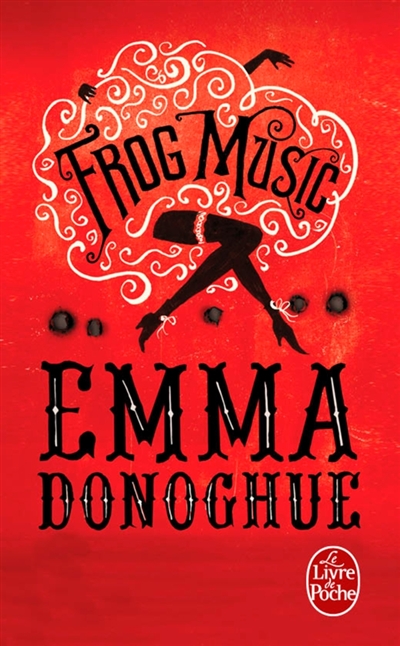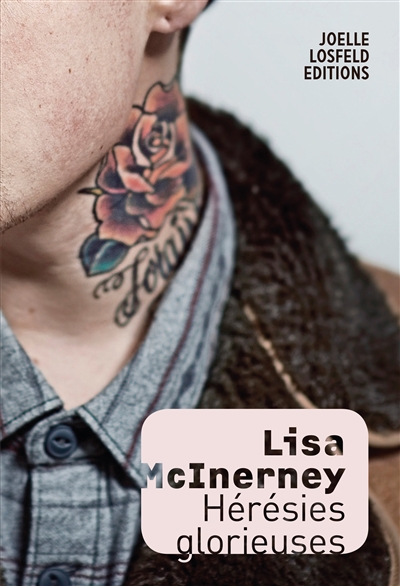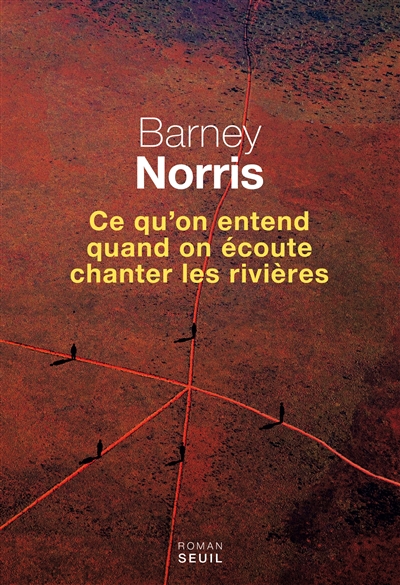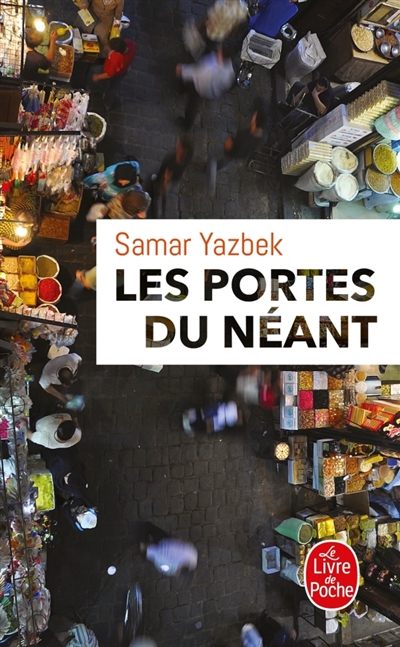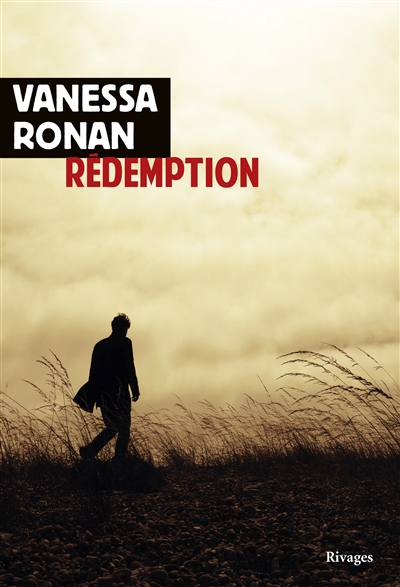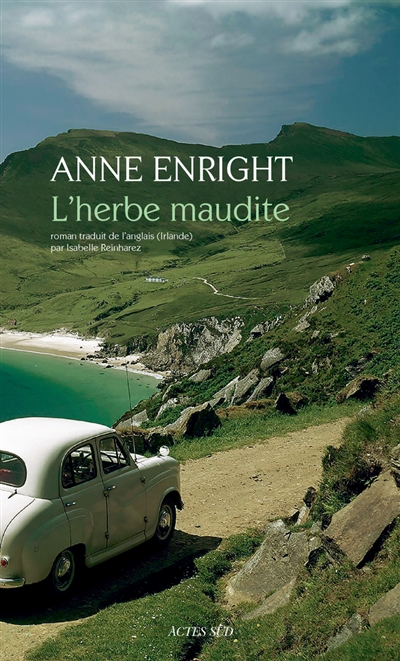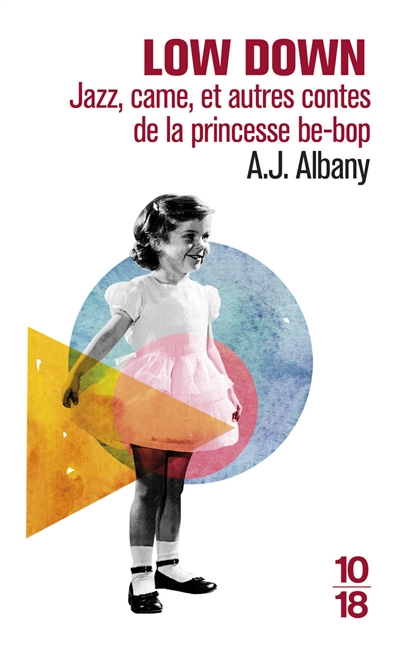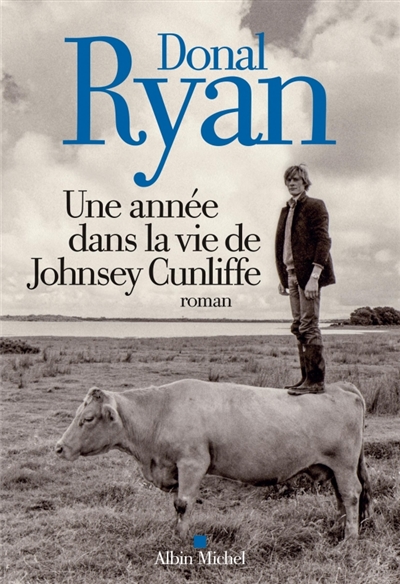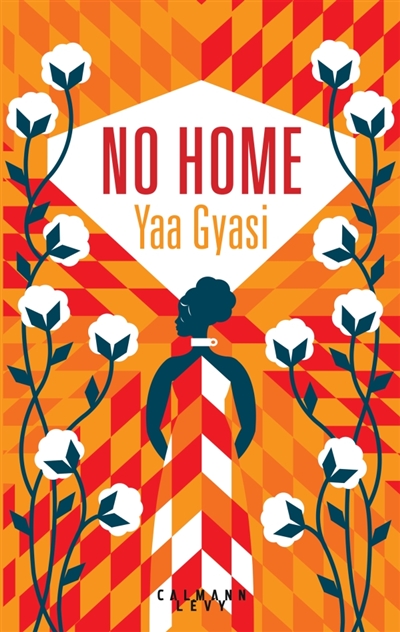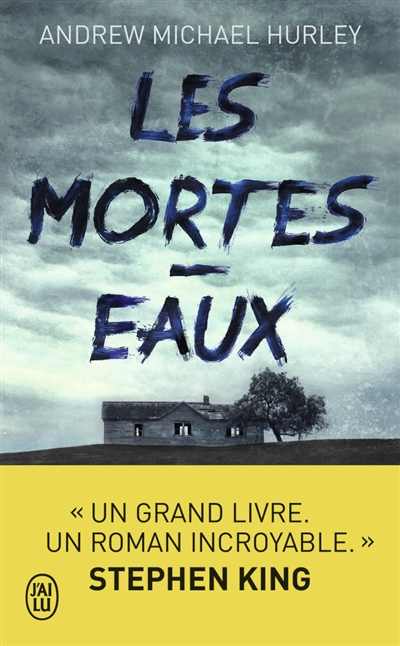Littérature étrangère
Zia Haider Rahman
À la lumière de ce que nous savons

-
Zia Haider Rahman
À la lumière de ce que nous savons
Traduit de l’anglais par Jacqueline Odin
Christian Bourgois éditeur
10/03/2016
528 pages, 25 €
-
Chronique de
Charlène Busalli
- ❤ Lu et conseillé par 1 libraire(s)
✒ Charlène Busalli
( , )
À trop vouloir s’attacher aux intrigues dites « efficaces », on a tendance à oublier aujourd’hui que le roman est un genre qui se savoure. Zia Haider Rahman fait fi des exigences rythmiques des page-turners de notre époque, et nous embarque dans un voyage littéraire et intellectuel au long cours.
Un matin de septembre 2008, Zafar, hagard et échevelé, apparaît à la porte d’un ami qui ne l’a pas vu depuis dix ans. Il lui raconte alors ce qui lui est arrivé depuis qu’il a quitté son poste de trader au sein de l’entreprise qui les employait tous les deux. Devenu avocat pour les droits de l’homme, il s’est rendu en Afghanistan en 2002 après s’être vu proposer de devenir conseiller pour le nouveau gouvernement. Mais les choses ont mal tourné, en partie à cause de sa tumultueuse histoire d’amour avec l’ambitieuse Emily. Les longues conversations qui s’ensuivent portent aussi sur bien d’autres sujets, comme leur passion commune pour les mathématiques, le parcours de Zafar depuis la campagne du Bangladesh jusqu’à Oxford où ils se sont rencontrés, ou encore l’état du monde actuel. Un roman qui interroge la perception que nous avons des autres et de nous-mêmes, et qui met superbement en éveil notre soif de compréhension du monde.
Page — Comme vous, le personnage principal de votre roman est né au Bangladesh mais passe la majeure partie de sa vie dans d’autres pays. Or, votre livre semble moins traiter de l’exil que de l’impression de n’appartenir à nulle part. Est-ce selon vous une situation partagée par beaucoup aujourd’hui ?
Zia Haider Rahman — Beaucoup de gens sillonnent les routes de nos jours, fuyant la guerre, les problèmes économiques ou toute autre forme de souffrances. Peu d’endroits dans le monde parviennent à accueillir les étrangers. Certaines parties des États-Unis, terre d’immigration par excellence, et le Canada, sont encore capables d’assimiler des migrants sans les aliéner. Cela reste vrai malgré l’actuel projet nativiste de l’extrême droite américaine. Mais l’aliénation peut prendre des formes diverses, pas seulement celle d’une aliénation des migrants. Il y a de l’aliénation aussi dans le fait de franchir les frontières de classe. D’ailleurs, Retour à Reims de Didier Eribon (Coll. « Champs essais », Flammarion) rend superbement compte de cela. La montée des populismes dans le monde reflète, entre autres, l’aliénation grandissante de beaucoup vis-à-vis des leviers du pouvoir. Le sentiment d’avoir une influence sur son environnement immédiat semble être un composant d’un sentiment d’appartenance.
Page — À un moment donné, le narrateur et son ami Zafar envisagent l’écriture d’un livre comme moyen de « ménager un pont entre des cultures ». Était-ce votre intention en écrivant ce roman ?
Z. H. R. — Dans le roman, quand Zafar parle de « ménager un pont entre des cultures », le narrateur croit qu’il fait référence au fait de jeter un pont entre différentes cultures ethniques ou géographiques. Il se peut que Zafar s’attaque malicieusement au schéma de pensée habituel du narrateur. Zafar corrige ce dernier et lui explique qu’il est intéressé par un autre fossé (celui qu’a identifié C. P. Snow dans l’essai majeur The Two Cultures paru en 1952). Il s’agit de la division entre les sciences d’un côté, et les lettres et les arts de l’autre. Zafar a du mal à se faire à l’idée de frontière, quelle qu’elle soit. Je ne pense pas qu’en écrivant ce roman, j’ai voulu faire avancer la cause d’un rapprochement entre les cultures, mais plutôt explorer des personnages et des idées à travers la vie et l’histoire de ces personnages. Je m’intéresse autant à la vie de l’esprit qu’aux actions des personnages.
Page — Le théorème d’incomplétude du mathématicien Kurt Gödel est au cœur du roman. Avez-vous créé vos personnages afin qu’ils puissent personnifier les implications philosophiques de ce théorème ?
Z. H. R. — Pas consciemment. Les idées qui animent ce roman se développent de manière organique en partant des personnages, peut-être que c’est pour cela que vous posez la question. Un grand nombre de mes amis sont des intellectuels et je prends plaisir à écouter des conversations autour d’idées philosophiques abstraites, mais mon esprit s’anime dès que la discussion s’oriente vers l’expression de ses idées au sein d’une vie humaine. Comment ces zones conceptuelles, ces noms abstraits – tels que l’épistémologie, le sexisme ou l’exil – sont-ils corroborés par la confrontation d’un être humain à son existence ? L’art de la fiction offre des techniques qui nous permettent d’expérimenter des idées auxquelles nous ne nous confronterions peut-être jamais autrement, en particulier les idées gênantes. Nos propres émotions nous donnent les moyens d’être piégés par des idées.
Page — Zafar, qui vient d’un milieu défavorisé, explique que ce que les gens prennent pour du racisme est souvent de la discrimination de classe. Est-ce quelque chose que votre propre expérience vous a amené à penser ?
Z. H. R. — La pure émotion, le pur préjugé ou la pure représentation n’existent pas. Toutes ces choses sont le résultat d’un mélange d’affect et de réflexion, mobilisant une large palette de couleurs et de textures. La différence de classe entre le narrateur (qui vient de l’élite internationale) et Zafar est aussi flagrante parce qu’elle n’est pas complexifiée par une différence raciale : tous deux sont d’origine ethnique sud-asiatique. D’après ma propre expérience – puisque vous posez la question –, en particulier en Grande-Bretagne mais aussi dans d’autres pays européens, et de manière moindre aux États-Unis, le rapport que les gens entretiennent avec moi, la façon que nous avons de nous mesurer, est fortement façonné par des considérations de classe. La Grande-Bretagne est une société qui ne pourrait pas s’appréhender sans classes. Celles-ci font partie intégrante de la psyché. Si Didier Eribon dresse un tableau fidèle de la France, alors la France aussi possède une logique de classe prédominante.
Page — Joyce Carol Oates a dit de votre roman que ce n’était pas un page-turner. Déplorez-vous la tendance générale actuelle du roman à vouloir construire avant tout une intrigue efficace ?
Z. H. R. — Joyce Carol Oates a en effet dit cela, puis elle a ajouté : « Quel est l’intérêt d’un page-turner quand le vrai plaisir d’une œuvre de fiction réside dans l’attrait gravitationnel que celle-ci exerce sur nous ? ». Ce qui est sûr, c’est que je ne déplore pas les romanciers littéraires. Il y a tant de gens qui essaient de publier des livres, tant de gens qui écrivent en dehors de ceux qui publient, tant de romans publiés chaque année, que ce que l’on voit dans le marché de l’édition est plus le reflet des appétits de lecture et de la viabilité financière. Ceux qui sont récompensés par des ventes reflètent les changements fondamentaux dans la distribution du livre, dans la manière dont les gens utilisent la langue, et dans ce que signifie être un auteur. Internet a bouleversé l’édition traditionnelle et son rôle de conservation et de garde-fou. Il y a une étude, apparemment, qui suggère que les phrases deviennent de plus en plus courtes dans les romans ; nous vivons à l’ère de la concision induite par les réseaux sociaux, une concision qui étouffe la représentation de la complexité naturelle du monde. Au final, le phénomène moderne de l’écrivain comme personnalité susceptible d’être appréciée punit des textes de qualité qui ne peuvent pas être promus par un communicant séduisant.