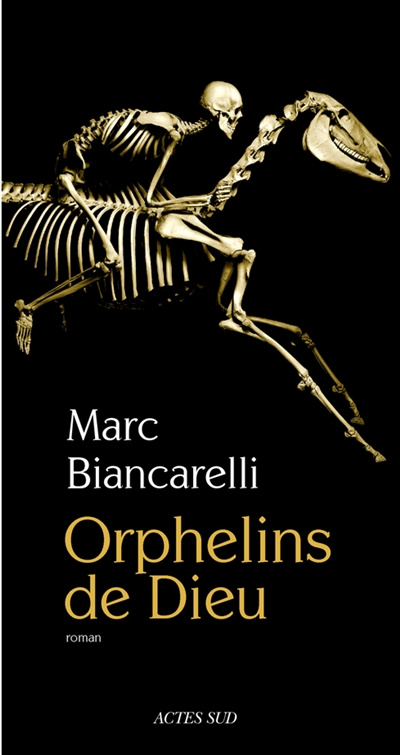Depuis la mort de leurs parents, Vénérande et son frère Petit Charles mènent une vie solitaire au milieu des collines corses. Un jour, alors que Petit Charles garde les moutons, il est attaqué par des bandits qui tuent et volent six de ses brebis, en prenant soin de lui couper la langue afin qu’il ne puisse pas les dénoncer. Vénérande se jure de le venger. Elle va alors trouver un homme qu’elle connaît de réputation, Ange Colomba, surnommé L’Infernu en raison du grand nombre d’hommes qu’il a tués. La jeune femme ne se contente pas de lui demander d’exécuter les quatre hommes qui ont mutilé son frère, elle insiste pour l’accompagner afin de les voir mourir de ses yeux. L’ancien rebelle devenu tueur à gages est à présent un vieil homme alcoolique et à moitié malade, mais il accepte ce dernier contrat avant de se retirer. Tout en s’acquittant de sa mission, L’Infernu raconte son parcours à Vénérande, notamment ses jeunes années passées au sein de la bande du célèbre Théodore Poli. S’il cherche l’absolution, Vénérande n’est pas le genre de femme impressionnable prête à la lui donner si facilement…
Page — Vous citez en exergue du roman John Ford et Charles Portis. Votre source d’inspiration est donc le western. Pourquoi avoir choisi ce genre ?
Marc Biancarelli — Cela fait longtemps que le désir d’écrire un western me poursuit et j’avais cette histoire en tête depuis quelques années déjà. Il a fallu attendre qu’elle mûrisse suffisamment pour passer au stade de l’écriture. Je trouve que l’environnement corse, son histoire, ses traditions orales, se prêtent tout particulièrement au western. Le XIXe siècle corse s’inscrit dans un contexte tourmenté, violent, pauvre… En outre, l’itinéraire de L’Infernu me permettait d’aborder les thèmes de la trahison et de la dérive des idéaux. Plein de l’ardeur idéaliste de la jeunesse, L’Infernu commence par combattre pour ses idées, avant de basculer dans le grand banditisme. L’idée que l’engagement politique, quand il se fonde sur une position aussi extrémiste que celle de L’Infernu, se trouve à un moment ou à un autre dévoyé constitue en quelque sorte l’arrière-plan du roman.
Page — Vous vous attardez peu sur le contexte politico-historique de l’époque, mais il s’avère qu’un certain nombre des personnages du roman ont réellement existé. Y avait-il de votre part une volonté de ne pas trop politiser l’intrigue en explicitant peu cet aspect de l’histoire ?
M. –B. — Je voulais d’abord exploiter le contexte historique à ma disposition. Le western américain procède d’ailleurs de même. Il travaille la mémoire historique et culturelle des États-Unis et la transforme en matière romanesque. C’est ce même principe qui a présidé à l’écriture de mon livre. J’ai utilisé le matériau historique, mais aussi la mémoire culturelle, orale de la Corse. Presque tous mes personnages ont existé. Ces rebelles, actifs pendant les années 1820-1830, apparaissaient déjà dans Colomba, le roman de Prosper Mérimée ; mais ils n’habitaient que les marges du texte, on ne savait pas vraiment qui ils étaient, ni ce qu’ils avaient accompli. Je trouvais intéressant d’en faire des personnages romanesques à part entière, de m’approprier cette réalité et d’en faire de la littérature. L’autre matière qu’il m’importait de fouiller, c’était la mémoire orale. Par exemple, l’histoire de Petit Charles à qui on coupe la langue, m’a été racontée. Je voulais établir des connexions entre le fond mémoriel corse et la littérature.
Page — Pourquoi ce titre ? D’où vient cette expression qu’utilise le bandit Théodore Poli pour se définir, lui et ses troupes ?
M. –B. — La formule apparaît alors qu’il s’est réfugié avec ses hommes en Toscane. Les rebelles corses avaient cette habitude de passer en Toscane ou en Sardaigne après avoir combattu dans l’île. Là-bas, ils se cachaient à l’intérieur des marennes, marécages sordides et insalubres, d’où ils menaient des opérations de brigandage. Cette pratique était surtout répandue au XVIIIe siècle, mais Théodore Poli et ses semblables ont perpétué cette tradition. Il paraissait donc crédible de les imaginer en train de se terrer dans les marennes toscanes. Je trouvais très romanesque de les décrire au milieu de cet univers, d’en faire des créatures infernales, des anges déchus. À un moment, Théodore s’entretient avec L’Infernu. Ils réfléchissent à ce qu’ils sont et portent sur eux-mêmes un regard assez critique. Ils ont conscience des dérives dont ils se rendent coupables, ils savent qu’ils ont cessé d’être fidèles aux idéaux de leur jeunesse. Théodore dit à L’Infernu : nous sommes devenus des assassins, on s’est éloigné de Dieu. Ça a donné le titre, que j’emprunte au roman de Cormac McCarthy, Un enfant de Dieu.
Page — Votre roman se garde de camper des personnages bons ou méchants. Chacun, à sa manière, est habité par la cruauté. Il y a le sadique qui défigure Petit Charles, L’Infernu qui est hanté par la violence du milieu dans lequel il a grandi, Vénérande qui est obsédée par son désir de vengeance…
M. –B. — L’humanité est comme cela… Mais c’est encore plus vrai quand on est pris dans une spirale de violence, quand le contexte au sein duquel on vit est aussi difficile que celui de la Corse du XIXe siècle. Cette période au cours de laquelle s’est développé le banditisme ressemble assez à ce qui s’est passé dans le sud de l’Italie au moment de l’unification du pays. Ce sont des époques d’une grande violence et je ne crois pas que l’on puisse rester un ange quand on est confronté à ce type de réalité.
Page — En dépit de la violence de l’intrigue, le style est sublime. Les descriptions de paysages sont d’une poésie incroyable. Par ailleurs, vous reproduisez de façon très vivante la gouaille des bandits. Murtoriu, votre précédent roman (Actes Sud), était traduit du corse. Vous avez écrit celui-là directement en français. Avez-vous la même facilité à écrire dans les deux langues ? Et pourquoi, cette fois, le choix du français ?
M. –B. — J’ai la chance d’avoir les deux langues à ma disposition et d’éprouver le même plaisir à les utiliser. J’ai publié beaucoup de livres en corse, mais l’écriture en français m’a toujours attiré. Je n’étais d’abord pas sûr de posséder le coffre pour écrire un long roman en français, mais j’avais quand même très envie de m’y confronter. Ces deux langues sont deux passions égales. Les textes que j’avais écrits en français par le passé ne possédaient pas une telle densité, mais j’ai découvert que je ressentais le même plaisir à écrire en français qu’en corse. Désormais, sans cesser d’écrire en corse, je crois que j’écrirai davantage en français.