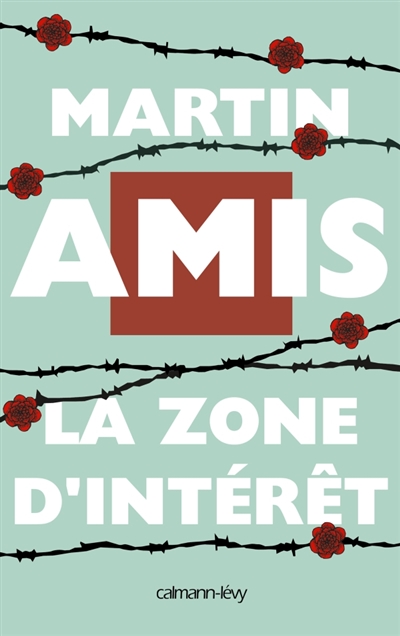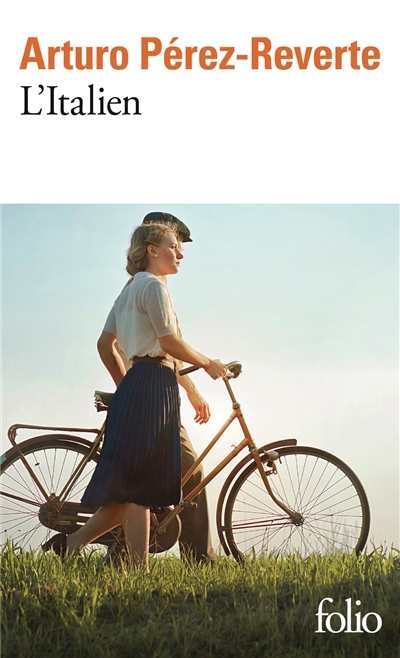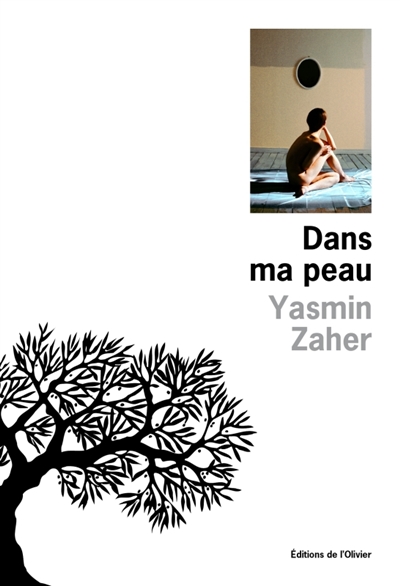Angelus Thomsen confie à son camarade Boris Eltz son attirance pour la belle Hannah Doll, dont ils viennent de croiser la route en se promenant. Une scène qui pourrait être tout ce qu’il y a de plus ordinaire… si elle n’avait pas lieu à Auschwitz et si Hannah Doll n’était pas la femme du commandant du camp. Paul Doll, que Thomsen et Eltz surnomment le Vieux Pochetron, a beau être terriblement stupide, il se rend rapidement compte du manège du jeune officier et tente à tout prix de l’empêcher de séduire son épouse. Pendant ce temps, la mécanique meurtrière du camp est en marche. Le prisonnier Szmul est là pour en témoigner, lui qui fait partie du Sonderkommando chargé de récupérer les cadavres à la sortie des chambres à gaz. Martin Amis donne à voir des officiers nazis dotés d’un sentiment de leur propre virilité tellement exacerbé, que cela en devient ridicule. Le romancier brosse les portraits d’hommes complètement indifférents à ce qu’ils sont en train de faire, et c’est bien là tout le tragique de cette histoire.
Page — Ce n’est pas la première fois que vous vous intéressez au camp d’Auschwitz. C’était déjà le cas dans La Flèche du temps (Folio), il y a presque vingt-cinq ans. La Zone d’intérêt est-il un roman auquel vous avez réfléchi longtemps avant de l’écrire ?
Martin Amis — Contrairement à ce qu’on peut penser, on ne décide pas d’écrire un roman. Les romans proviennent d’une sorte d’angoisse muette. On écrit des romans sur des sujets dont on ne savait même pas qu’ils nous préoccupaient à l’origine. C’est tout le travail de l’inconscient. Les romans naissent de ce que Nabokov appelle une pulsation, d’autres écrivains parlent d’un frisson. Une image émerge de notre subconscient et c’est à ce moment-là qu’on peut se mettre à écrire. L’image qui a présidé à l’écriture de ce roman est celle d’un homme tombant éperdument amoureux, dans le cadre d’Auschwitz. C’est par-là que tout commence et la bataille est toujours la même, quel que soit le sujet traité. En littérature, on parle de décorum. Cela n’a rien à voir avec ce que l’on entend par décorum dans la vie de tous les jours. Dans le cas du roman, cela signifie trouver les mots justes et l’atmosphère adéquate pour une situation donnée.
P. — Vous dénoncez le nazisme en le tournant en ridicule. Vous dépeignez les nazis comme des hommes médiocres malgré tout le bien qu’ils pouvaient penser d’eux-mêmes, comme des hommes dépourvus d’un quelconque sens moral. Cela m’a fait penser au concept de banalité du mal d’Hannah Arendt. Ce roman était-il pour vous une manière d’illustrer ce concept philosophique par la fiction ?
M. A. — Aujourd’hui, beaucoup de gens disent qu’Hannah Arendt avait été dupée par Eichmann pour parler ainsi de banalité du mal. On a aussi dit d’elle qu’elle était la pire chroniqueuse judiciaire de tous les temps. Car Eichmann n’était pas du tout banal. Aucun d’eux n’était banal. Peut-être l’étaient-ils au départ, mais ils ne l’étaient certainement pas après ce qu’ils avaient fait. Eichmann a déclaré qu’il sauterait de joie dans sa tombe en sachant qu’il était responsable de la mort de cinq millions de Juifs. Cela n’a rien de banal.
P. — Il y a trois narrateurs dans ce roman : l’officier Thomsen, le commandant Doll et un prisonnier juif, Szmul, qui fait partie du Sonderkommando en charge des cadavres sortant des chambres à gaz. Était-ce important pour vous de donner à entendre la voix de Szmul pour contrebalancer les aspects plus comiques du roman ?
M. A. — Le mot comédie me gêne. La comédie suggère une certaine légèreté. Mais quand on y pense, nous ne rions pas souvent de joie. Nous rions pour exprimer notre incrédulité, notre dégoût. Je préfèrerais donc qu’on utilise le mot satire. De nombreux aspects de l’idéologie et des agissements nazis étaient ridicules. C’était presque du niveau du vaudeville tellement c’était stupide. La comédie et le rire sont une manière d’attaquer ce que nous haïssons. Ne vous y trompez pas, les criminels de ce monde craignent le rire presque davantage qu’ils ne craignent le châtiment. Au moment de leur chute, certains des héros de Shakespeare disent : « Allez-y, riez maintenant ». Voilà ce que le guerrier ou le prince craint le plus : le rire du peuple. Alors oui, Doll est un personnage ridicule et il fallait qu’il soit contrebalancé par une victime. Cette fois, je me sentais un peu plus équipé pour parler de la victime que lorsque j’ai écrit La Flèche du temps. Entre-temps j’ai épousé ma seconde épouse, qui est juive, et nous avons deux filles. La famille de ma femme a beaucoup souffert durant l’Holocauste. Cela fait donc partie de mon sang maintenant.
P. — Le nom d’Adolf Hitler n’apparaît à aucun moment dans le texte. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas le mentionner ?
M. A. — J’ai écrit un roman sur le goulag et je n’y mentionnais jamais Staline. Il y est désigné par le nom de Joseph Vissarionovitch, son patronyme. Écrire le nom d’Adolf Hitler de but en blanc à quelque chose de grossier, de déplacé. C’est pourquoi figure à la fin du livre un court essai, dans lequel je pouvais le nommer et aborder son cas. Il fallait que ce soit dans cette postface, mais pas à l’intérieur du roman lui-même.