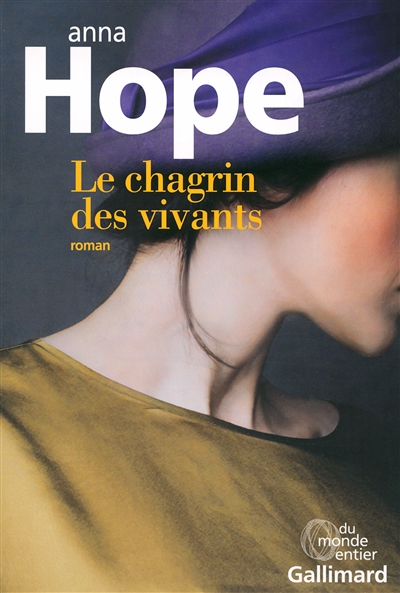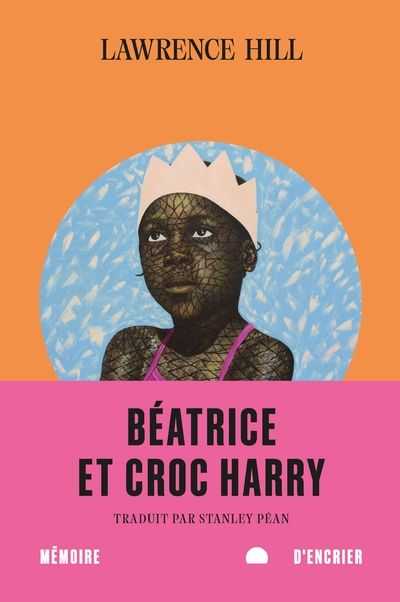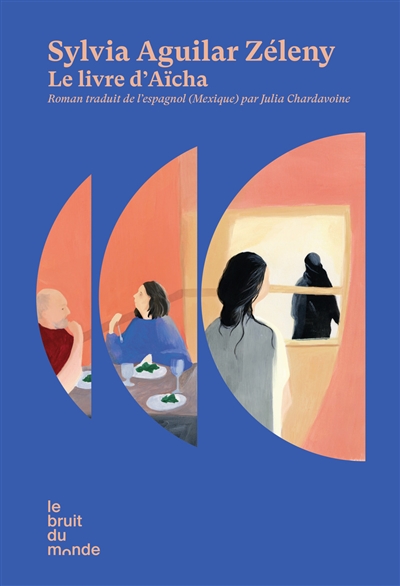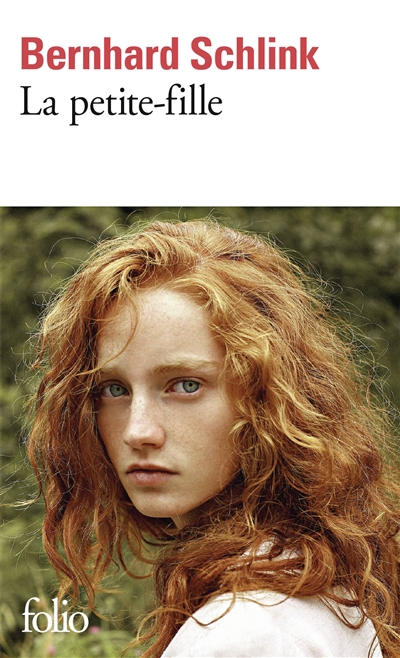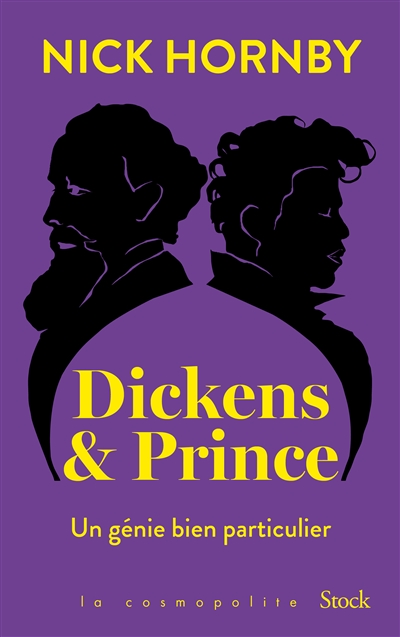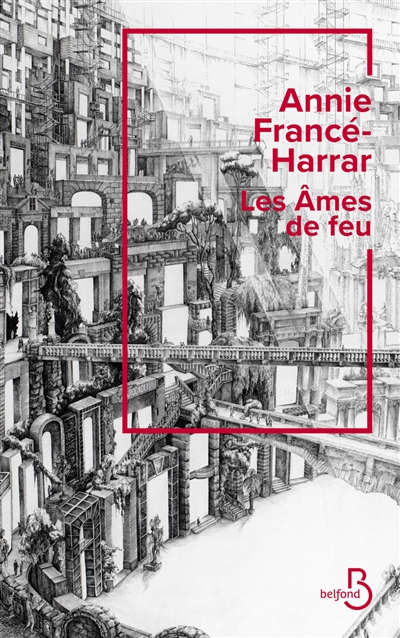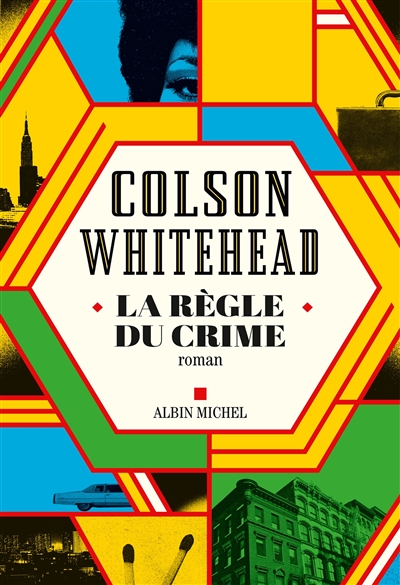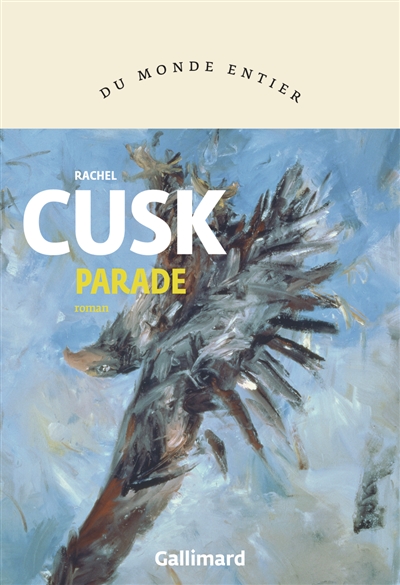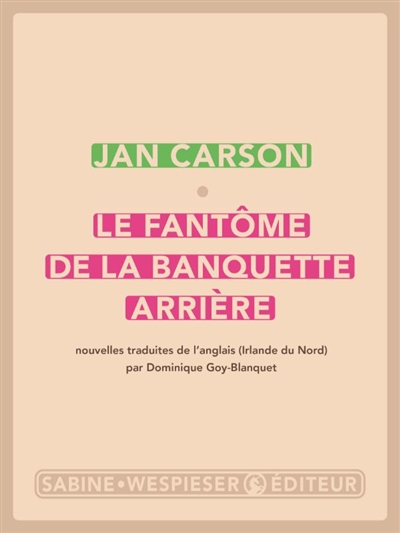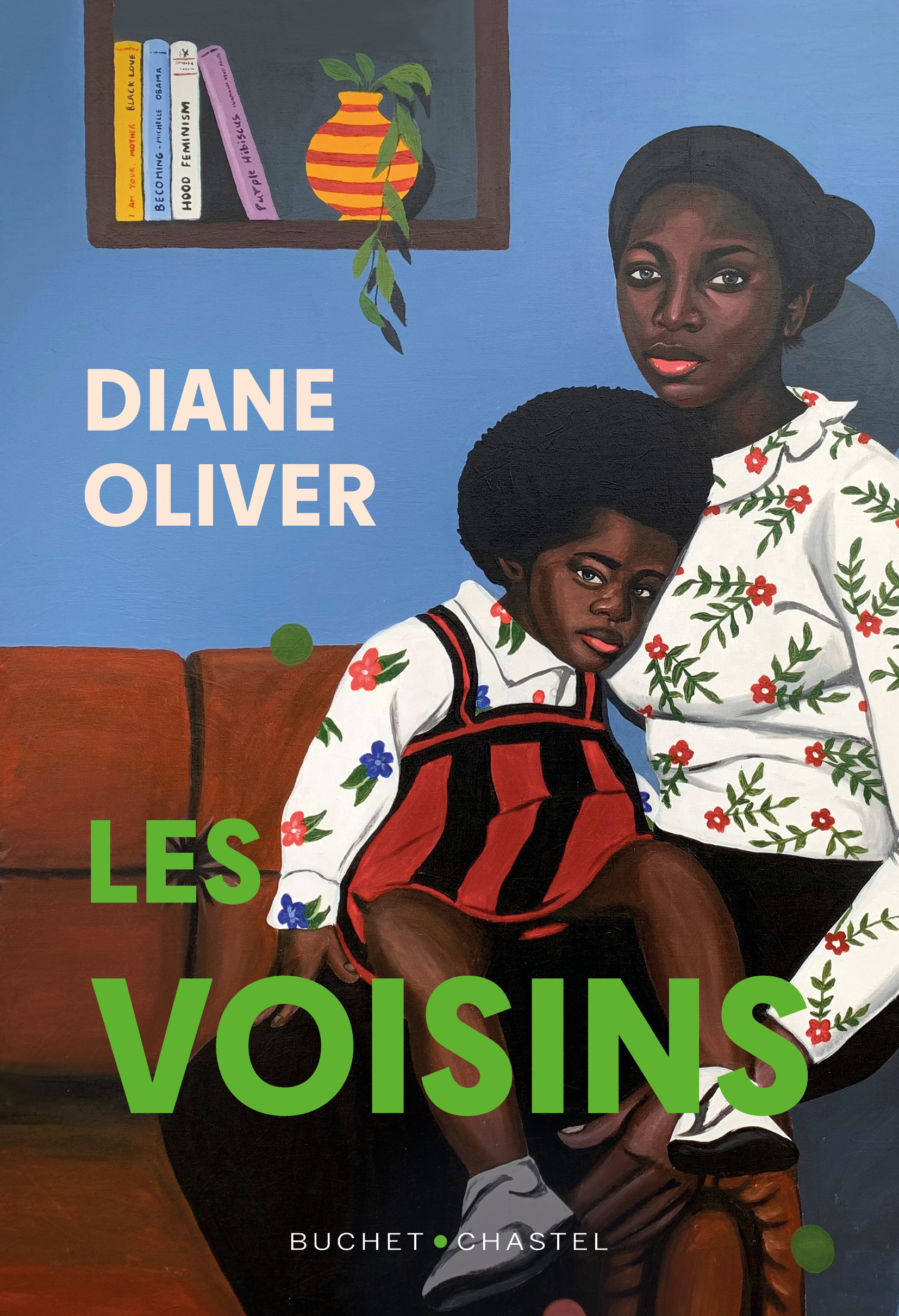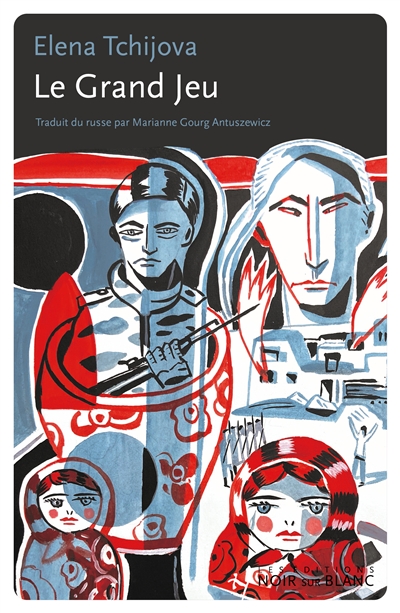Page — Pourquoi avoir choisi d’écrire sur l’idée de deuil collectif et sur la commémoration des morts de la Première Guerre mondiale ?
Anna Hope — Pour de multiples raisons, dont la plupart sont sans doute inconscientes. Quand au cours de mes recherches, j’ai visité les champs de bataille de la Somme, j’ai ressenti viscéralement quelque chose qui m’avait toujours semblé n’être qu’un fait, en quelque sorte abstrait. Aucune des dépouilles des soldats tombés au champ d’honneur n’a été rapatriée, ils ont tous été enterrés près de l’endroit où ils ont péri, en France et en Belgique. Ce fait m’a semblé intéressant d’un point de vue social et politique, dès lors qu’il évoque une démocratisation de la mort, une impression renforcée lorsque, face aux cimetières, vous constatez que toutes les pierres tombales sont identiques. J’ai alors commencé à me demander s’il était facile de visiter ces cimetières. À vrai dire, ce n’est pas si évident pour une famille de la classe ouvrière venant du Nord de l’Angleterre. Comment avoir les moyens d’entreprendre un tel voyage ? Quant à celles qui, comme le personnage d’Ada dans mon livre, n’avaient pas de sépulture pour leurs proches, quel réconfort cela pouvait-il leur apporter ? Il m’apparaissait ainsi qu’il y avait plusieurs niveaux de deuil et de commémoration à explorer.
P — Pourquoi avoir choisi de concentrer votre histoire sur les cinq jours qui précèdent les commémorations du Soldat inconnu ?
A.H. — À mon retour de la Somme, j’ai vu un documentaire qui mettait en scène le choix du Soldat inconnu. Cela faisait quelque temps que je cherchais la structure temporelle de mon livre et, tout à coup, j’ai eu une révélation. Les cinq jours qui ont séparé l’exhumation du corps dans le Nord de la France de son inhumation dans l’abbaye de Westminster semblaient offrir une fenêtre dans une période qui, autrement, aurait été beaucoup trop vaste à explorer. De plus, j’avais un grand intérêt pour la période de l’après-guerre avec l’Empire britannique terrassé par le chagrin, les soldats mendiant dans la rue, l’énorme changement dans la vie des femmes – beaucoup avaient travaillé et goûté à l’indépendance pour la première fois pendant la guerre. Une période aussi riche se prêtait extraordinairement bien à l’écriture.
P — À propos du titre et de sa traduction française : en anglais, le livre s’intitule Wake. Ce mot a une double signification. Il indique à la fois la veillée funéraire et la période de deuil, alors qu’en français le titre évoque le chagrin des personnages, le chagrin de trois femmes après le décès d’un frère, d’un mari ou d’un père. Qu’en pensez-vous ?
A.H. — J’étais très heureuse que le titre Wake convienne à tout point de vue. Mais ce n’est pas le cas dans d’autres langues. Et je pense que Le Chagrin des vivants est un titre magnifique.
P — Vous dites avoir puisé votre inspiration auprès de plusieurs auteures comme Vera Brittain, Juliet Nicholson, Vera Nicolson, Joyce Marlow, ou encore Mary Borden. Pourriez-vous nous parler de ces influences ?
A.H. — Le livre de Vera Brittain, Testament of youth, est longtemps resté sur mes étagères comme pour me reprocher d’avoir mis tant de temps avant de m’y plonger. C’est un pavé, très connu en Grande-Bretagne. J’ai eu quelques difficultés à m’y mettre au début, mais j’ai vite constaté combien c’était remarquable. J’y ai découvert une colère inouïe. L’héroïne est révoltée d’avoir sacrifié sa jeunesse et d’avoir perdu son amant. Elle est torturée par la culpabilité d’avoir survécu. Le livre est irradié d’un sentiment brûlant, et c’est pour cela que je l’ai aimé. J’ai voulu donner à Evelyn, qui est de la génération de Vera Brittain, une sensibilité de la même intensité. Quant à Mary Borden, elle est tout simplement extraordinaire et mérite d’être mieux connue. Elle surpasse Hemingway lui-même quant au rythme et à l’originalité de sa prose. Dans son livre intitulé The Forbidden Zone, elle décrit son expérience d’infirmière dans le Nord de la France. C’est un texte ravageur.
P — Comment avez-vous eu l’idée du personnage d’Hettie, la danseuse de compagnie ?
A.H. — Je connaissais le palais d’Hammersmith de longue date. C’était une salle de danse emblématique qui est restée ouverte jusqu’en 2007. Ma mère allait y danser adolescente au début des années 1960. J’ai appris plus tard que le lieu avait ouvert en 1919 et que des milliers de personnes avaient assisté à la soirée d’ouverture. J’ai été interpellée par la clientèle. Ces gens n’appartenaient pas à l’élite qui fréquentait les cocktails, mais plutôt à la classe ouvrière. Ils ont dû éprouver un vif désir de danser après toutes ces années de chagrin, et l’orchestre de jazz Dixieland y jouait une musique étonnante et nouvelle. Je me suis renseignée sur ce phénomène de professeurs de danse et le sujet m’a passionné. Ces jeunes hommes et femmes qu’on pouvait engager pour 6 pence par danse. Qui en avait eu l’initiative ? Les jeunes hommes – dont la confiance en eux-mêmes avait été fracassée par la guerre – qui cherchaient un peu d’intimité ? Ou les jeunes femmes qui voulaient simplement être prises dans les bras d’un homme, quand tous ceux qui pouvaient leur convenir avaient été pulvérisés sur les champs de bataille ? C’est fascinant de s’intéresser à un tel lieu et à un tel mode de relations.
P — Quelle serait la différence entre le deuil d’après-guerre chez les hommes et chez les femmes ?
A.H. — À l’époque, du moins en Grande-Bretagne, il n’y avait pas d’incitation à parler de ces traumatismes et du chagrin. Et les représentations de la virilité, bien que menacées par l’émergence des femmes dans le monde du travail, étaient encore bien établies. Je pense que l’expérience était dure pour les deux sexes et qu’on aspirait peut-être à enfouir la peine pour recommencer à vivre. Chose extraordinaire, les funérailles du Soldat inconnu ont donné aux gens la possibilité de pleurer, de faire le deuil, de se libérer. C’est d’autant plus important, car jusqu’alors toute cérémonie avait été refusée aux familles. Et ce corps du Soldat inconnu pouvait être celui du fils, du frère ou de l’amant de n’importe qui. Cela a été une catharsis pour beaucoup. Je pense que nous, Britanniques, sommes un peu étranges à cet égard. Voyez l’extraordinaire débordement de chagrin pour la disparition de la princesse Diana, par exemple. Lorsqu’on interrogeait les gens dans la rue, ils pleuraient non seulement pour cette femme qu’ils n’avaient jamais connue, mais pour la perte de leurs proches. Nous manifestons rarement notre chagrin en public, mais quand nous le faisons, ce peut être un débordement.
À propos du livre
En novembre 1920, la Grande-Bretagne est endeuillée. Le Soldat inconnu a été rapatrié et son inhumation à Londres est imminente. Les trois héroïnes du roman sont à l’image de cette génération de mères, d’amantes ou de sœurs, qui a été anéantie par le deuil. Toutes ressentent la nécessité d’accomplir un geste humain, celui d’assurer aux défunts une place spécifique. Ces trois personnages ont des airs d’Antigone. Il y a Hettie, une danseuse de compagnie qui se déhanche sur des ragtime endiablés ; Evelyn, dont le fiancé a été tué et qui travaille au bureau des pensions de l’armée, et Ada, qui aperçoit son fils à tous les coins de rue. Dans Le Chagrin des vivants, Anna Hope ausculte avec talent le chagrin, le deuil collectif, mais aussi la vie. « La pensée de l’approche du centenaire m’est apparue, alors que j’étais plongée dans l’écriture depuis six mois », précise l’auteure. Elle fait exister le décor de manière saisissante grâce à de nombreux détails historiques. On est pris d’emblée par la justesse psychologique de ses portraits.