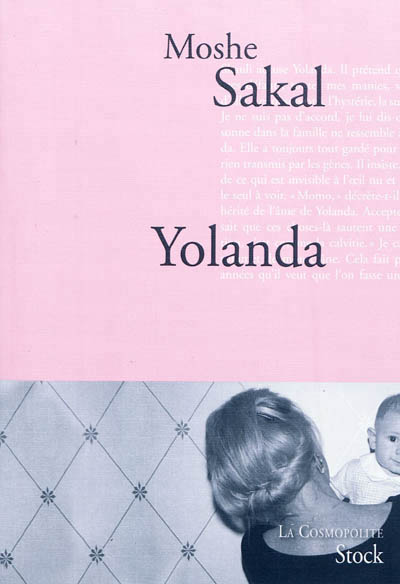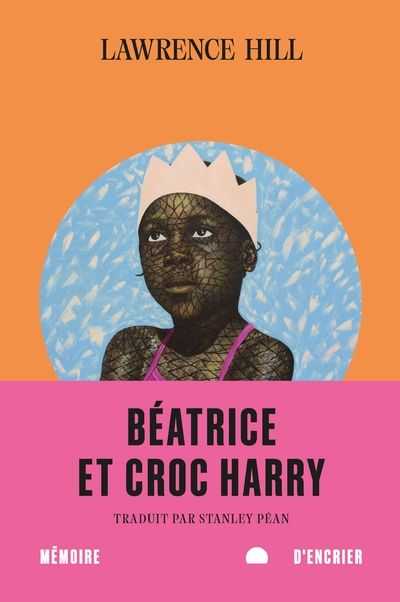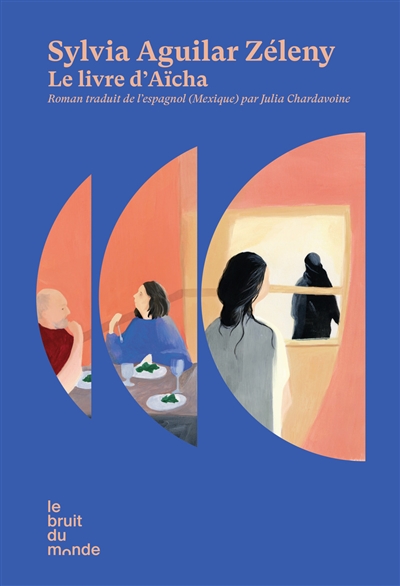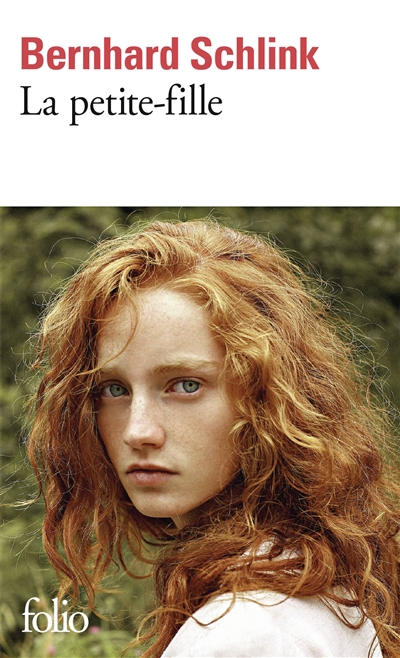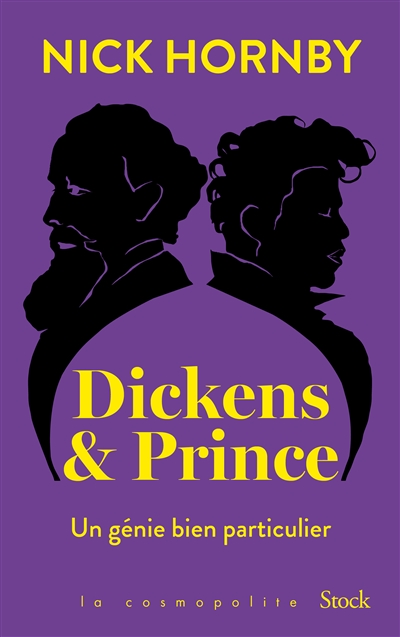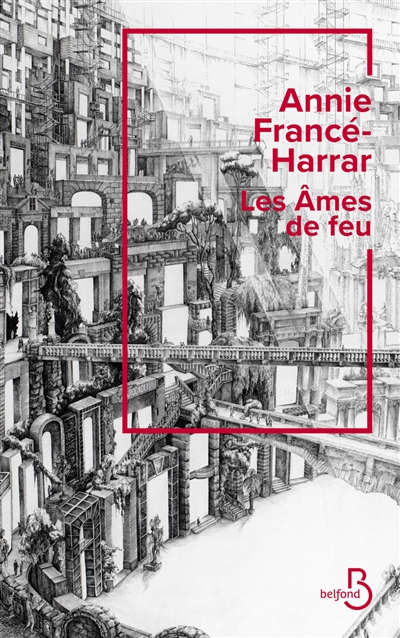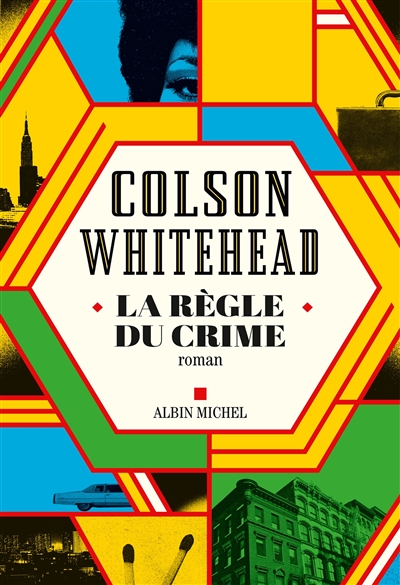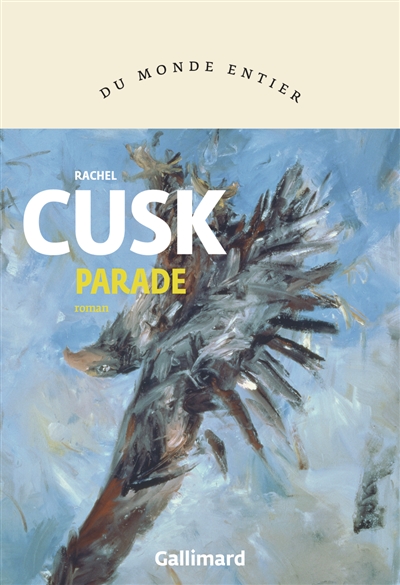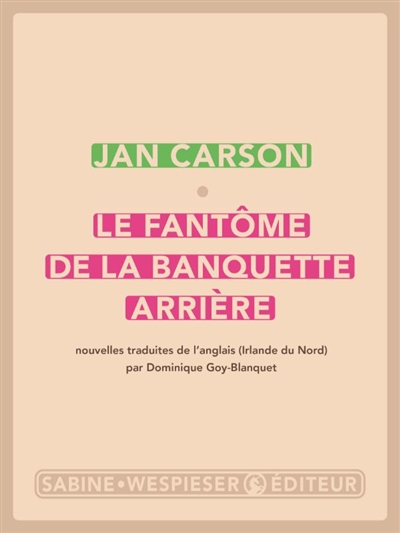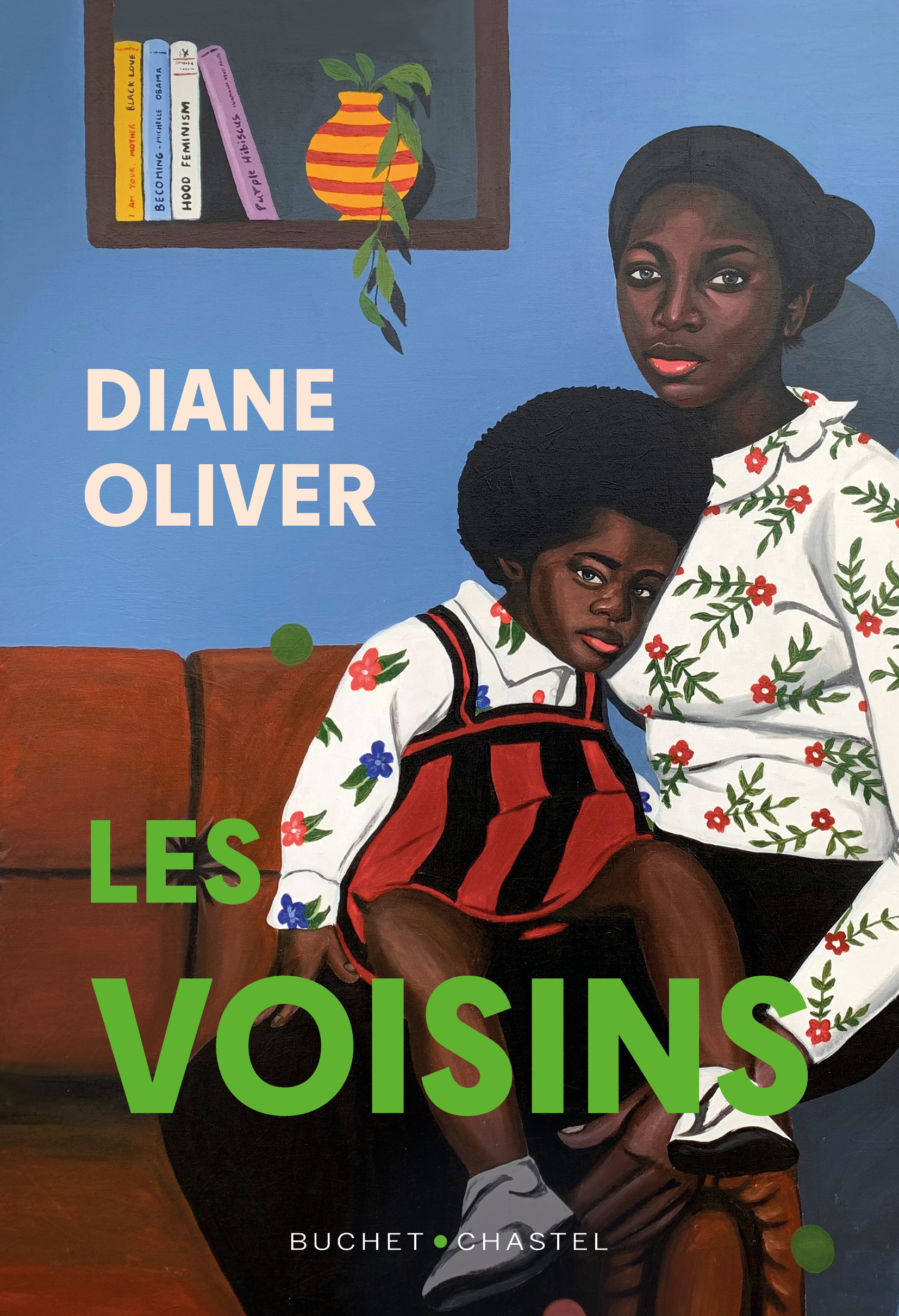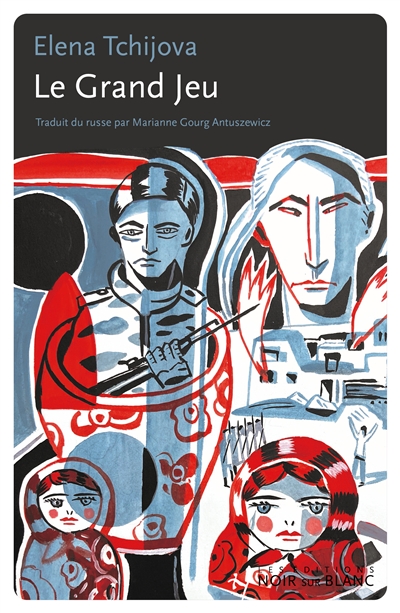PAGE : Vous racontez la vie de votre famille par le prisme de ce personnage emblématique, Yolanda. Pourquoi ce désir de lui rendre hommage ?
Moshe Sakal : C’est un personnage qui m’intrigue car il s’agit d’une femme très fragile et forte à la fois. Yolanda est pleine de contradictions, de lubies. D’humeur capricieuse, elle ne connaît que les hauts sommets ou les abîmes les plus profonds de l’existence. Une belle femme libérale et même féministe à sa manière, qui a choisi, par principe, de ne pas immigrer en Europe ou aux États-Unis, mais en Israël où elle vit complètement cloitrée dans son propre royaume de bourgeoise européenne fantasmée. Yolanda représente à merveille la communauté juive du Caire ou au moins la partie de cette communauté qui est venue s’installer en Palestine et qui y a vécu de longues années, dans une sorte de « double exil » ; car au Caire Yolanda regrette Paris, alors qu’à Tel-Aviv elle regrette Le Caire où elle regrette Paris.
Mais Yolanda est aussi un roman de formation, dans lequel Yolanda incite son petit-fils à vivre et à assumer sa différence, tout comme elle.
Ce personnage est très inspiré par ma grand-mère maternelle d’origine cairote, même si j’ai changé plusieurs détails importants. Je l’ai délibérément écrit de manière équivoque, comme le reste de l’œuvre, d’ailleurs. C’est-à-dire que le lecteur ne peut jamais démêler ce qui relève de la fiction de ce qui est vrai. C’est un genre littéraire qui m’intrigue tout particulièrement, car il mêle le réel et l’imaginaire, il suggère un univers bien distinct mais non pas illusoire. En lisant un roman qui est écrit de cette manière, on se rend compte non seulement de l’effet que la vie peut avoir sur la littérature, mais aussi de l’immense effet que produit la littérature sur la vie.
P. : Pourquoi cette volonté de raconter la vie de votre famille ?
M. S. : Mes grands-parents ont laissé derrière eux une vie pleine et belle en Égypte et en Syrie pour s’installer en Israël dans les années 1940. Leur culture était européenne d’une part et arabe d’autre part. Ils se sont installés en Israël mais sont toujours restés – paradoxalement – dans une sorte de Diaspora. À leurs enfants ils ne parlaient ni en français ni en arabe. Ils les ont élevés pour devenir de vrais sabras, des israéliens « de souche » et ne leur ont légué qu’une seule langue et qu’une culture forcément appauvrie et auréolée d’un grand refoulement. Yolanda reflète un phénomène très présent en Israël depuis une dizaine d’années : la tentative d’une nouvelle génération d’intellectuels israéliens de retrouver leurs racines et leur culture en Diaspora, dans leur histoire familiale et dans leur passé mythique. Ceci après que les deux générations précédentes d’Israéliens – celles de nos parents, certes, mais tragiquement celle de nos grands-parents aussi – ont tout fait pour en gommer les traces afin de répondre à une certaine conception du nouvel Israélien. Yolanda pose aussi la question – essentielle en Israël – de l’identité nationale : que signifie être Israélien ? Quelle est la place de la culture juive diasporique dans l’identité d’un Israélien né dans le pays ? Le roman s’interroge sur la manière dont les sabras « authentiques » regardent les immigrés juifs – et notamment les ressortissants des pays arabes – depuis la création de l’État en 1948 et jusqu’à nos jours. La population israélienne a longtemps été soumise à une sorte de diktat collectif qui l’obligeait à tourner le dos à la Diaspora, à oublier l’histoire familiale afin de créer une nouvelle identité nationale basée sur ce melting-pot que certains considèrent comme raté. La création littéraire d’auteurs israéliens de cette « troisième génération », vague dans laquelle Yolanda s’inscrit, est certainement un des signes que cet effacement forcé de l’Histoire est maintenant remis en question et reconsidéré d’un œil critique. Dans mon livre je regrette le Juif cosmopolite, l’homme du monde. Pour le retrouver, je dois donc tourner les yeux vers la génération de mes grands-parents tout en sautant celle de mes parents, « la génération muette ».
P. : Quel a été l’accueil de Yolanda auprès des vôtres ?
M. S. : Je n’ai pas eu le courage de donner à lire le livre à ma mère jusqu’à ce qu’aucun changement n’ait plus été possible. Je lui ai laissé le manuscrit chez mon frère. Au bout d’un jour, j’ai reçu un texto de sa part : « C’est formidable, la manière dont tu as fait revivre le passé, la famille, la vie en Égypte et à Tel-Aviv, bravo ! » J’ai répondu, très soulagé évidemment : « Alors je comprends que tu as terminé la lecture ». Et elle : « Mais pas du tout, je suis à la troisième page… » Il va sans dire que je n’ai pas fermé l’œil pendant toute une semaine. Mon père est un orfèvre ; c’est un vrai artisan et il n’avait jamais lu mes précédents livres. Mais il a été évidemment intrigué par l’histoire familiale de Yolanda qu’il a fini par lire et apprécier. Il a été très touché par le livre et je pense aussi que le fait que le roman ait gagné une belle reconnaissance auprès des lecteurs et de la critique en Israël l’a ému.