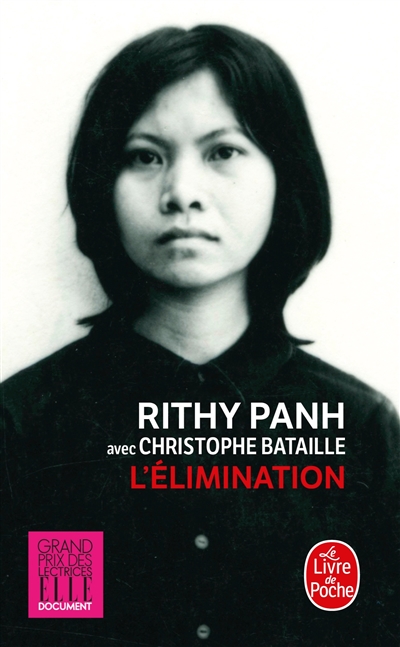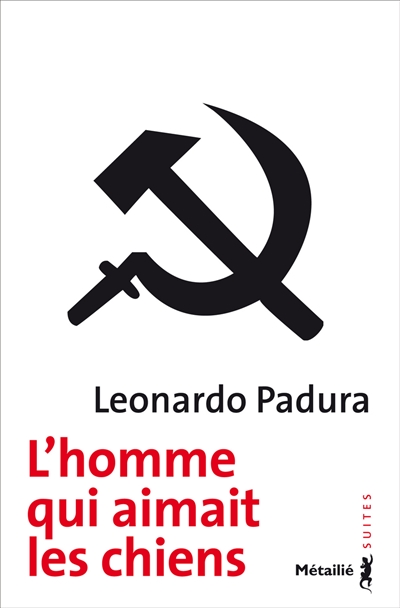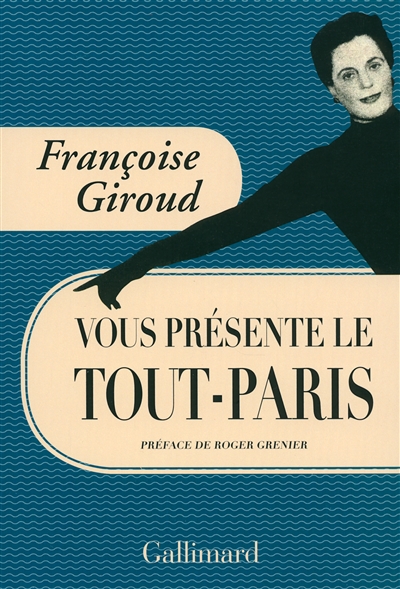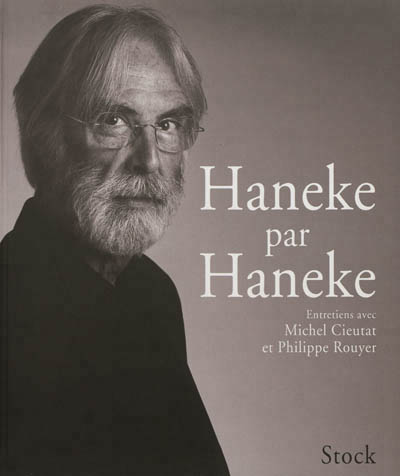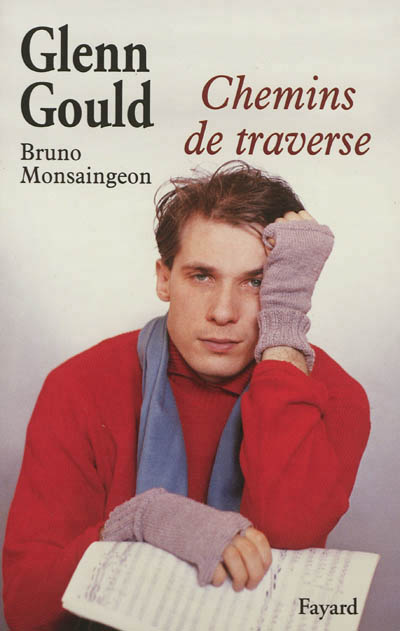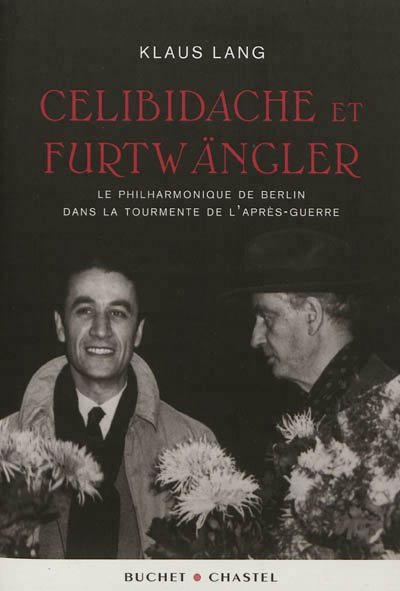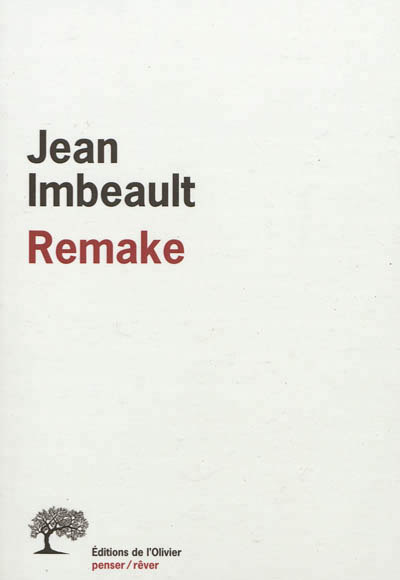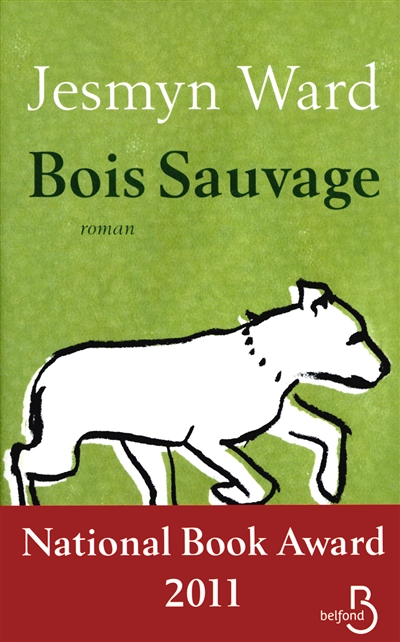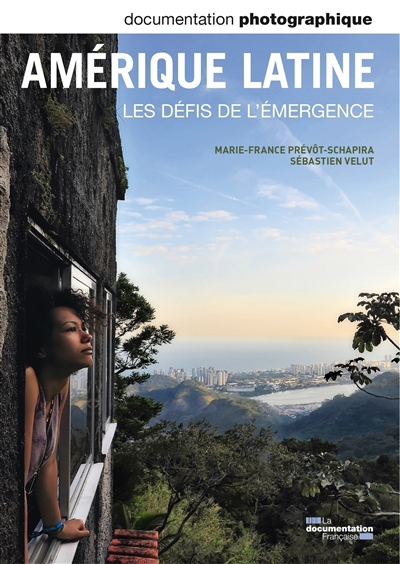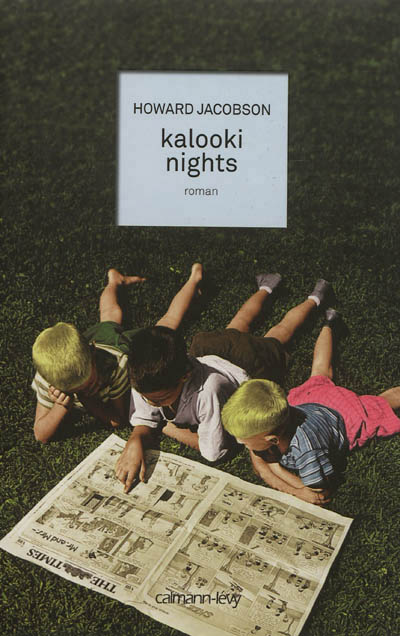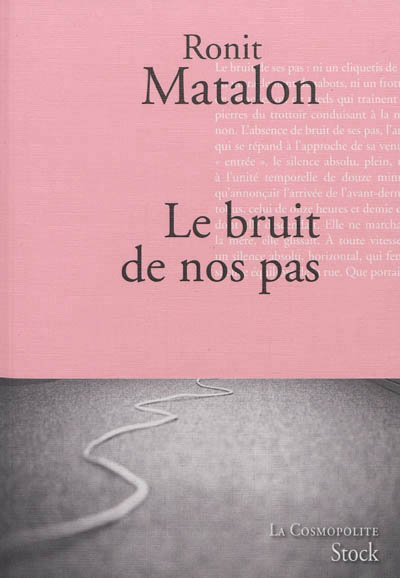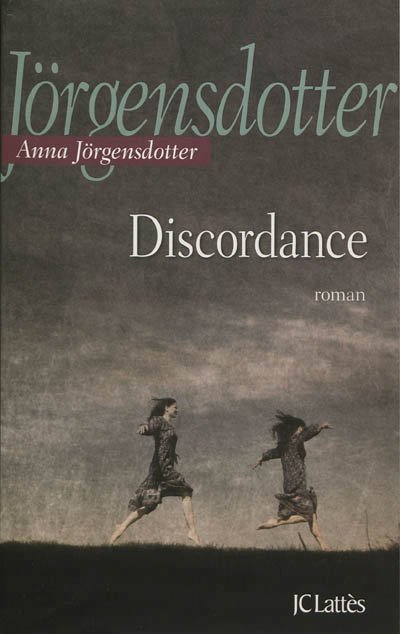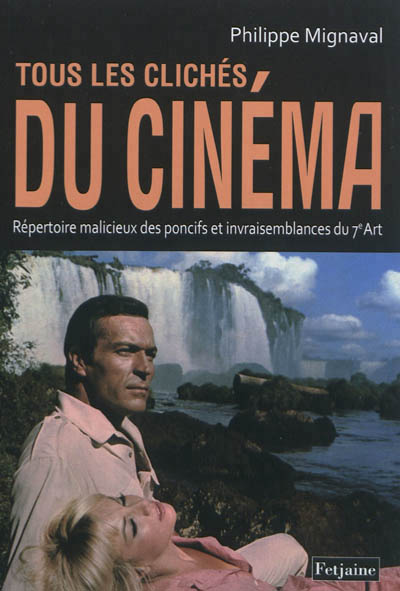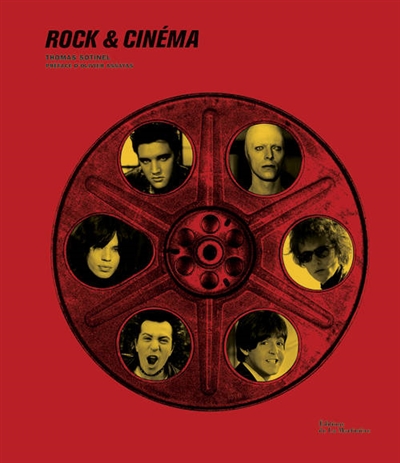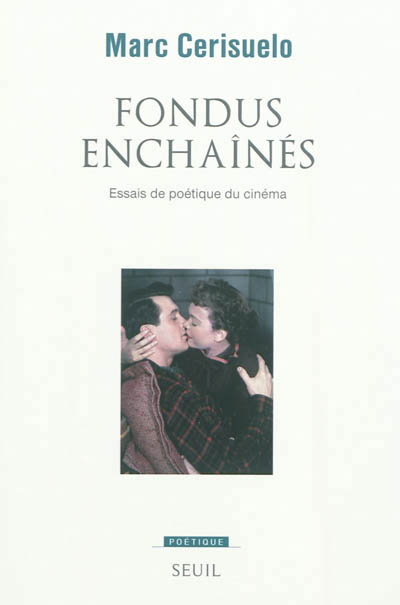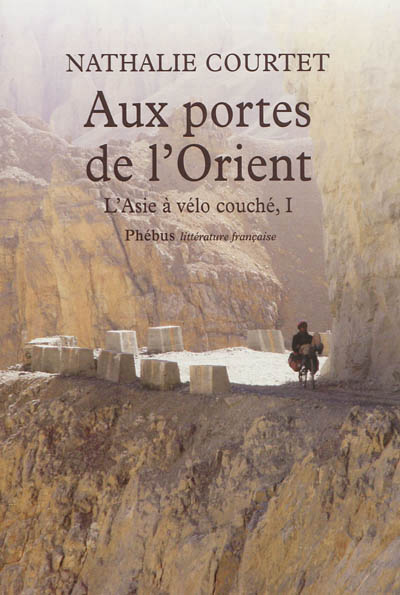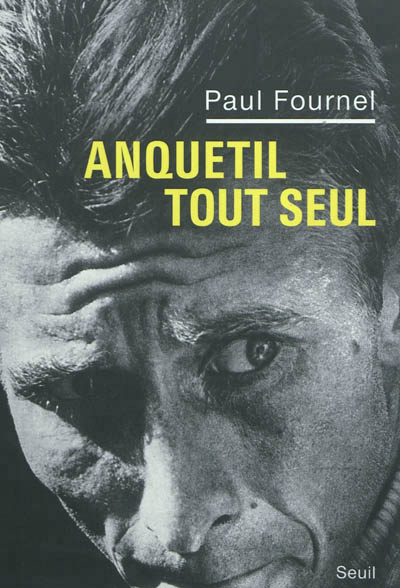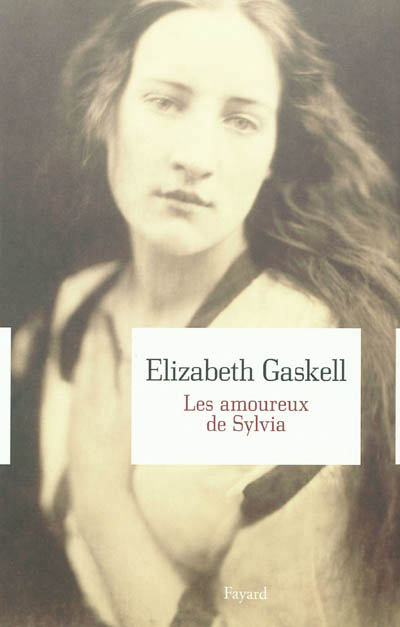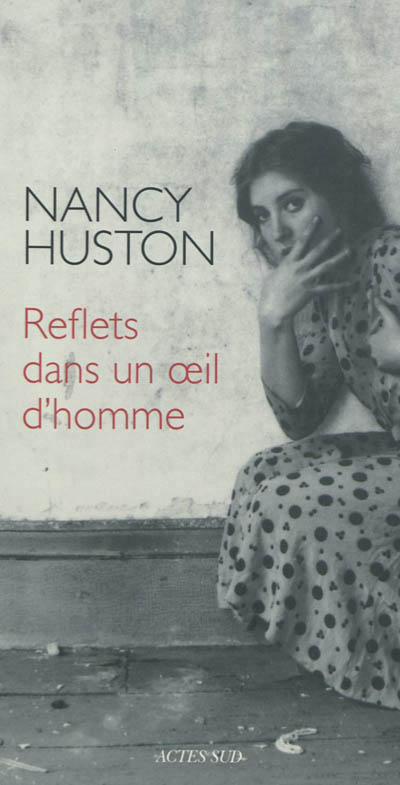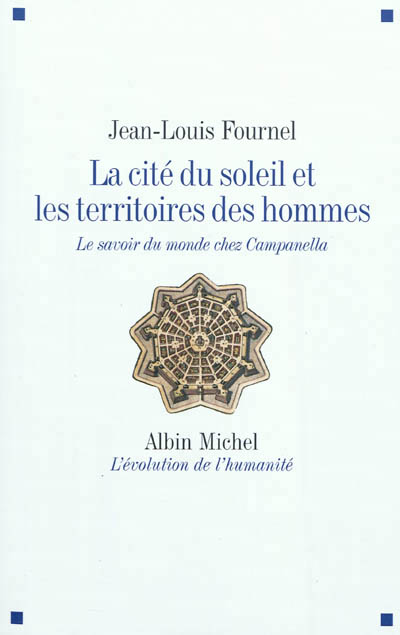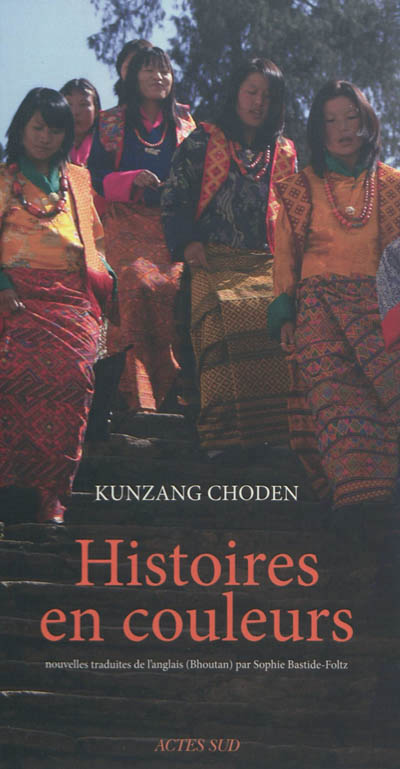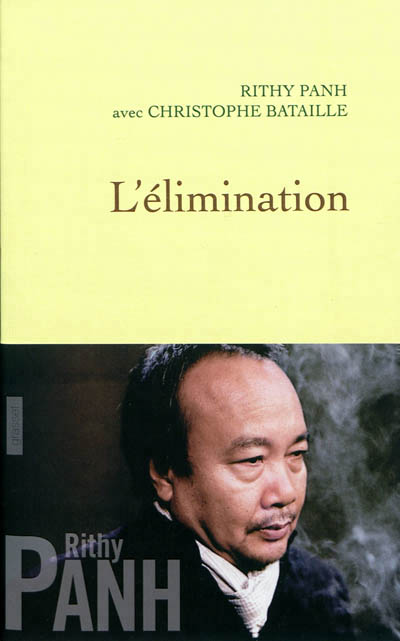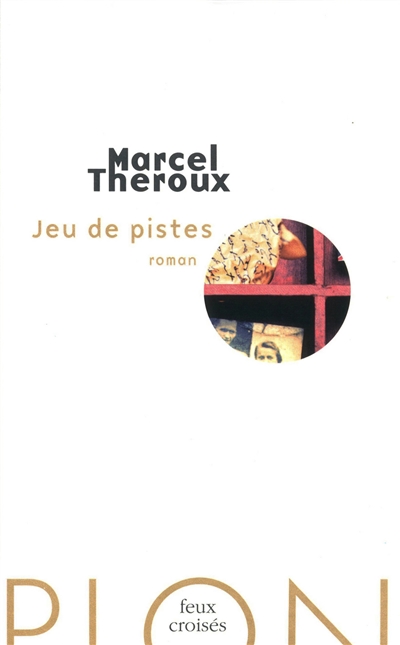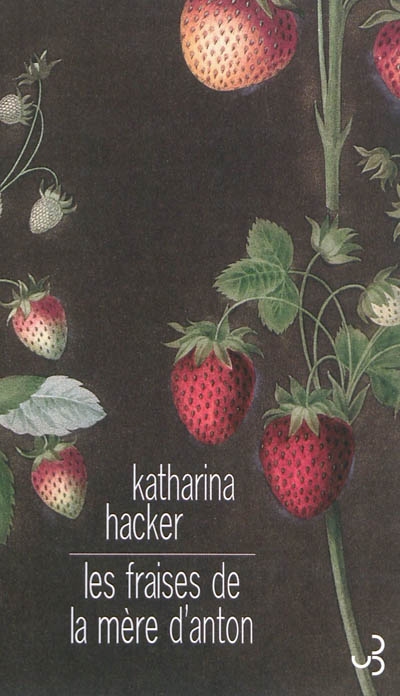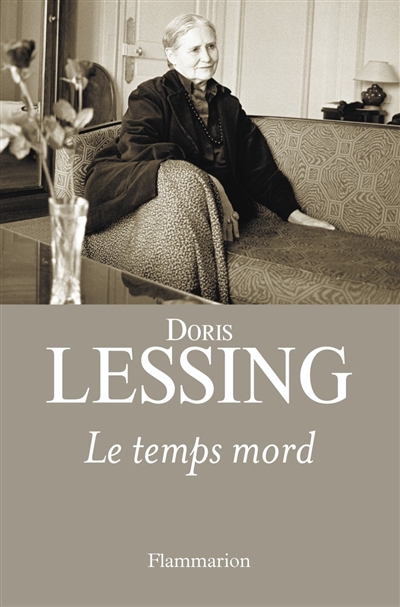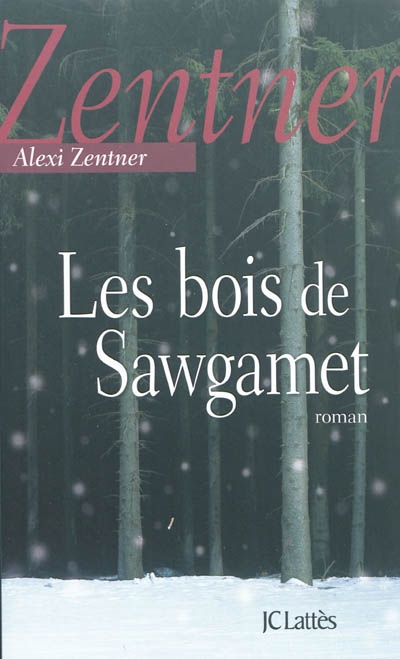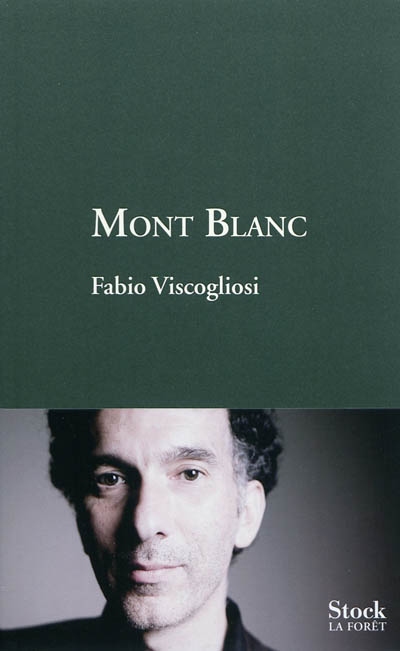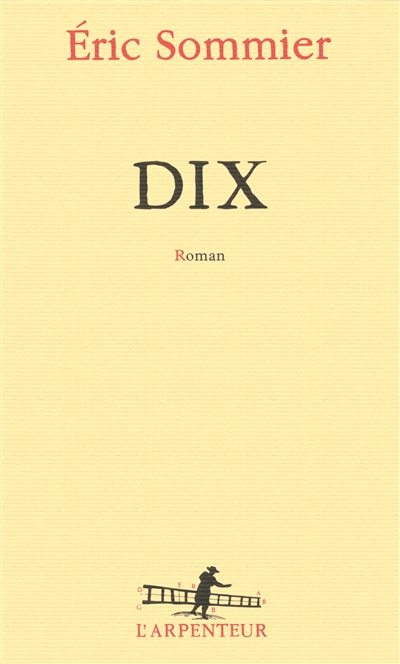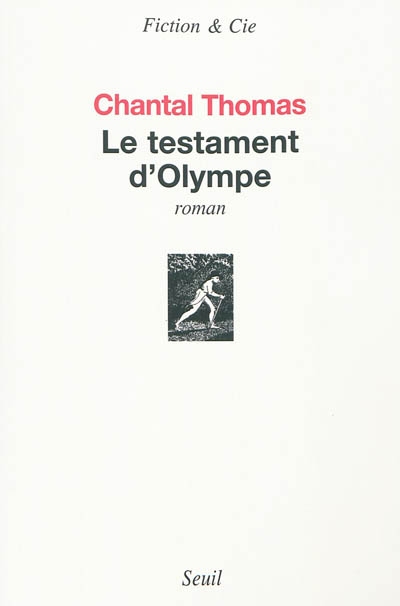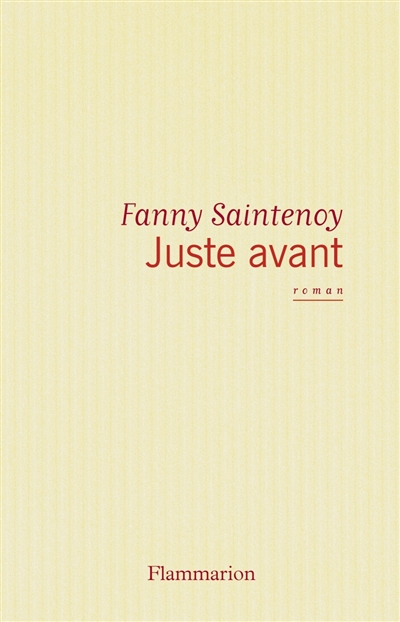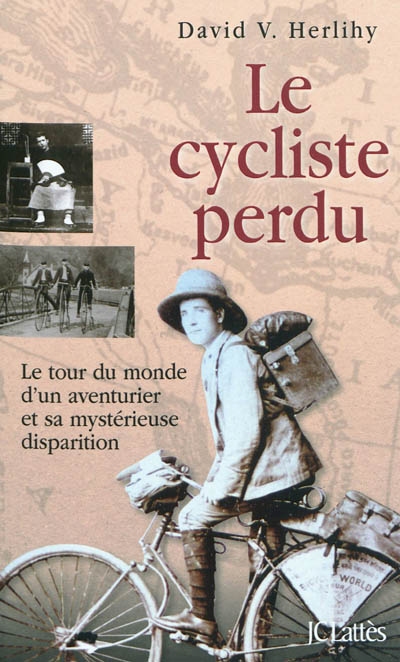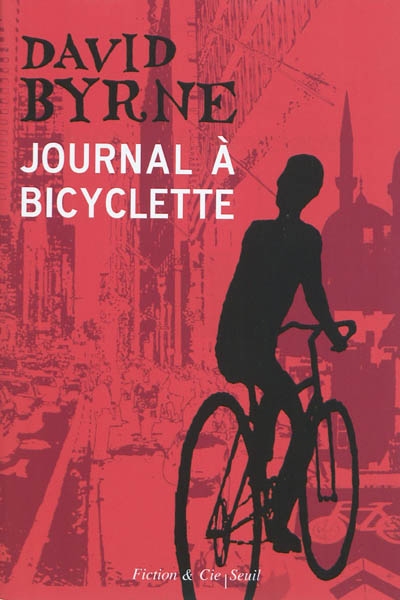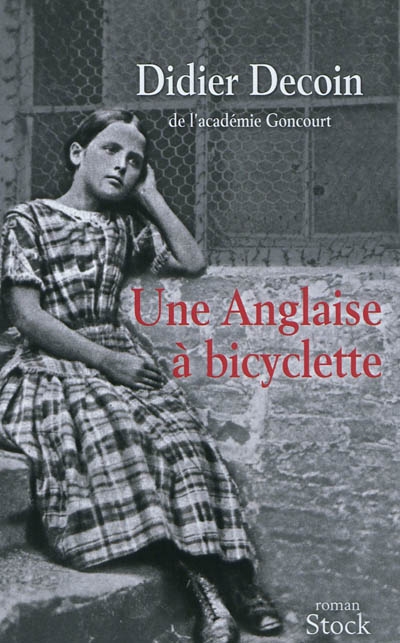Littérature étrangère
David Grossman
Tombé hors du temps
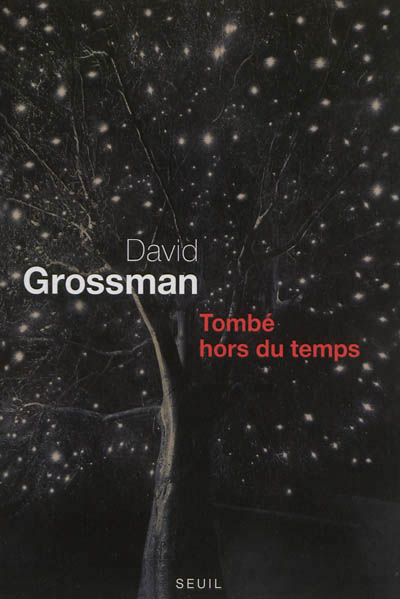
-
David Grossman
Tombé hors du temps
Traduit de l’hébreu par Emmanuel Moses
Seuil
11/10/2012
204 pages, 17,50 €
-
Chronique de
Géraldine Huchet
Pigiste () -
❤ Lu et conseillé par
3 libraire(s)
- Aurélie Janssens de Page et Plume (Limoges)
- Jean-Baptiste Hamelin de Le Carnet à spirales (Charlieu)
- Alexandra Romaniw de L'Atelier (Paris)
✒ Géraldine Huchet
(Pigiste , )
Après le succès critique et public de Une femme fuyant l’annonce, prix Médicis Étranger l’année dernière (et qui vient de paraître en poche), David Grossman, l’une des voix les plus importantes de la scène littéraire israélienne, livre ce « récit pour voix », beaucoup plus court et néanmoins d’une grande force.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’écrivain, farouche partisan de la paix, a été surpris dans la rédaction de Une femme fuyant l’annonce (Points), en 2006, par la mort de son fils de 20 ans, tué pendant la guerre menée par Israël au Sud-Liban. La mort d’un enfant… On sait bien que toute mort est horrible mais celle d’un enfant paraît encore plus insupportable et injuste. Grossman pensa alors que continuer à écrire son roman était bien peu de chose face à cette perte. Finalement, c’est l’écriture qui lui a permis de tenir. Et voilà que, quelques années plus tard, il écrit Tombé hors du temps, livre dont l’unique sujet est la mort des enfants. Une approche frontale, mais poétique, puisque ce texte n’est pas véritablement un roman, plutôt un chœur formé de voix qui s’entremêlent pour dire la douleur, en vers, en prose. C’est un chant, une prière ininterrompue. Bouleversante. Pourquoi ? Parce que l’écrivain n’oublie pas l’importance des mots, de la parole. Il raconte. Dire inlassablement pour ne pas oublier, comme une litanie qui, peut-être, permettrait d’apaiser pour un moment l’absurde culpabilité qui vient hanter le père incapable de protéger son enfant. La fable inventée par l’écrivain est simple mais belle : le chroniqueur de la ville, qui est mandaté par le duc pour relater les faits et gestes des habitants (on comprend vite que tous ont perdu un enfant), commence son récit en relatant le dîner d’un couple. Cela fait cinq ans que leur enfant est mort, cinq ans qu’ils se sont tus. Quand soudain, leur voix revient, l’homme décide de partir « là-bas », c’est-à-dire dans un endroit où on peut parler de la mort. Il ne veut pas retrouver son fils mort dans un au-delà virtuel, seulement accepter cette mort, pouvoir enfin en parler. Il va ainsi marcher. D’abord autour de chez lui, puis peu à peu de plus en plus loin, jusqu’aux confins de la ville, à flanc de colline, pour trouver l’endroit de l’apaisement. D’abord seul, il est bientôt rejoint par d’autres, cordonnier, sage-femme, professeur, et puis le duc et le chroniqueur lui emboîtent le pas. Il est l’homme qui, tel le joueur de flûte du conte – mais délivré du désir de vengeance qui animait celui-ci –, entraîne ses semblables hors de la ville afin de les guérir. Retrouver la parole, pour ensuite retrouver la vie. Ainsi, dit le centaure, incroyable personnage inventé par l’auteur, qui, attaché à un bureau d’écolier, ne peut s’arrêter d’écrire : « Je ne l’avais pas compris plus tôt. / Le père ne meurt pas / Son fils, ce n’est pas mon fils / Que je ranime / Et fais trembler. C’est moi-même / Que je rassasie / De mots, de chimères, / De formes pareilles / À des épouvantails / Collés maladroitement / Avec de la paille / Et de la boue / Pour ne pas cesser et me pétrifier. […] / Et c’est mon âme / Qu’on coupe / Dans le blanc froid entre mot / Et mot. C’est / Moi, / Qui gigote comme proie / Dans la gueule / De l’absolu. » Trouver des mots pour dire l’inacceptable, c’est ce vers quoi tendent les protagonistes de cette fable poignante. À lire, de préférence, à voix haute, pour lui donner toute son ampleur.