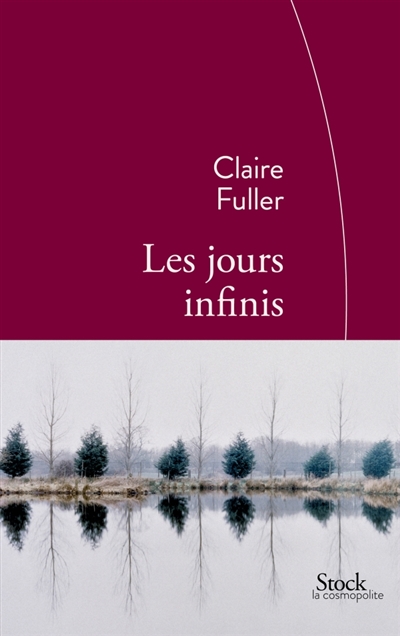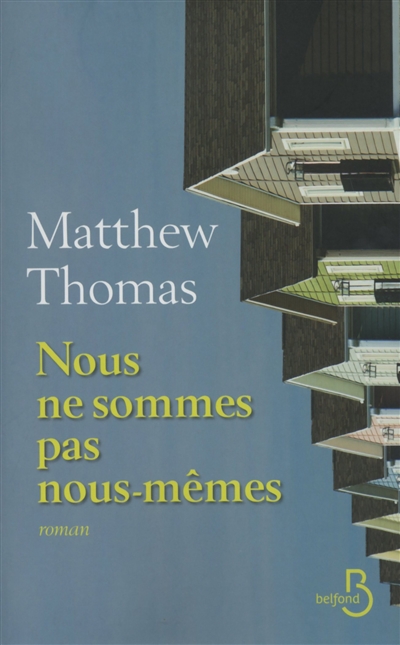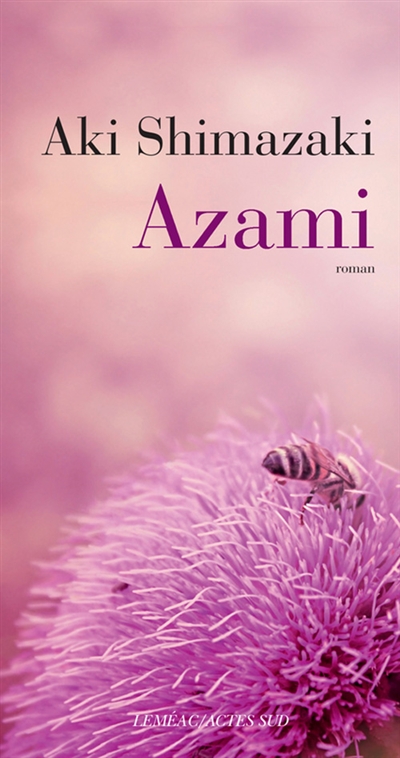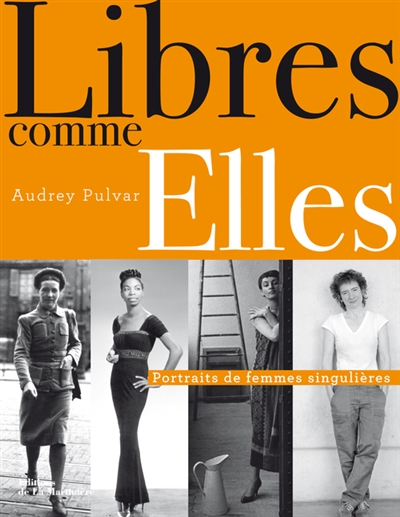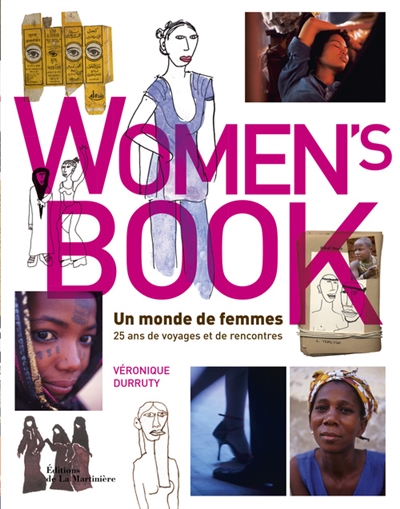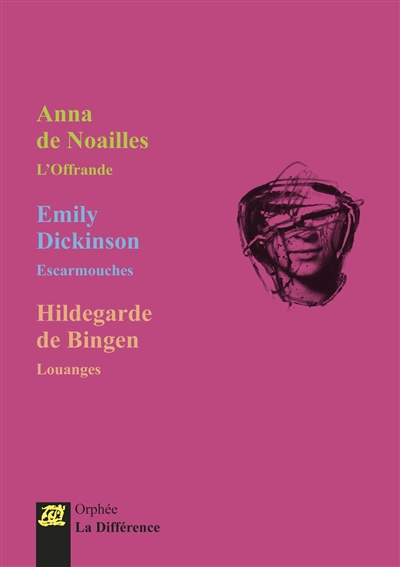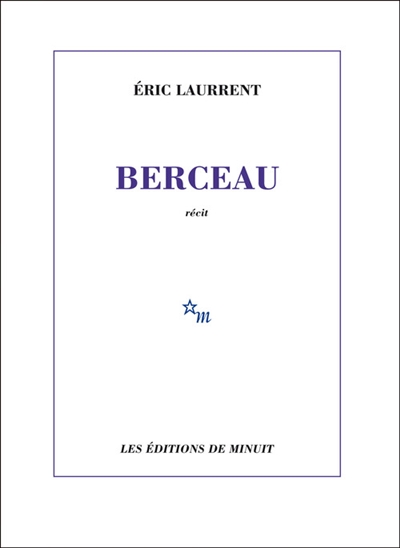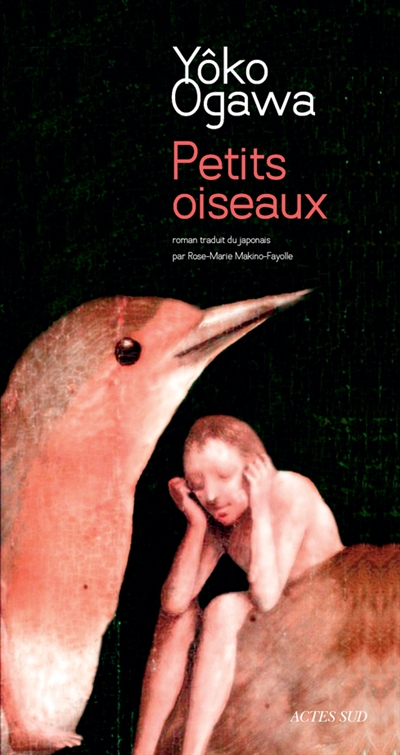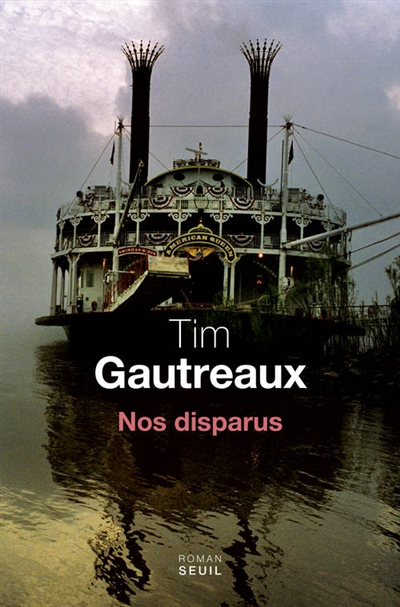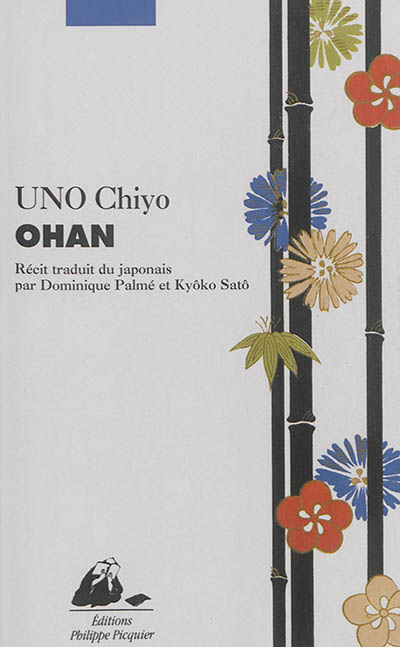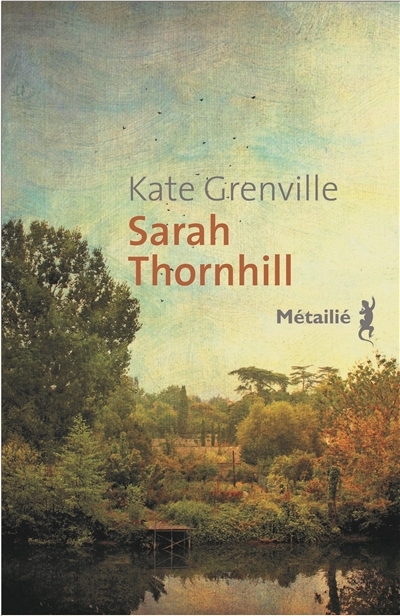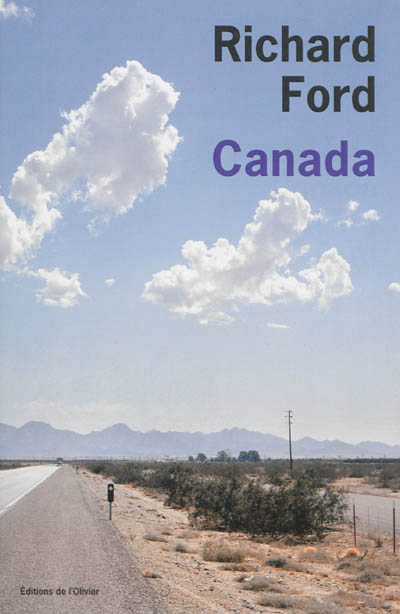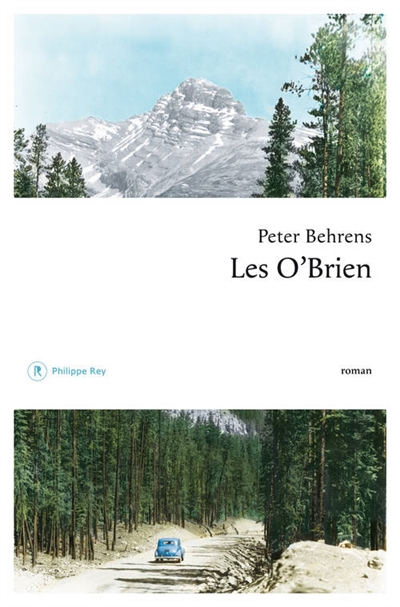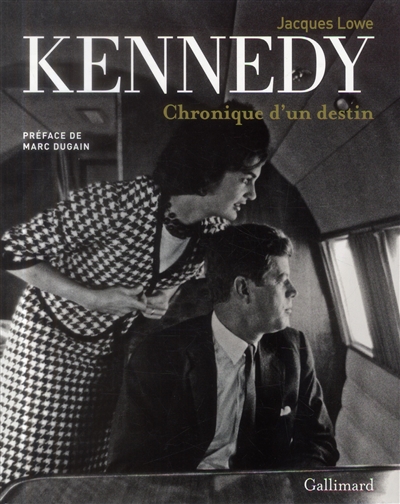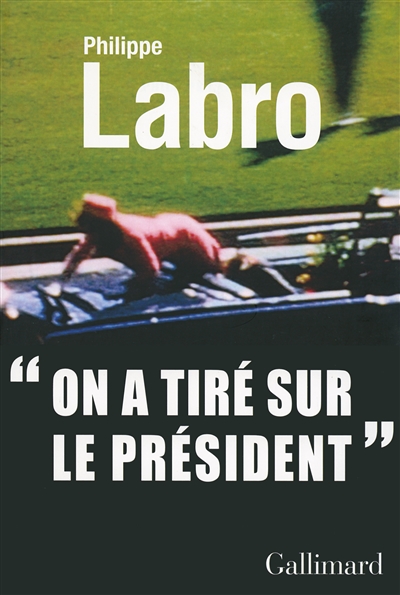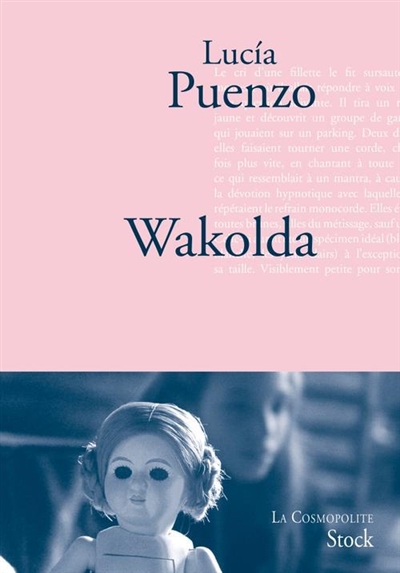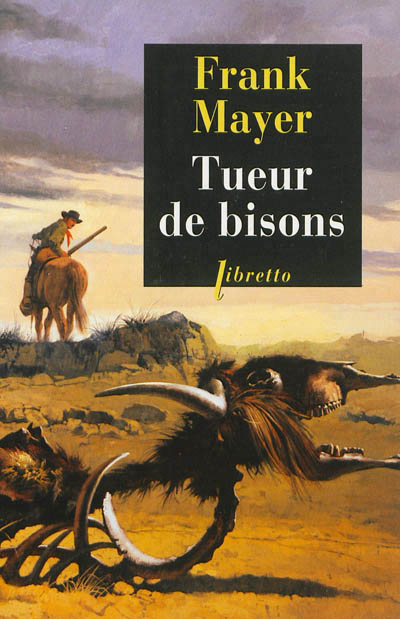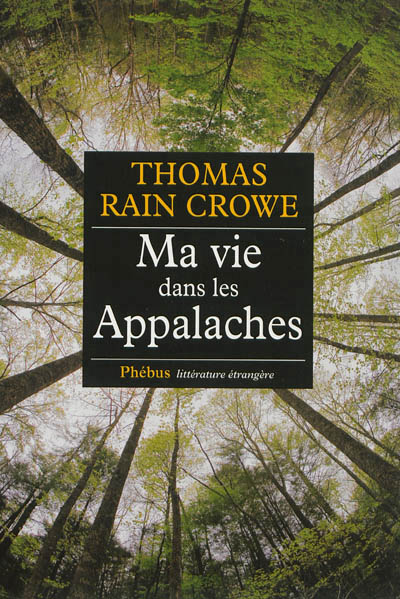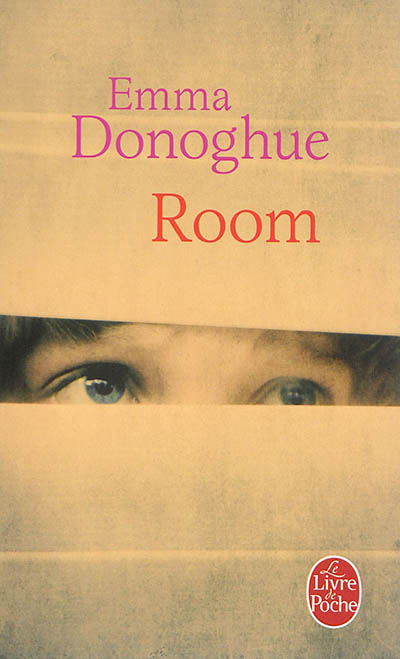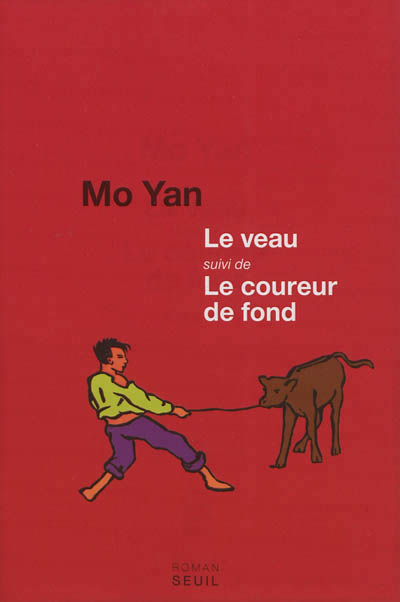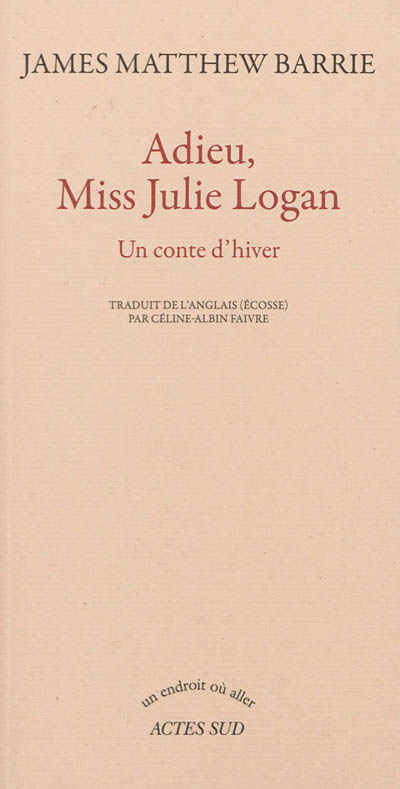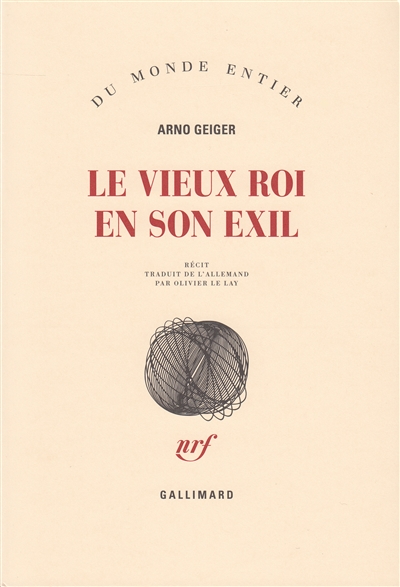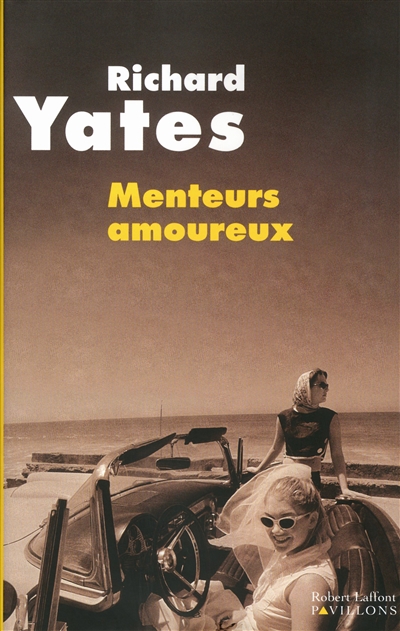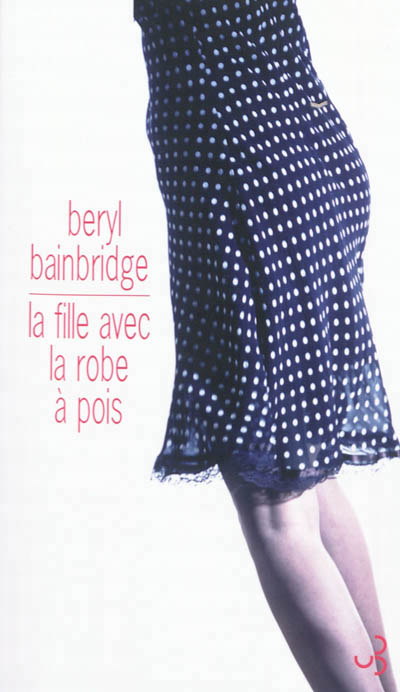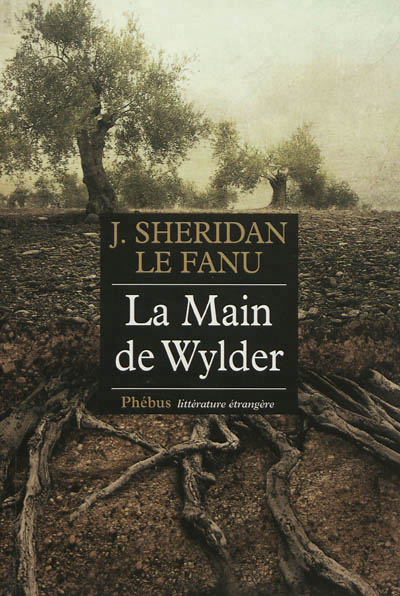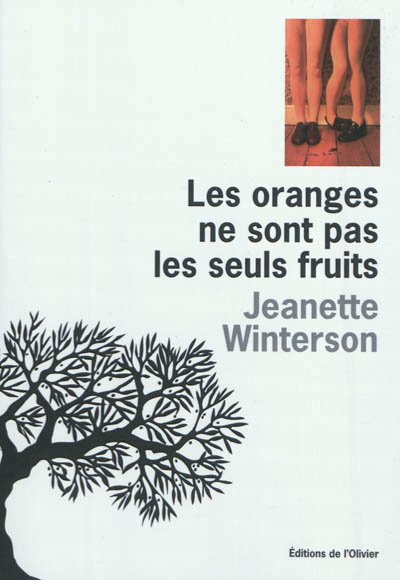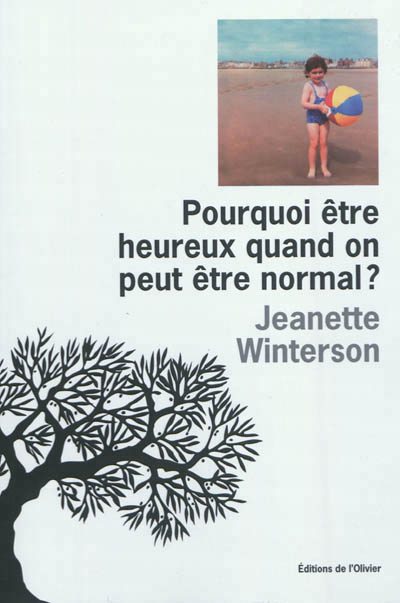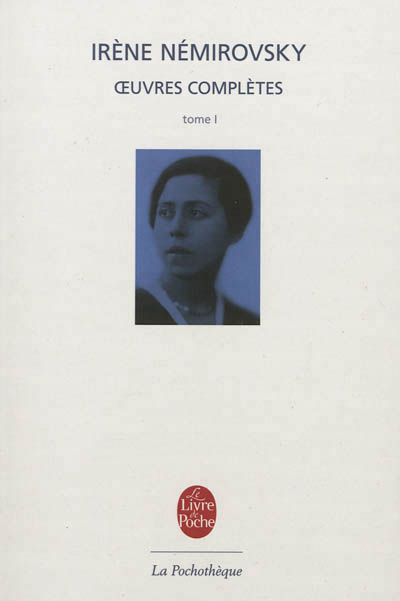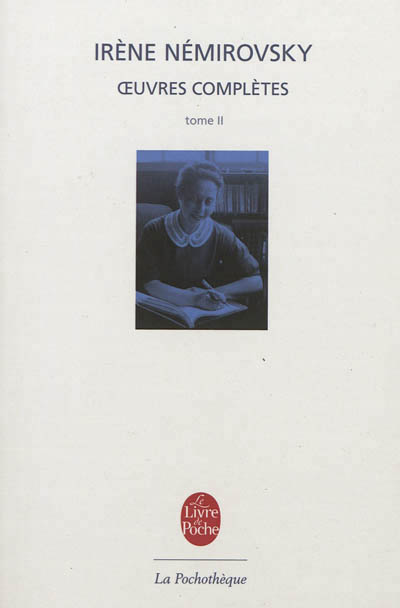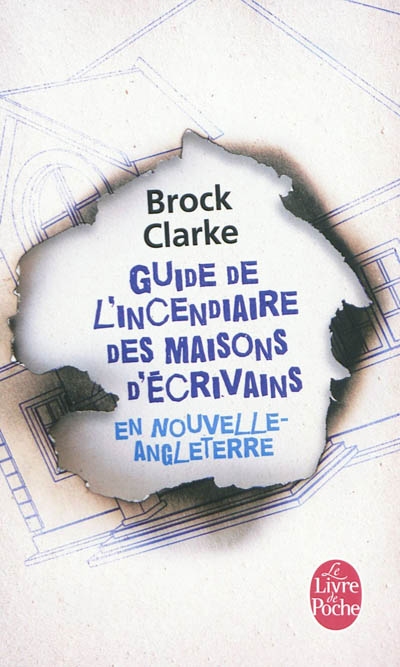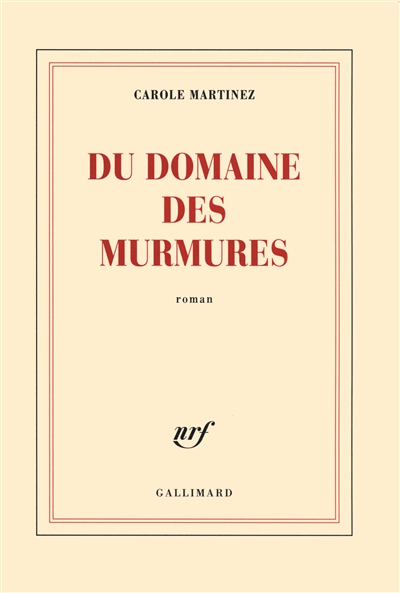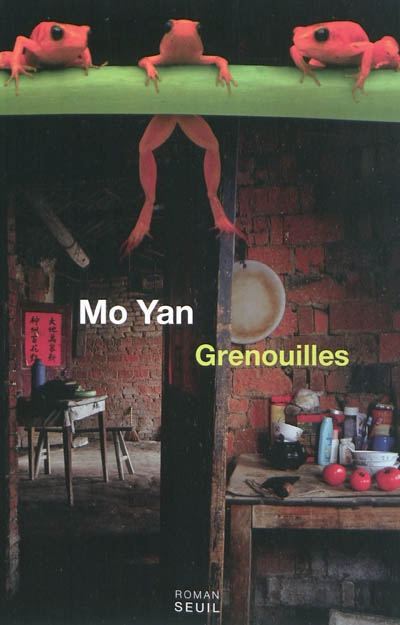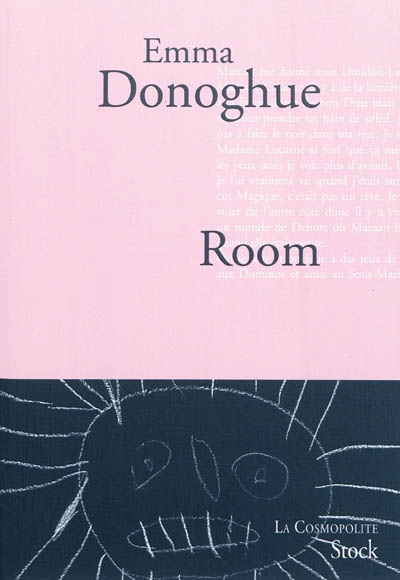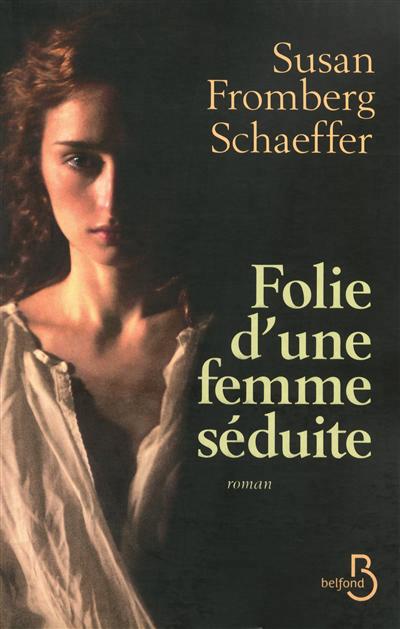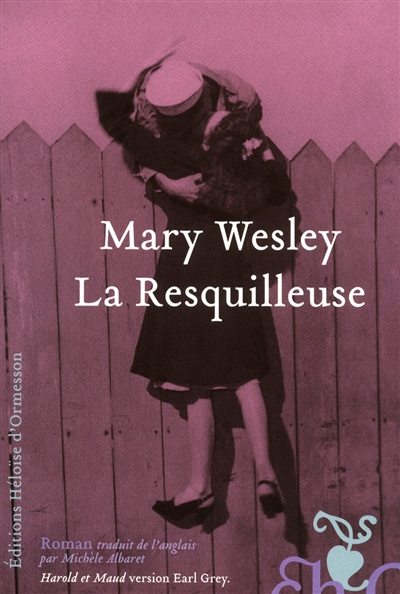Littérature française
Lydie Salvayre
Pas pleurer

-
Lydie Salvayre
Pas pleurer
Seuil
21/08/2014
288 pages, 18,50 €
-
Chronique de
Sandrine Maliver-Perrin
- ❤ Lu et conseillé par 16 libraire(s)
✒ Sandrine Maliver-Perrin
( , )
PRIX GONCOURT 2014
Fille d’exilés espagnols qui ont fui le franquisme, la grande Lydie Salvayre explore les méandres de la mémoire et de l’Histoire dans ce roman puissant et foisonnant, qui nous ramène dans l’Espagne rurale d’avant Franco.
Pas pleurer. Ce titre qui ne peut laisser indifférent, Lydie Salvayre le doit à la poétesse russe Marina Tsvetaïeva. Dans une lettre adressée à Boris Pasternak, en se remémorant des sentiments douloureux, cette dernière s’arrête et note : « pas pleurer ». Mais ce « pas pleurer », c’est aussi une posture héritée par l’auteure de sa mère, jeune Catalane en exil et arrivée seule en France à l’adolescence. Elle n’a jamais pleuré et l’interdit à sa fille. Cette mère parle un français de guingois, une langue baroque truffée d’hispanismes et de mots inventés. Lydie considèrera longtemps la langue de son enfance comme un handicap et n’aura de cesse de cultiver à l’école et avec les livres « la belle langue ». Devenue adulte, elle comprend que cette langue française tant admirée et celle de ses parents ne vont pas l’une sans l’autre et font sa force. Montse, la mère de la narratrice, nous donne à entendre cette langue maternelle extraordinaire et sa manière de rafraîchir le français. Un délice à la lecture. Hommage à la mère, mais également hommage à Georges Bernanos, l’écrivain des Grands cimetières sous la lune (Le Castor astral), « témoignage d’un homme libre » dénonçant les répressions franquistes. La langue bancale mais envoûtante de la mère dialogue avec celle de l’auteure pour raconter ce court moment où les anarchistes prirent le pouvoir en Espagne en août 1936. Témoins de cette période tragique de l’Histoire, ils nous la content chacun à leur manière et à leur tour. S’entrelacent ainsi le texte de Bernanos, que la narratrice feint de lire, et la parole de la mère, longtemps retenue, qui raconte, soixante-quinze ans plus tard, ces trois mois d’euphorie qui la marquèrent à jamais. Que dire de plus sans trop en dévoiler, sinon que, dans ma langue à moi, on dit d’un roman de cette qualité que c’est un chef-d’œuvre.