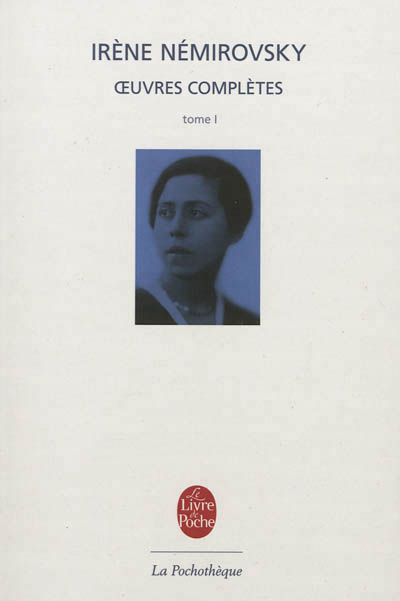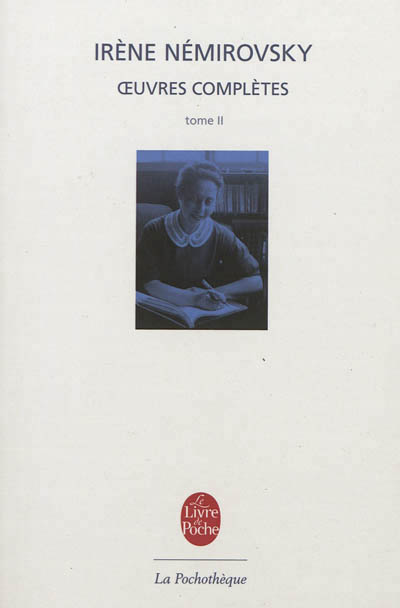PAGE : Qui est à l’origine de ce projet ? Combien de temps avez-vous travaillé dessus et comment ?
Olivier Philipponnat : C’était le désir de Denise Epstein, fille aînée d’Irène Némirovsky, de réunir les œuvres de sa mère dans une édition à la fois exigeante, élégante et accessible à tous. C’était une chance unique de présenter ses derniers textes inédits – nouvelles, dramatiques pour la radio, scénarios de cinéma –, dont certains n’ont été retrouvés que récemment. C’est le cas par exemple des quatre Dialogues comiques qui ouvrent le premier volume : rédigés à 18 ans, assez délurés, ils n’ont d’intérêt que si on veut bien les comparer au Bal ou à David Golder, composés quelques années plus tard. Ces saynètes montrent qu’Irène, comme le personnage d’Ada dans Les Chiens et les loups, commence par exceller dans la caricature, la satire, la dérision. C’est une dimension qu’il faut garder à l’esprit quand on lit la suite de l’œuvre. Il est aussi très intéressant de voir comment, entre L’Ennemie, roman introuvable de 1928 plein de bile et de haine, et Le Vin de solitude (1935), qui en est l’amplification, Irène est parvenue à surmonter sa rancœur contre sa mère pour transformer un mélodrame en roman de formation. Seules des œuvres complètes permettent ce genre de rapprochements et c’est pourquoi les œuvres posthumes sont ici présentées dans l’ordre de leur composition, non de leur publication.
Pour écrire la biographie de Némirovsky, nous n’avions pas travaillé chronologiquement : un biographe est tributaire de ses découvertes, qui ne se présentent pas en ordre de bataille ! J’avais conscience, de ce fait, qu’une partie de la logique interne de l’œuvre avait pu m’échapper, ses enchaînements thématiques, son mûrissement stylistique, etc. Avant de me lancer dans ce projet, j’ai donc commencé par relire toute l’œuvre très attentivement, dans l’ordre chronologique, de 1921 à 1942, ce qui représente tout de même près de 4000 pages, dont la moitié produite durant les quatre dernières années de sa vie ! Cela m’a pris quelques mois. On découvre ainsi de petits traits obsessionnels et de grandes hantises comme celle de la noyade, omniprésente d’un bout à l’autre. Ou des détails plus émouvants : je ne m’étais jamais aperçu que dans plusieurs de ses livres, tout au long des années 1930, Irène cite le cri des vendeuses de sardines italiennes qu’elle entendait à Nice lorsqu’elle était enfant. Cela suffit à souligner la force de la nostalgie qui imprègne son œuvre.
P. : Comment définiriez-vous Irène Némirovsky et qu’est-ce qui, selon vous, caractérise son écriture et son œuvre ?
O. P. : Il y a un mot qui revient souvent sous sa plume, aussi bien dans ses livres que dans ses brouillons, c’est celui d’ « orgueil ». D’Antoinette dans Le Bal à l’abbé Péricand dans Suite française, il caractérise bon nombre de ses personnages. Ce n’est pas très loin de ce qu’elle appelle, un nombre incalculable de fois, la « chaleur du sang », une volonté farouche, indomptable, de vivre une vie libre, digne et indépendante, pour ne pas dire individuelle. En même temps, ses personnages, souvent des orphelins, sont guidés par le désir tout aussi fort de faire partie d’une famille, d’être acceptés dans le monde ou de s’enraciner dans la société française. On retrouve cette dualité chez Irène : son orgueil d’écrivain est très développé, elle ne veut se soumettre à aucune autocensure, quitte à courir le risque d’être interprétée de travers ; et, en même temps, c’est une exilée russe, techniquement apatride, qui se considère comme orpheline de mère et dont l’ambition est d’être adoptée par la littérature française. Elle fréquente des cercles aussi compassés que l’Académie ou la Revue des deux mondes, solidement enracinés dans la tradition. Et, de loin en loin, elle s’efforce de composer un grand roman « à la française » dont elle n’est généralement pas satisfaite. Car elle préfère « peindre des loups », comme elle dit. Ce tropisme judéo-russe est sa « malédiction particulière ». Henri de Régnier a vu juste quand il écrit : « Némirovsky écrit russe même en français. » Pour elle, les juifs, particulièrement les immigrés de l’Est, incarnent mieux que quiconque ce paradoxe : une singularité assumée, mais aussi la volonté d’assimilation. Une autre chose me frappe dans son œuvre, flagrante dès que l’on se penche sur ses brouillons : leur teneur autobiographique. Je crois que l’inflexibilité, la distance ironique, la prétendue objectivité qui caractérisent son style et sa « direction d’acteurs », si l’on peut dire, ont pour fonction d’atténuer, ou plutôt de masquer cette part de subjectivité. Sans laquelle, pourtant, les critiques de l’époque n’auraient pas été unanimement frappés par le don de vie qu’elle insuffle à ses créatures. C’est qu’elle les connaît pour la plupart intimement ! Ainsi, presque personne n’a vu que le personnage frivole et matérialiste de Joyce, dans David Golder, ou celui de Corte, l’écrivain infatué de Suite française , relèvent en partie de l’autodérision, comme le montrent plusieurs indices… D’une façon générale, l’écrivain Némirovsky n’a qu’un seul souci, une seule motivation : donner la vie. Une de ses plus grandes joies aura été de voir David Golder incarné par Harry Baur à la scène et à l’écran. Elle a elle-même souligné que son seul vrai plaisir était d’imaginer la « vie antérieure » de ses personnages dans les plus infimes détails avant d’entreprendre ses romans. Et l’un de ses plus beaux livres est une biographie : celle de Tchekhov, qui n’a pas pris une ride.
P. : Pouvez-vous nous parler des différentes périodes de l’auteur et de l’évolution de son œuvre, aussi abondante qu’hétéroclite ?
O. P. : Si Irène n’avait écrit que David Golder et Suite française, ce serait déjà exceptionnel. C’est tout l’intérêt d’une édition intégrale que de montrer l’incroyable richesse de cette œuvre. Jusqu’au milieu des années 1930, pour schématiser, on peut dire qu’elle est travaillée par quatre tendances : la nostalgie d’une enfance qu’elle n’a pas aimée (Le Vin de solitude), l’attachement presque onirique à la Russie perdue (Les Fumées du vin), l’énigme sans cesse interrogée de la judéité (Fraternité) et l’accusation quasi suicidaire de l’hérédité maternelle, sublimée dans le dossier d’instruction qu’est Jézabel. Tout cela se mélange de façon parfois troublante. À partir de 1936, les personnages de forbans se multiplient dans son œuvre, des loups solitaires animés par un puissant instinct d’ascension sociale. Cette obsession coïncide avec une relative érosion de son lectorat, l’apparition de son nom dès 1937 dans certaines brochures antisémites, sa crainte de ne jamais acquérir la nationalité française et finalement sa conversion au catholicisme en 1939. Puis viennent les grandes chroniques romanesques de la maturité, Deux, Les Biens de ce monde et Les Feux de l’automne, où les petites histoires éclairent la Grande Histoire. « Que nous sommes petits et que nous sommes grands », c’est le principe, qui culmine dans Suite française. Elle était convaincue d’écrire là son chef-d’œuvre, et je crois en effet qu’il fait la synthèse de tous ses talents : c’est un roman par nouvelles (genre qu’elle a abondamment illustré), d’une ampleur tolstoïenne assumée, où la source subjective s’inscrit dans l’Histoire et où elle retrouve intacts l’humour et l’ironie de ses débuts. On est étonné, lorsqu’on lit les premiers commentaires que lui inspire son projet, à l’automne 1940 et alors que sa situation est désespérée, de voir qu’elle y prend un plaisir fou ! On a trop lu Suite française comme un document – comme, d’ailleurs, l’on n’avait vu en 1930 dans David Golder qu’« un réquisitoire contre la folie juive de l’or » (André Billy), ce qui est à la fois absurde et réducteur. Ce genre de jugement nous en apprend plus sur le lecteur que sur l’auteur… J’aimerais que l’édition de ces Œuvres complètes rappelle quelle artiste extraordinairement douée était d’abord et avant tout Irène Némirovsky, en dehors de toute interprétation et de toute donnée biographique.