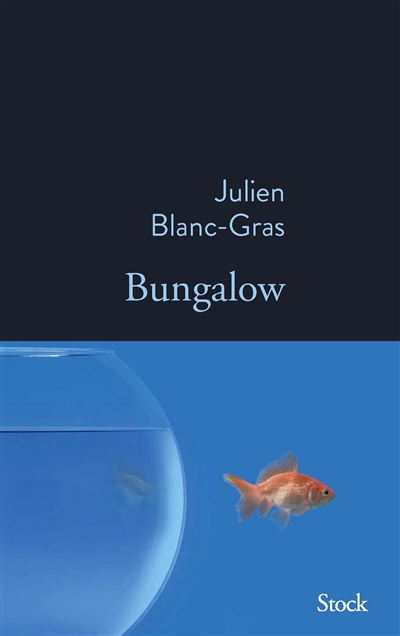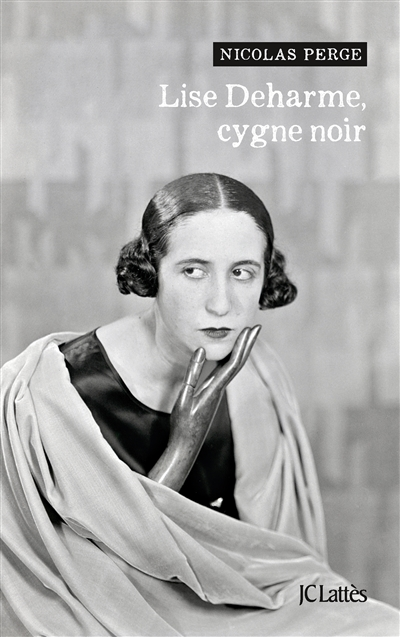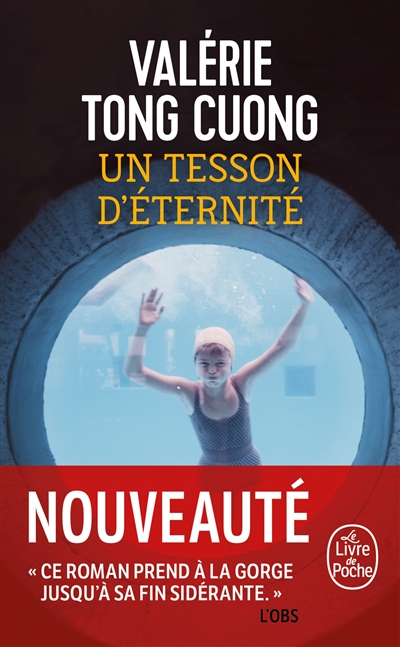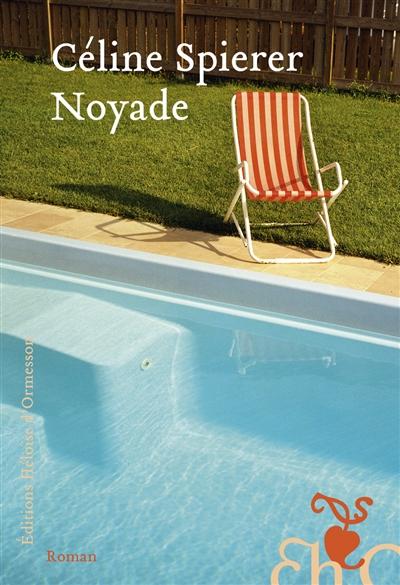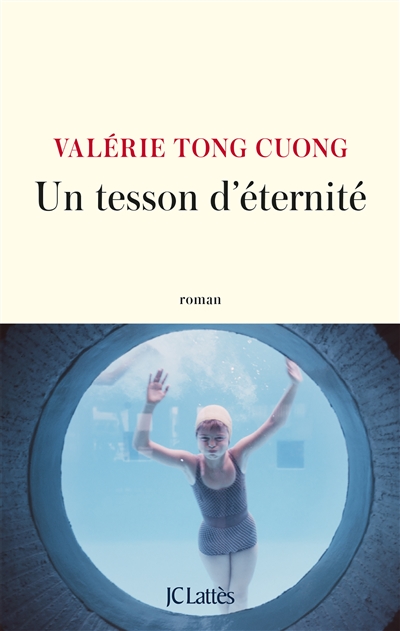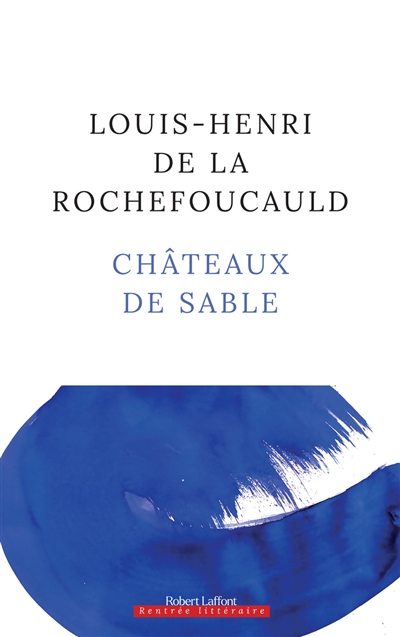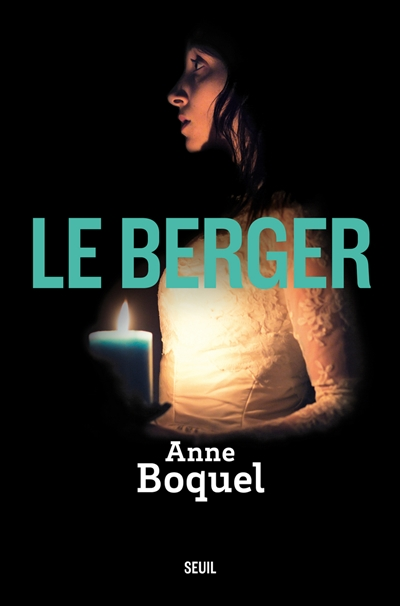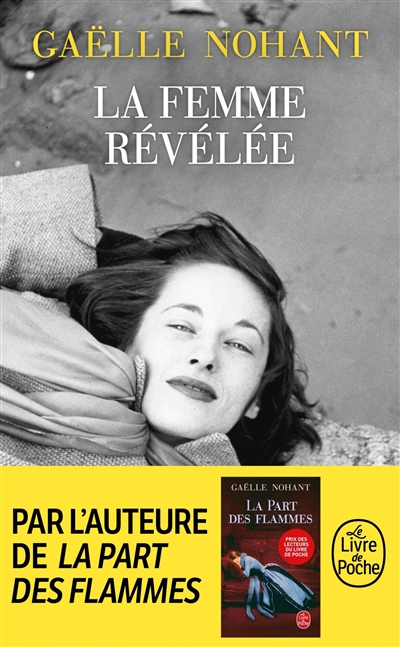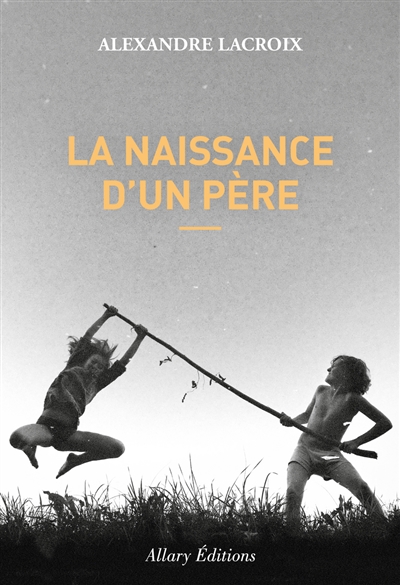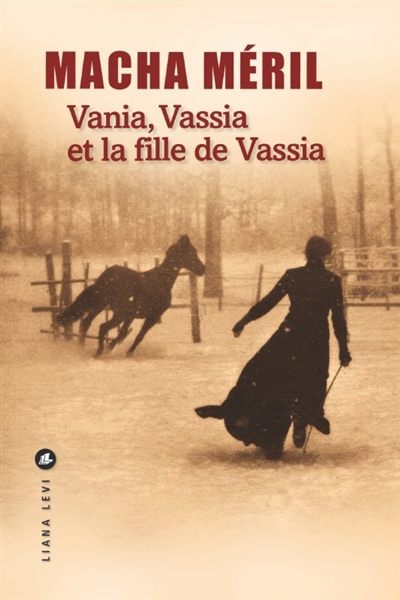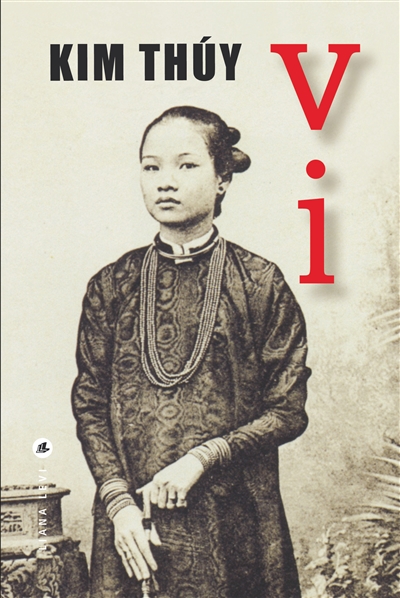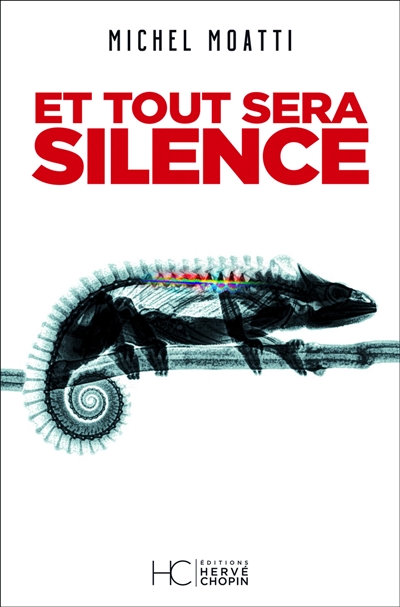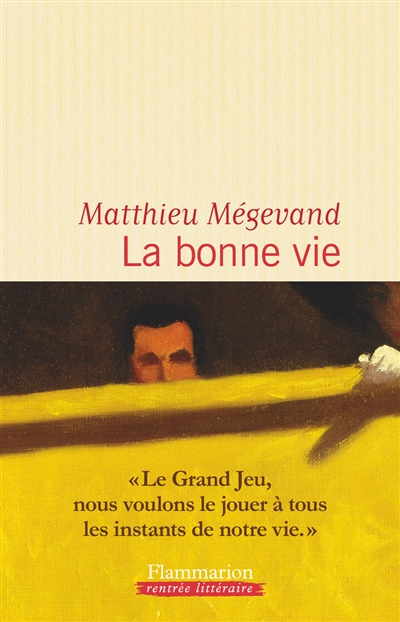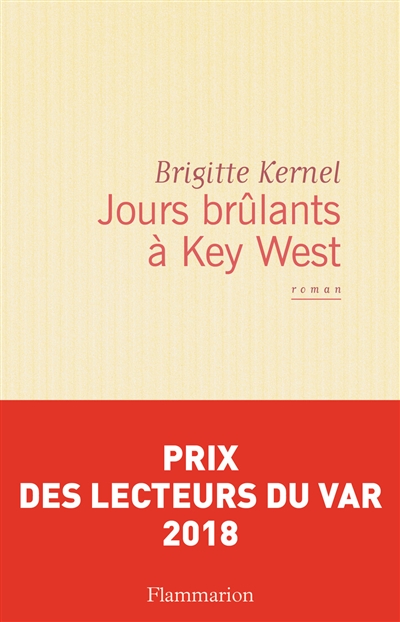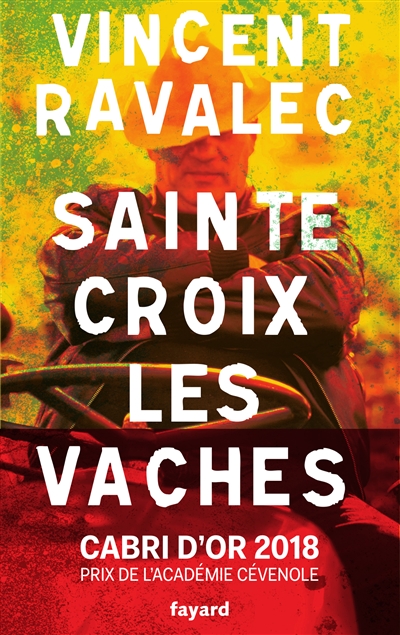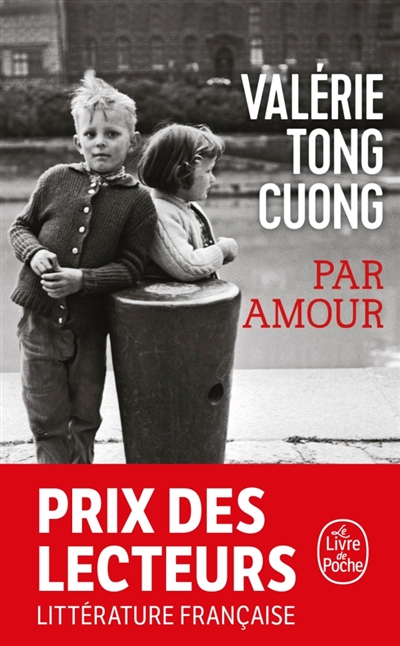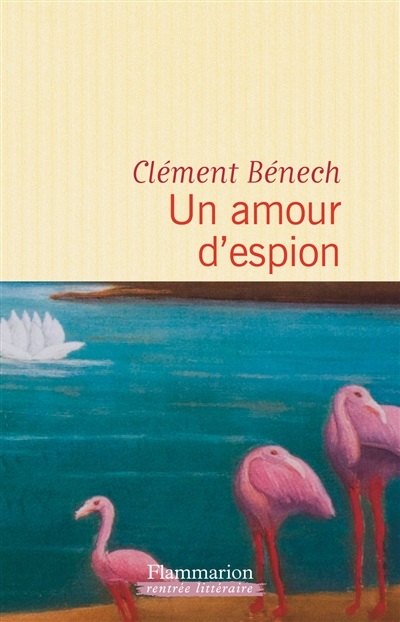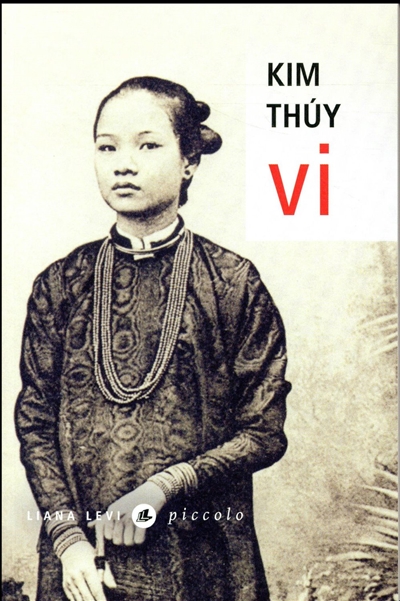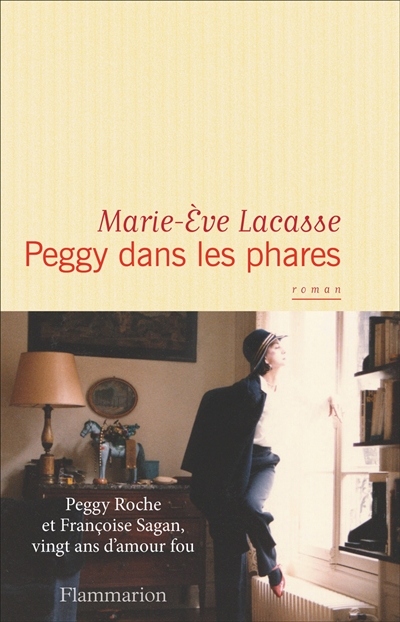Littérature française
Dan Nisand
Les Garçons de la cité-jardin
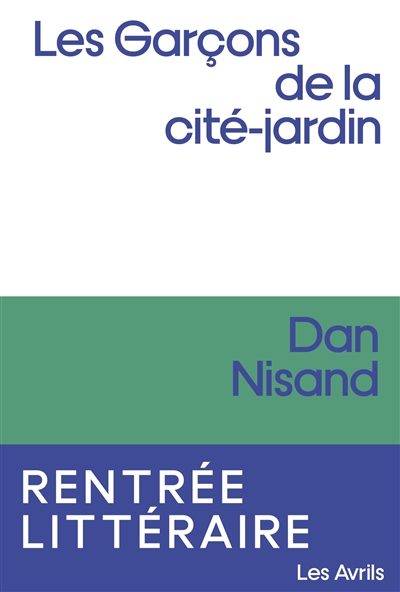
-
Dan Nisand
Les Garçons de la cité-jardin
Les Avrils
18/08/2021
378 pages, 22 €
-
Chronique de
Murielle Gobert
- ❤ Lu et conseillé par 12 libraire(s)

✒ Murielle Gobert
( , )
Impossible d'oublier, en refermant ce livre, tous les mauvais garçons de ces cités-jardins qui bataillent pour devenir des hommes. Ce roman d'une tension folle, électrique, oscillant sans cesse entre l'intime et l'universel, est un concentré d'émotions qui nous met K.O à chaque page.
Votre roman raconte l'histoire des fils Ischard et de leur père. Ces quatre personnages, et bien d’autres encore, vivent dans une cité jardin. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces cités ?
Dan Nisand - C’est un concept très particulier d'urbanisme au début du XXe siècle, consécutif à des problèmes dans les milieux ouvriers. On a théorisé une ville éternellement heureuse qui devait réaliser une sorte d'union joyeuse de la ville et de la campagne, où les ouvriers cesseraient de vivre dans la misère. Ça a beaucoup plu aux patrons paternalistes de cette époque qui souhaitaient que leurs ouvriers puissent mener une vie « plus morale et hygiénique ». Elles ont fleuri dans la périphérie de Paris et en Alsace où je suis né. Je m’y suis beaucoup intéressé mais pour le roman, je n'ai pas voulu subir la tyrannie de la réalité de celle que j'avais connue. J'ai réinventé son histoire pour pouvoir y mettre ma propre histoire, celle que je voulais écrire.
Le père est exilé dans une sorte de solitude. Vous dites qu’il est comme « retiré du monde des vivants ». On va découvrir pourquoi au fil du roman. Il tient grâce à son plus jeune fils, Melvil, qui se consacre entièrement à lui. Un jour, les frères aînés reviennent, après des années d’absence et d’attente qui ont alimenté la tension dans laquelle baigne le début du roman.
D. N. - Melvil, c’est le petit, mais il est grand par la taille, un peu comme Avrel ! Il est paisible, cérébral, affectif, pas du tout brutal, mais il est né dans cette famille et ses frangins sont des chefs de bandes, ils ont fait du quartier un vrai coupe-gorge infréquentable. Il regrette de ne pas être capable d’être brutal comme eux. C’est là qu’on le trouve au début du livre, sous le choc de la nouvelle du retour. C’est l’occasion pour lui de reprendre les choses où elles en étaient restées il y a des années. Il va chercher à s’épanouir dans cet univers, dans l’atmosphère que ses frères ont eux-mêmes créée.
Melvil est très fier de son nom. Mais n’est-ce pas en réalité une malédiction pour lui ?
D. N. - Melvil a une vraie mythologie, celle des récits et des aventures de ses grands frères, mais c’est un piège. Il a vécu dans cette mythologie secrètement pendant leur absence et ne se sent pas à la hauteur. Mais pourquoi ne pas se sentir à la hauteur de la violence ? C’est l’angle qui est peut-être original. En général, dans les histoires, la violence apparaît soit sous les dehors de la banalité, soit sous son aspect traumatique. Là, c'est la violence du quotidien qui ressort et c’était intéressant pour moi de la placer dans ce milieu fermé dont il est impossible de sortir.
Il y a un personnage, Nelly, qui vient illuminer un temps le quotidien des Ischard, comme si elle arrivait tout naturellement à débusquer la tendresse chez eux. La force de la présence féminine est-elle de désamorcer la violence ?
D. N. - Nelly, c’est celle qu’on aime. C’est un personnage qui est une véritable clef de voûte dans l’histoire, elle revient dans la cité pour y chercher quelque chose. C’est loin d’être l’incarnation de la femme douce, idéale, mais elle apporte la lumière, le roman bouge avec elle. L’autre personnage féminin, c’est la mère, absente, mais qui aurait sans doute pu infléchir le destin de cette famille.
La nature est très présente dans le livre, elle arrive par des accès très puissants. Est-ce à l’image de la nature humaine qui implose dans ces cités où elle est mise sous tutelle ?
D. N. - Oui, on ne peut pas mettre le vivant sous tutelle. On ne peut pas décréter le bonheur pour autrui. C’est un peu l’utopie et la tyrannie des cités-jardins : c’est impossible de dire aux gens quelle vie ils vont avoir. Au départ, il y a quelque chose d’extrêmement despotique dans la façon d’envisager la famille. Et cette famille des Ischard va à l’encontre de l’idéal de départ qu’on avait imaginé pour elle.
On sent quelque chose d'inéluctable dans le roman, comme dans les tragédies antiques. L'aviez vous souhaité ?
D. N. - Je voulais une tension de chaque instant, c’était l’atmosphère dans laquelle je voulais faire baigner le livre. C’est pour cette raison qu’il a été long à écrire car je n’ai pas utilisé de moyens faciles, ni d’artifices narratifs, mais un langage assez soutenu. L’aspect tragique est essentiel : il y a quelque chose de souterrain dans le texte qui s’impose. On sent qu’il va se produire quelque chose de dur. On y court et on ne peut pas l’éviter.
À propos du livre
« Il y a eu un coup de fil. » Ces quelques mots du père font perdre le sommeil à Melvil, le cadet de la famille Ischard. L’attente « exquise et intolérable » commence et, avec elle, l’espoir que, peut-être, dans un temps indéfini, ses frères vont rentrer chez eux après des années d’absence mystérieuse dans la cité-jardin Hildenbrandt qu’ils ont rendu infréquentable. Avec le bonheur débordant de les retrouver viendra la brutalité de leur présence animale, dangereuse, et la fierté de porter leur nom qui pourtant sonne comme une malédiction. La quête périlleuse d’un équilibre et malgré tout la lumière de quelques êtres dont les apparitions et les éclipses rythment le roman. C’est dans ces creux que se dessine le destin intense et brûlant de ce gamin. L’incendie qui couve, sous le style puissant et poétique de Dan Nisand, éclaire d’une manière flamboyante l’absurdité de ces cités idéales où le vivant, mis sous tutelle, implose ou se consume.