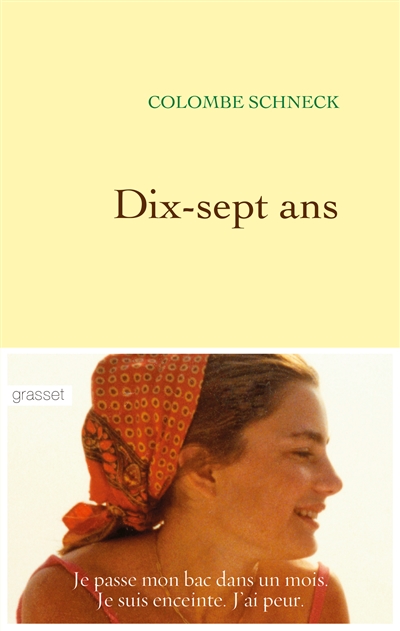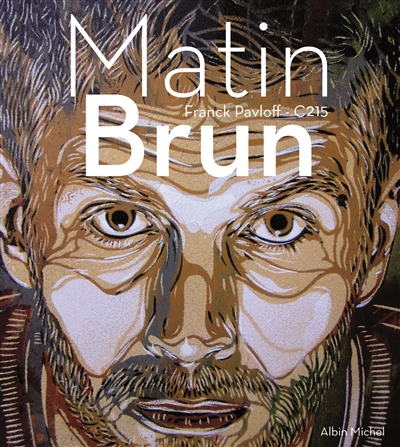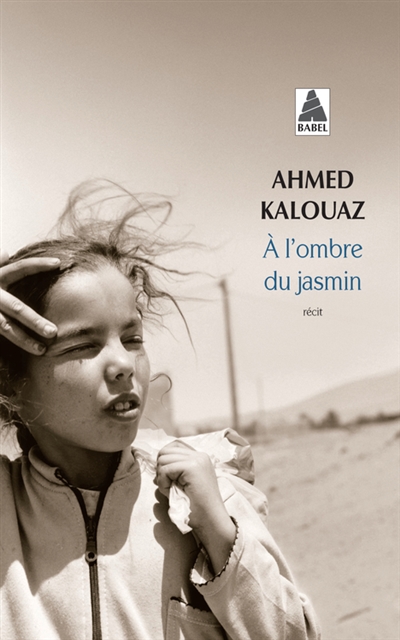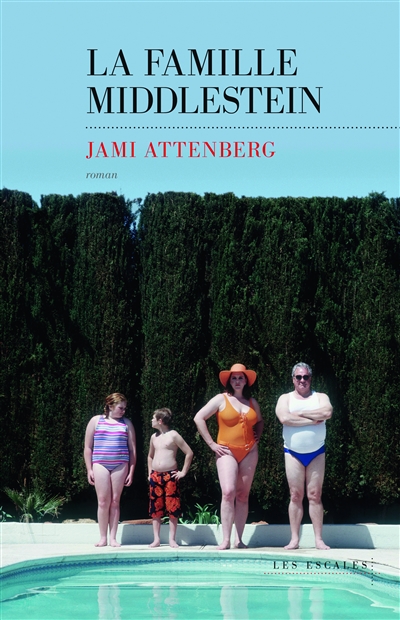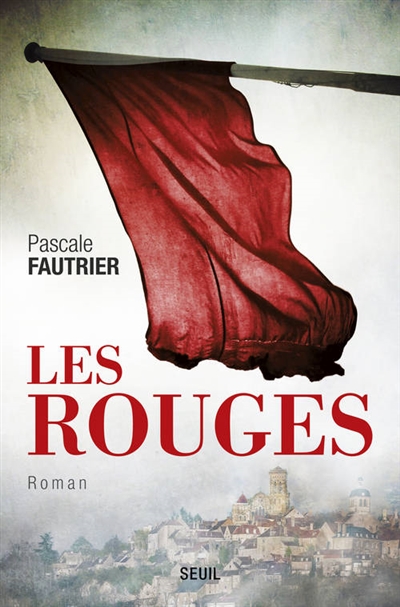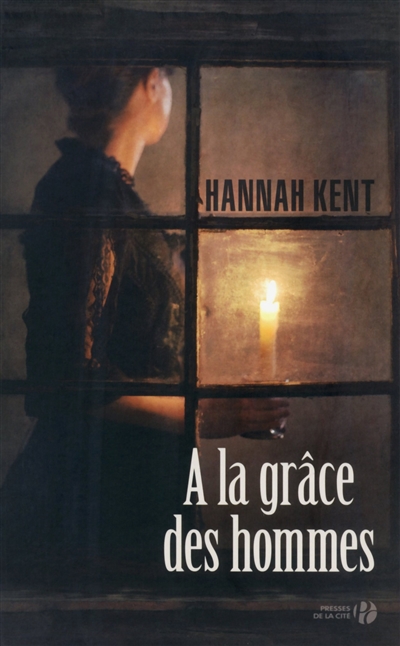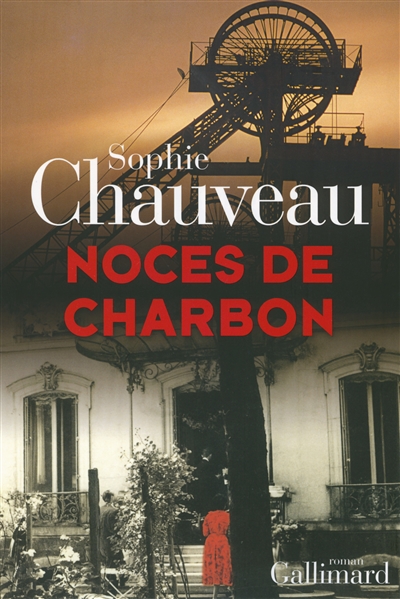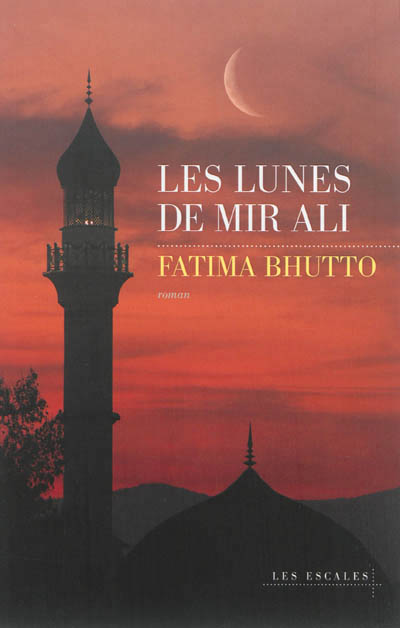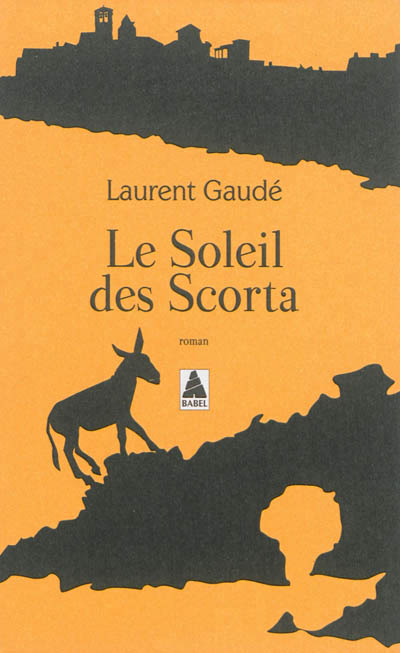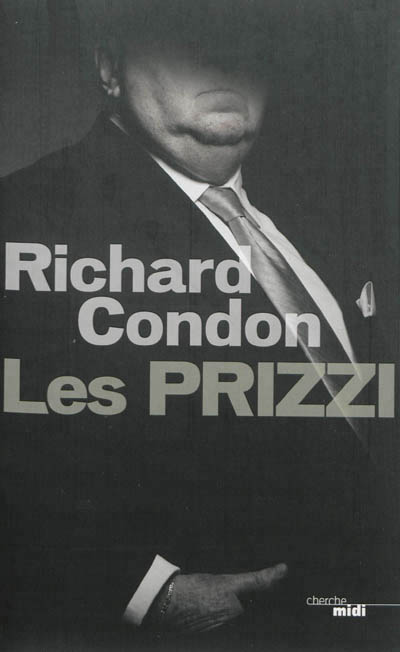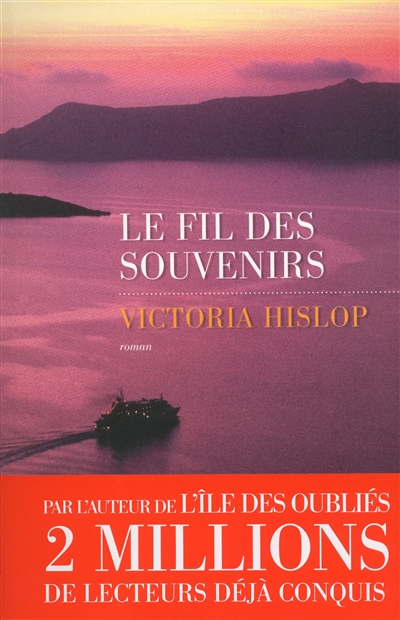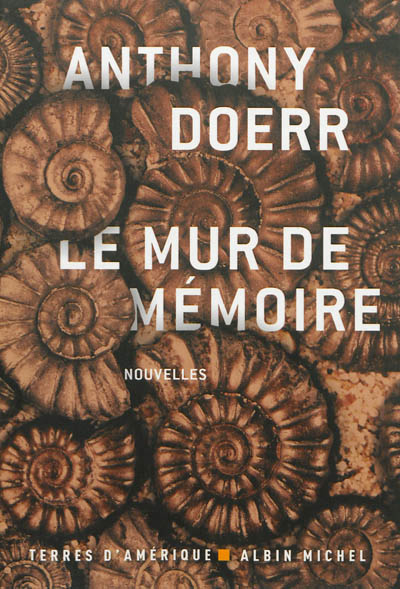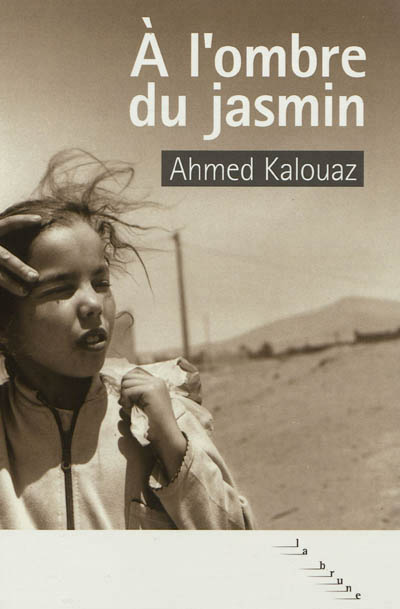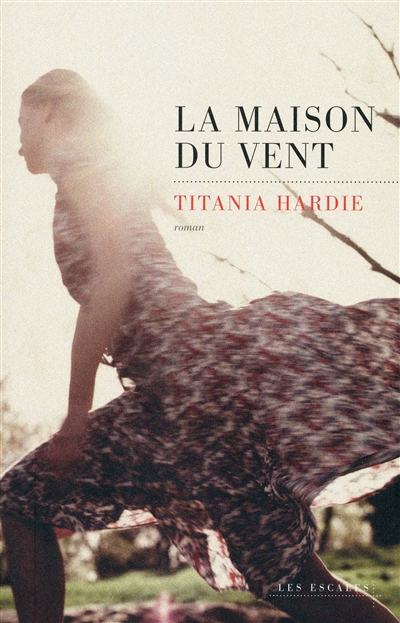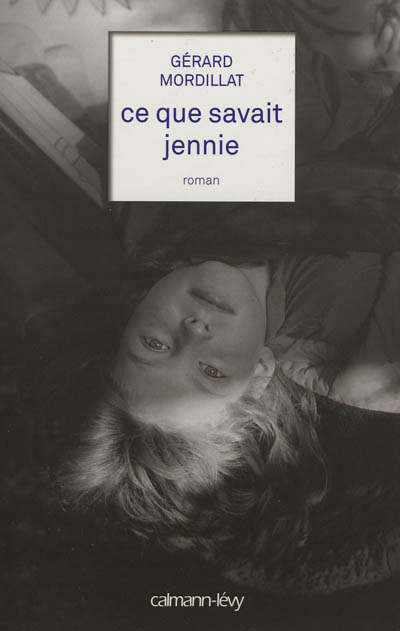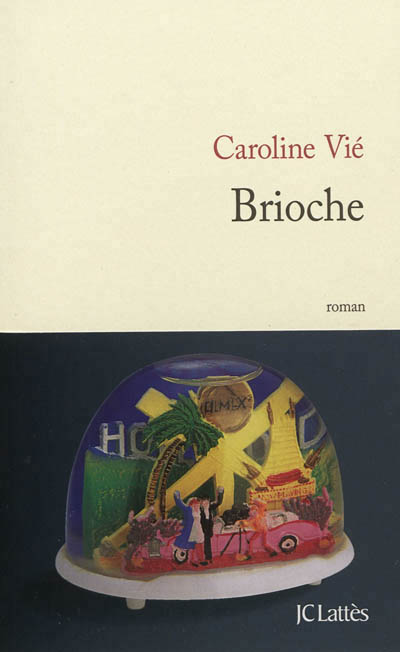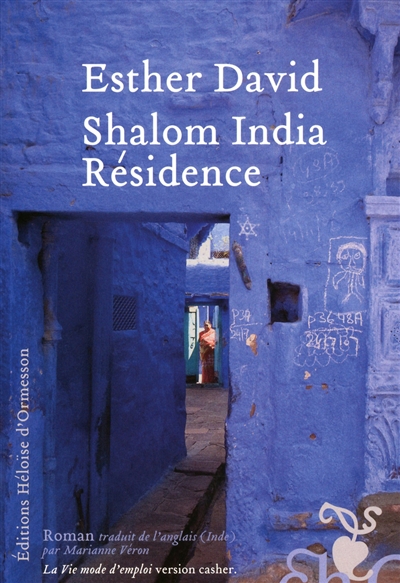Essais
Karim Miské
N’appartenir
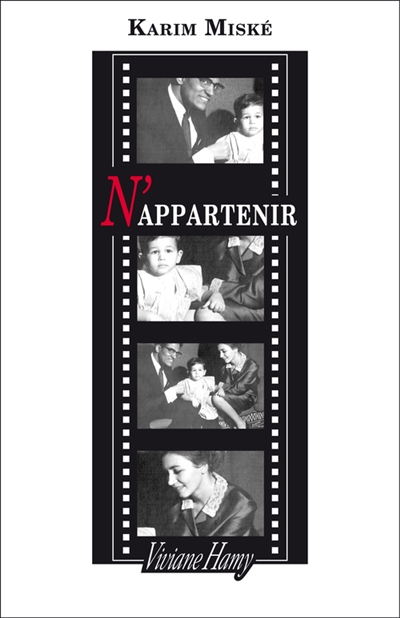
-
Karim Miské
N’appartenir
Viviane Hamy
05/05/2015
88 pages, 12,50 €
-
Chronique de
Coline Meurot
Librairie L'Interligne (Lille) - ❤ Lu et conseillé par 15 libraire(s)
✒ Coline Meurot
(Librairie L'Interligne, Lille)
Né d’un père diplomate mauritanien musulman et d’une mère française issue d’une famille catholique, mais athée, en plus d’être féministe et anti-impérialiste, Karim sera sommé, tout au long de sa vie, de choisir son camp : français ou mauritanien ? Musulman ou catholique ? Il a finalement décidé de « N’appartenir ».
Karim Miské livre un texte très fort sur la violence de devoir toute sa vie choisir et toujours se justifier. Physiquement il n’a pas l’air d’être vraiment français. Mais ayant grandi en France avec sa mère, il n’est pas arabe non plus. Sa découverte à 15 ans du pays de son père lui confirmera qu’il n’a rien en commun avec cette famille du désert très pieuse et ouvertement raciste envers les Noirs. Quelle claque pour un adolescent parisien élevé dans les milieux intellectuels de gauche ! Puis il y aura la violence de la découverte des régimes socialistes. L’engagement politique de sa mère les mènera dans l’Albanie de Enver Hoxha, communiste stalinien. Le fossé entre les idéaux défendus en France et la réalité de leur application l’empêchera de se sentir appartenir à une identité politique. Avec une écriture puissante et très rythmée, Karim Miské nous fait part de la difficulté de n’être pas celui qui correspond à l’image qu’il renvoie. À l’heure où les questions d’identité sont de tous les débats, il serait bon de faire lire ce texte au plus grand nombre.
Page — Pour ceux qui vous découvrent, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ?
Karim Miské — La manière dont je parle de moi peut varier selon les époques ou les personnes qui m’interrogent. Soit je dis que je suis franco-mauritanien, mais ce n’est pas vraiment exact car je suis culturellement beaucoup plus français que mauritanien. Soit je dis que je suis français d’origine franco-mauritanienne. C’est toujours un peu étrange de se définir de cette manière, mais, vus mon nom et mon apparence, les gens ont toujours une attente de savoir d’où je viens. Quand je dis que je viens de Paris, cela ne leur suffit pas, alors je donne quelques explications, qui changent selon la personne que j’ai en face de moi.
P. — Ce texte est très fort, je l’ai ressenti comme un coup de poing ou un cri de rage contre les catégorisations que la société nous impose. Qu’est-ce qui vous a fait écrire ce livre ?
K. M. — C’est toute ma vie. C’est-à-dire le fait de devoir toujours me définir. Puisque je ne rentre pas dans les cases, j’ai eu le désir de l’expliquer en long et en large. C’est toujours bizarre d’être confronté à ces questions : qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? On n’est pas seulement une personne en face d’une autre personne. Si en France, deux Blancs se rencontrent, même s’ils se demandent de quelles régions ils viennent, ça n’influera pas sur leurs rapports. Alors que lorsqu’on me pose la question de mes origines, il y a toujours des enjeux qui ramènent à la question dont je parle dans N’appartenir : s’il y a la guerre, tu vas te battre de quel côté ? Il y a quelque chose de l’ordre du conflit qui est convoqué à ce moment-là. Je pense qu’il existe une certaine violence là-dedans et j’ai eu envie de l’expliciter et de trouver un moyen de la dépasser. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans ces cases. Même si on a deux parents d’une même origine, on ne se sent pas toujours conforme à l’image que l’on attend de vous. À partir de mon histoire, j’essaie de trouver une réponse qui puisse être universelle à la question de l’appartenance.
P. — La question du genre est également abordée dans N’appartenir. Pour vous, il s’agit aussi de « cases » dans lesquelles on doit rentrer ?
K. M. — Oui, quand j’ai commencé à écrire, j’avais une intuition de ce que j’allais faire, mais je n’ai pas fait de plan. J’ai vraiment voulu écrire à partir d’une nécessité intérieure. Au fur et à mesure de l’écriture, je me suis rendu compte que la question des origines menait à la question d’une identité politique : les engagements successifs de mes parents et surtout de ma mère. Ça ne paraît pas forcément évident aujourd’hui, mais dans les années 1970 l’appartenance politique était très forte, notamment à gauche. Cela m’a ramené à la question de l’appartenance religieuse et, pour finir, à la question du genre. Finalement c’est la première question à laquelle on est tous confrontés. Dès la naissance on est fabriqué comme garçon ou comme fille. Cela implique toutes sortes de choses, y compris dans le fait de s’autoriser la violence ou, au minimum, une vision très dépréciative de l’autre. C’est cet aspect qui m’intéresse car au cœur du livre il y a la question de la violence. Être garçon, c’est se sentir supérieur. Finir sur les identités de genre permettait de mieux faire toucher du doigt le côté universel du propos.
P. — Vous parliez de la violence qui est au cœur du livre. Pouvez-vous nous dire de quelle violence il s’agit ?
K. M. — Pour moi cette prise de conscience de la violence est passée par l’identité marxiste-léniniste dans laquelle je grandissais. Cette identité très particulière m’a mené jusque dans l’Albanie d’Enver Hoxha qui était resté stalinien. Avoir été là bas enfant avec ma mère et dans des conditions privilégiées m’a fait plus tard prendre conscience de cette violence politique. Il y a un âge où j’ai compris la nature d’un tel régime, le sort qui était réservé aux opposants. Et moi, j’avais fréquenté ceux qui envoyaient ces opposants en camp ou à la mort. Il y avait quelque chose en moi qui savait qu’il existait un rapport entre cet engagement et la mort ; et que finalement il y avait aussi un rapport entre toute forme de croyance un peu forte et la violence. Car il n’y a pas de moyen de garder les gens à l’intérieur d’un groupe sans avoir recours à la violence. Être dans le groupe, c’est être protégé de la violence, mais c’est aussi avoir le droit de l’exercer sur ceux qui sont à l’extérieur. C’est cette démonstration qui est un peu au cœur du livre. Mes séjours en Albanie ont été courts et cependant forts. C’était très marquant pour moi qui grandissais à Paris au milieu d’intellectuels de gauche. Je me suis retrouvé dans un pays où l’on était censé mettre ces idées politiques en application et je me rendais compte qu’il y avait des contradictions. J’ai grandi sans frère et sœur, dans un monde d’adultes. Donc très tôt, j’étais dans le langage de la politique, dans des discours très construits que je ne comprenais pas entièrement mais que je répétais. J’étais déjà dans le monde des adultes à 7 ans. La violence du système est entrée en moi et c’est ce qui a fait que j’ai été autant marqué par ces voyages.
P. — Vous avez plusieurs casquettes : romancier, documentariste. Quels sont vos projets actuels ?
K. M. — En ce moment je travaille surtout sur la suite d’Arab Jazz (Points) qui va être une trilogie. Je n’ai pas forcément envie de faire dix livres avec le couple d’enquêteurs Rachel Kupferstein et Jean Hamelot. Mais il y a des choses au bout desquelles je dois aller et ça nécessite deux livres de plus pour que l’histoire retombe réellement sur ses pieds. Cela devrait m’occuper pendant deux ans.