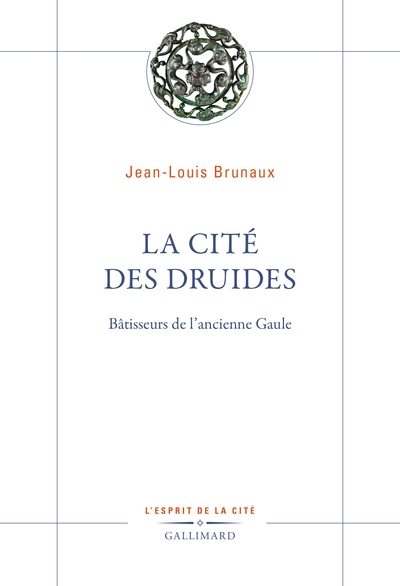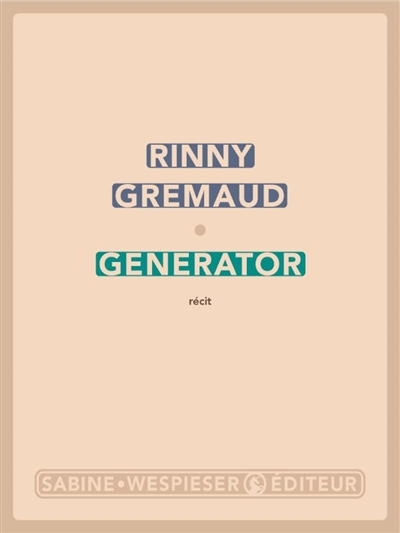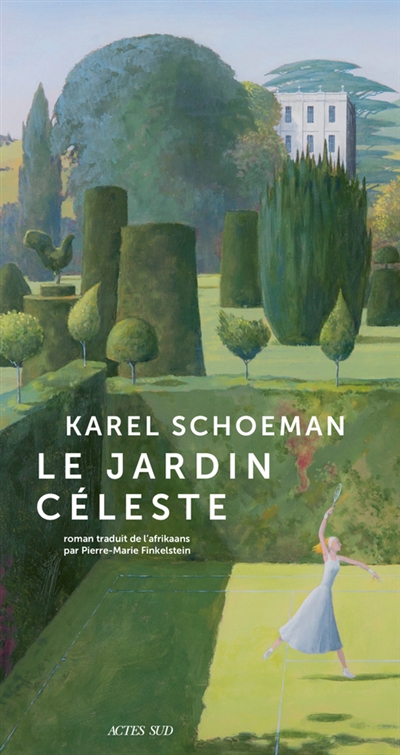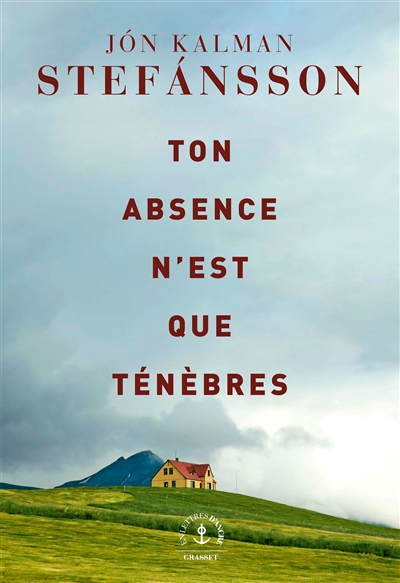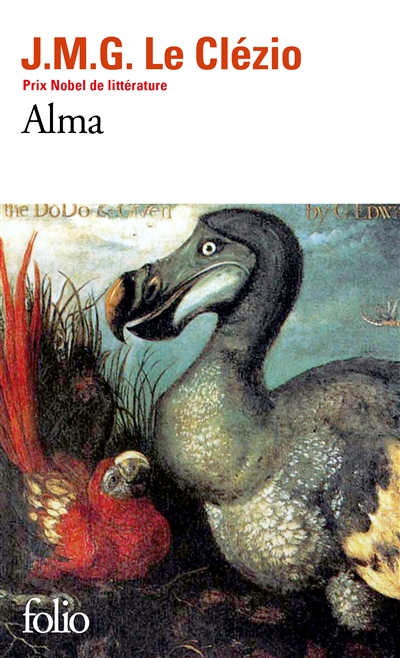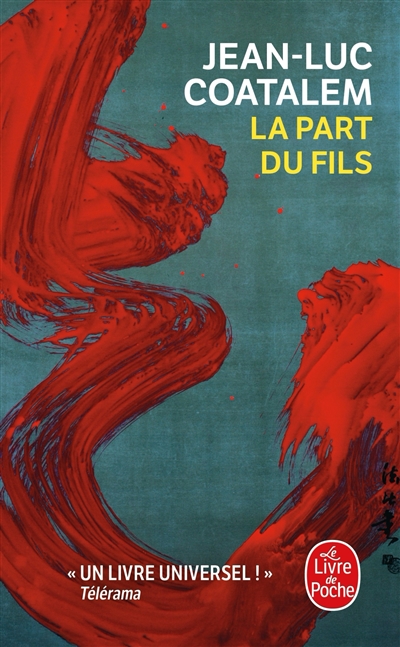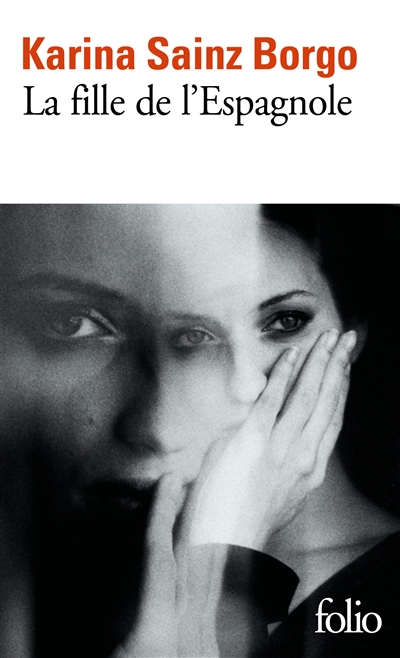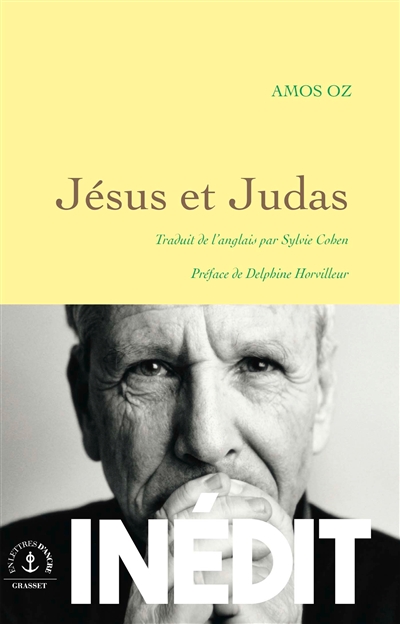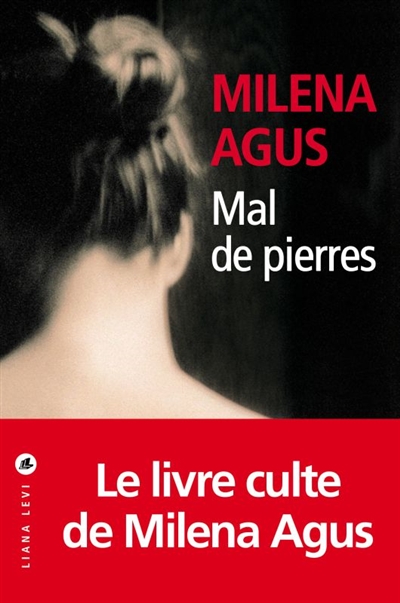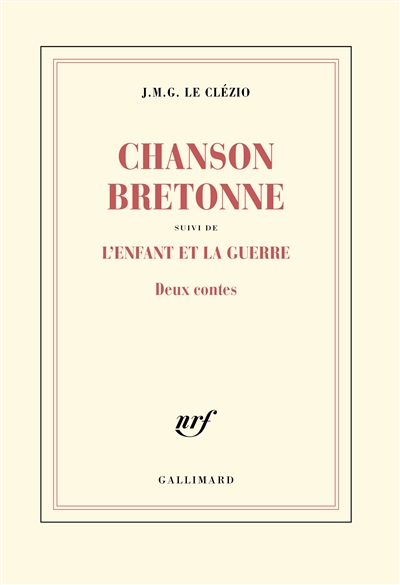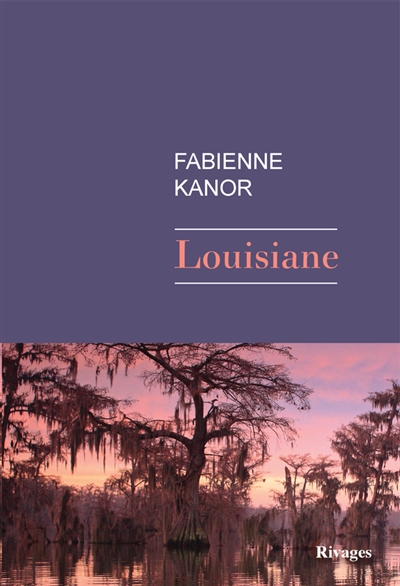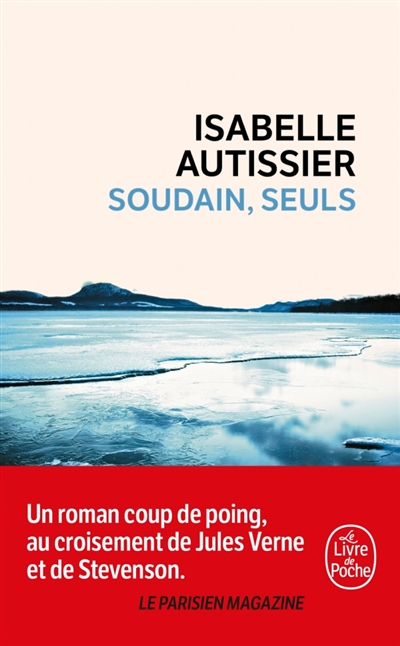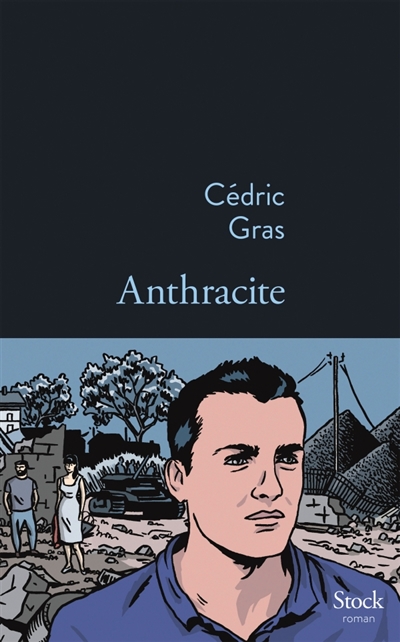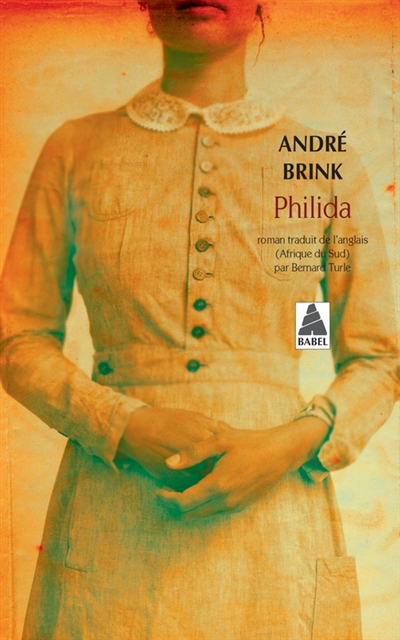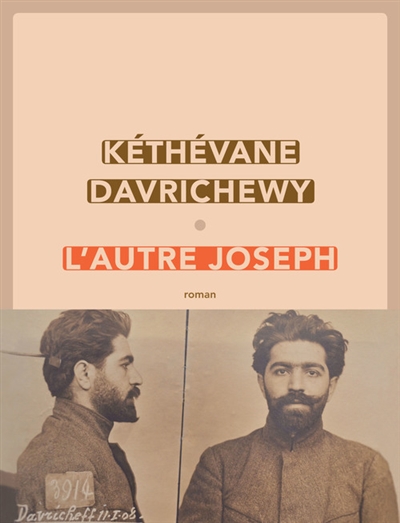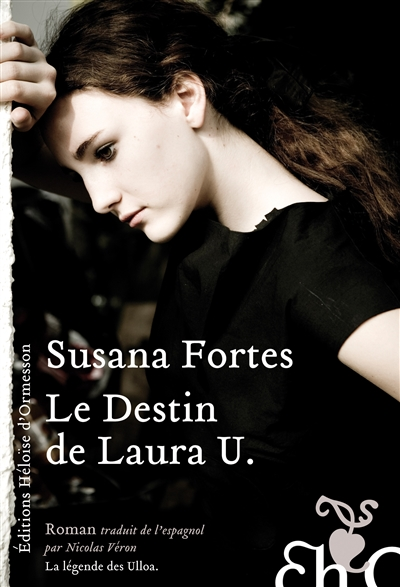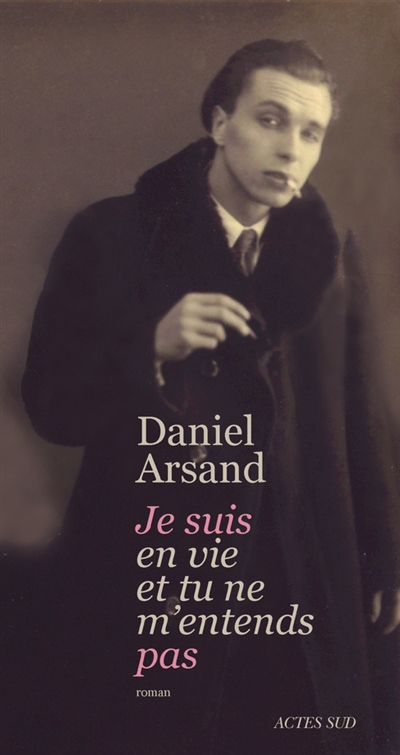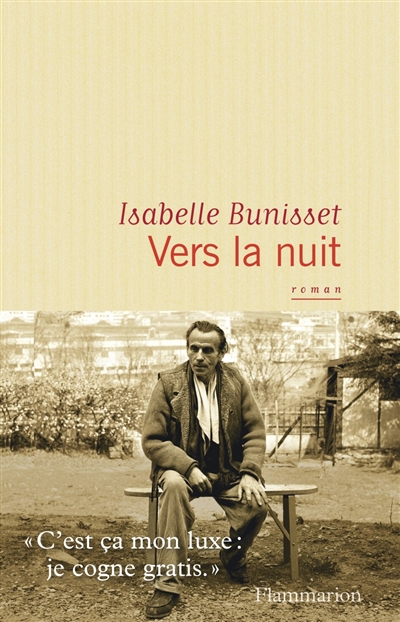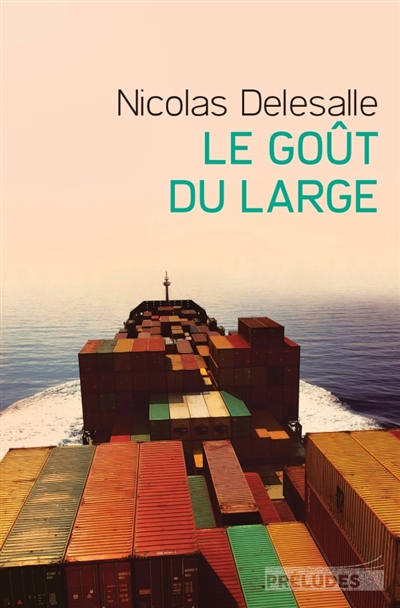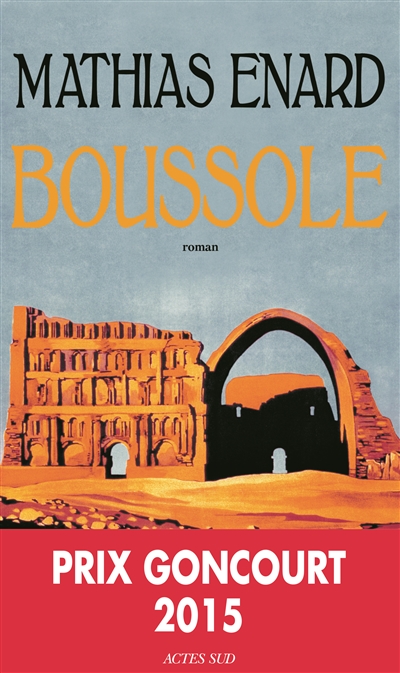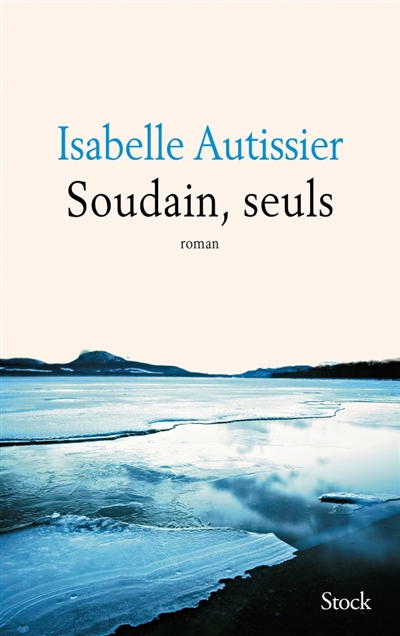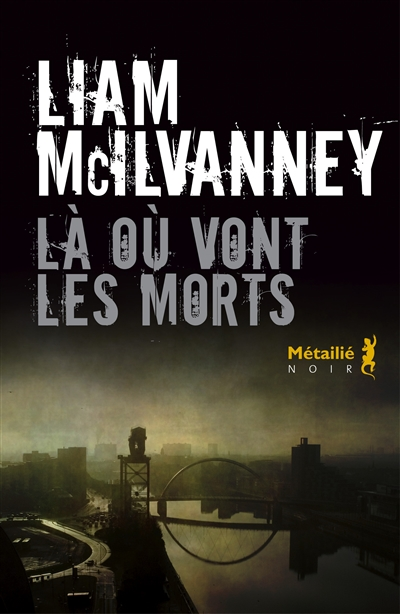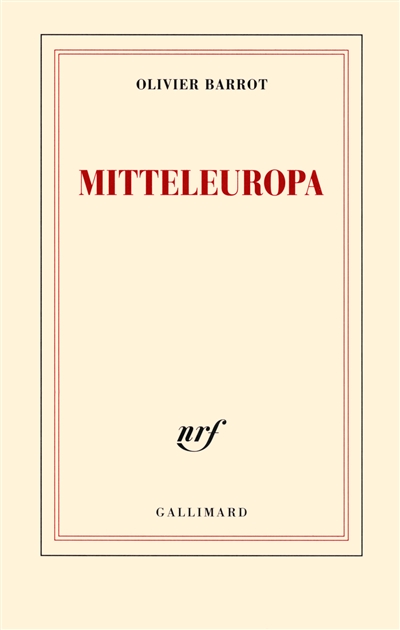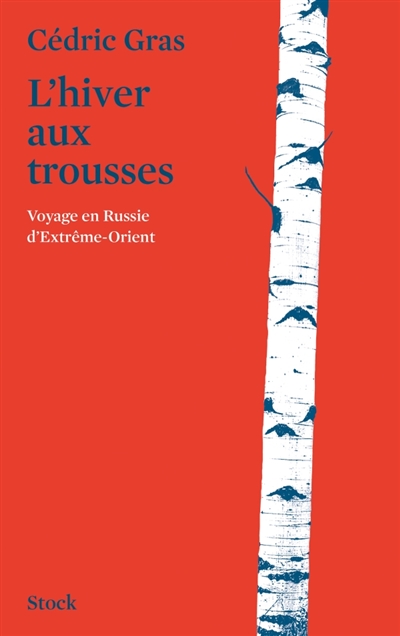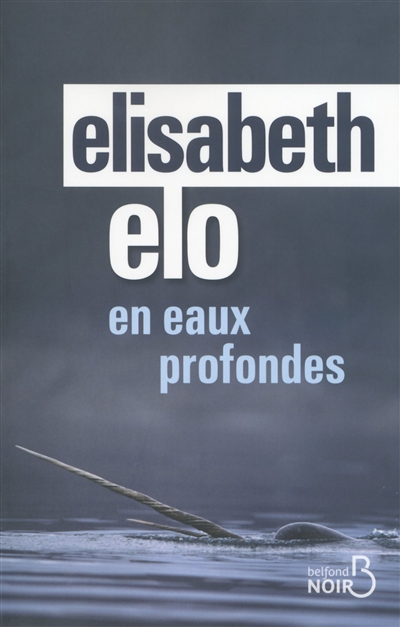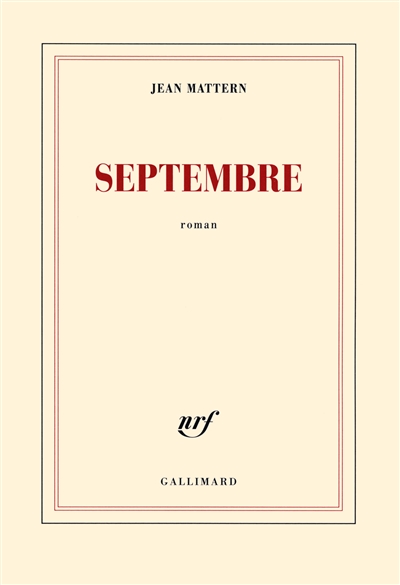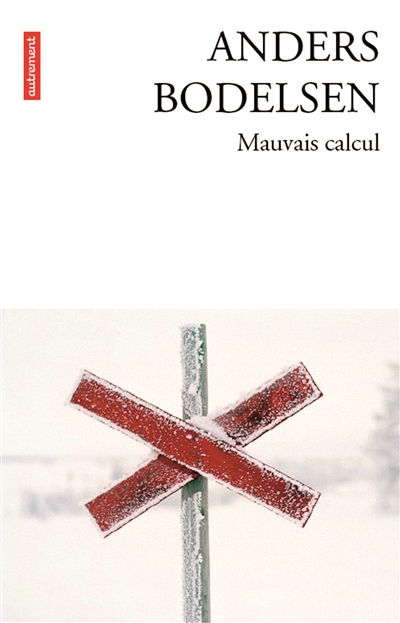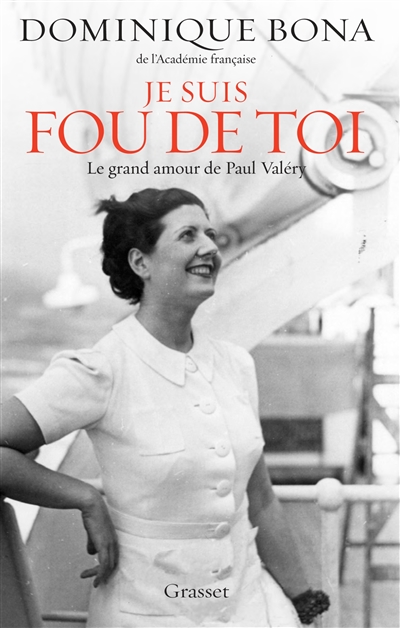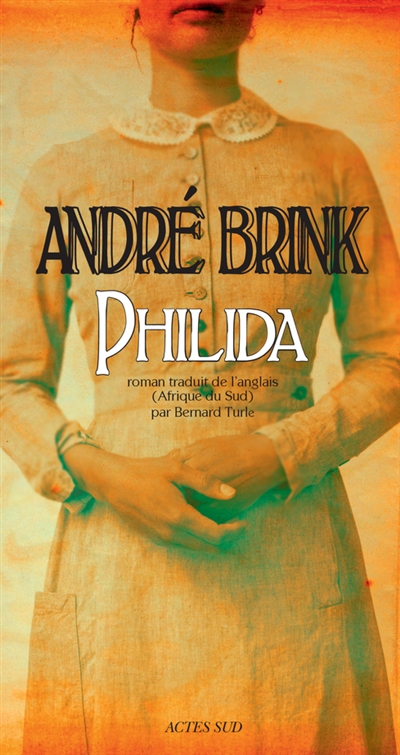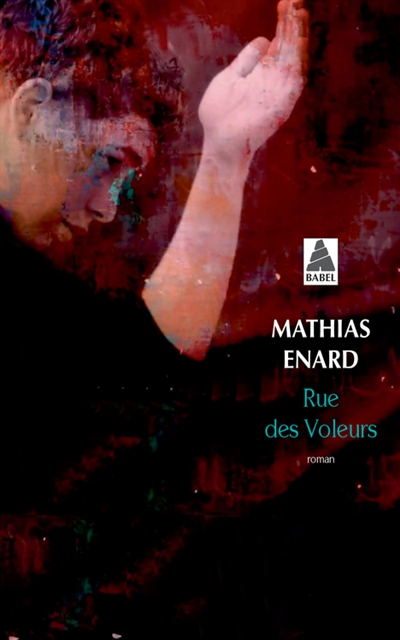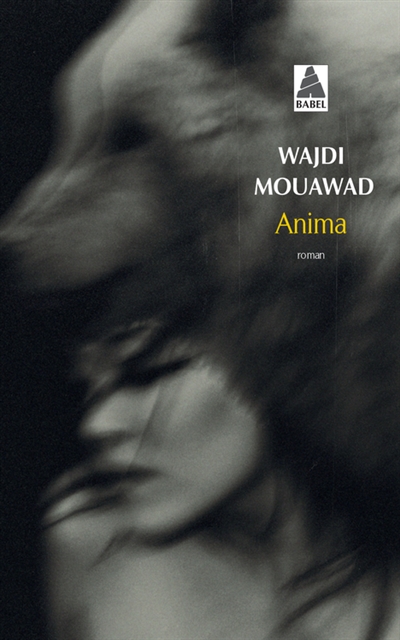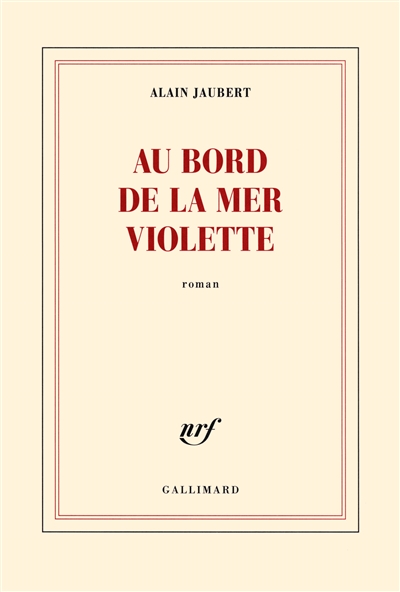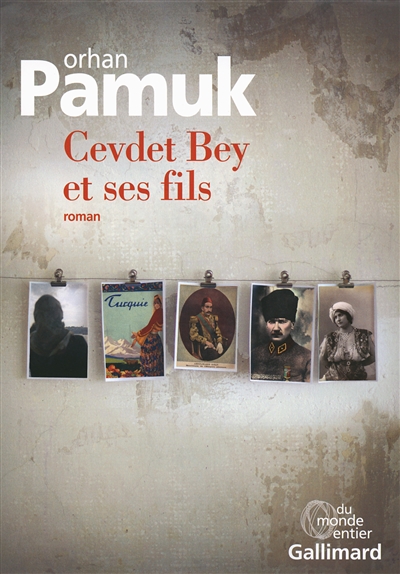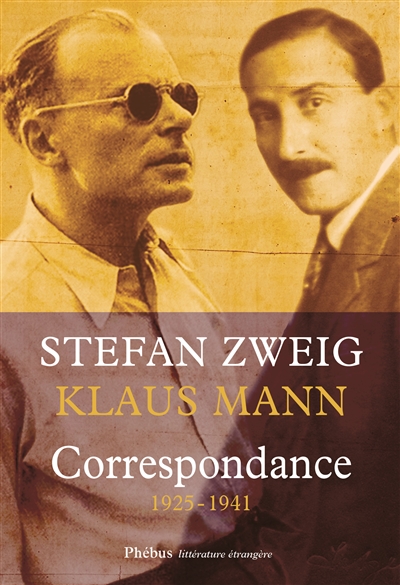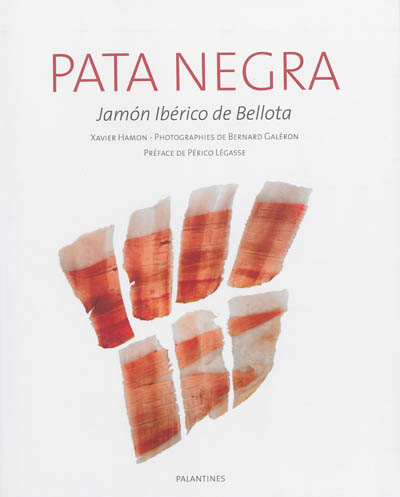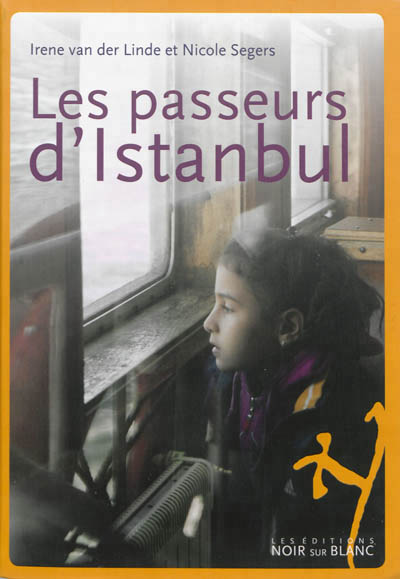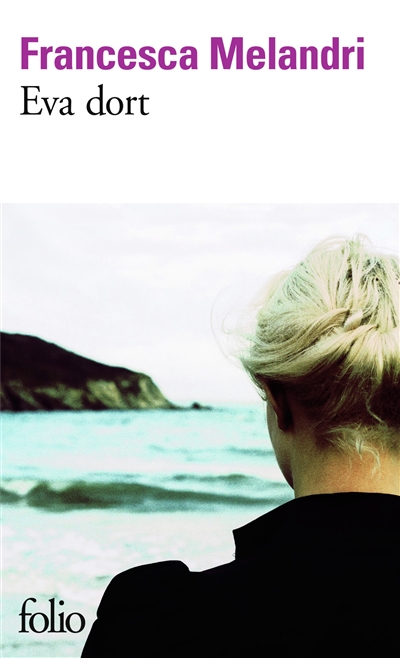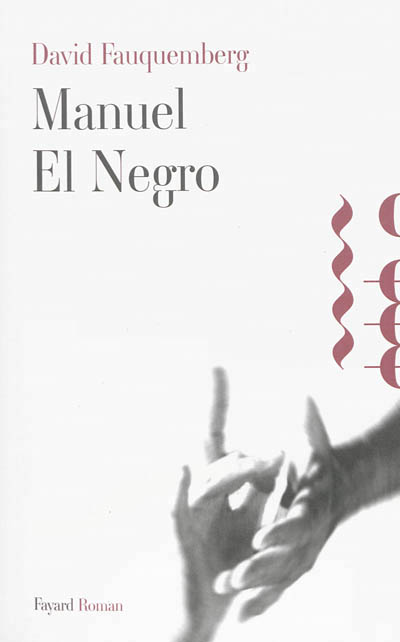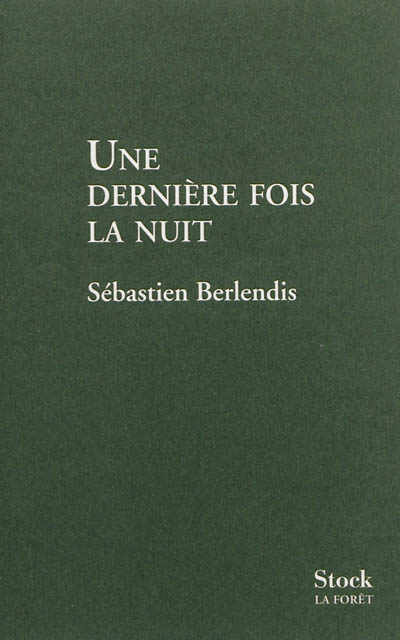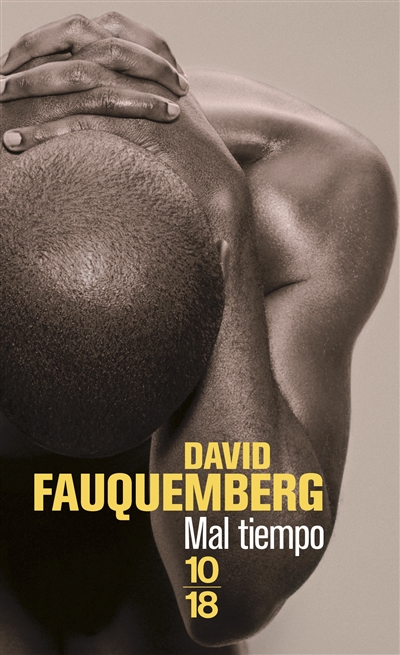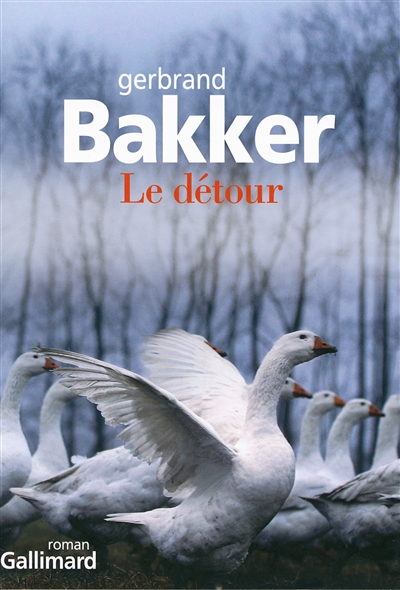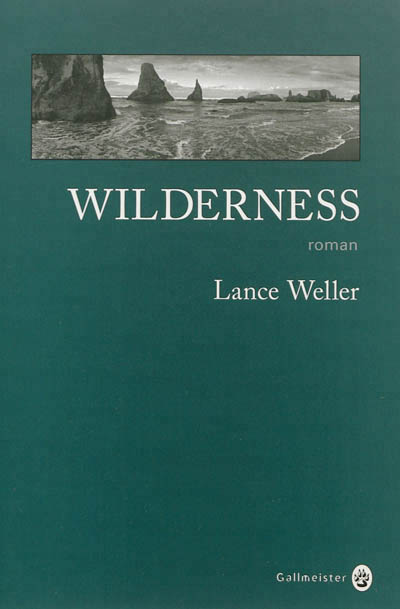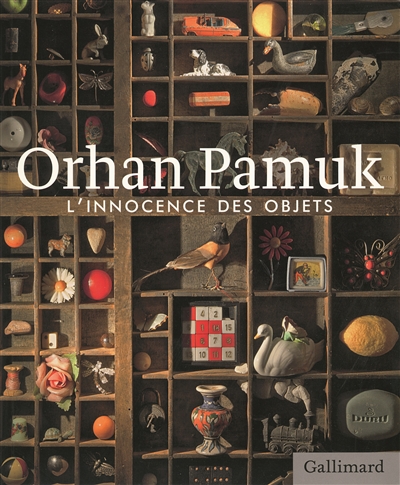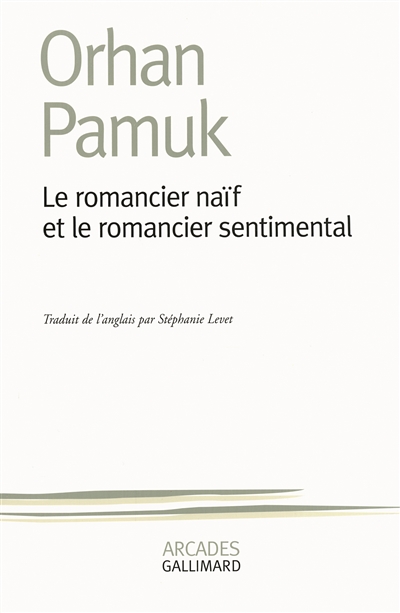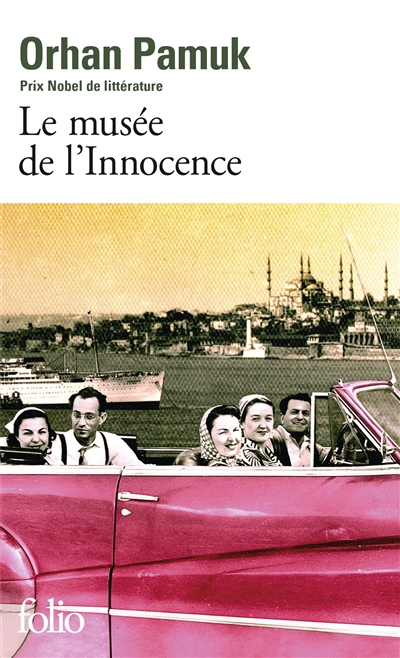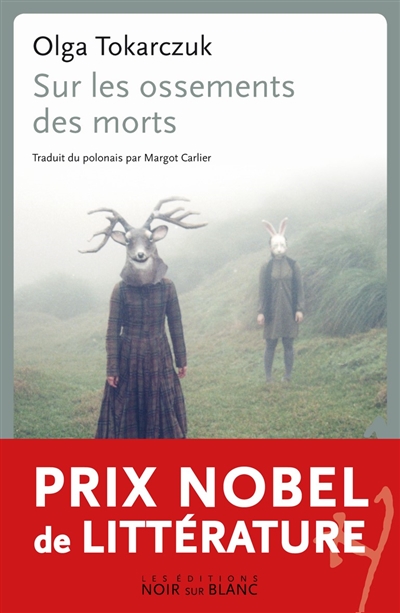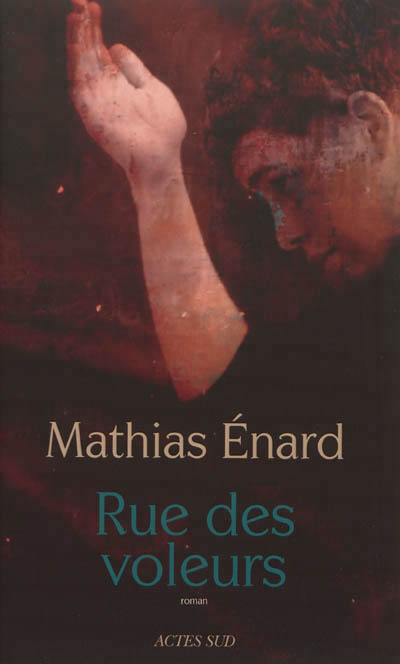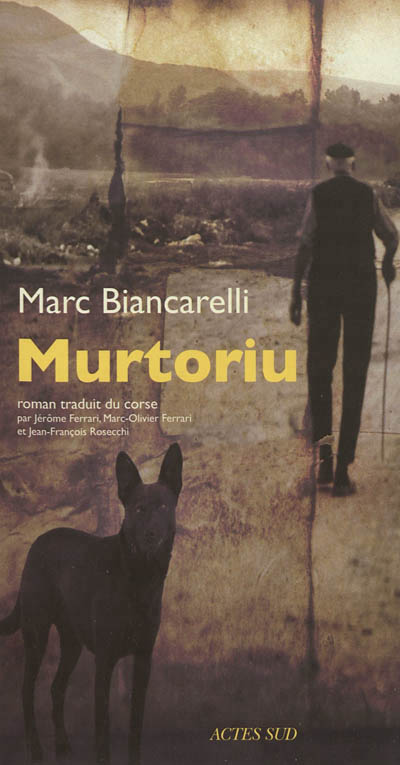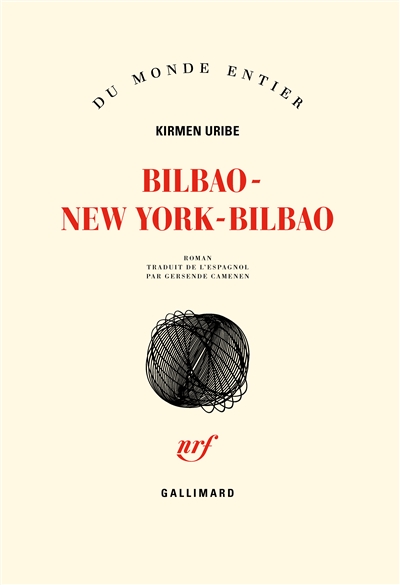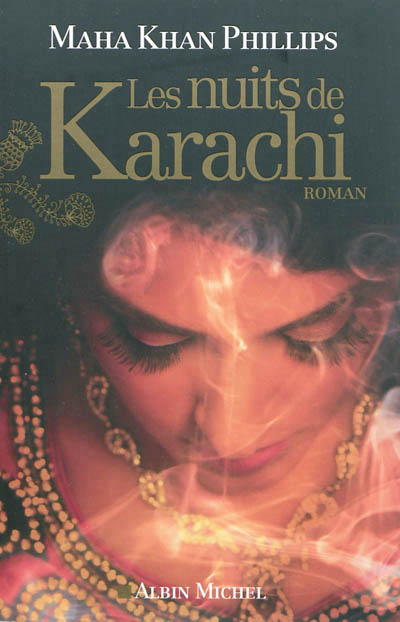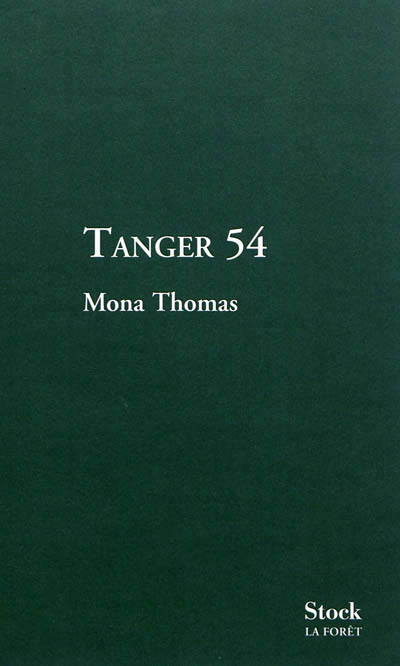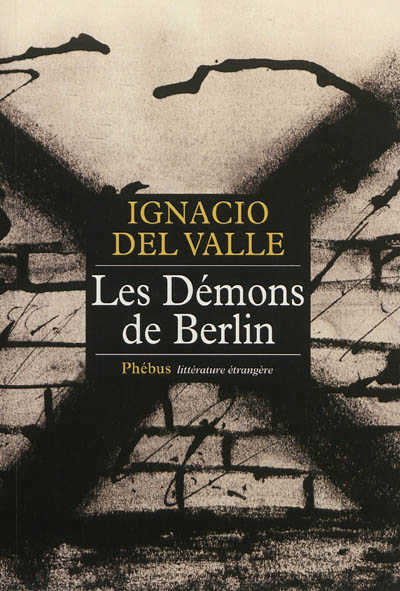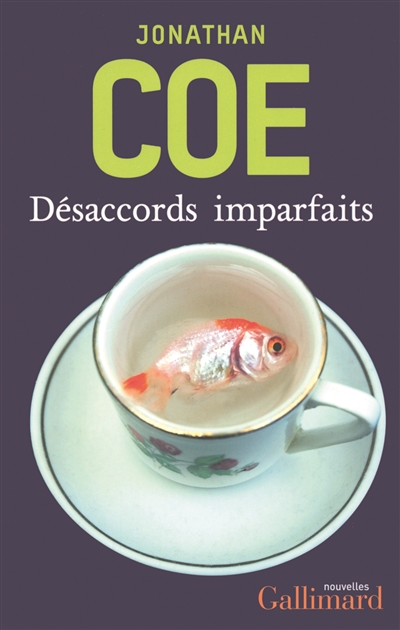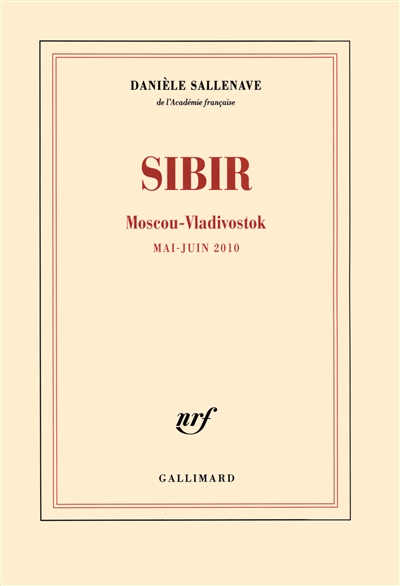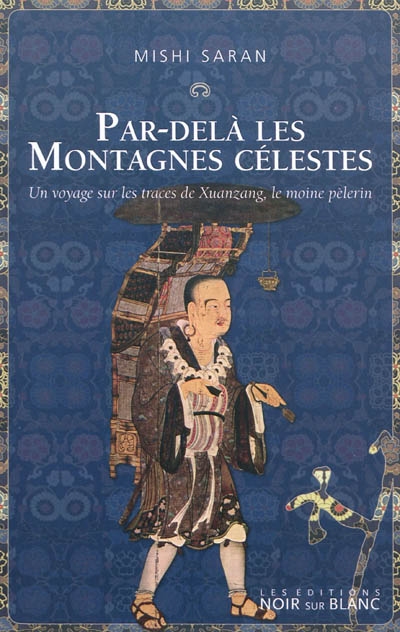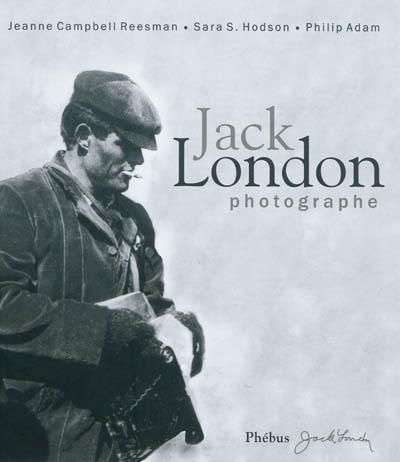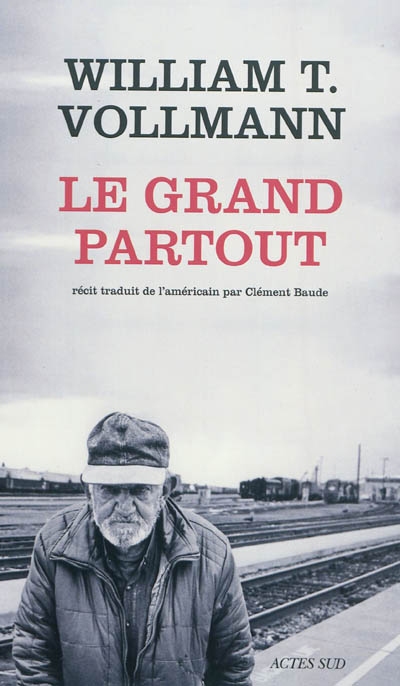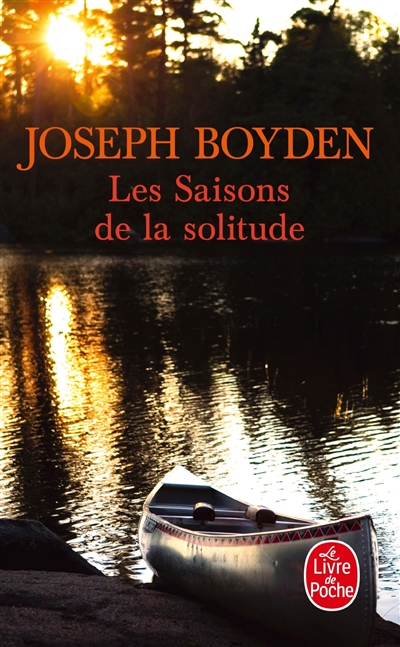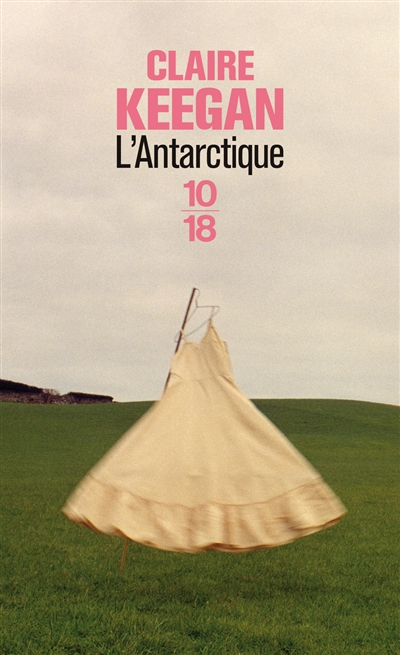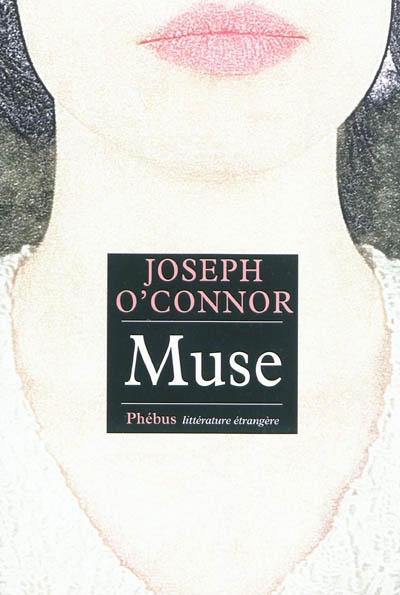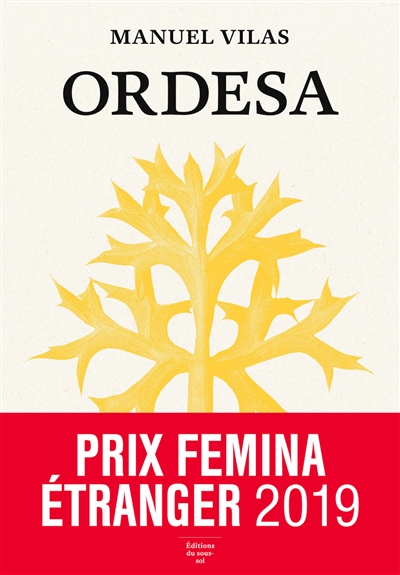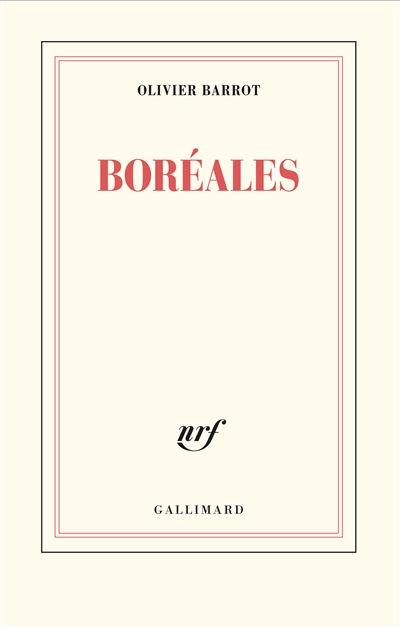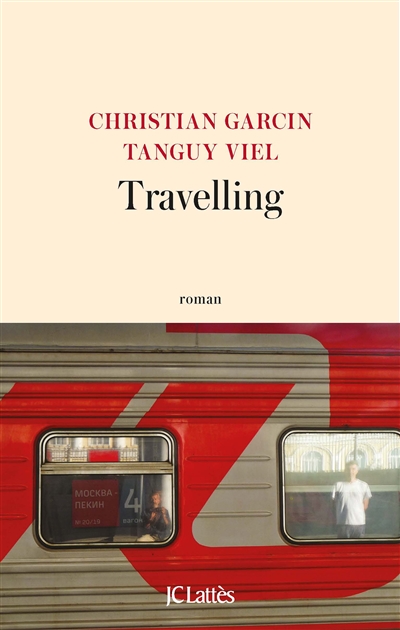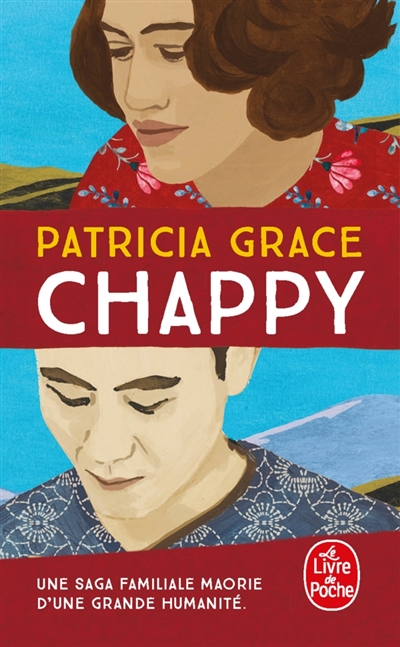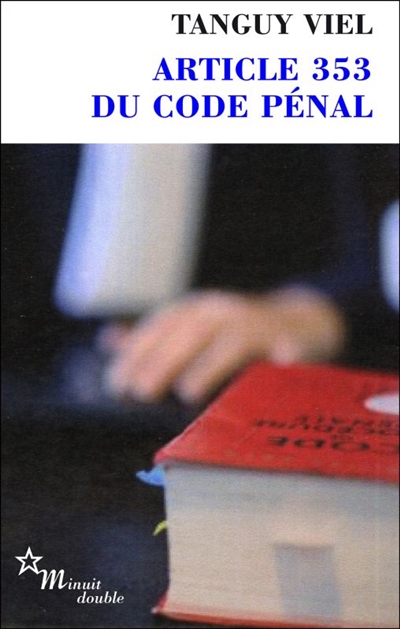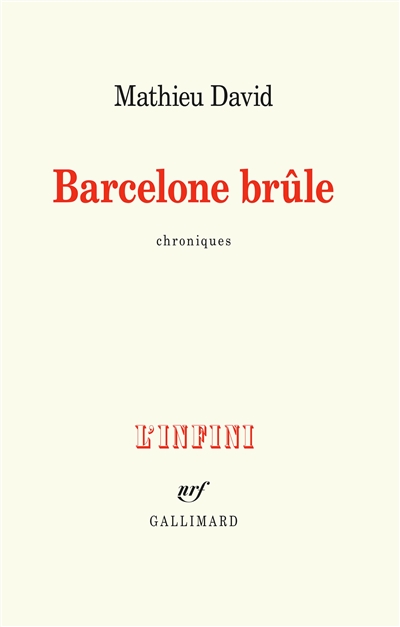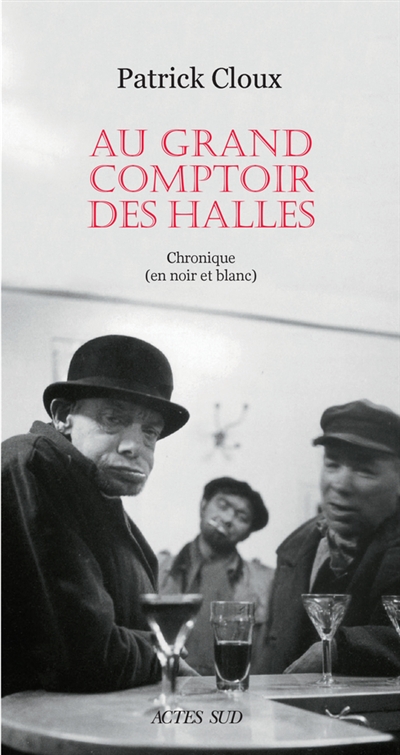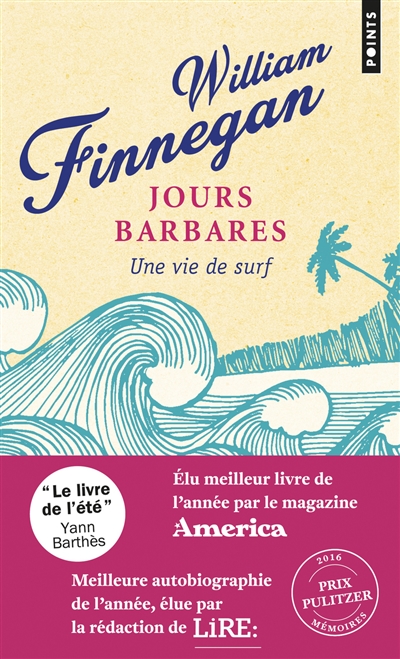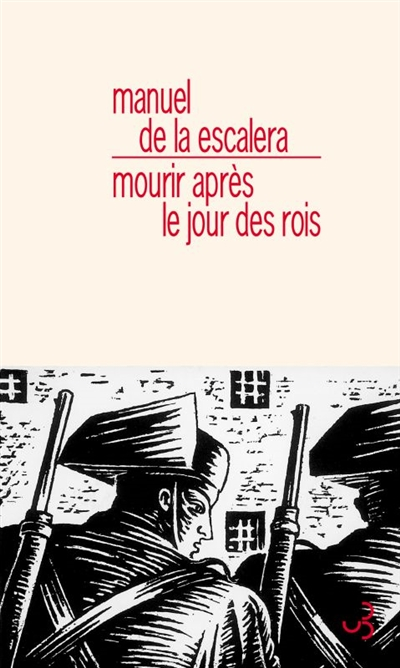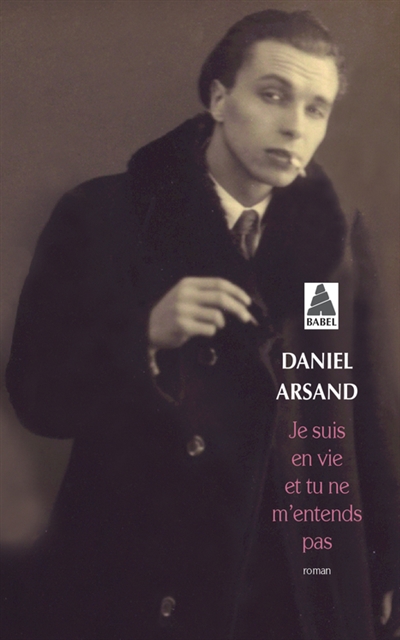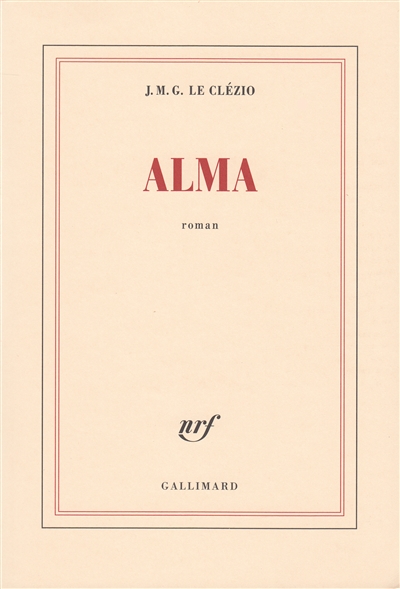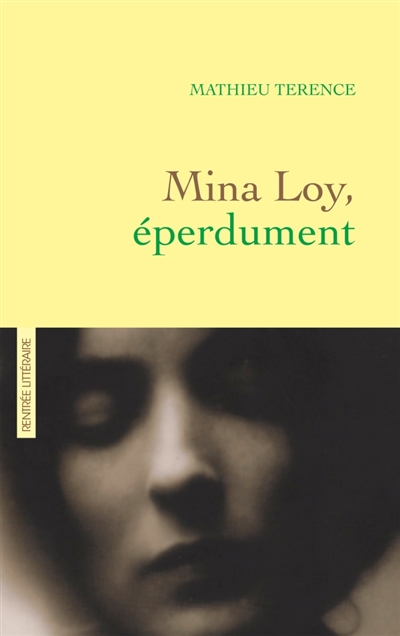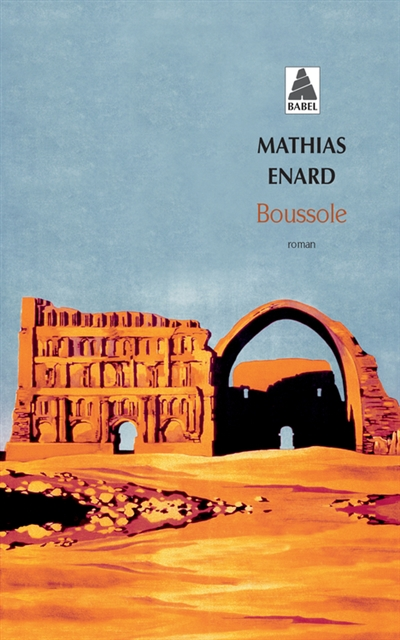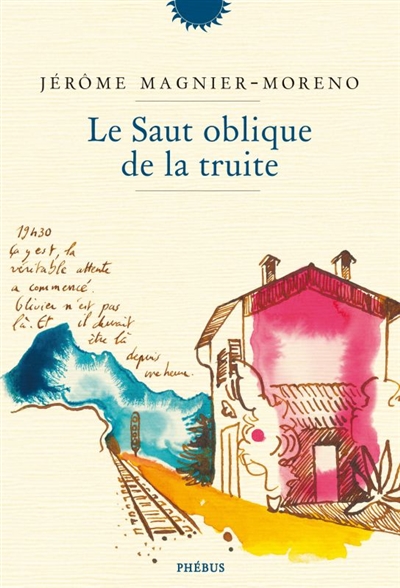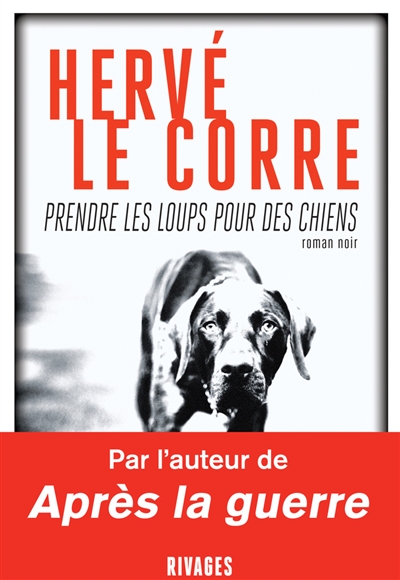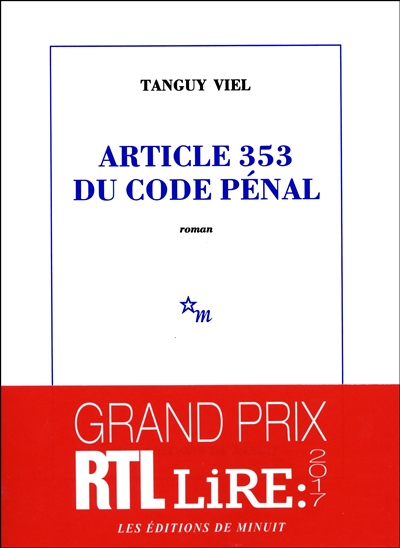Littérature étrangère
Gabriele Tergit
Les Effinger

Partager la chronique
-
Gabriele Tergit
Traduit de l'allemand par Rose Labourie
Christian Bourgois éditeur
05/10/2023
949 p., 30 €
-
Chronique de
Marie Hirigoyen
Librairie Hirigoyen (Bayonne) -
Lu & conseillé par
6 libraire(s)- Pascal Aurejac de Le Rouge et le Noir (Saint-Chély-d’Apcher)
- Marie Hirigoyen de Hirigoyen (Bayonne)
- Isabelle Poilbois de Espace Culturel E.Leclerc (Chambly)
- Valérie Barbe de Au brouillon de culture (Caen)
- Vinciane Cannic de Le Livre bleu (Versailles)
- Marie-Ève Charbonnier de Paroles (Saint-Mandé)


Chronique de Marie Hirigoyen
Librairie Hirigoyen (Bayonne)
Souvent perçue comme le pendant juif et féminin des Buddenbrook, voici une œuvre monumentale de la littérature européenne, traversée par une étonnante modernité de style. Par cette fenêtre ouverte sur une brèche du temps, Gabriele Tergit (1894-1982) rend hommage à un monde aboli par la barbarie nazie. Essentiel.
« Ce que je souhaiterais, c’est que tous les juifs allemands disent : "Oui, c’est ainsi que nous étions, c’est ainsi que nous avons vécu entre 1878 et 1939" ». Gabriele Tergit, avec son œil affûté de journaliste, déroule ce roman-fleuve fortement inspiré par son histoire familiale. En 1933, les SA débarquent chez elle provoquant sa fuite. C’est entre cette date et 1950 que le manuscrit voit le jour dans des chambres d’hôtel à Prague, Jérusalem, Tel-Aviv et Londres où elle a vécu jusqu’à sa mort en 1982. Elle nous plonge dans l’intimité de trois familles juives bourgeoises sur quatre générations : les Goldschmidt, les Oppner et les Effinger. C’est de Kragsheim la provinciale, berceau des Effinger que l’ambitieux Paul, fils d’horloger, va gagner Berlin et créer une fabrique de vis. À force de travail, il deviendra le pionnier de la construction automobile, avec sa voiture sans chevaux et sans rails, « l’automobile du peuple ». Entrepreneurs ou banquiers, maîtres du changement, Prussiens progressistes, ils sont le moteur de la révolution industrielle qui va projeter la métropole trépidante dans le XXe siècle, le miracle de l’électricité, la fumée des usines et le capitalisme moderne. Face à la richesse des uns, la classe ouvrière commence à chuchoter le nom de Marx. Les femmes quant à elles peinent à quitter le XIXe siècle, soumises aux mariages arrangés et au regard de la société mondaine. Toutefois les premiers mouvements féministes s’organisent. Sofie Oppner s’affranchit du carcan, divorce et mène la vie d’artiste. Amours, jalousies, politique, économie, finance, théâtre, architecture, impressionnisme, expressionnisme, religion, éducation : toutes les préoccupations de l’époque sont évoquées par des dialogues vifs, percutants, souvent caustiques, au cœur d’intérieurs opulents où bruissent les étoffes et tinte l’argenterie. La guerre de 1914, la fin de l’Empire, l’inflation et la révolution de 1918 sonnent le début de la fin. Suit ce que l’on sait : le nazisme, les spoliations, la déportation, la fuite vers la Palestine. Le récit s’accélère alors que les Effinger se débattent dans l’angoisse de la chute et la perte de leur avenir. Mais ils restent fidèles à leur pays : « Nous continuons à aimer une Allemagne qui n’existe plus. Nous croyons à l’humanisme allemand ». Cette fresque pétille tellement de vivacité et d’énergie qu’elle a l’air de narguer le destin tragique d’une lignée dont l’arbre généalogique est constellé d’une date glaçante : 1942.