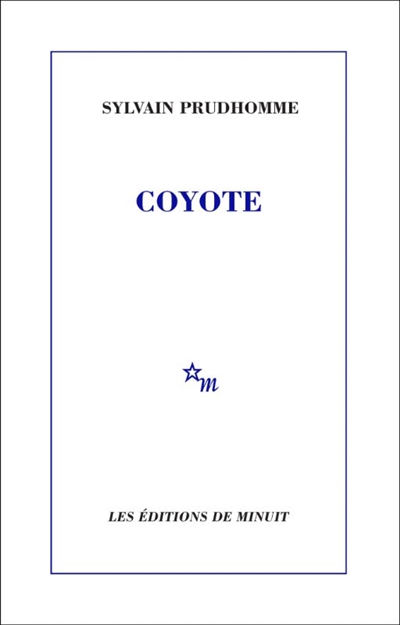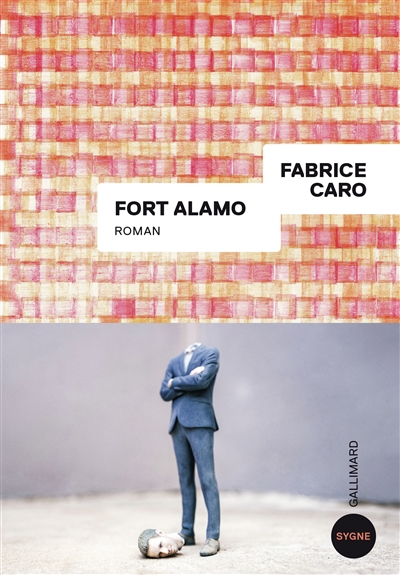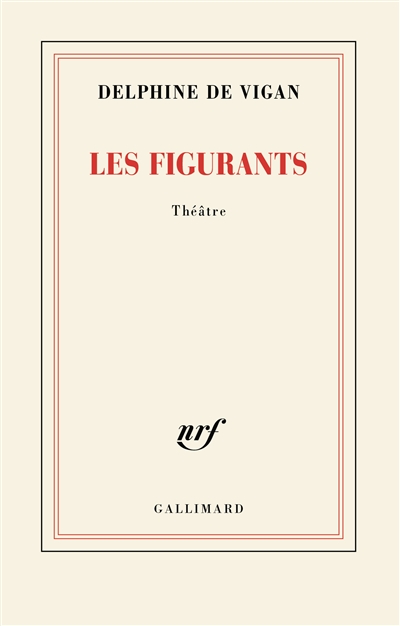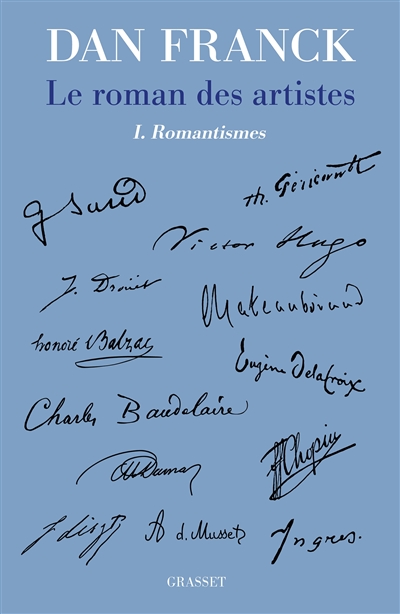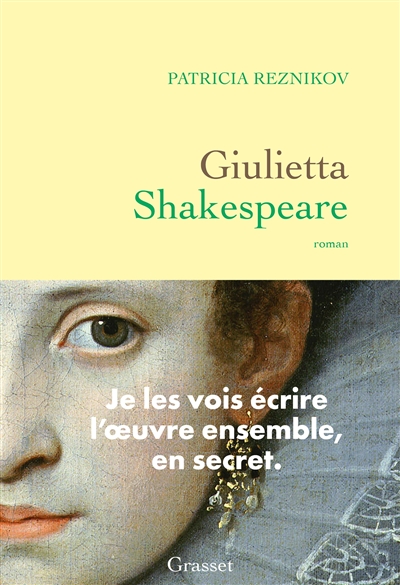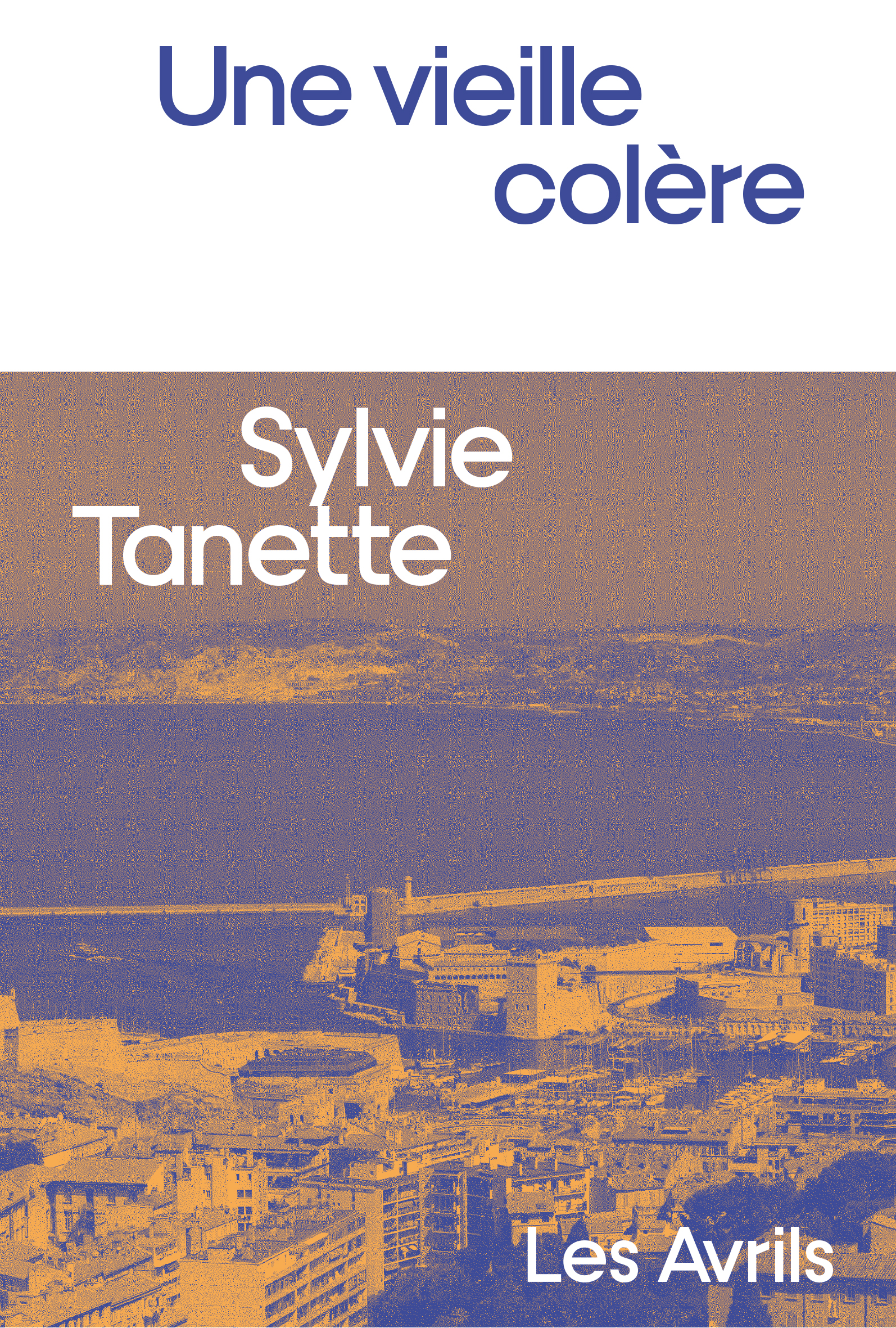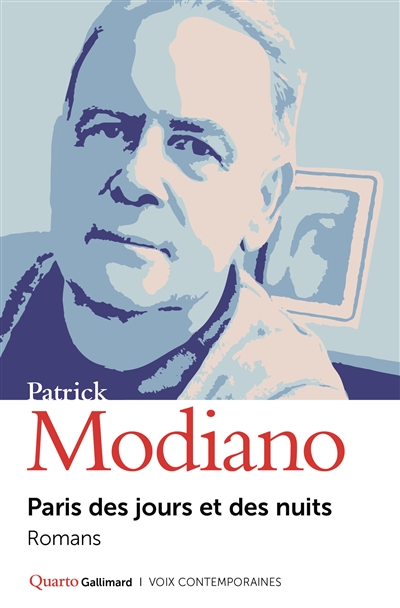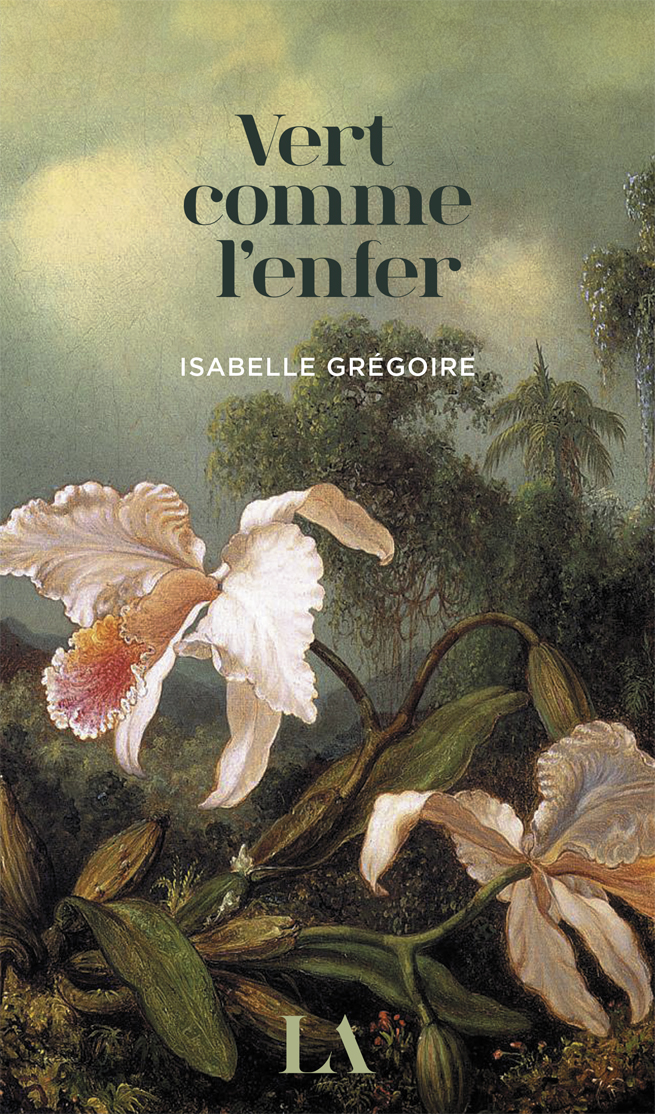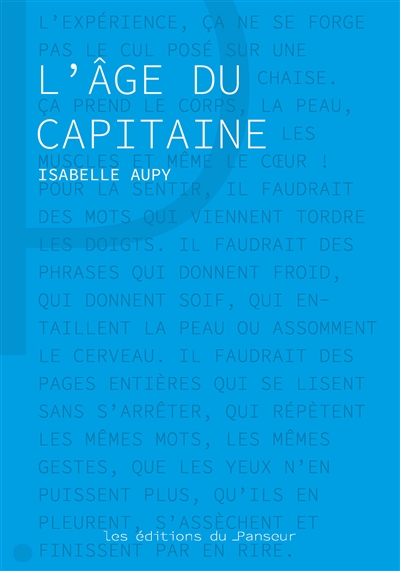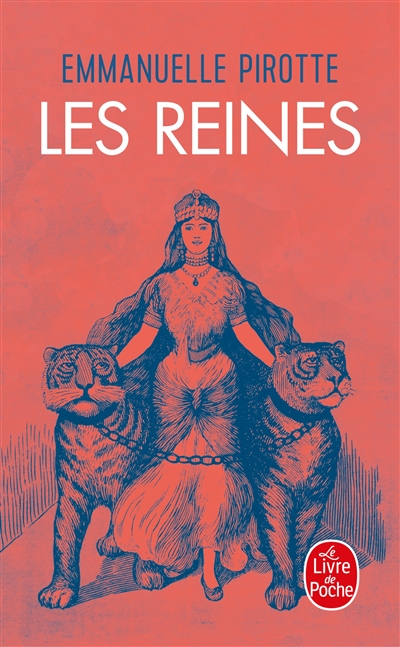Un meurtrier de 12 ans, une victime de 6 ans ! Trois jours et une vie joue d’emblée dans la cour des grands. Quitte à heurter les sensibilités en mettant le lecteur en prise directe avec les pensées et mouvements d’âme d’un enfant tueur ! Tout à la fois suspense psychologique angoissant, roman à l’ambiance rurale poissante, pesante, il pose des questions fondamentales sur l’humanité. Comment peut-on commettre l’irréparable sur un coup de sang, de colère, sur un sentiment d’injustice ? Comment, en quelques minutes, une vie bascule ? Comment vivre dans le secret de la faute ? La vie elle-même ne se charge-t-elle pas de punir le coupable, quitte à ce qu’il s’en arrange ? Faute, secret, conscience, destin, expiation… le propos, presque métaphysique, est tendu par une intrigue qui se noue au cœur d’une province française des années 2000. Relations de voisinages, rivalités des classes sociales, poids des notables, Pierre Lemaitre nous entraîne au cœur d’une France familière, presque familiale ?
Page — Succès d’Au revoir là-haut, Goncourt en bandoulière... comment avez-vous vécu cette reconnaissance et cette pression ?
Pierre Lemaitre – Il est évidemment difficile de se remettre d’un succès, mais c’est tout de même... un problème de privilégié. Je souhaite à tous mes confrères de vivre une aussi heureuse difficulté. La pression est évidemment importante. On a toujours l’impression d’écrire sous le regard de ses lecteurs, on doute de pouvoir écrire un roman aussi réussi que celui qui vous a valu à la fois les faveurs du public et un prix prestigieux. Je n’ai jamais cessé d’écrire, tout bonnement parce que j’en suis incapable. Mais j’écrivais à un rythme lent parce que mon temps était mobilisé autour de la promotion d’Au revoir là-haut en France et à l’étranger. J’avais pensé ce livre comme le premier volet d’une suite et le succès m’a conduit à la mettre en chantier. Mais c’est un piège que, finalement, je suis parvenu à éviter.
Page — À quel moment l’écriture de Trois jours et une vie a-t-elle démarré ?
P. L. – Lorsque Au revoir là-haut a été achevé, j’avais commencé cette histoire d’un jeune meurtrier de 12 ans. Et j’ai compris que si je ne l’écrivais pas maintenant, pris par l’importante machinerie que constitue toujours une suite romanesque, je ne l’écrirais jamais. J’ai donc changé mes plans. J’ai écrit Trois jours et une vie. Le roman existe, il est à sa place dans ma bibliographie et je peux maintenant sereinement me remettre au travail sur cette suite dont je sais aujourd’hui qu’elle sera, a minima, une trilogie.
Page — Quelle est l’idée de départ de Trois jours et une vie ?
P. L. – J’ai été frappé ces dernières années du grand nombre de faits divers mettant en scène de jeunes meurtriers : adolescents (comme ceux qui sont dépeints par Morgan Sportès), des jeunes et même de très jeunes enfants. Leurs motivations varient de l’idéologie au réflexe psychologique, de l’influence à la manipulation. Le point commun reste le même et la question demeure : comment devient-on un meurtrier à un âge pareil ? C’est une vaste question à laquelle je ne me sentais pas de travailler. En revanche, comment vit-on ensuite ? Ça, je pensais pouvoir y réfléchir dans une perspective romanesque. Je suis donc parti d’une question très simple : que se passe-t-il lorsqu’un acte qui va peser sur votre destinée est commis avant que vous ayez conscience de ce qu’est la destinée. Ce roman, dans sa facture, s’inscrit dans la lignée de plusieurs de mes romans, comme Cadres noirs (Le Livre de Poche) par exemple. Il ne sera une surprise que pour les lecteurs qui n’ont lu, de moi, que le prix Goncourt. J’ai opté pour une trame purement linéaire et chronologique pour tenter de créer une impression de rouleau compresseur. J’ai très peu utilisé les outils ordinaires d’accélération du récit. L’intérêt du roman me semblait résider dans un mélange étroit entre événements prévisibles et événements inattendus. J’ouvre Rosy & John (Le Livre de Poche), un de mes derniers romans noirs, par ces mots : « Les choses définitives ne mettent pas un dixième de seconde à se produire ». C’est vrai aussi pour Antoine. Situer cette histoire dans la banlieue parisienne ou celle d’une grande ville, par exemple, m’aurait contraint à traiter d’autres dimensions de cette tragédie qui n’étaient pas au cœur de mon projet. Les relations avec l’environnement ne sont pas les mêmes, les ressorts de l’intrigue auraient été très différents. Par ailleurs, une petite ville de province touchée par la crise offrait une bonne caisse de résonance au fait divers tragique, comme on le trouve par exemple dans Laidlaw (Rivages/Noir), le chef-d’œuvre de McIlvanney.
Page — Antoine, l’enfant sage, innocent presque, commet l’irréparable. Comment êtes-vous rentré dans la psychologie d’un enfant meurtrier ?
P. L. – Oui, le roman raconte le crime d’un innocent. Au fond, vu sous cet angle, c’est moins un crime qu’une faute... C’était évidemment un enjeu du roman : comment raconter une histoire du point de vue d’un garçon de 12 ans. J’ai fait de nombreuses tentatives jusqu’à la scène de la page 45 où il m’a semblé avoir trouvé la bonne manière. Antoine s’exprime de manière peu rationnelle parce qu’il n’a pas la maturité nécessaire. Il le fait donc à partir d’images livresques, télévisuelles, de clichés, de ce dont il dispose et qui n’est pas suffisant pour gérer la situation complexe dans laquelle il est plongé. Je tente de provoquer chez le lecteur à la fois un mouvement d’empathie et une condamnation morale vis-à-vis de son comportement. On veut voir punir quelqu’un, que, pour autant, on ne déteste pas. Afin d’obtenir cette ambivalence, il fallait que le lecteur entre dans le personnage, donc le lui livrer à peu près entier. L’une des questions que, j’espère, pose le roman, est celle de la faute et de l’expiation : quelqu’un qui n’a pas de juge est condamné à devenir son propre bourreau. C’est le problème du « crime parfait ». Pour qu’il soit réellement parfait, il faudrait que le meurtrier parvienne à l’oublier, parce que s’il le mâche et le remâche, il devient son propre bourreau. Le roman travaille sur l’hypothèse selon laquelle tout le monde a une mauvaise action à se faire pardonner. Le temps cache les choses mais ne les fait pas disparaître. Si Antoine s’était conduit différemment, il aurait expié autrement. Mais quel que soit son choix, quelle que soit sa conduite, Antoine ni personne dans ce genre de situation, ne peut échapper à une expiation. La sienne consiste à accepter ce qui, à ses yeux, était peut-être le pire. Mais je crois, hélas, qu’il va finir... par s’y faire.