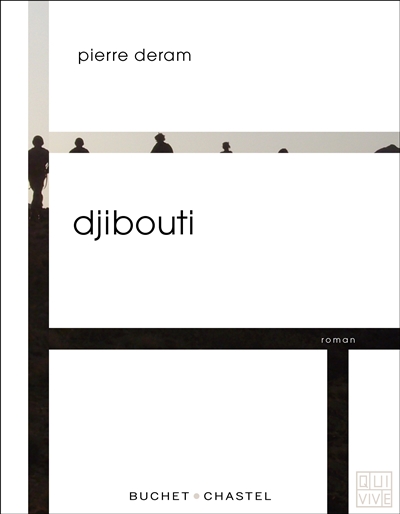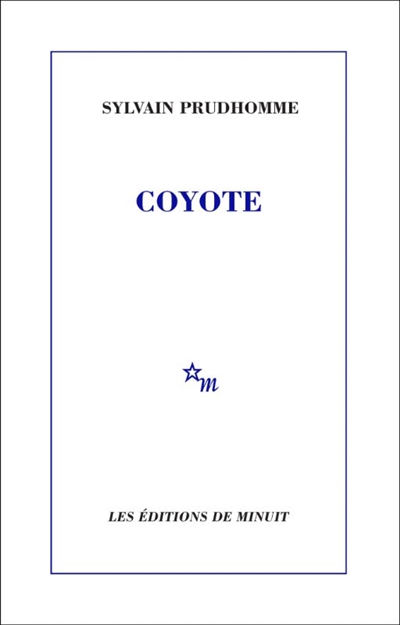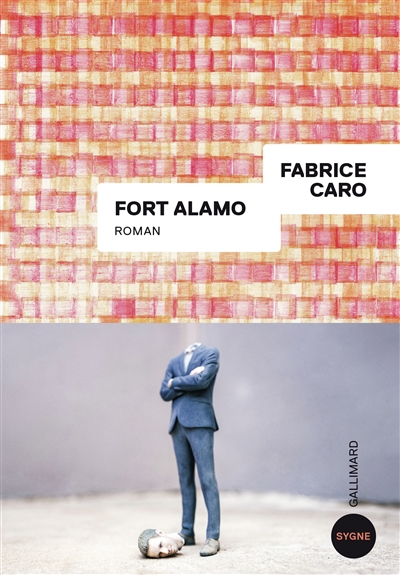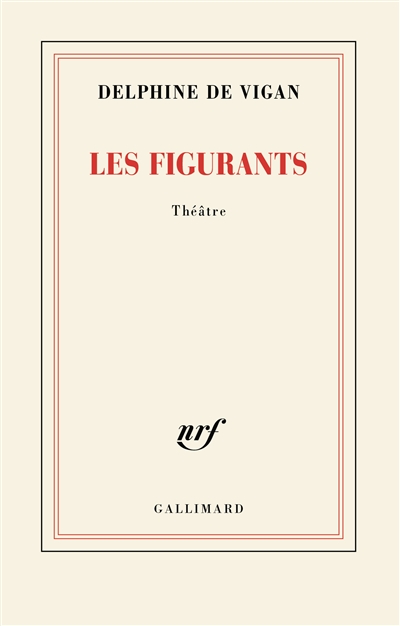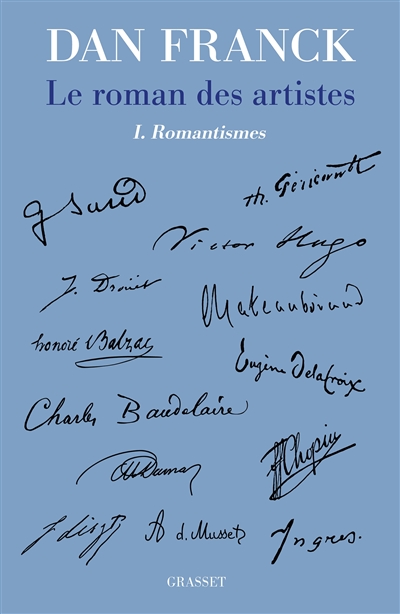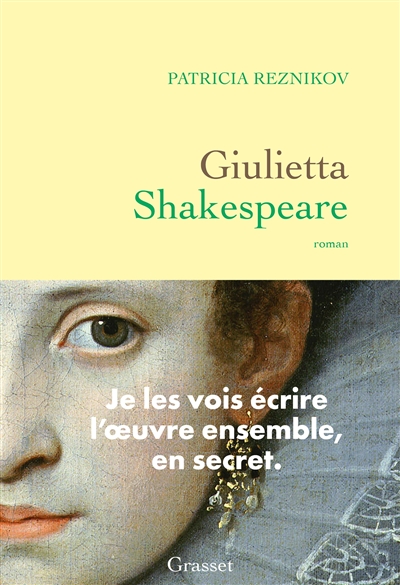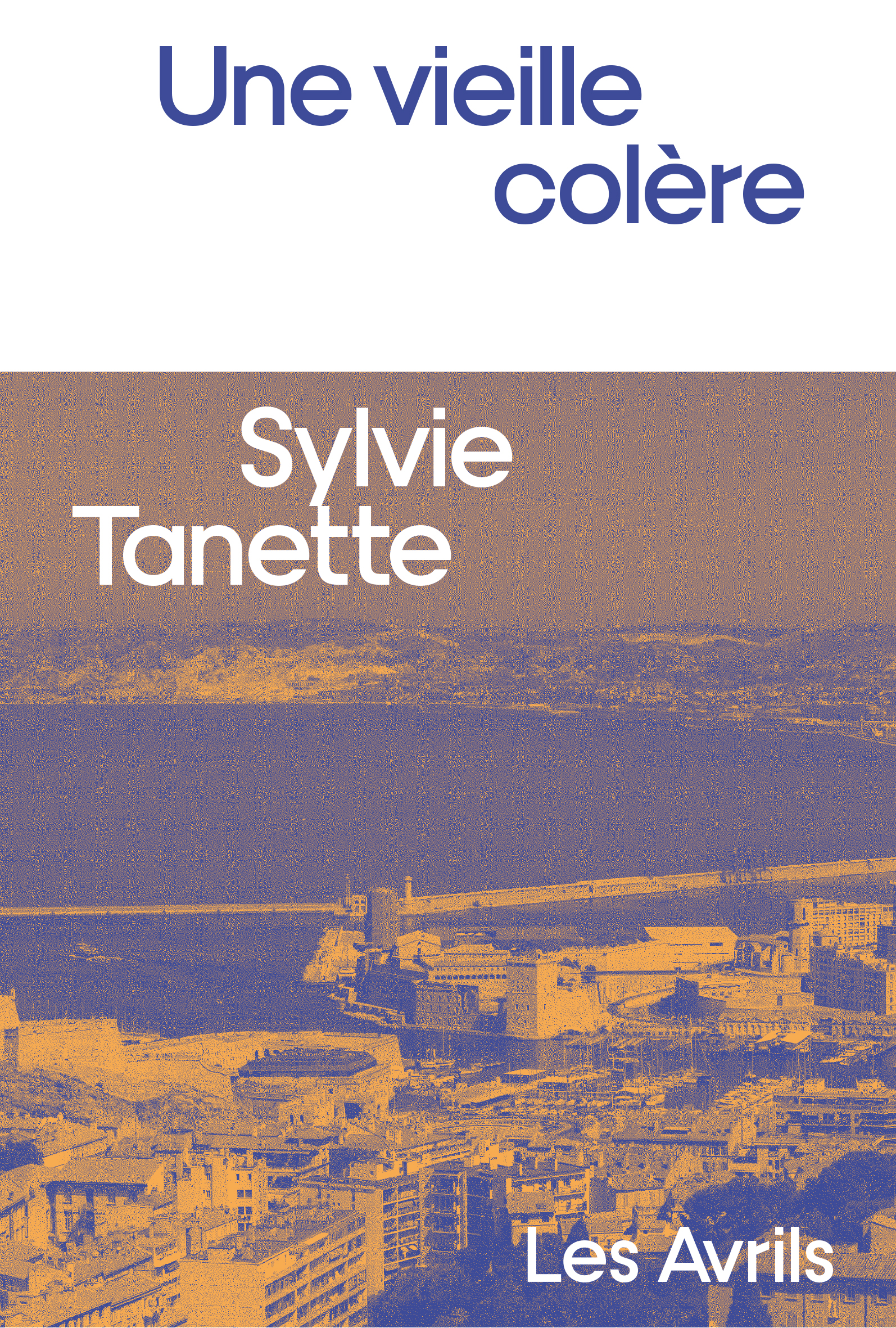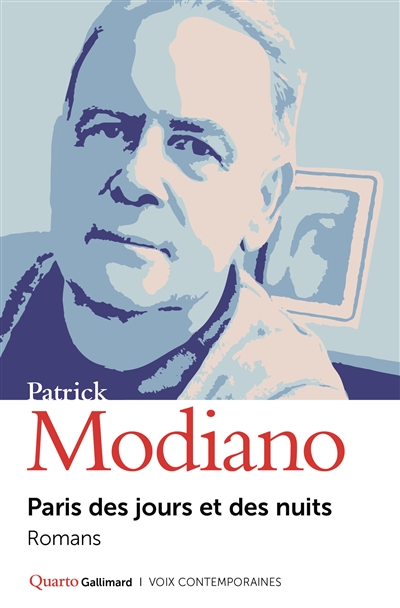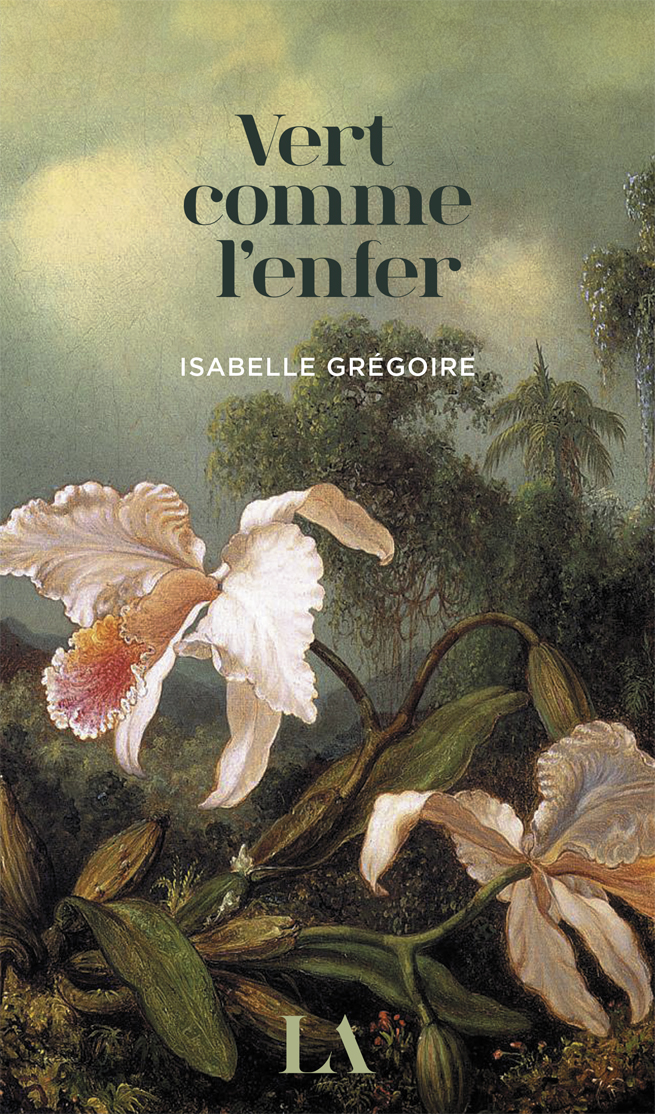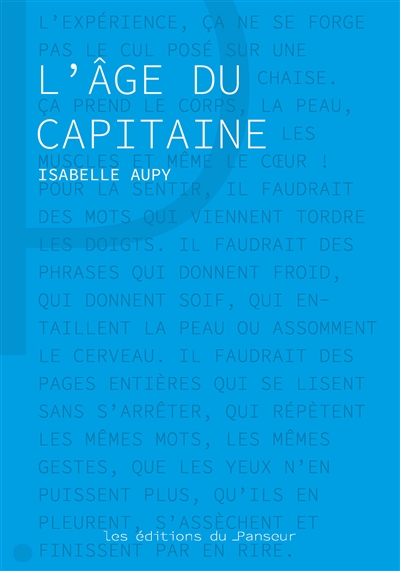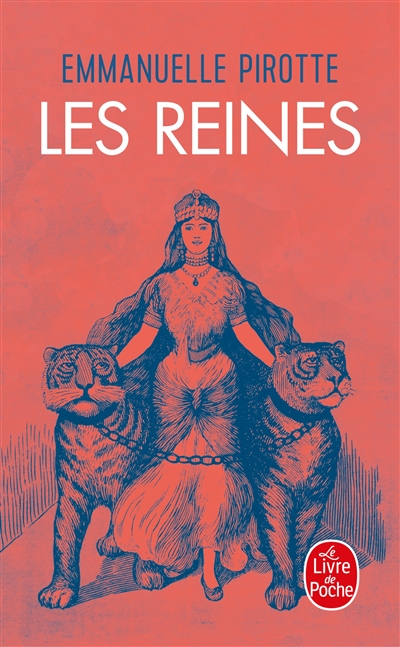Entretien avec Pierre Deram from PAGE des libraires on Vimeo.
Brûlant et urgent ! Djibouti est le premier roman d’un jeune auteur de 26 ans. L’âpreté de son texte révèle un raconteur qui sonde l’humain et la violence avec la lucidité et l’acuité d’un vieux baroudeur des mots. Djibouti vous saisit comme une salve d’arme automatique. L’écriture d’une précision cinématographique ou d’un lyrisme incantatoire, ne laisse aucun répit. Markus, soldat dans la coloniale, vit sa dernière nuit à Djibouti, « un pays de malheur, un implacable désert ». Six mois après son arrivée, il plonge à corps perdu dans son implacable désert, sa chaleur étouffante, et déambule dans les rues, les bars, pour une ultime confrontation avec les putains et les militaires ivres de solitude et de violence. Le temps d’une nuit, Markus fait l’expérience d’une humanité à la fois sordide et flamboyante. Une errance initiatique qui sonde les corps, les cœurs et les âmes. Au petit jour, le temps du retour approche... Quelle part d’humanité reste-t-il en lui ?
Page — Comme le titre l’indique, Djibouti est l’un des principaux personnages du livre. Pourquoi avoir choisi cette ancienne colonie française comme cadre de votre premier roman ?
Pierre Deram — Djibouti est un tout petit pays à l’extrême pointe de l’Afrique, limitrophe de l’Éthiopie, la Somalie, l’Érythrée et le Yémen, face à Aden. Dans l’embouchure de la mer Rouge. C’est une terre qui a été assez peu explorée au niveau littéraire. Les connaisseurs de Rimbaud la reconnaîtront, bien sûr. Paul Nizan, Henri de Monfreid avec ses romans d’aventure, l’ont aussi évoquée. J’ai vécu une expérience de plusieurs mois à Djibouti. Le roman montre l’adéquation entre mon état d’esprit de l’époque et ce pays un peu fou. Il est né de la rencontre avec cette terre désolée, au bout du monde, entre la mer Rouge et le désert. Vous n’avez, là-bas, que des militaires et des prostituées. Toutes les armées du monde cherchent à s’y implanter. C’est une zone stratégique. Les Français ont développé les premières infrastructures : voies ferrées, bâtiments, comptoirs commerciaux… Cela a commencé à l’époque de Rimbaud. La place principale de la capitale portait d’ailleurs son nom. Djibouti s’est libéré de la tutelle de la France dans les années 1970. Les deux pays entretiennent toujours des relations privilégiées. Il y a là-bas des régiments d’infanterie, des légionnaires, une base navale, une base aérienne…Les Américains et les Japonais sont également présents. Les Chinois cherchent à s’y implanter. Djibouti est une terre déchirée entre les intérêts des grandes puissances du monde.
P. — Le roman se déploie le temps d’une nuit avec des allers-retours entre ce présent et des scènes vécues par Markus pendant ses six mois d’armée. Comment avez-vous construit cette déambulation ?
P. D. — Je n’ai pas voulu une construction, plutôt une superposition cousue de flashs et de souvenirs. Je voulais que l’action se passe au long d’une nuit qui s’étire. Je n’ai pas voulu faire une description de Djibouti, même si elle apparaît en creux. L’impulsion première du roman est une angoisse métaphysique. Une sorte de vision de fin du monde qui serait, non pas un moment de l’histoire comme on veut nous le faire croire en ce moment, mais la réalité de notre existence. Une fin du monde, infinie et répétée depuis la nuit des temps. Il se trouve que ce sentiment s’est mélangé avec la géographie de Djibouti. Cela a été une expérience totale.
P. — Markus est militaire. Pendant le temps qu’il passe au sein de l’armée, il a vécu la mort et l’errance de ces militaires qui, dans le roman, ne se battent jamais. Sauf, peut-être, contre eux-mêmes, ou les uns contre les autres dans des jeux absurdes. Le mythe du beau légionnaire qui sent bon le sable chaud s’effondre donc ?
P. D. — Je ne sais pas si le mythe du légionnaire existe vraiment. Il y a beaucoup de fantasmes véhiculés à ce sujet. Il y a différentes strates. On n’a pas l’habitude de voir les choses comme je les décris ici. C’est toutefois ce que j’ai observé, de l’intérieur. Et c’est quelque chose de très violent, de très beau, de très viril. C’est de la chair. Ce n’est pas une idéologie, une idée. Dans le roman ces hommes font des choses qui les dépassent eux-mêmes. Le corps parle avec désespoir. Djibouti est une ville de garnison, un lieu de folie. Il y a quelque chose de plus universel que l’armée et les militaires. Cela m’a touché. Je ne suis pas militaire. Si on creuse, on gratte la surface du monde et on parvient au chaos fondamental de toute chose. Un chaos qui les dépasse et les emporte tous.
Une des scènes du livre raconte un jeu auquel les hommes se livrent dans les bars. Il consiste à se cogner tête contre tête, les mains attachées dans le dos, les yeux bandés. Le but est de se charger, de s’assommer. Je ne l’ai pas inventé. Ce jeu existait déjà en Indochine. La période de la guerre d’Indochine m’a toujours fasciné. J’ai retrouvé à Djibouti cette sorte d’errance et de désespoir qui existait là-bas. Les scènes du roman ne sont pas symboliques. Elles sont vécues dans leur chair par les personnages.
P. — Pour sa dernière nuit, Markus se jette à corps perdu dans Djibouti. On croise des soldats ivres de folie, de violence et de solitude, des prostituées prêtes à aimer des militaires le temps d’une passe. Une humanité est-elle encore possible ?
P. D. — Ces militaires sont de grands enfants qui sur-jouent la virilité. Là-bas, toutes les femmes sont des prostituées. Les militaires ne sont en contact qu’avec ce genre de filles. Et j’ai éprouvé une grande tendresse et une grande fascination pour ces femmes. Un sentiment que je ne savais exprimer autrement qu’en l’écrivant. En peignant ces corps et ces jeunes filles perdues, je décris l’alliance de la beauté et de la violence. C’est le lien qui unit les militaires et les prostituées. Ces hommes perdus et ces femmes perdues m’intéressaient. Finalement les uns servent aux autres. Les deux se complètent. Comme deux totems posés côte à côte.
Sélection prix du Style 2015 et Fête du livre du Var 2015