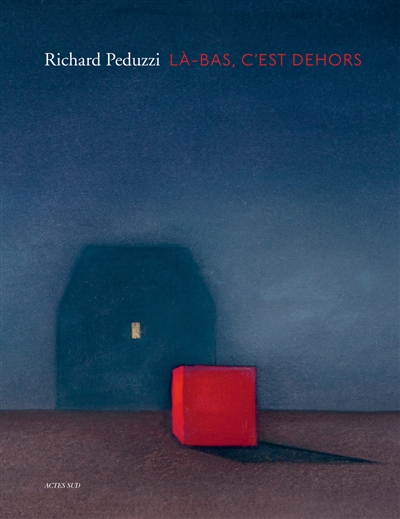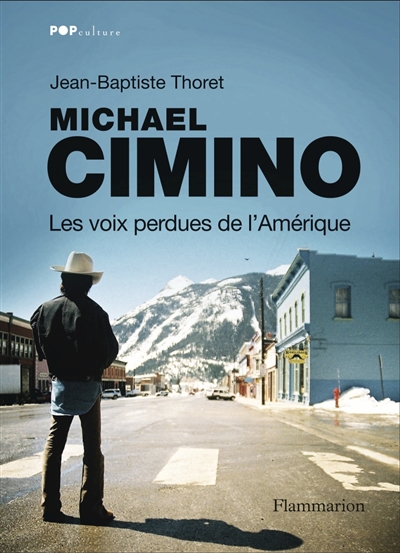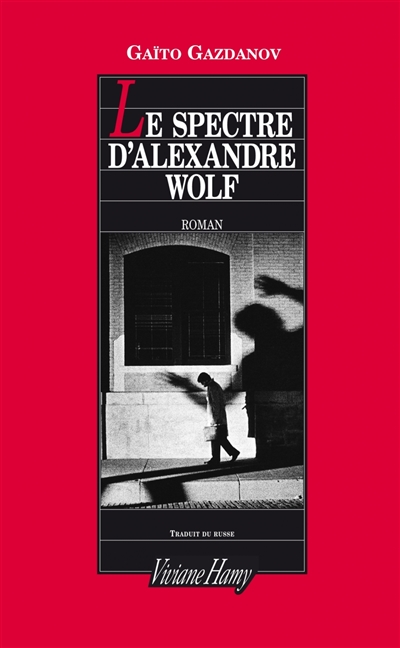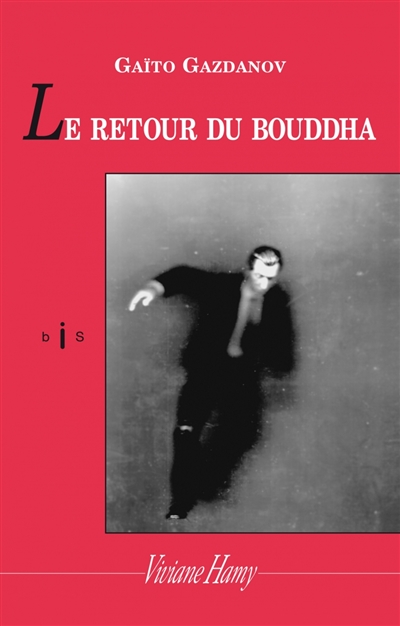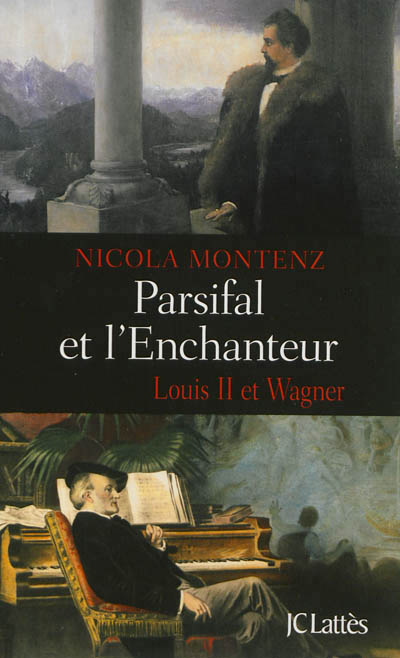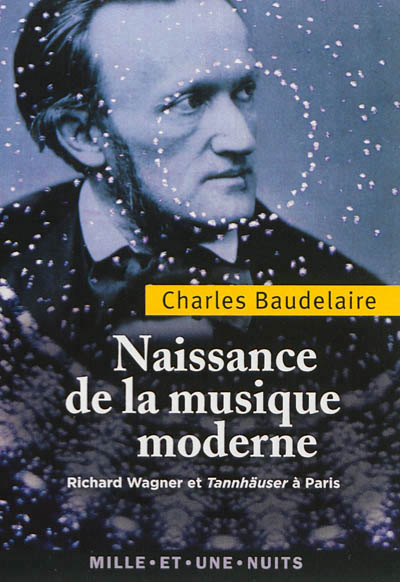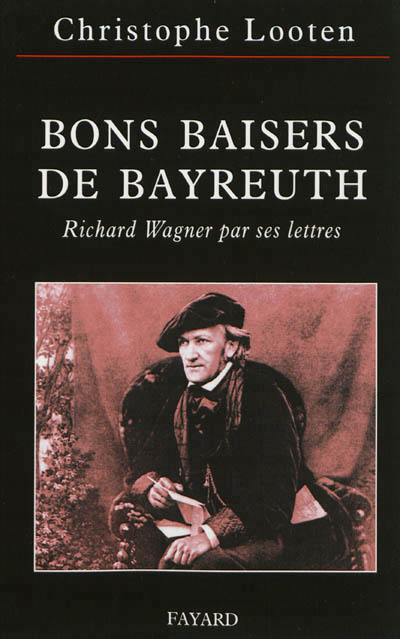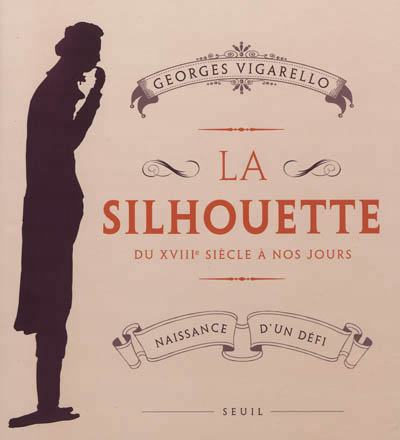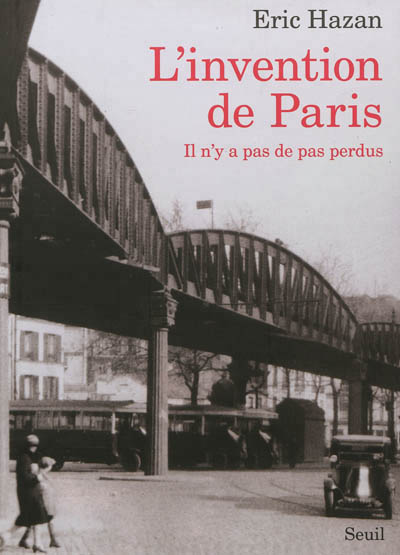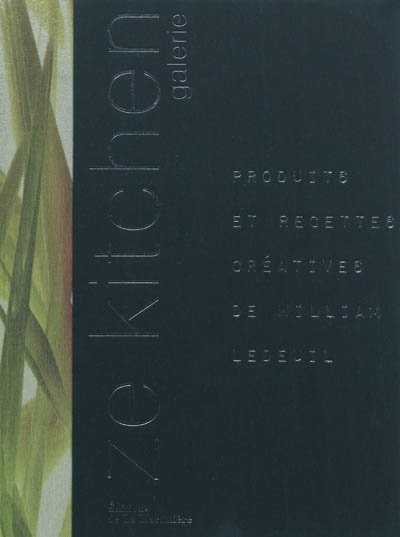Littérature étrangère
Andrea Bajani
Toutes les familles

-
Andrea Bajani
Toutes les familles
Traduit de l’italien par Vincent Raynaud
Gallimard
01/01/2005
311 pages, 23,90 €
-
Chronique de
Philippe Poulain
-
❤ Lu et conseillé par
1 libraire(s)
- Alexandra Romaniw de L'Atelier (Paris)
✒ Philippe Poulain
( , )
Il faut lire Andrea Bajani, et son roman Ogni promessa, dans la traduction exacte qu’en rend Vincent Raynaud. Il faut adhérer à son plan, et que les chaussures du lecteur adhèrent aussi exactement aux empreintes des pas de l’auteur. Il ne faut ni vouloir ralentir, ni brusquer le pas. Il suffira de cette adhésion pour que les promesses soient tenues.
Une phrase simple, des verbes à l’imparfait, des actions décrites comme un quotidien banal. Un commencement d’intrigue, peu d’indices. Des renseignements aidant au profil des personnages, de leur identité ou de leur altérité, très parcimonieusement : on apprend à reconnaître la mère, le narrateur enfant, puis le narrateur au présent, devenu instituteur, et sa fiancée, Sara. Le grand-père enfin, Mario, élément moteur du récit, pivot, mais aussi personnage en creux, trou noir de l’histoire, et de l’Histoire. Dans les premières pages où il apparaît, Mario est nommé « le squelette », lorsque, enfant, le narrateur voit ce fou, ce vagabond venir le chercher à l’école. Très vite, le fantôme disparaît, même des discours de la mère, même comme secret de famille à partager. Puis il ressurgit sur une photo, et au verso de la photo, « Front russe, décembre 1942 ». Avec cette photo, que le narrateur enfant colle dans son album, le mystère s’épaissit entre les vivants et les morts, entre les vaincus d’alors et les victimes d’aujourd’hui. Jusqu’à ce qu’une autre image relance le mystère, comme dans un jeu de piste : « Sur la photo, on voyait une chose qui ressemblait à un but de football et un jeune homme qui était pendu au but. Dessous, on distinguait trois soldats en train de rire, deux d’entre eux fixaient l’objectif, le troisième regardait ailleurs. C’était un but comme les autres, au milieu d’un endroit qui avait tout d’une place. » Nous sommes page 163, à l’exact milieu du livre ; de cet endroit qui a tout d’une place, le narrateur adulte part en reconnaissance, au fond de la steppe russe. Sur son deuxième versant, le roman ressemble à un film de Théo Angelopoulos, de Tarkovski ou de Wenders, quand des personnages dont on ne sait pas grand chose s’avancent le long de fleuves que troublent sans cesse les brumes, et s’enfoncent dans les pays loin derrière le rideau de fer. Pourtant les êtres – principalement des femmes – que rencontre alors le narrateur sont mieux identifiables, la jeune femme à la réception de l’hôtel, une « dame aux dents en or », une ancienne conductrice de tracteurs médaillée comme héroïne socialiste ; chacune apporte un fragment d’explication et d’expiation, de rémission au crime commis jadis par le grand-père, soldat aux ordres du régime mussolinien. « Les premiers temps où nous vivions ensemble, Sara m’accompagnait à l’école le matin pour voir les enfants. » C’est la première phrase du roman ; il y est déjà question de temps, de vivre ensemble, et de voir les enfants. Ainsi, par ces lieux qui se superposent, se ressemblent, on saisit combien le passé devient une construction, un emboîtage d’une vie à l’autre, un sentiment déjà ressenti par un autre. On habite où d’autres ont habité ; on abrite les histoires des autres, on en a la responsabilité, sans toujours la mémoire. Pour en apprendre plus et s’en délivrer, il faut lire Andrea Bajani.