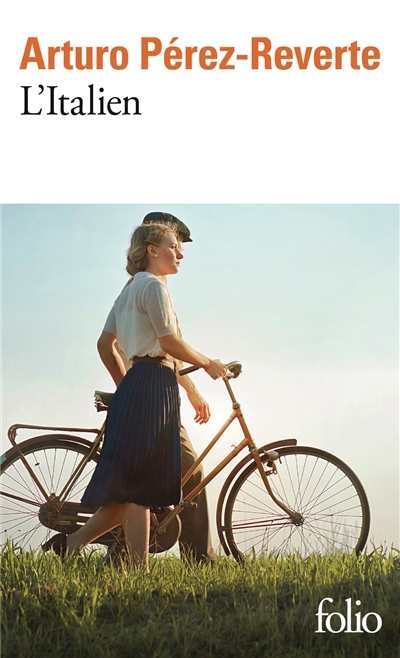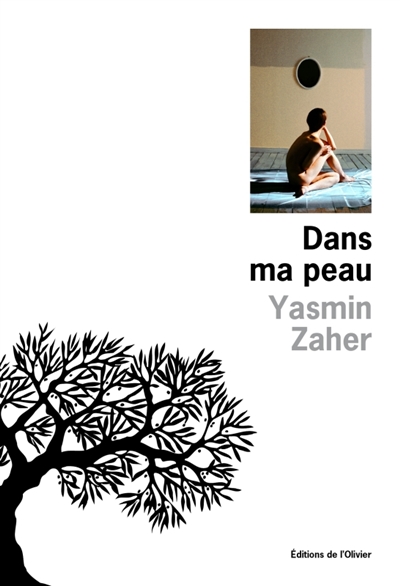Au cœur d’un hiver sombre et glacé, Keelut, petite ville à la frontière de l’Alaska sauvage, a perdu trois enfants après une attaque de loups affamés. Medora Jones, la mère de la dernière victime fait appel à Russel Core, qui s’est autrefois illustré dans une affaire similaire, afin de retrouver les restes de l’enfant et d’abattre l’animal qui lui a pris son garçon. Mais les hommes nous jouent plus de tours que les loups et ce que va découvrir Russel Core est bien éloigné de ce qu’il avait pu imaginer. L’homme, dans ce roman, est aussi sauvage que la nature qui l’entoure. Il reste dans ce lieu un sens aigu de la tribu, un héritage venu des peuples inuits. Les lois qui ont cours ici ne sont pas celles des autorités, elles tiennent bien plus de l’instinct de chasse et de protection. William Giraldi nous entraîne dans une course poursuite sanguinaire et sans merci à la recherche de la vérité derrière la disparition de cette petite victime. Un roman glaçant !
Page — Dès les premières pages de votre roman, j’ai été frappée par l’ambiance, l’atmosphère qui s’en dégage : cet hiver crépusculaire, les loups qui entourent la ville, le froid. Quels sont vos liens avec l’Alaska ? Pourquoi avoir choisi de situer votre roman dans un lieu si isolé et hostile, un lieu dont le nom fait référence à une créature mythique pour le peuple Inuit ?
William Giraldi — J’habite à Boston et je n’ai jamais mis les pieds en Alaska. Cela me semblait essentiel pour que le roman ne devienne pas un reportage déguisé en fiction. L’Alaska d’Aucun homme ni dieu devait rester un Alaska de l’imagination. C’est un lieu auréolé de mystères, un lieu de dangers et de secrets, mais aussi un lieu d’une immense beauté. Ces éléments sont essentiels pour l’histoire que je raconte. Le lieu devait devenir un personnage à part entière. L’Alaska est l’un des derniers paysages encore sauvages aux États-Unis, une étendue gigantesque qui demeure fermée aux étrangers et qui abrite une importante population de loups. C’est un lieu qui nourrit l’imagination, or je me considère comme un romancier de l’imaginaire, et non un romancier versé dans l’autobiographie.
Page — Les loups se sont approchés de la ville par manque de proies pour se nourrir. Des enfants ont disparu et parmi eux, le fils des Slone, Bailey. Medora, sa mère, écrit à un spécialiste des loups dans l’espoir qu’il vienne l’aider à retrouver les restes de son enfant. Dans le roman, Russel Core est l’œil extérieur, l’étranger qui nous permet de découvrir Keelut. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce personnage et son importance dans le roman ?
W. G. — Russel Core, comme son nom l’indique, est au cœur de cette histoire. Il est l’étranger confronté à un mystère et, en ce sens, le lecteur et lui sont similaires : des étrangers cherchant à comprendre ce qui est en train de se jouer. Russel Core est notre guide dans ce lieu. C’est à lui que revient de raconter cette histoire, une histoire qui se révélera faite d’altérité et de sang. De plus, à soixante ans, c’est un personnage entre deux âges, entre deux existences, tout comme le village Keelut est coincé entre la société et la nature.
Page — À cet endroit, il semblerait que, comme les loups, les hommes vivent en meute. Les étrangers sont tenus à l’écart des rites et des croyances. On pourrait parler de liens tribaux en quelque sorte. Pouvez-vous nous en dire plus sur les liens qui unissent ces hommes ?
W. G. — En effet, ces liens puissants au sein de la tribu sont très importants. Ils sont dictés par un sens du dévouement, de la loyauté qui fait cruellement défaut à la civilisation actuelle. À Keelut, si vous n’êtes pas loyal envers votre clan et son code de valeurs, vous ne survivrez pas à la violence et à la bestialité du lieu.
Page — La violence et la noirceur d’âme sont au centre de votre roman. Au départ, vous nous laissez croire que les loups sont des créatures diaboliques, mais en fait se sont bien les hommes qui sont des bêtes sans cœur. Pourquoi tant de violence ?
W. G. — Personne n’a jamais été blessé dans un roman ou dans aucune œuvre construite par l’imagination. La question du mal ou de la violence devient donc une question d’esthétique et non de morale. Le style et le ton correspondent-ils à l’ambiance de l’histoire, aux vies intérieures agitées des personnages ? La teneur de ma prose offre-t-elle du plaisir et quelques bribes de sagesse ? Martin Amis dit que le style est la moralité, que le style prévaut, et je pense qu’il a raison. Le style vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir, même quand vous lisez des textes sur la violence et le mal. Il n’y a aucune jubilation devant le sang versé dans ce livre, pas de fierté tirée de ces vies perdues. Les femmes et les hommes d’Aucun homme ni dieu sont violents parce que la nature est violente – en vivant au cœur de ces étendues sauvages, ils abritent une sauvagerie aussi effrayante et nécessaire que celle présente dans la nature de l’Alaska. Je parle de l’esprit rebelle de l’homme, un esprit qui imprègne la nature et ne peut être altéré. Cela dit, il y a plus de cigarettes que de sang versé dans ce livre ! Je suis à moitié étonné que le lobby anti-tabac ne s’en soit pas pris à mon éditeur ! Quelqu’un fume à chaque page de ce roman. Arrivé à la page 100, je me suis surpris à tousser : j’ai alors réalisé que la quantité de fumée de cigarettes insufflée dans ce récit était peut-être le meilleur présage d’une mort imminente.
Page — Certains retiendront la rudesse de l’hiver, d’autres la noirceur des hommes et d’autres encore cette quête de vengeance. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur la genèse de ce roman, d’où vient cette histoire ?
W. G. — Il y a quelques années, j’ai lu un article au sujet d’un village isolé au Pakistan qui avait été la cible de plusieurs attaques de loups. Ils avaient enlevé des enfants et je me souviens avoir pensé combien cela était inimaginable, insupportable. J’ai été absolument fasciné par cette histoire, par son caractère à la fois mythique et surnaturel. Je n’arrivais pas à chasser ces images de mon esprit. J’ai écrit une nouvelle sur ce sujet, mais la forme courte ne suffisait pas, il fallait en faire un roman. Je voulais également écrire un livre sur le mystère du mal et la majesté meurtrière de la nature. La plupart d’entre nous ne vivent pas ce genre de vies, affronter le mal et tenter de s’approcher du sublime, mais c’est nécessaire pour certains individus, pour des personnes extraordinaires. Il me semble que le rôle du roman est d’aborder l’extraordinaire et non pas de décrire un simulacre de réalité.
Page — Pouvez-vous nous dire deux mots d’un auteur français que vous avez particulièrement aimé ces derniers temps ?
W. G. — Voilà plusieurs années déjà que je voulais lire Patrick Modiano. Quand il a reçu le Prix Nobel, je ne pouvais plus attendre. J’ai récemment lu, dans la traduction anglaise, Chien de printemps, Remise de peine, et Fleurs de ruine. Quel magnifique styliste ! Et quelle incroyable sensibilité dans la narration ! Il y a tellement d’humanité dans ses phrases. Je suis très admiratif de son incroyable talent.