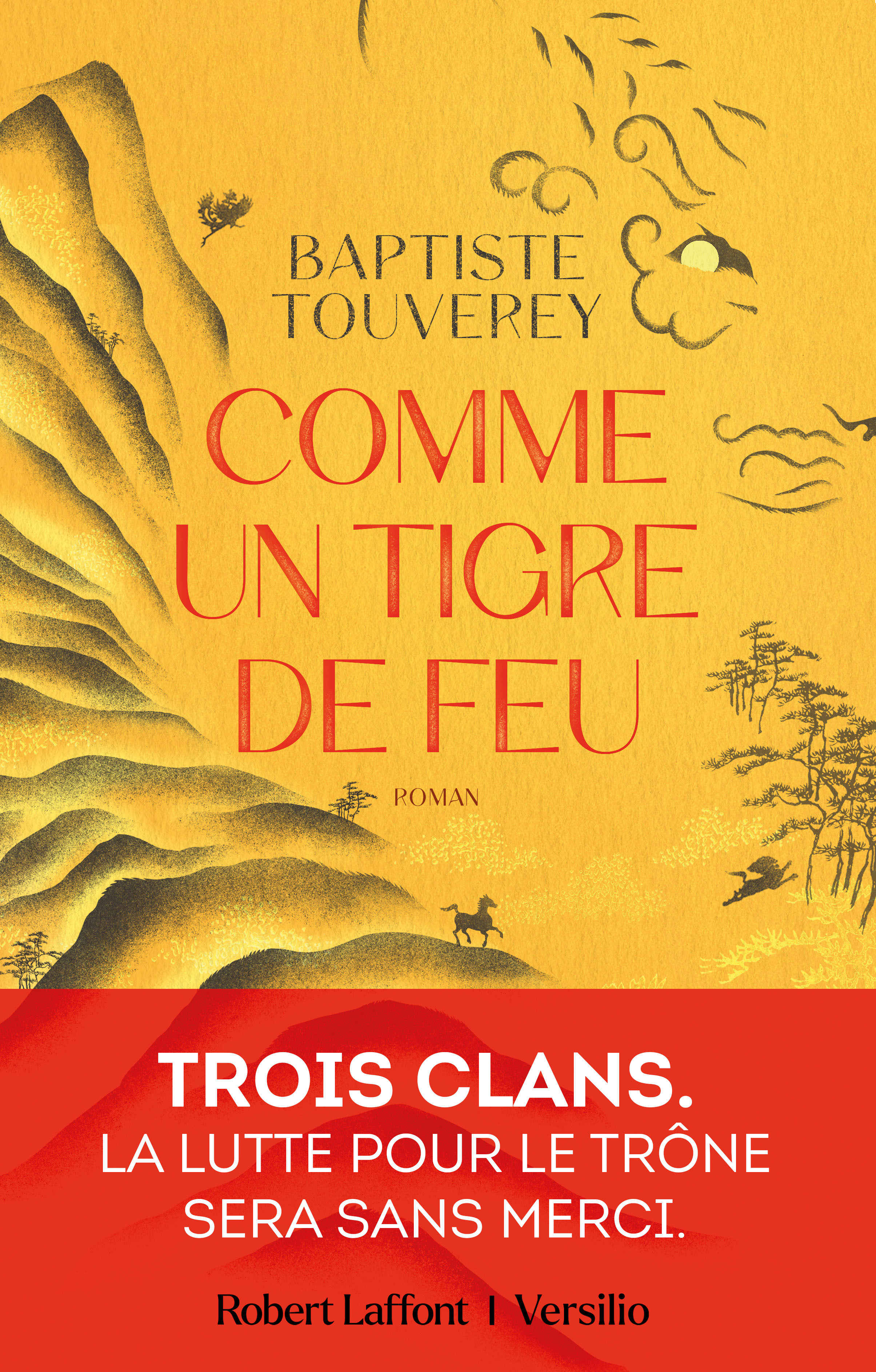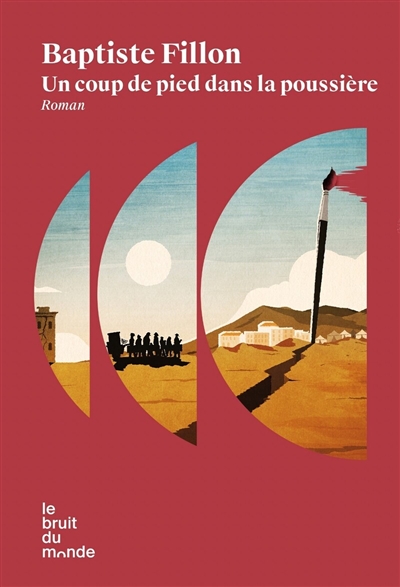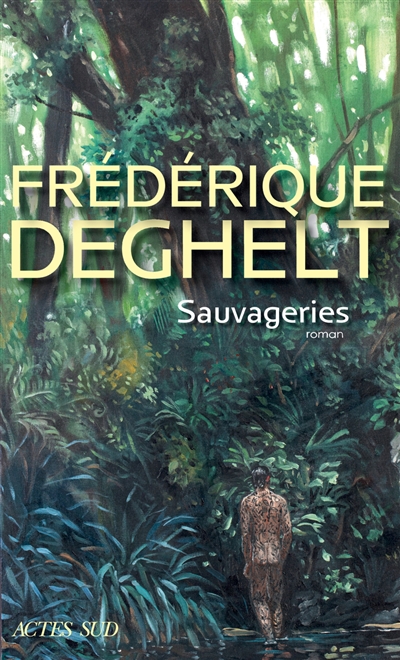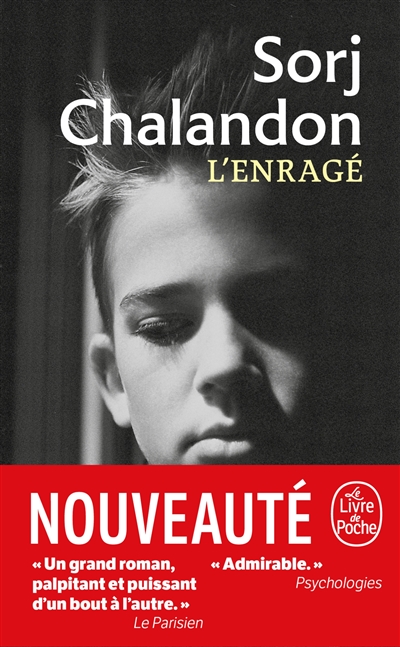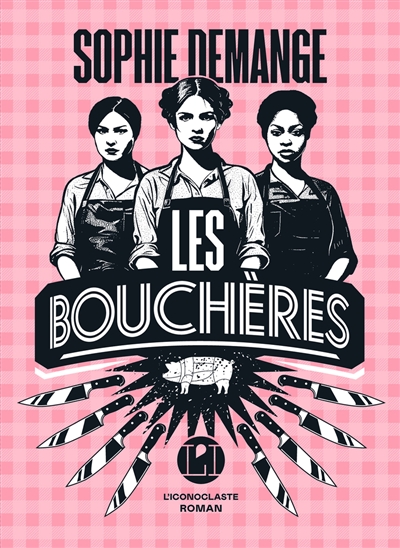Xenia, héroïne des temps modernes, est une jeune femme comme tant d’autres, complètement immergée dans la vie, dans ce monde contemporain injuste et inacceptable, dans ce monde économique impitoyable et déréglé, destructeur. Xenia est une jeune femme comme tant d’autres, belle et sensuelle, qui se bat et se débat, qui avance tête haute, forte de ses droits, qui prend la vie à bras le corps, avec ses envies, ses désirs, ses plaisirs et ses mystères. Xenia c’est notre frangine de cœur, notre camarade de lutte. Xenia c’est un peu toutes les femmes, mères, travailleuses, amantes, qui se démènent et se construisent malgré tout. Gérard Mordillat nous la rend si proche, si vraie, si bouleversante, que vous allez adorer l’accompagner tout au long de ce livre. Et puis de la lire, c’est un peu dire non à toutes les injustices qui lui sont faites, dire oui à toutes les beautés que la vie lui réserve in fine. Que la littérature serve à cela, c’est déjà pas si mal, non !
Page — Nous voilà avertis dès les premiers instants : Xenia, votre nouveau livre, s’inscrit dans la droite ligne de votre roman Les Vivants et les morts paru il y a juste dix ans. Dix ans sont passés, mais vos motivations ont-elles changé ? Et votre colère ? En dix ans, qu’est-ce qui a évolué ?
Gérard Mordillat — Dans dix ans, si d’aventure quelqu’un veut savoir ce qu’était la France entre 2005 et 2014, il aura intérêt à lire mes romans plus que le millier d’essais qui auront été publiés sur la question. La fiction marche toujours un pas en avant sur le réel. Et – hélas – ce qui s’annonçait comme « roman », comme « fiction » dans Les Vivants et les morts, Notre part des ténèbres, Rouge dans la brume, Jennie, etc. (tous disponibles au Livre de Poche), se déroule sous nos yeux dans le scénario implacable écrit par les tenants du libéralisme économique, c’est-à-dire du capitalisme sans entraves. Ce qui, dans Les Vivants et les morts portait en soi les atteintes à la démocratie, à la République, sont à l’œuvre plus que jamais dans Xenia que je publie aujourd’hui. Nous vivons désormais dans un régime post-démocratique, voire post-républicain. Mon travail, en tant qu’écrivain, est de dire le réel, c’est-à-dire ce qui ne va pas, de le mettre en mots. Pour cela, la colère est bonne conseillère et la mienne croît chaque jour un peu plus au regard des injustices, des reniements, des lâchetés, des horreurs sociales et politiques qui nous cernent. Comme le disait Antonin Artaud à Jacques Prevel : « Vous n’êtes pas assez révolté, Monsieur Prevel ». Eh bien oui, nous ne sommes pas assez révoltés. Nous ne le serons jamais assez.
Page — Vous placez en exergue de votre livre la très belle phrase d’Arthur Rimbaud : « quand sera brisé l’infini servage des femmes. » Votre livre est une histoire de femmes, belles et rebelles, courageuses, déterminées, et qui se battent pour s’affranchir. Est-ce un livre féministe, fondamentalement féministe ?
G. M. — Xenia n’est pas un livre féministe dans le sens où il n’est pas l’œuvre d’une femme agissant pour une organisation de défense de ses droits. Dans mes romans, dans tous mes romans, s’il n’y a pas de héros au sens masculin du terme, il y a des héroïnes. Pourquoi ? Je ne me risquerai pas à le théoriser. Simplement, je peux dire que mes amitiés littéraires ont toujours été des femmes : Geneviève Serreau, Béatrix Beck, Christiane Rochefort, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras et, aujourd’hui Annie Ernaux ; ensuite, que la condition des femmes (plus particulièrement des femmes en lutte) a toujours suscité mon admiration pour le courage, l’endurance, la lucidité qu’elles montraient tout en ne renonçant jamais à vivre, à aimer, à jouir. Les femmes, dans mes livres, sont toujours du côté de la vie malgré les coups reçus, les douleurs secrètes ou publiques, les violences du temps présent. En cela, Xenia est la sœur de Dallas des Vivants et les morts, de Mado de Notre part des ténèbres, d’Anath de Rouge dans la brume, de Jennie…
Page — Votre livre est éminemment romanesque, vivant, émouvant, sensuel, drôle et tragique à la fois. Mais son caractère social et politique est flagrant, revendiqué. Ne craignez-vous pas que l’on vous reproche un certain manichéisme ?
G. M. — Comme l’écrivait le poète objectiviste Charles Reznikoff : « J’ai depuis longtemps appris à être seul ». Qu’on cherche à disqualifier mes livres pour leur portée politique et sociale n’est pas une surprise pour moi. Au contraire, cela me conforte dans l’idée que je touche le centre de l’œil. Ainsi, dans Xenia et les autres, je forcerais le trait en décrivant la vie d’une femme qui travaille dans le nettoyage industriel, d’une qui est caissière dans un surpermarché, qui vivent avec 1100 euros par mois dans un pays où plus de trois millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, où il y a plus de cinq millions de chômeurs, des milliers de sans-abri, de sans-papiers, etc. Molière aurait écrit : « cachez ce réel que je ne saurais voir ». Moi je le vois. Je laisse volontiers aux commentateurs les livres sucrés qui font leurs délices, cette littérature de chapons sous les crédences petites-bourgeoises du passé simple et de l’imparfait. J’écris au présent des livres réfractaires, durs et brûlants.
Page — Balzac disait : « La mission de l’art n’est pas de copier la nature mais de l’exprimer ». Vous citez Balzac lors d’un très beau passage évoquant la peinture de Patrice Giorda (je renvoie d’ailleurs les lecteurs à votre autre parution récente, Le Miroir voilé, paru chez Calmann-Lévy également). Reprenez-vous à votre compte cette idée de Balzac ? N’allez-vous pas un peu plus loin ? Exprimer le monde n’est-il pas pour vous une première étape ? Exprimer le monde pour mieux le changer ? Et l’art pour ré-enchanter la vie, y croyez-vous encore et toujours ?
G. M. — Je ne suis pas croyant, ni en matière artistique ni en matière religieuse, ni en matière politique. Ma seule certitude tient à l’écriture. J’écris pour saisir le réel sous toutes ses formes, dans tous ses axes. C’est mon style qui dit le monde, qui le rend visible sur la page, qui efface le tain du miroir écartant la tentation de n’y regarder que moi pour regarder les autres, l’ailleurs, le dehors. La force du roman est d’inventer un lecteur intelligent, de lui rendre une histoire que la société lui dénie ; de lui redonner une identité, des pensées, des sentiments, une sexualité, des convictions, des doutes, des emportements ; de lui offrir du savoir et de la mémoire, d’être au monde.