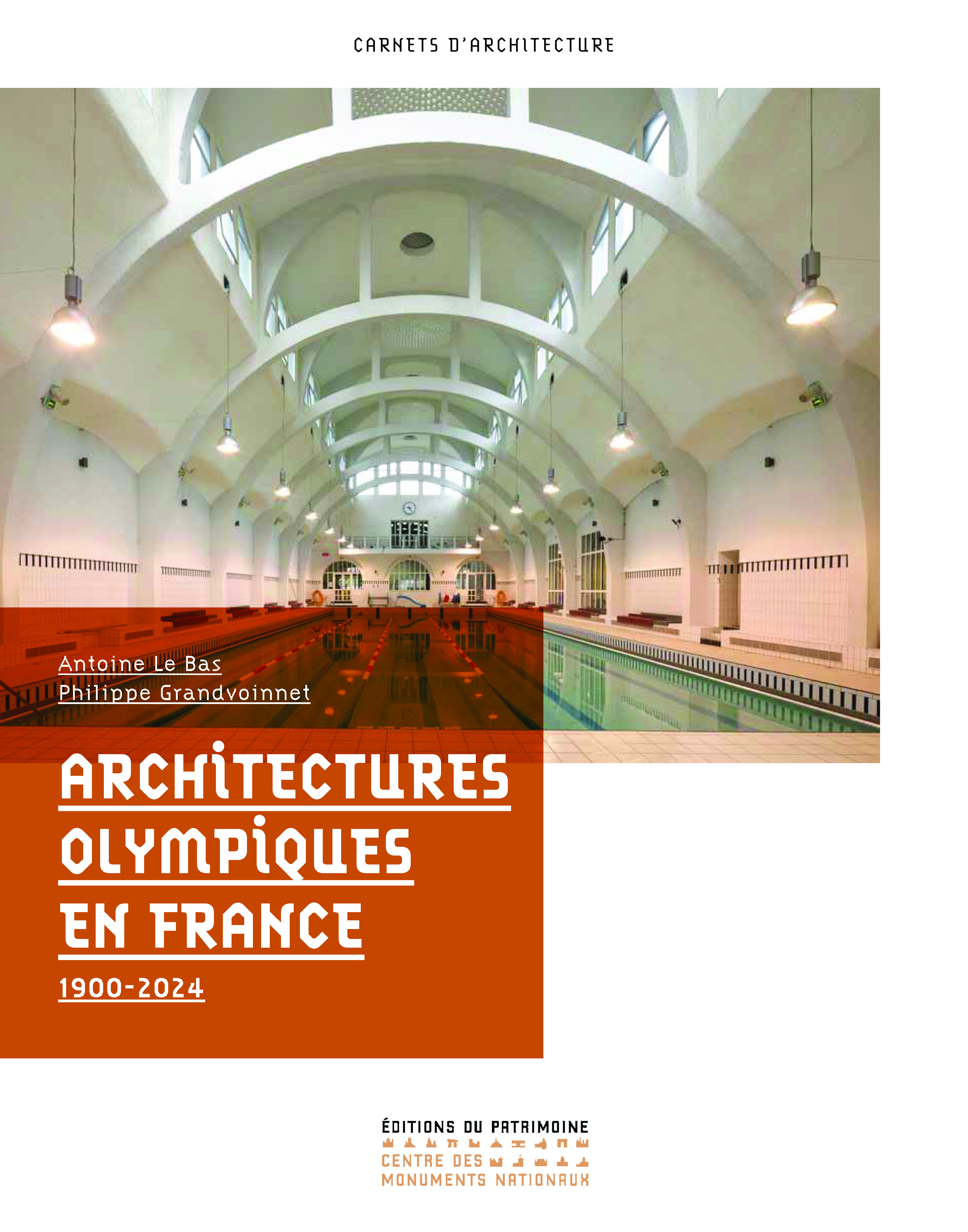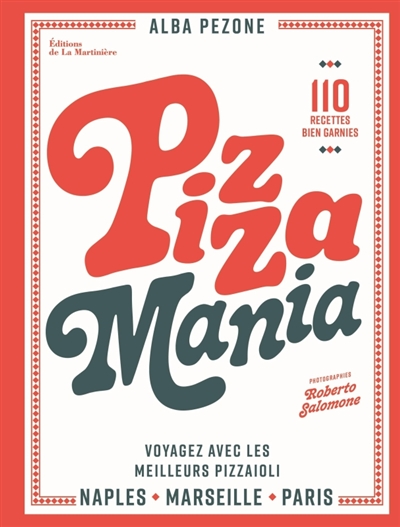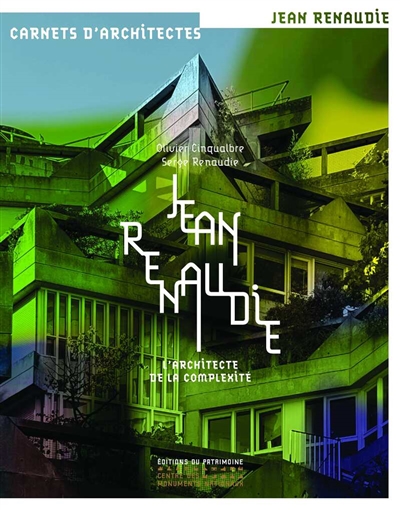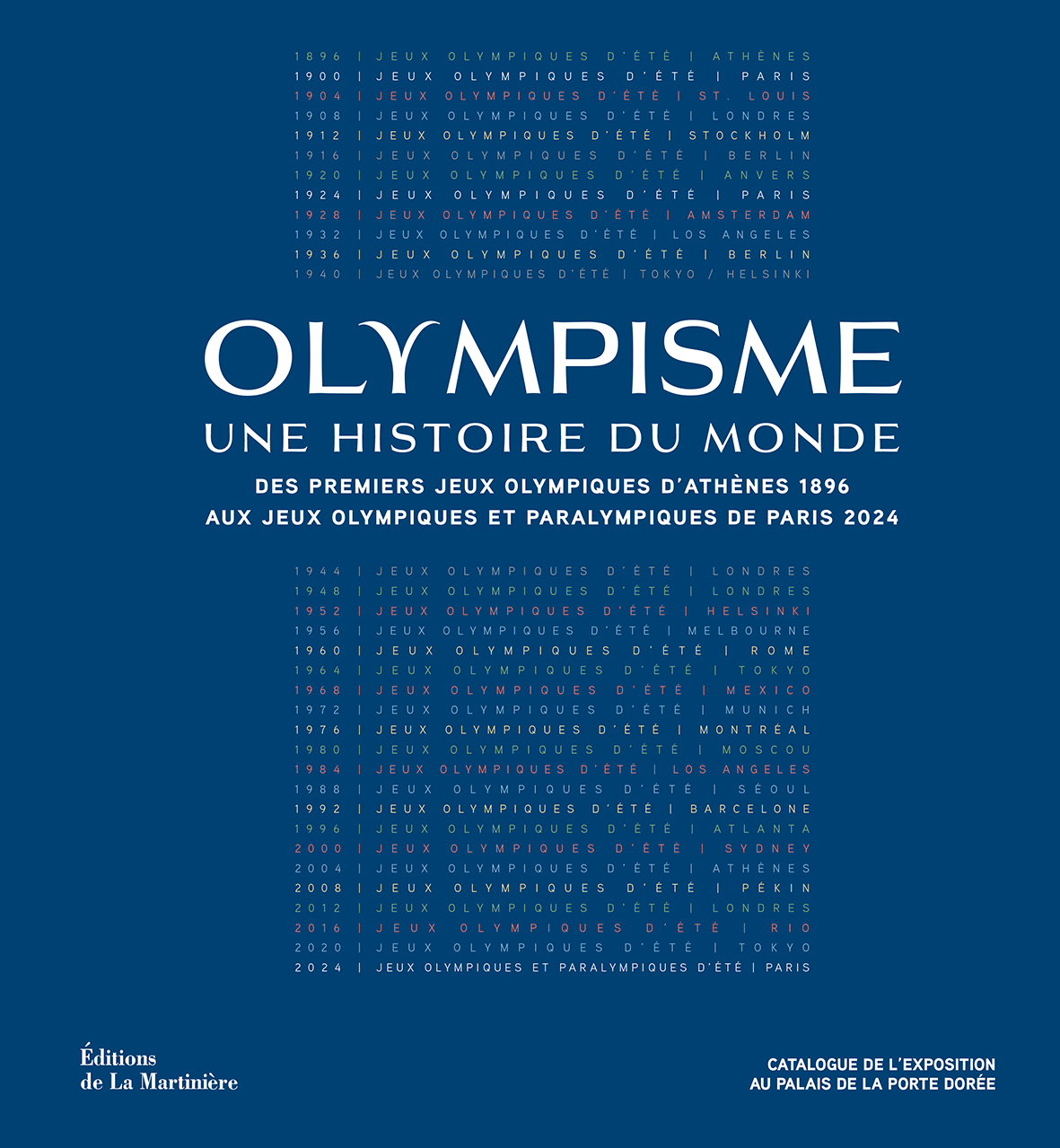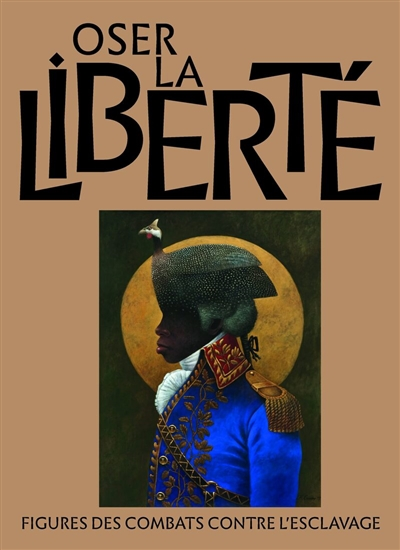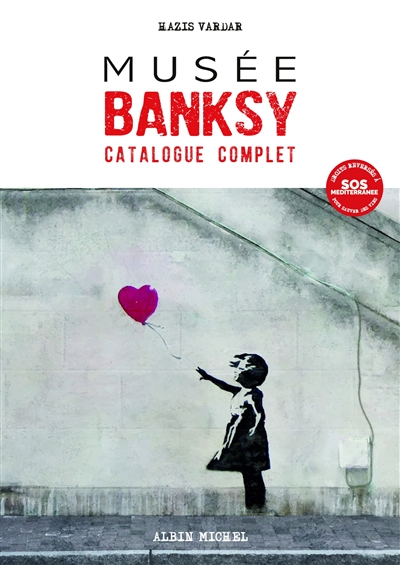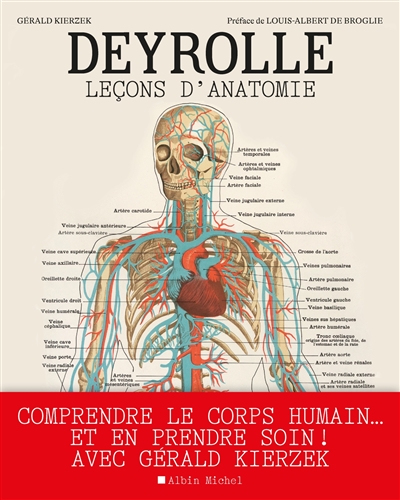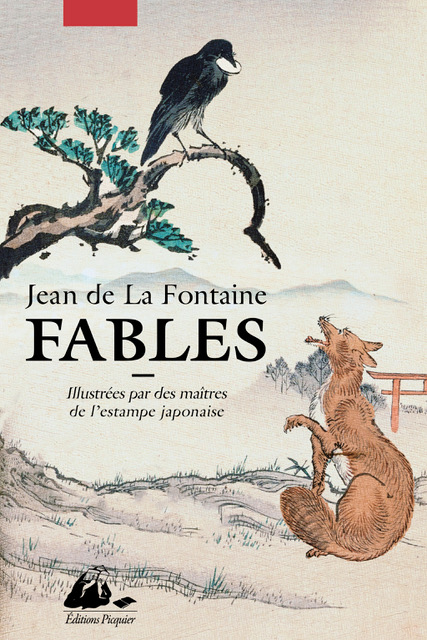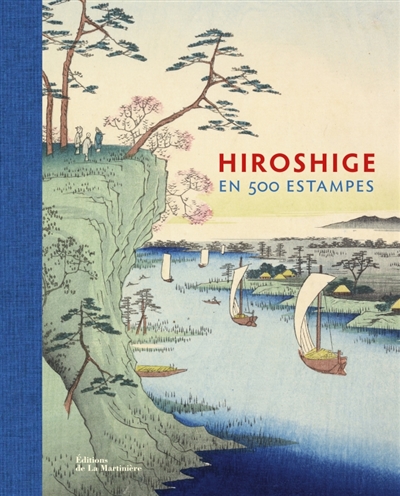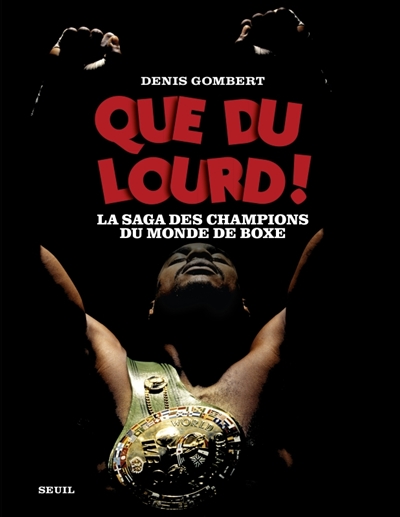PAGE : Jean-Marie Pérouse de Montclos, dans quelles circonstances êtes-vous recruté en 1964 par André Chastel et André Malraux pour être le premier chercheur à l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ?
Jean-Marie Pérouse de Montclos : Après avoir grandi à Amiens, où je me suis beaucoup ennuyé, j’ai rejoint Paris pour y suivre les cours de Sciences-po. Je dois avouer que je n’ai pas beaucoup étudié et que j’ai passé plus de temps au Flore et dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés que dans les salles de cours. À Sciences-po, j’ai choisi les relations internationales, non que je me destinai à une carrière diplomatique, mais la matière m’apparaissait comme la plus représentative de l’école, la plus proche de sa vocation. Le cursus nécessitait de préparer parallèlement une licence en Droit ou en Histoire. J’ai choisi l’Histoire, que j’ai associée à une licence libre d’histoire de l’art, ce qui m’a donné l’opportunité de suivre l’enseignement d’André Chastel sur l’art à Florence à la fin du xve siècle. L’Italie, Florence en particulier, m’ont très tôt passionné. Je me souviens qu’enfant, je parcourais les rues de Florence sur des plans et voyageais en Italie grâce à mes livres. En 1964, André Chastel me recrute à l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, à sa création. Sans doute m’a-t-il surestimé : mon éloquence sur l’Italie a dû lui laisser penser que j’étais capable de bien autre chose. Il m’a chargé de m’occuper de la méthode, car l’Inventaire était un service régionalisé et il importait de savoir comment toutes ces équipes allaient travailler ensemble de façon cohérente. Je pensais œuvrer à la mise au point d’une méthode scientifique, mais André Chastel considérait davantage le projet sous un angle administratif.
P. : Quelle a été votre mission à la naissance de l’Inventaire ?
J.-M. P. de M. : Au contact des différentes équipes, j’ai constaté à quel point le métier manquait d’un vocabulaire commun, précis, riche et complexe afin de permettre des descriptions efficaces et partagées par la profession, d’autant plus que je connaissais la très grande qualité du travail que Jacques-François Blondel avait accompli sur l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. J’ai alors rappelé à André Chastel que les deux précédentes tentatives d’inventaire amorcées pendant la Révolution puis sous Louis-Philippe avaient achoppées dès leurs déclarations de principes, précisément parce qu’elles ne s’appuyaient pas sur un lexique commun. J’ai donc insisté sur la nécessité d’une normalisation du vocabulaire de l’architecture, notamment moderne, car les médiévistes possédaient déjà un vocabulaire, ce qui n’était pas le cas des modernes qui étaient complètement parasités par les historiens de la peinture. Il n’a pas été facile de le convaincre. Pourtant, il s’est finalement rangé à mon opinion et m’a confié pour mission de normaliser le vocabulaire de l’architecture, de toute l’architecture, dans le but que les différents secteurs de la profession aient une langue commune et que l’on puisse décrire efficacement les édifices en identifiant leur style – plutôt que de partir du style pour les décrire, ce qui avaient jusque-là été la source de quantité d’erreurs de jugements. Cette volonté de normalisation du vocabulaire de l’architecture est sous-tendue par ma conception de continuité de l’histoire de l’art tout autant que de l’histoire de l’architecture. Les ruptures dans la chronologie sont artificielles. Les styles évoluent, changent, naissent et meurent, mais il n’y a pas de rupture d’une époque à une autre, encore moins dans le vocabulaire, même si les spécialistes ne partagent pas tous la même terminologie et parfois même s’opposent en recourant à des termes différents pour rendre compte d’une même réalité. Mon projet consistait à faire en sorte que chacun parle de la même chose, de créer un outil commun pour parler du patrimoine architectural de la France.
P. : Comment est né le livre Architecture ?
J.-M. P. de M. : En 1972 a paru la première édition du Vocabulaire , soutenue par le ministère qui, bien conscient de l’importance du projet, a consentit à débloquer un budget conséquent pour réaliser ce livre que j’envisageais davantage comme un instrument de travail que comme un beau livre. De 1964 à 1972, nous avons fait cinq ou six tirages polycopiées de quelques centaines d’exemplaires pour les envoyer à différents spécialistes et obtenir leur aval. Aussi, toutes les semaines j’allais voir Francis Salet, conservateur du musée de Cluny, et Sylvain Stym-Popper, architecte en chef des monuments historiques, qui corrigeaient et validaient mon travail – le but étant de ne pas raconter trop de bêtises. Il nous a aussi fallu de nombreuses années pour rassembler toutes les illustrations. J’accorde une importance considérable à l’aspect iconographique, car un historien de l’art est d’abord un montreur d’images. Enfin, sur le conseil d’Albert Beuret, qui assurait le suivi éditorial de la collection « L’univers des formes » créée par André Malraux chez Gallimard, on a procédé à un premier tirage de cinq mille exemplaires. Malgré la disparition des archives de l’Imprimerie nationale, le premier éditeur du Vocabulaire , le nombre d’exemplaires vendus depuis 1972 peut être estimé à cent mille. Il est à noter que de 1972 à cette nouvelle édition de 2011, il n’y a quasiment aucune évolution du contenu. Quelques modifications ont été apportées, mais ce sont surtout des interventions sur la présentation du livre qui ont justifié les nouvelles éditions, non des modifications du contenu.
P. : Comment a été accueilli le livre ?
J.-M. de M. : Dès sa parution, ce premier volume d’une collection de l’Inventaire général du patrimoine culturel* piloté par le ministère des Affaires Culturelles a reçu un excellent accueil. Il est très vite devenu un usuel dans les bibliothèques et a aussi été d’emblée reconnu par les spécialistes étrangers qui ont manifestés beaucoup d’intérêt pour la qualité de notre méthode, si ce n’est celle de notre travail. En revanche, si les modernistes ont été séduits par la mise au point d’un vocabulaire spécifique à l’architecture toutes époques confondues, les autres spécialistes, notamment les médiévistes, n’ont pas modifié leurs usages lexicaux. Bien qu’ils recourent abondamment au livre à des fins de documentation, leur approche de l’architecture ne s’en est pas trouvée modifiée et ils continuent d’employer des termes qui ne sont pas forcément appropriés à ce qu’ils décrivent. Il a cependant été mieux accepté et partagé par les architectes des bâtiments de France – lesquels, j’avoue, ont pour la plupart été mes étudiants.
P. : Quelles sont les plus importantes modifications de la nouvelle édition ?
J.-M. de M. : L’éditeur m’a convaincu d’adopter la couleur. Et je dois reconnaître qu’il a eu raison. Pour moi, le premier critère de l’illustration était la pertinence de l’information, ensuite je voulais que les illustrations, qui ont été largement renouvelées, composent une anthologie des sources de l’architecture française par l’image, qu’il y ait au moins une illustration de tous les grands traités et que ce soit également une manière d’hommage aux meilleurs illustrateurs français, les grands illustrateurs d’estampes, Viollet-le-Duc par exemple. Je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude à mon iconographe pour la qualité et la richesse de son travail, ainsi qu’au maquettiste et à l’équipe éditoriale pour la finesse de sa relecture. Là où, dans l’ancienne édition, la définition et ses sources, l’illustration et sa source ainsi que sa légende étaient éparpillées à différents endroits, la nouvelle édition a pris le parti de réunir l’ensemble des informations sur une même page. Au départ, j’ai montré quelque circonspection devant la perspective de tout intégrer au même endroit. J’avais peur que cela affecte le confort de lecture. Mais grâce au travail du maquettiste, on est parvenu à une remarquable lisibilité tout en ayant un accès rapide à l’information. En dehors de la forme, qui s’est nettement améliorée, les modifications concernent l’apparition d’une centaine de mots nouveaux, tels dendrochronlogie (système de datation par les cernes des bois) ou photogrammétrie (technique permettant d’opérer des mesures en utilisant la parallaxe obtenue par des prises de vues selon différents axes) qui correspondent à une mise à niveau des techniques de l’archéologie et de la cartographie. D’autre part, notons l’augmentation de certains chapitres, celui consacré à l’ornement notamment, ou le chapitre sur les systèmes de circulation rassemblant les escaliers, les cheminées (considérées à tort uniquement comme ornement dans la précédente édition) et l’évacuation des eaux.
P. : Carl van Eizsner, l’un de vos éditeurs, a dit de vous : « Il aime se mettre en danger. On peut tout lui faire quitter si on lui on donne l’ivresse d’une aventure intellectuelle dangereuse. » L’aventure de l’Inventaire vous a-t-elle procuré de l’ivresse ? L’effet persiste-t-il ?
J.-M. P. de M. : Bien sûr !
* Nouvelle dénomination de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.