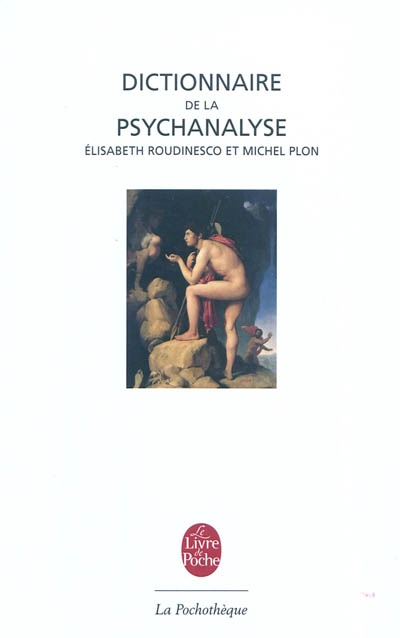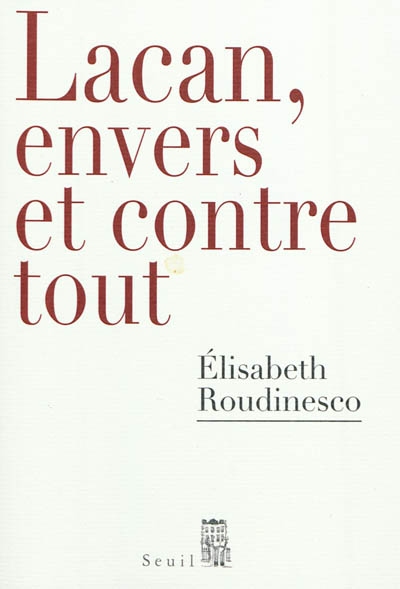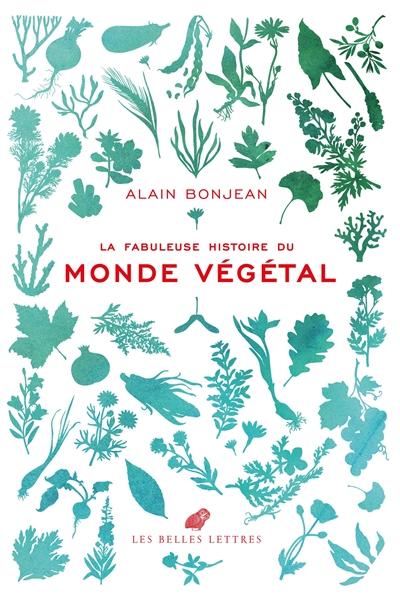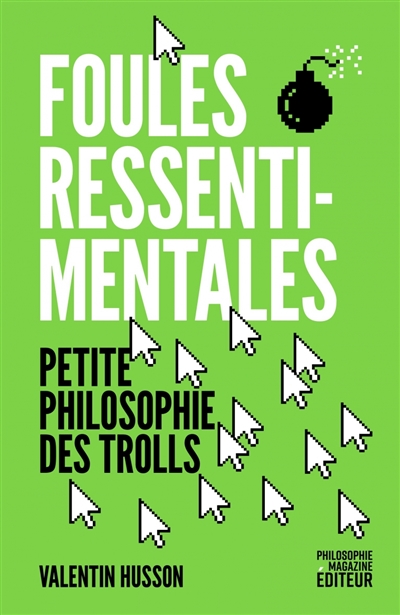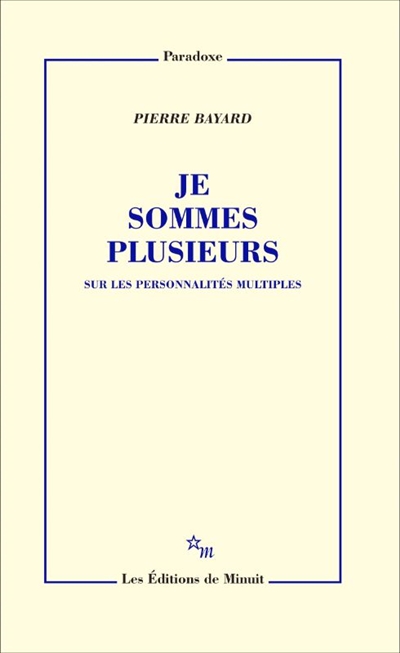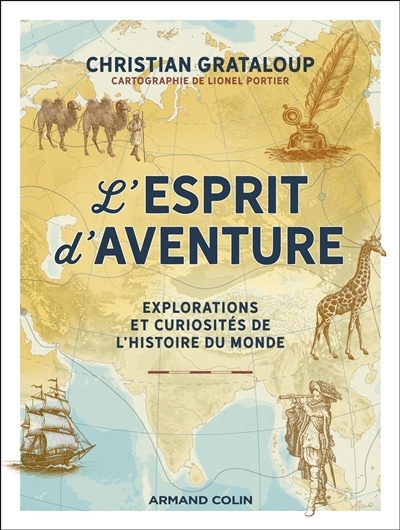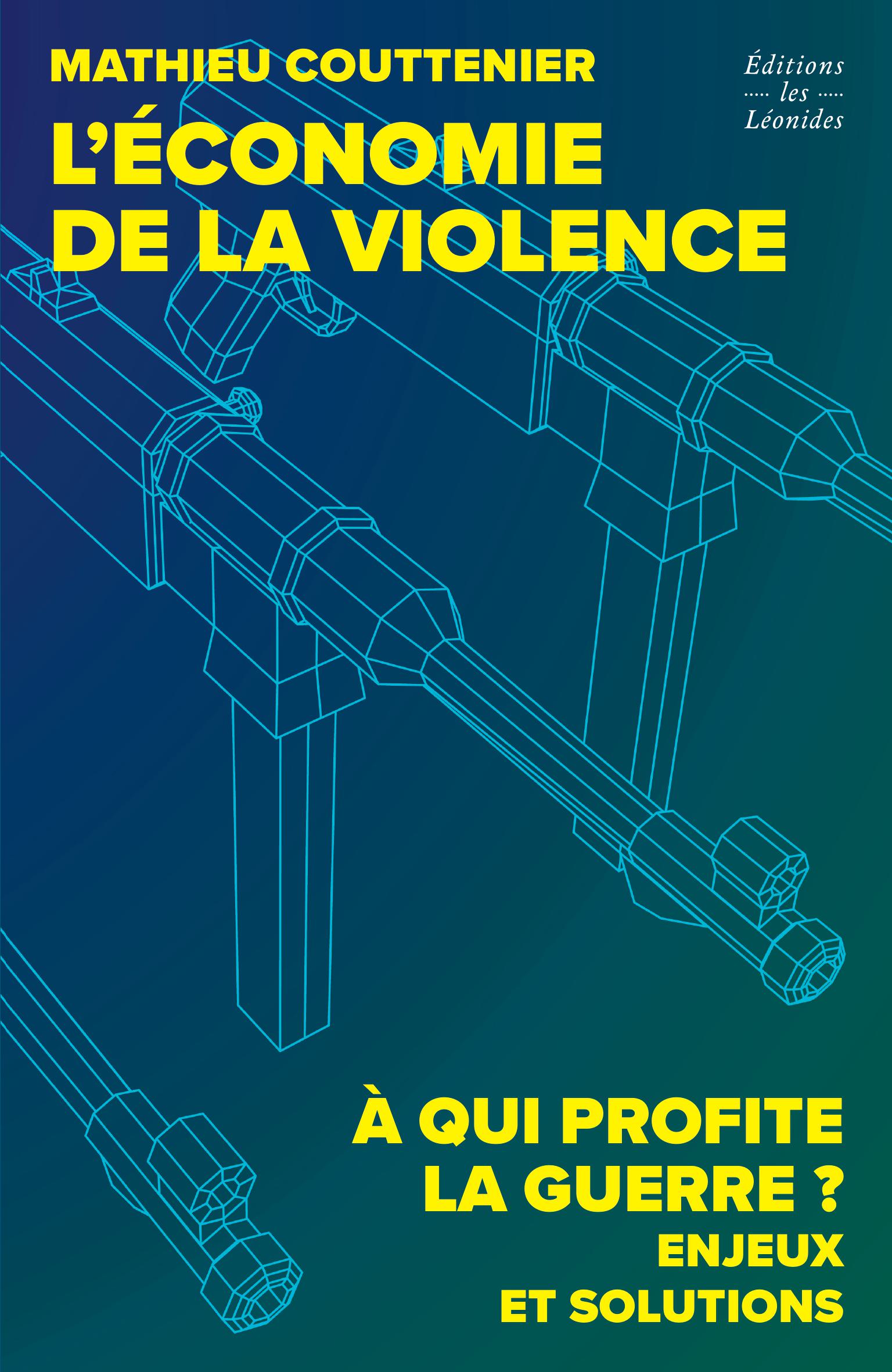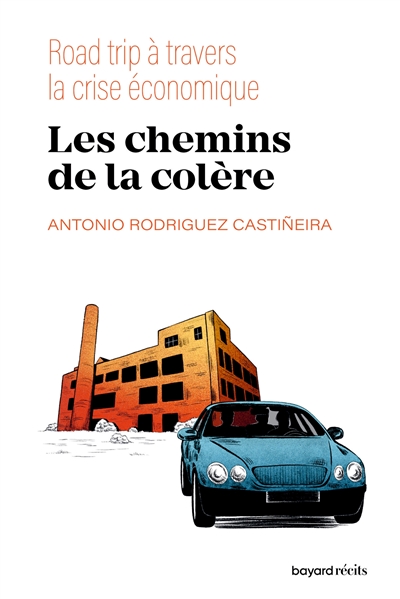PAGE : Trente ans après sa mort et près de vingt ans après la parution de Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, troisième tome de votre grande Histoire de la psychanalyse en France, vous revenez à la fois sur le personnage et ses postérités. À quelle persévérance renvoie le titre choisi pour cet ouvrage, cette volonté d’écrire Lacan « envers et contre tout » ?
Élisabeth Roudinesco : Ce titre m’est venu spontanément. Lacan emploie lui-même cette expression dans son fameux séminaire sur Antigone, qui occupe dans mon livre une place importante, et il définit Antigone comme celle qui ne cède pas sur son désir, envers et contre tout. Il m’a semblé que cela correspondait bien à Lacan. Non pas que Lacan soit Antigone, mais Lacan, c’était « envers et contre tout ». À contre-courant de la pensée dominante, toujours dans l’extrême et en même temps dans la raison. En reprenant cette formule, j’annonçais également un hommage, certes critique, mais « en dépit de tout » : des réserves et des excès.
P. : Vous décrivez, dès votre introduction, des temps très sombres, l’avènement d’une « société dépressive » cultivant la haine de l’autre comme celle de la pensée, et où s’affirme – c’est ce que vous semblez craindre le plus – la définition de l’homme par son être biologique. Aussi, est-ce envers et surtout contre cette « réduction » qu’il faut relire Lacan, et rappeler, comme vous le souhaitez, « ce que fut la geste lacanienne » ?
E. R. : La réduction de l’homme à ses comportements, lisible jusque dans l’usage qui est fait de nos jours des sondages en politique, représente évidemment l’une des cibles théoriques de cet essai. Mais l’écriture de cet hommage s’insurge davantage contre une époque qui considère le terme d’« intellectuel » comme une insulte. Il est insultant en effet d’être un « intellectuel » aujourd’hui, à tel point qu’il n’est pas exagéré de dire que notre époque témoigne d’une véritable haine contre la pensée, jusqu’à marquer, inévitablement, le triomphe d’une certaine bêtise. Probablement que cela existait avant, mais de façon moins visible, moins triomphante. Quant au terme de « société dépressive » que j’emploie depuis plus de dix ans déjà, il renvoie à des pathologies devenues caractéristiques à partir de la fin du xxe siècle. Freud a inventé la psychanalyse à partir de la question du conflit : l’hystérie, la révolte, la frustration, les fils contre les pères, et les pères contre les fils. Or, nous assistons aujourd’hui au développement de pathologies qui relèvent davantage de la dépression, du rapport de soi à soi. Ces pathologies que l’on appelle « narcissiques » décrivent une société où la liberté est beaucoup plus grande, mais où le conflit s’atténue et nous laisse finalement en conflit avec nous-mêmes. Dans ce contexte où l’on ne croit plus ni à la pensée ni à la révolution, il me semblait important de rappeler l’extraordinaire aventure intellectuelle engagée par Lacan.
P. : Dans cet ouvrage, toutefois, vous incitez moins à relire Lacan qu’à remettre en lumière ses faces cachées. S’agissait-il, contre ceux qui l’ont toujours regardé, dites-vous, « tantôt comme un démon, tantôt comme une idole », de le rendre à sa complexité ? Et pourquoi ?
E. R. : Après avoir écrit une biographie de référence, il n’était pas question de refaire le même geste. Et pourtant, j’ai voulu marquer cet anniversaire. J’ai choisi l’essai, le « vagabondage littéraire », tout en reprenant l’ensemble des textes qu’en dix-huit ans, j’ai pu écrire sur Lacan. Ce livre ne dévoile aucun fait nouveau, mais de nouvelles interprétations. Je n’avais pas analysé Antigone de cette façon-là, j’avais pensé le rapport entre Kant et Sade, mais encore une fois, pas de cette façon-là. Surtout j’ai voulu éclairer certains points, notamment du dernier Lacan : la pulsion néologique, les listes, le collectionneur, etc. Un autre Lacan, une autre facette qui n’invalide pas le travail antérieur. Peut-être aussi l’anti-freudisme radical qui s’est déversé en France depuis quelques années a-t-il joué un rôle. À force d’excès, les insultes contre Freud et la psychanalyse ont fini par s’épuiser, et du coup, il y a une lassitude. Et comme chacun sent aussi que le vent est en train de tourner et qu’on en a assez des fanatismes, la presse accueille favorablement un portrait de Lacan positif et critique. Il me semble qu’il y a là une revanche sur le n’importe quoi qui avait été dit. Un retour peut-être des querelles de savoir. En tout cas je constate que si l’insulte demeure, elle est aussi, et en permanence, contestée, ce qui montre la fragilité permanente dans laquelle on se trouve face à de tels phénomènes.
P. : De l’œuvre lacanienne, il semble autorisé de dire, à la façon dont Nietzsche présentait Ainsi parlait Zarathoustra, qu’elle est une œuvre « pour tous et pour personne ». Vous abordez notamment chez Lacan sa « manie » du néologisme. En quoi ce rapport aux mots, qui a fondamentalement renouvelé la théorie psychanalytique et la pratique de la cure, est-il source d’ambiguïtés ?
E. R. : Lacan est source d’ambiguïtés, beaucoup plus que d’autres penseurs. Quelqu’un comme Derrida, qui a cultivé l’amphibologie – je suis là, je ne suis pas là, fidèle c’est être infidèle – l’a en même temps théorisée. La déconstruction autorise, non pas à dire tout et son contraire, mais à penser l’ambivalence permanente. Lacan en revanche, a procédé autrement : il a livré l’ambivalence comme un réel brut. Autrement dit, Lacan incarne, presque dans son corps, ce que vous reformulez très justement comme « l’œuvre pour tous et pour personne », alors que Derrida la théorise. Et c’est la raison pour laquelle Lacan avait si peur de l’histoire, des compilations, des archives. Il était à lui-même sa propre histoire. Il faut convenir que cela est fascinant.
P. : Vous montrez d’ailleurs de manière frappante que ce « clinicien de la parole, écouteur de l’inconscient et de la folie […] ne sut jamais dialoguer avec qui que ce soit », et qu’au fil des années, il perdit de vue « l’essence conflictuelle du dialogue ». Ce mouvement se retrouve-t-il parmi ses héritiers, lesquels donnent souvent, aux profanes, l’impression d’une fixation autour d’un dogme ?
E. R. : Il existe des héritiers fous, et pas seulement à l’école de Lacan. Il faut y insister. Les grands maîtres produisent toujours des disciples fous, c’est-à-dire des adulateurs qui restent dans la parole d’autrefois pour faire vivre le maître en eux. Avec Lacan, c’est bien plus que cela puisque beaucoup de ses disciples ont été analysés par lui. La dimension du transfert non dénoué fait donc que pour nombre de ces héritiers fous, très minoritaires aujourd’hui, Lacan vit en eux. Il y a un effet – non pas précisément de secte – très étrange, qui fait que ça parle en eux et ce n’est pas eux. L’existence de pareils héritiers, de ces jargons fous, de ces imitateurs, Lacan s’y prêtait. À nous autres, héritiers de cette pensée, de produire des bilans critiques. Il est impossible de tout retenir en étant habité. Fidèle donc et infidèle, puisque être fidèle à un maître, c’est lui être infidèle. Prenons justement la pulsion néologique de la fin. Le geste est beau, fascinant, mais c’est une impasse, si on la répète.
P. : La fin de l’époque « héroïque » de la psychanalyse équivaut-elle à une crise de la discipline ?
E. R. : Il y a surtout une crise de la psychiatrie. Je parle là du point de vue des praticiens. Lacan s’appuyait à l’époque sur des praticiens psychiatres qui avaient une grande culture clinique et intellectuelle. D’un côté, on observe l’effondrement de la psychiatrie, devenue comportementale ou tout chimique. Et de l’autre, la psychanalyse n’est plus portée par des cliniciens ayant une formation philosophique. Avec la nouvelle réglementation, elle s’appuie désormais sur les psychologues. Ce n’est pas la même formation. Ce sont d’excellents praticiens, mais ils n’ont pas la culture philosophique et littéraire capable de porter cela. La véritable crise, et elle est mondiale, est celle du repli vers la clinique. Ce n’est donc en aucun cas, comme on pourrait trop facilement le croire, parce qu’il n’y a plus de grand maître.
P. : Si l’anniversaire des trente ans de la mort de Lacan a pu être l’occasion d’un bilan, sur quelles perspectives croyez-vous qu’il puisse ou qu’il doive ouvrir ?
E. R. : Je dirais que c’est déjà là. Une nouvelle génération est là qui lit Lacan. À mon sens, la véritable question est celle de la pratique de la cure. Je pense que les psychanalystes doivent faire avec la psychanalyse ce que font les autres thérapeutes. Autrement dit, ils doivent non pas proposer des psychothérapies psychanalytiques, mais appeler psychanalyse tout travail qui met en jeu l’inconscient, la sexualité, le désir, etc. Cela commence à émerger sous la pression des patients. Il faut diversifier l’analyse. Ce peut être une cure très courte, quelques séances, un face à face ; ce peut être aussi régler un problème. Tout ce qu’on fait en institution avec la psychanalyse ! Cela ne signifie pas qu’il faille abandonner les longues analyses, mais qu’il faut être plus souple, de façon à ne pas laisser toute la place aux thérapies anti-freudiennes, alors qu’elles n’ont aucune efficacité. Vingt-cinq séances de thérapies comportementales pour arrêter de fumer, je vous assure que cela ne sert à rien. Avec la psychanalyse, on ne guérit pas, on change. Mais on peut résoudre certains problèmes et il n’y a pas de raison de refuser en analyse des gens qui ont des problèmes ponctuels. Et surtout parler : pas de silence. Pas le silence fou. Cette tendance à se taire ne concerne pas les lacaniens en particulier ; tous les psychanalystes se taisent beaucoup trop. Pourtant Freud n’était pas silencieux, Lacan non plus. Continuons déjà, dans nos écrits, à les faire parler.