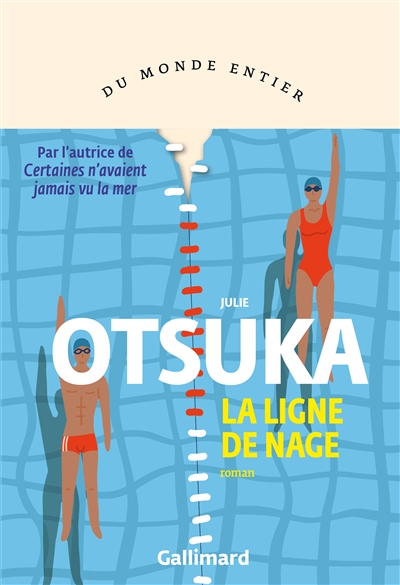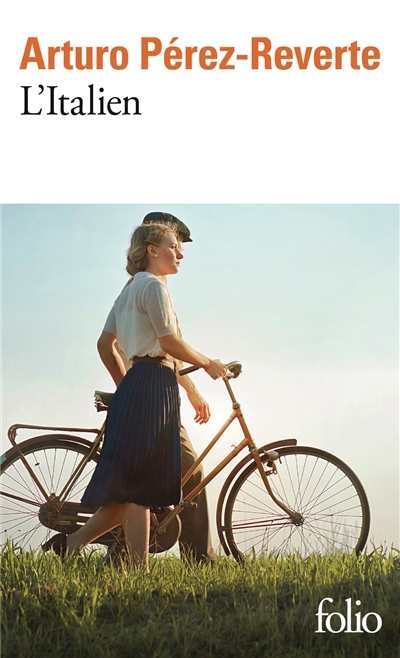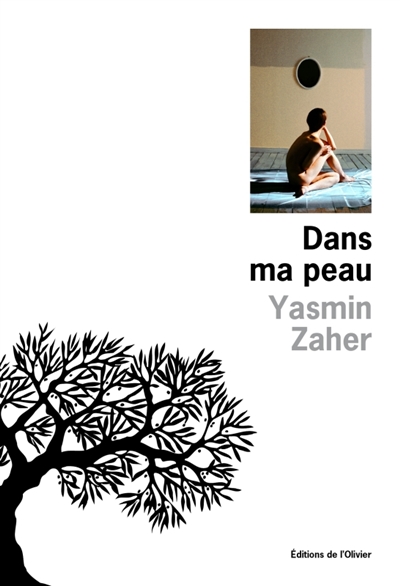Vos deux précédents romans sont considérés comme des fictions historiques. La Ligne de nage se déroule de nos jours. Comment les nageurs sont-ils nés ? Aviez-vous ce roman en tête depuis longtemps ?
Julie Otsuka - Oui, très longtemps. Il y a environ quinze ans, j’ai écrit quelques paragraphes sur une piscine publique et les nageurs qui la fréquentaient régulièrement. Des personnes qui non seulement aimaient nager mais vivaient pour nager. Il y a quelque chose d’intrigant, à mes yeux, dans ce processus fanatique, obsessionnel, dans la vie du corps. L’anonymat de la piscine m’intéressait également. Sur la terre ferme, quelqu’un peut être un astrophysicien, un gardien d’immeuble, un diplomate, que sais-je. Dans l’eau, tout ce qu’on sait de l’autre, c’est : quelle ligne de nage ? Rapide, moyenne, lente ? J’ai écrit ce texte sur la piscine dans un esprit ludique, puis je l’ai laissé plusieurs années dans un tiroir pendant que je terminais Certaines n’avaient jamais vu la mer. Je ne savais absolument pas que cela deviendrait le germe de mon roman suivant. Mais j’ai toujours voulu écrire un roman contemporain.
Dans la piscine, une fissure, motif romanesque et cinématographique, suscite diverses angoisses et interrogations. Que représente-t-elle ?
J. O. - Eh bien, d’abord, cela pouvait être une fissure matérielle. Mais cela pouvait également être considéré comme la métaphore d’une rupture. Une interruption soudaine de la réalité. L’inconnu. Plusieurs critiques ont vu dans cette fissure une métaphore de la pandémie, ce qui n’était pas mon propos — j’ai écrit la partie « Fissure » avant la pandémie —, mais j’aime bien l’idée qu’on puisse l’interpréter ainsi. Et puis encore, la fissure pouvait aussi être quelque chose de plus personnel : la mort d’un enfant, apprendre que votre compagnon vous a trompée, le choc brutal d’un diagnostic fatal. Ou, dans le cas d’Alice, la lente intrusion de la démence. Certains ont même mis en question la réalité de la fissure – peut-être tout cela n’arrive-t-il que « dans la tête d’Alice ». J’aime bien aussi cette interprétation. Toutes, dirais-je, sont vraies.
Au fil du livre, l’horizontalité de la nage est supplantée par la verticalité du plongeon dans la profondeur des souvenirs. Quelle est la place du corps et notamment du lien entre l’esprit et le corps dans votre livre ?
J. O. - À la piscine, vous êtes réduite à votre corps. Vous vous concentrez sur l’essentiel – respirer, ne pas se noyer, faire attention aux gens qui vous entourent. Vous êtes dans l’instant. Et vous accomplissez ce prodige – flotter et rester en vie – sans en prendre conscience, ce qui est une sorte de miracle. Et puis, il y a le pur plaisir sensuel d’être dans l’eau. Je voulais transmettre tout cela dans la première moitié du roman. À quel point chacun de nous est incarné, ce que nous avons tendance à oublier, surtout à l’âge du règne des écrans. Aussi, le corps est quelque chose qui vieillit, dont il faut prendre soin et c’est ce dont je parle dans la seconde moitié. Mais avant tout, le corps est ce qui abrite le cerveau, réceptacle de tous nos souvenirs. Et ce sont les souvenirs qui font de chacun de nous un être unique. L’une des questions auxquelles j’ai essayé d’apporter une réponse dans le livre est : qui êtes-vous sans vos souvenirs ?
Alors que la première partie use du « nous », la partie « Belavista » adopte la deuxième personne du pluriel. Comment vous est venue l’idée d’user de cette voix narrative plus inhabituelle ?
J. O. - Je voulais commencer le roman d’un point de vue quasiment aérien – nous regardons la piscine en contrebas. Alice n’est qu’une petite silhouette, un personnage périphérique. Mais elle est là depuis le tout premier paragraphe en réalité, même si le lecteur n’en a pas forcément conscience. Et puis, dans la seconde moitié, on zoome soudain sur Alice et l’on voit se dérouler la fin de sa vie. Ce soudain changement de focale peut être un choc pour de nombreux lecteurs, mais il est intentionnel. Afin d’accentuer la différence entre les deux moitiés du roman, je voulais utiliser une voix narrative radicalement différente pour la seconde. J’écrivais toujours sur une communauté, sauf qu’il s’agissait de personnes âgées dans une boîte (Ephad) en surface et non plus de nageurs et nageuses dans une boîte (piscine) souterraine. Passer à la deuxième personne du pluriel m’a semblé parfait. C’est une voix omnisciente et toute-puissante qui s’adresse au personnage d’Alice. Une fois de plus, on la regarde d’en haut. C’est comme si Dieu s’adressait à elle.
À propos du livre
Une communauté de nageurs passionnés se retrouve chaque semaine dans une piscine pour oublier leurs soucis de « là-haut ». Dans ce microcosme déterminé par un code de conduite, chacun à ses manies tandis que l’eau les enveloppe. Et chacun ses mots. À la manière d’un chœur aux multiples voix, l’autrice donne vie à ses personnages avec une tendresse jubilatoire. Un jour, l’apparition d’une fissure au fond de la piscine vient rompre l’équilibre de ce monde souterrain et infléchir le cours de l’existence des nageurs. Et notamment celle d’Alice qui perd lentement la mémoire. Dans ce conte créatif tragiquement humoristique, Julie Otsuka capte sans pareil les accrocs d’une vie en encapsulant pleinement chaque mot. Prolongeant son exploration du roman familial, elle parle avec vitalité des choses graves et livre une merveilleuse variation sur la beauté de la routine qui modèle nos identités, les liens qui nous unissent et la fragilité de l’existence.