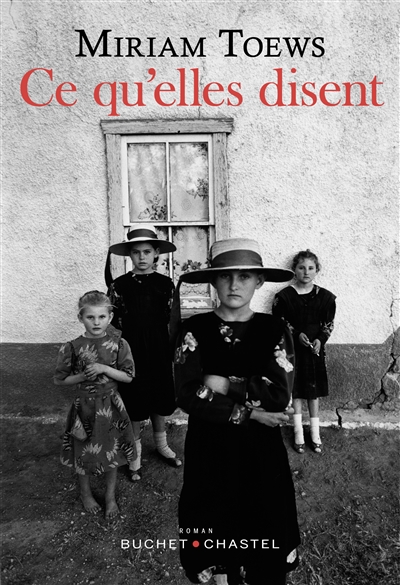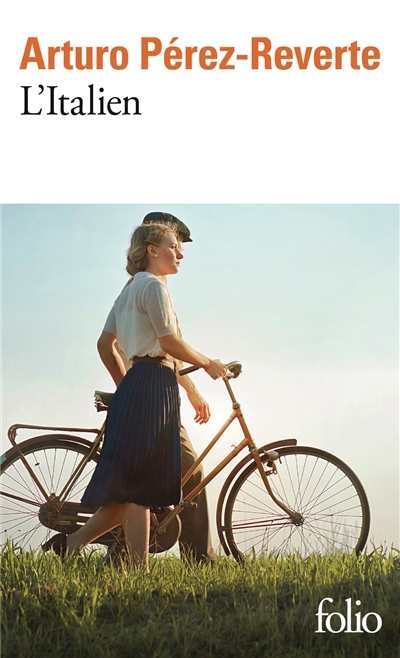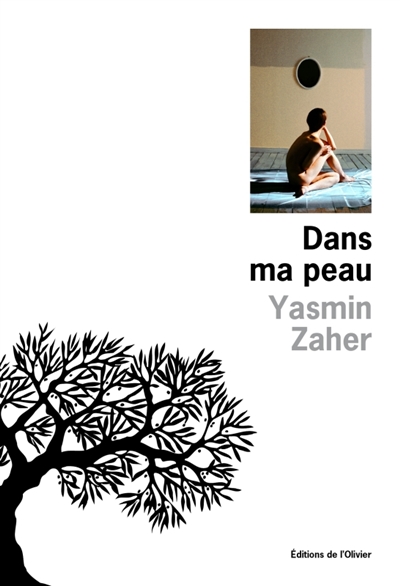Dans une communauté mennonite, plusieurs femmes, après avoir pensé être victimes de démons, prennent conscience qu’elles sont en fait violées dans leur sommeil par des hommes du groupe après avoir été droguées. Alors que les coupables sont éloignés du village et confiés à la police, les femmes se réunissent pour décider ensemble de ce que sera désormais leur vie. Vont-elles accepter de pardonner, partir ou se battre ? Durant deux journées, cette assemblée de femmes, sur trois générations, va rire, pleurer, batailler et communiquer enfin, pour faire entendre la voix de celles qui ont été privées de la possibilité d’apprendre à lire, à écrire et cantonnées aux tâches domestiques depuis toujours. Au centre de ce magnifique roman féministe, la parole comme catharsis et force libératrice qui permettra à ces femmes de devenir enfin maîtresses de leurs choix et de leurs vies. Une ode à l’action qui résonne fortement dans les thématiques contemporaines.
PAGE — Comment vous est venue l’envie de raconter cette histoire singulière ?
Miriam Toews — La première fois que j’ai lu quelque chose concernant les viols de la colonie mennonite de Manitoba en Bolivie, c’était en 2009. Ces Mennonites boliviens appartiennent au même groupe que moi, les Kleine Gemeinde, qui ont quitté la Russie pour rejoindre le Canada, où ma famille s’est installée, alors que d’autres sont descendus vers l’Amérique latine. J’ai tout de suite su que je voulais écrire sur ces femmes. J’avais tant de questions sur ce qui s’était passé, mais je sentais aussi que je pouvais apporter un certain éclairage à leur histoire, moi qui avais grandi dans le même environnement. Même si cette histoire m’a horrifiée, je n’étais pas entièrement surprise, vu tout ce que je savais de ces colonies isolées. J’ai pourtant mis des années à trouver comment raconter cette histoire.
P. — Comment avez-vous choisi cette forme narrative originale qui renforce ce sentiment d’urgence présent tout au long du livre ?
M. T. — J’ai su très vite que je ne voulais pas faire revivre ces crimes dans le livre. Ce qui me semblait plus urgent, c’était de savoir comment ces femmes y répondraient, individuellement et collectivement. Je voulais que cette urgence qui me tenaillait soit manifeste dans le livre. J’ai donc décidé qu’elles auraient une contrainte de temps, une pression. Comme l’heure tourne, il leur faut aller droit aux questions essentielles – sur leurs croyances et leurs principes – afin de pouvoir prendre des décisions et passer à l’action. Comment rester fidèles à leur foi et à leur dieu tout en assurant leur sécurité et celle de leurs enfants ? J’ai choisi d’intégrer le personnage d’August Epp comme narrateur parce que, contrairement à ces femmes, il est allé à l’école et est capable de lire et d’écrire. Il est comme un guide dans leur monde exotique. La tâche qui lui est attribuée, celle de prendre les minutes de leurs débats, se révèle presque superflue. Et pourtant, il enregistre les étincelles d’une révolution et ses notes deviennent le roman.
P. — Ces femmes, d’une communauté hors du temps, ont des voix d’une universalité et d’une modernité incroyable !
M. T. — Si elles semblent hors du temps, c’est parce que les Mennonites vivent loin du monde. Ils n’ont recours ni à l’électricité, ni aux voitures, ni à aucun confort moderne. Ils obéissent à des règles strictes concernant l’habillement, le culte, et la manière de se soumettre à Dieu (l’attachement aux biens de ce monde est considéré comme le pire des péchés). Les hommes s’occupent de la terre et des bêtes, et les femmes des corvées domestiques. À bien des égards, ces colonies fermées sont semblables à des villages superstitieux du Moyen Âge. Pour les filles et les femmes, dont les vies sont contrôlées de près par des hommes plus âgés et religieux, cela peut se traduire par un isolement extrême, frôlant l’emprisonnement. Et pourtant, ce qu’elles vivent est une sorte d’exemple poussé à l’extrême de ce que les femmes vivent dans nos sociétés contemporaines où elles sont confrontées à des formes moins radicales de pouvoir patriarcal et d’autorité religieuse. Ne rien faire, se battre ou partir ? Dans le monde entier des femmes opprimées se trouvent face à ces choix impossibles. Les enjeux sont immenses.
P. — Au-delà des liens qui unissent ces femmes, c’est comme si vous vouliez nous encourager à repenser la sororité. Le salut des femmes ne peut-il passer que par l’entraide et le soutien des autres ?
M. T. — Absolument. Résister à la violence sexiste requiert solidarité et vision commune. Mais nous avons besoin et nous voulons aussi que les hommes participent à cette conversation.
P. — Le seul homme « décent » de votre histoire est aussi celui qui a choisi une voie différente du reste de la communauté.
M. T. — J’ai le sentiment qu’August Epp serait un homme décent en toutes circonstances, quel que soit son lieu de vie et son expérience. C’est un outsider par nature. L’isolement de ces colonies est indéniablement un facteur favorisant les actes de violence. Le viol est un crime qui va de pair avec le sentiment de légitimité de ceux qui le perpétuent. Dans une société hiérarchique et autoritaire qui confine et fait porter le poids de la honte aux femmes en ne leur offrant aucun droit ni aucun recours, il y aura toujours des hommes pour abuser de leurs privilèges, d’autant plus s’ils savent que le monde extérieur est indifférent ou peu prompt à intervenir.