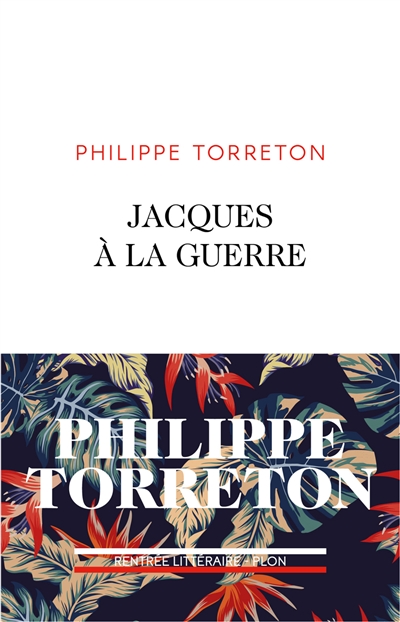Adolescent en 1940, Jacques subit de plein fouet les privations que l'Occupation impose. Bouleversé par les ruines de sa ville de Rouen détruite à la Libération, il choisit l'engagement militaire comme promesse de nouveaux horizons. Mais ce lointain, c'est l'Indochine et de nouveau la guerre, non plus subie mais menée comme si Jacques déchirait le miroir de son enfance. Comment construire alors une vie d'adulte si l'on va à l'encontre de l'enfant qu'on a été ? Comment dépasser ces douleurs et ces traumatismes alors qu'on aspire à la simplicité ? Le destin de Jacques s'écrit. Philippe Torreton lui donne voix dans une narration qui porte une urgence et creuse des interrogations en profondeur sur la vie et les valeurs d'un homme, figure emblématique d'une génération sacrifiée. Rythmé, le récit articule finement les temporalités, alternant l'enfance normande, le monde adulte de Jacques et les très beaux et émouvants passages de la vieillesse de ce père au chevet duquel ses fils se pressent, héritiers de cette histoire et porteurs de ses valeurs.
PAGE — Inspiré par la vie de votre père, Jacques à la guerre mêle un fil intime et familial à une trame fictionnelle. Comment est née la volonté d’écrire ce roman ? Comment avez-vous composé cet équilibre entre réalité et fiction ?
Philippe Torreton - La mort de mon père a permis la fiction. Avant cela, je n’osais pas me décoller de ses souvenirs, même usés et parcellaires. Il y avait un respect bien sûr, mais aussi une prudence. Or écrire est un acte imprudent et impudent. Il faut se servir de l’autre comme lorsqu’on joue la comédie ; le personnage est toujours un prétexte. La fiction était inhérente au « je » de la narration. Ce « je » est une prise de parole à la place d’un homme à qui l’on n’a rien demandé. Mais, n’étant pas cet homme-là, cela induit un récit imaginaire dont les semelles useraient un chemin de réalité.
P. — À travers la figure de Jacques, souhaitiez-vous dresser le portrait d’une génération bouleversée par la guerre ?
P. T. - Au fil du récit mémoriel fractionné et fragile de mon père s’est imposée à moi une vision de la guerre mais aussi de sa grande Histoire à hauteur d’enfance puis de jeune homme. Et cette vision venait préciser cruellement ce que nous savons tous, mais de façon plus ou moins scolaire. J’ai été frappé par la réalité des restrictions alimentaires, par la faim, l’obsession de trouver un « quelque chose » à manger, par les kilomètres parcourus sur des vélos durs pour quelques œufs et du beurre, par la peur, le dégoût du peu qui flottait dans les assiettes creuses. Mais encore par l’ennui, par la ville devenue terne, sans festivités accessibles, cernée de peur et d’autorité affichée. Par le ciel transformé en danger été comme hiver, le matin comme la nuit. Par toute cette réalité que l’Histoire oublie ou néglige, qu’elle dilue fatalement dans son grand récit.
P. — Vous alternez les différentes périodes de la vie de Jacques en faisant se côtoyer l’enfant, le soldat et le vieil homme qu’il a été. Cette structure riche d’interrogations n’est-elle pas le cœur du roman ?
P. T. - Oui, absolument. Je suis intimement persuadé que nos vies ne sont pas des suites de périodes plus ou moins étanches les unes par rapport aux autres. Nous sommes vieux, jeunes, adolescents, adultes, tout cela en même temps. Nous additionnons, nous accumulons et la tristesse de certains de nos contemporains vient d’un oubli façonné de toutes les vies qui nous composent. Mon roman est écrit en tentant de rendre compte de cette multiplicité.
P. — Votre roman est-il celui de la filiation, de l’héritage et de la transmission de valeurs par-delà les douleurs et les traumatismes ?
P. T. - C’est aussi cela, bien sûr. Je me suis senti comme un réparateur de mémoire. Mon père m’a permis de devenir comédien, de choisir un métier d’expression. Si j’étais devenu maçon, j’aurais bâti une maison pour mes parents ; menuisier je leur aurais fait une armoire ; cuisinier ils auraient eu table ouverte dans mon restaurant : c’est aussi dans cet esprit que j’ai écrit ce livre. Le roman est également un dialogue complice, celui qui m’a manqué avec mon père, dialogue que l’âge a un peu restauré vers la fin, mais qui m’a absolument manqué lorsque j’étais enfant. Mon père n’a jamais joué avec moi. Il ne savait pas. La Guerre lui a volé son enfance.
P. — Comment vos métiers d’acteur et d’auteur se nourrissent-ils l’un l’autre ?
P. T. - Mes premiers écrits correspondent exactement à mes premiers pas sur scène, à l’âge de douze ans. Le théâtre fut donc pour moi une autorisation à aller sur ce drôle de chemin. « L’oralité » m’a amené à l’écrit, « moi l’autre hiver » – comme dit Rimbaud –, rétif à la grammaire et à l’orthographe, inhibé, convaincu que les livres n’étaient que de gros objets lourds entraînant une faible note en cours de français. Le théâtre a illuminé l’écrit, il est venu avec ses muscles, sa sueur, ses douleurs et ses délires, il a fait de chaque livre des messages dans des bouteilles permettant de rompre des solitudes. Plus tard, Shakespeare est venu me dire que l’on pouvait, que l’on devait s’autoriser à y aller, que l’écrit n’a pas de marges rouges ni de lignes ni de carreaux, ni Dieux ni maîtres, que les auteurs sont des grands frères d’écriture qui ont tâté le terrain avant vous. Lorsque l’on joue sur scène, il y a immersion. Un acteur est une pièce du grand Lego et j’écris un peu comme ça. J’aime être plongé dans le récit, ne pas être le grand bâtisseur érudit manipulant ses personnages. Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir d’écrivain mais j’aimerais conserver ce cheminement à côté des personnages, comme des rencontres.