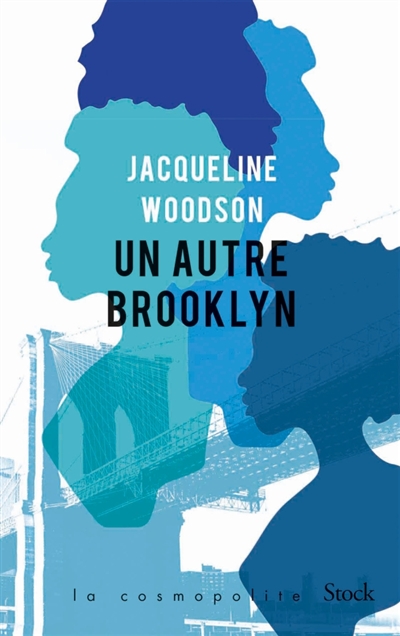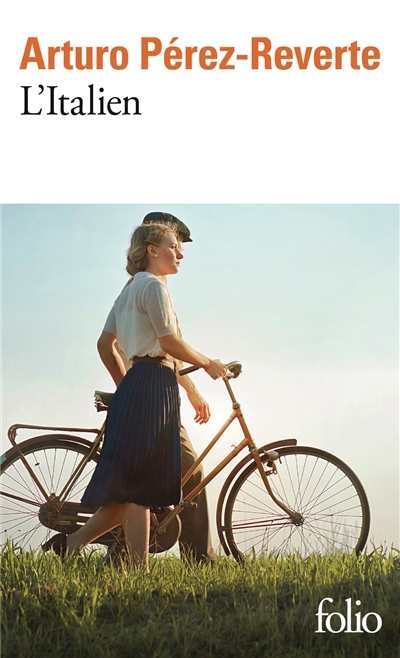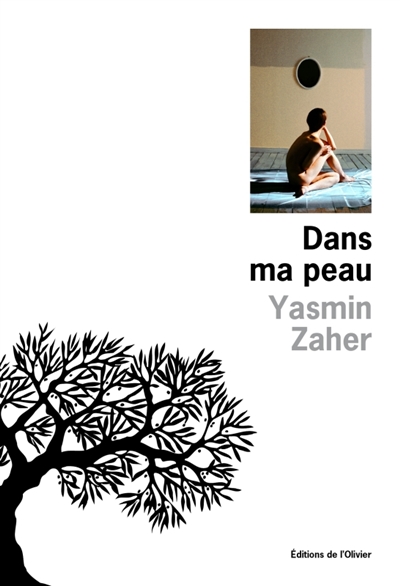Lire Un autre Brooklyn, c’est marcher en compagnie d’August, adulte, venue dire adieu à son père. Le temps est aux retrouvailles, aussi bien avec son frère qu’avec avec son passé. La mémoire ressurgit par bribes, les souvenirs se croisent et se répondent, s’imbriquent comme les pièces d’un puzzle que le lecteur assemble mentalement, découvrant peu à peu quatre visages. Ce sont ceux de quatre filles, des adolescentes dans le New York des années 1970 où le danger se tapit dans le hall des immeubles. La meilleure des armes, c’est leur amitié qui les soude, les met en rage parfois, mais leur procure également des moments de tendresse et d’amusement, où elles chantent leurs chansons favorites à tue-tête. On se surprend à ralentir la lecture de ce magnifique récit doux-amer, pour mieux en savourer sa beauté et sa force, car si les épreuves sont nombreuses, on en ressort avec l’envie de se battre, toujours. Les mots de Jacqueline Woodson se déploient sur la page des haïkus pour célébrer l’énergie de l’adolescence et l’évanescence de ces liens d’amitié qui ont façonné ces jeunes femmes.
PAGE — Un autre Brooklyn s’ouvre sur une dédicace : « Pour le quartier de Bushwick (1970-1990) ». En souvenir. » Est-ce là que vous avez grandi ? À quel point avez-vous puisé en vous pour parler d’August ?
Jacqueline Woodson — En effet, j’ai grandi à Bushwick. Quand j’ai vu à quelle vitesse ce quartier se métamorphosait, j’ai décidé d’y situer un roman, pour réinvoquer celui de mon enfance. Lorsque l’on arrive dans un endroit, on pense le « découvrir » alors que ce lieu a déjà toute une histoire. Aujourd’hui, Bushwick est un quartier branché. Bien avant d’être cela, des gens ont grandi dans son atmosphère bienveillante, encourageante. Ceci étant dit, Un autre Brooklyn n’est pas autobiographique. L’adolescence d’August est bien éloignée de la mienne. Mon livre dépeint à la fois un Bushwick passé, évoque la vie de quatre filles et appartient aussi à la poésie, un genre que j’adore. J’ai voulu utiliser des manières de raconter différentes.
PAGE — Il y a une certaine ambivalence dans les sentiments que ces filles éprouvent les unes pour les autres. L’amitié qui les lie est extrêmement forte mais cela ne les empêche pas de ressentir de la jalousie ou une certaine incompréhension.
J. W. — Un autre Brooklyn est une ode à l’adolescence. À cet âge, tout est intense, l’amour est passionnel. Bien sûr qu’il y a de la jalousie, du désir aussi. Mais il y a une mélancolie qui traverse tout cela. Car même si les filles vivent dans l’instant, elles savent déjà que plus tard, leur belle amitié ne sera plus. C’est tout cela que j’ai voulu écrire. Ces filles s’aiment profondément. Elles ont besoin les unes des autres. Elles seraient capables de se battre pour leurs copines, de mourir pour elles. Et puis vient le moment du changement, même si cela était en germe depuis bien longtemps.
PAGE — Pour vos personnages, être une fille noire dans le Brooklyn des années 1970 pouvait être dur, voire dangereux. Qu’en est-il maintenant ?
J. W. — Mais grandir en tant que fille, dans n’importe quel endroit du monde, à n’importe quelle époque peut être dur, voire dangereux ! Cela ne concerne pas que les Afro-américaines. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec tous ces prédateurs sexuels. Regardez dans le monde entier, toutes ces femmes qui racontent qu’elles ont été agressées, violées. Malheureusement, cela ne concerne pas qu’une période donnée. Il a toujours été compliqué de grandir en tant que fille, et cela, partout dans le monde. Mais c’est aussi quelque chose de fantastique !
PAGE — Je vois ces quatre filles comme des féministes en herbe : elles s’entraident, se serrent les coudes pour dissuader leurs potentiels agresseurs ! Ensemble, elles revendiquent leur force et refusent d’être maltraitées par les garçons. On voit que la défense des droits des femmes est une question cruciale pour vous.
J. W. — Oui. Je défendrai toujours l’idée que chaque individu a le droit de vivre pleinement, en sécurité, quel que soit son genre, son ethnie, sa religion, ses préférences sexuelles, etc. Cette liste n’est pas exhaustive.
PAGE — La force de votre livre réside dans l’espoir qui subsiste, malgré les épreuves, les deuils, la solitude. Pourtant, le roman s’ouvre quasiment sur ce constat : « La tragédie ne se vit pas sur le moment. Mais dans le souvenir ». Que représente la mémoire pour vous ? Les souvenirs sont-ils un poison ou une bénédiction ?
J. W. — La plupart des gens ont peur d’affronter leurs souvenirs les plus tristes. Mais pour moi, la mémoire est un tout. Vous connaissez l’expression qui dit que si vous savez d’où vous venez, vous saurez où vous allez ? Pour moi, la mémoire c’est ça. J’ai besoin de connaître mon passé, de m’en souvenir (et ça implique mon histoire personnelle mais aussi celle de mon pays et du monde entier) pour comprendre le moment dans lequel je vis. En ce qui concerne le livre, mes souvenirs m’ont aussi été utiles pour retranscrire une émotion, un moment précis comme lorsque les filles chantent « Down down baby, down by the roller coaster… ». J’écoutais cette chanson quand j’étais ado, dans les années 1970 et j’aime à penser que c’était le cas pour toutes les filles de Brooklyn, à cette époque.