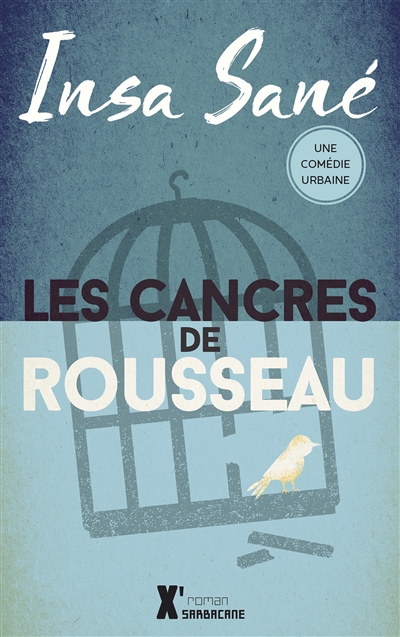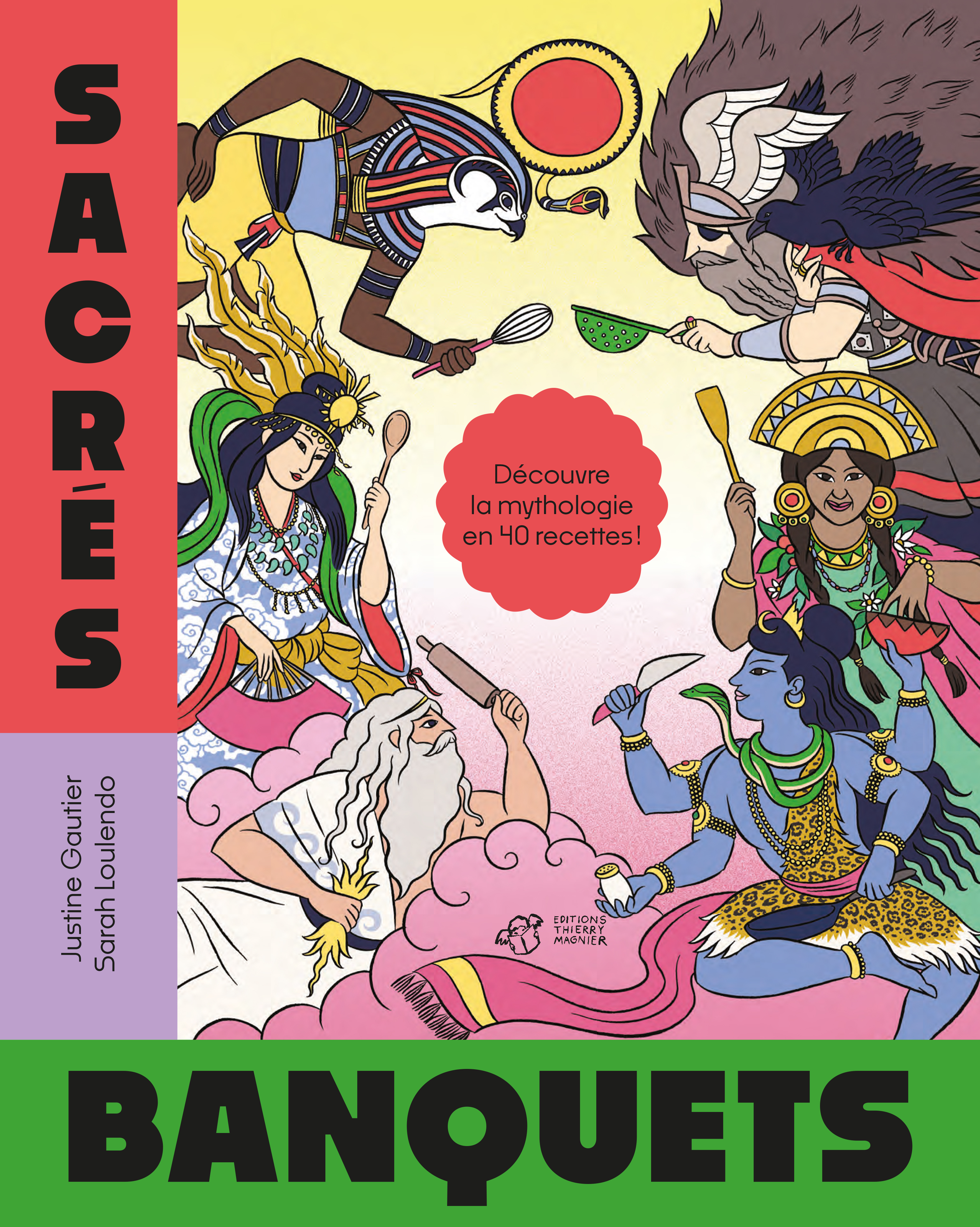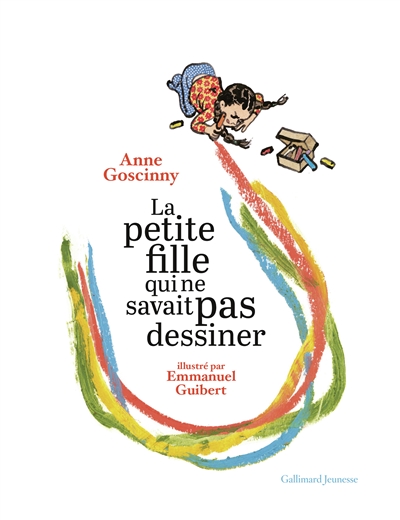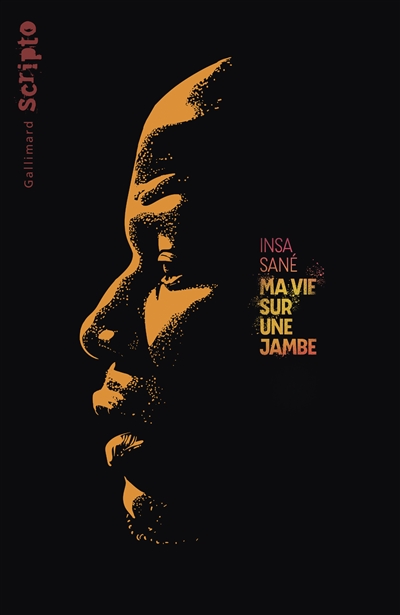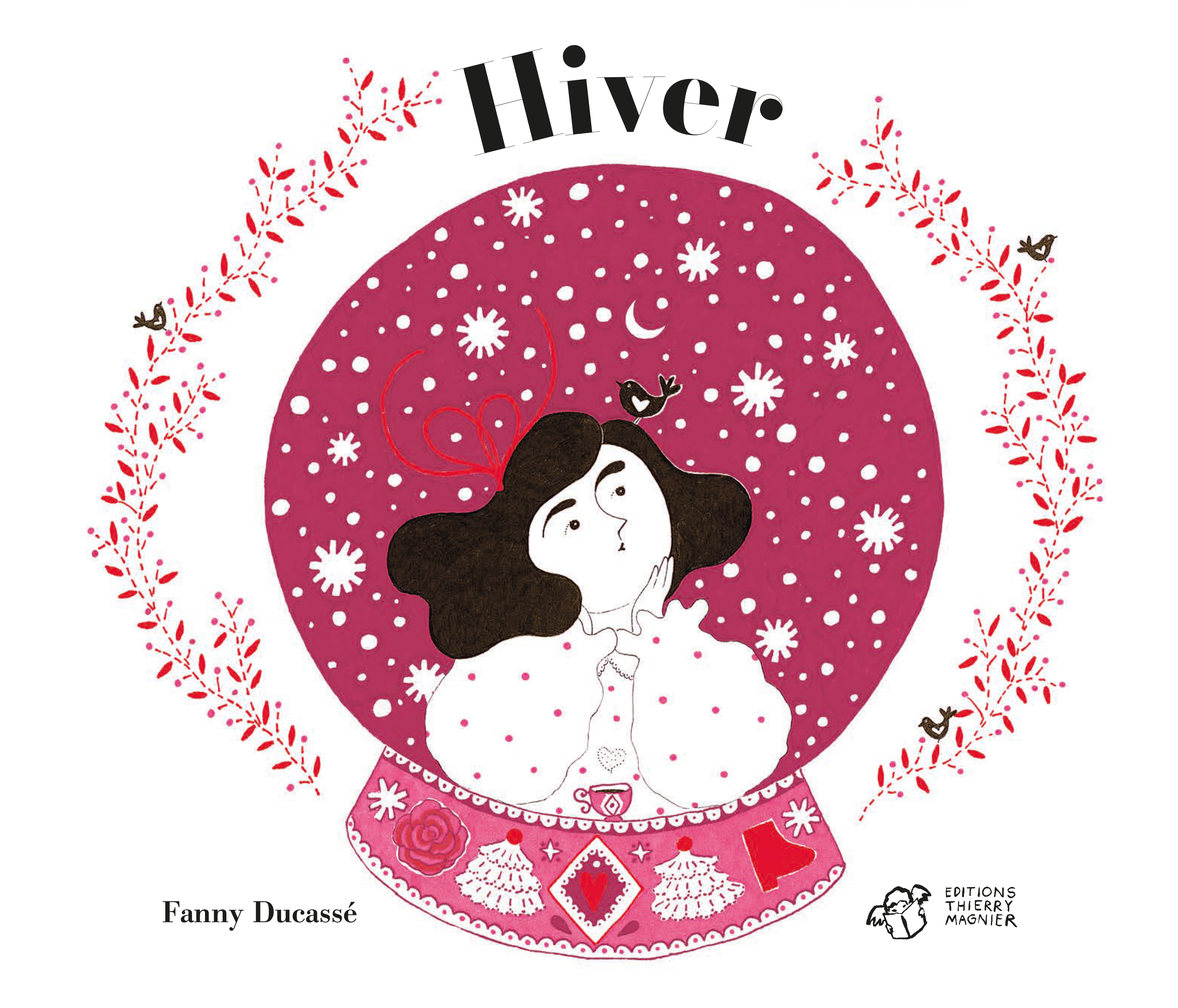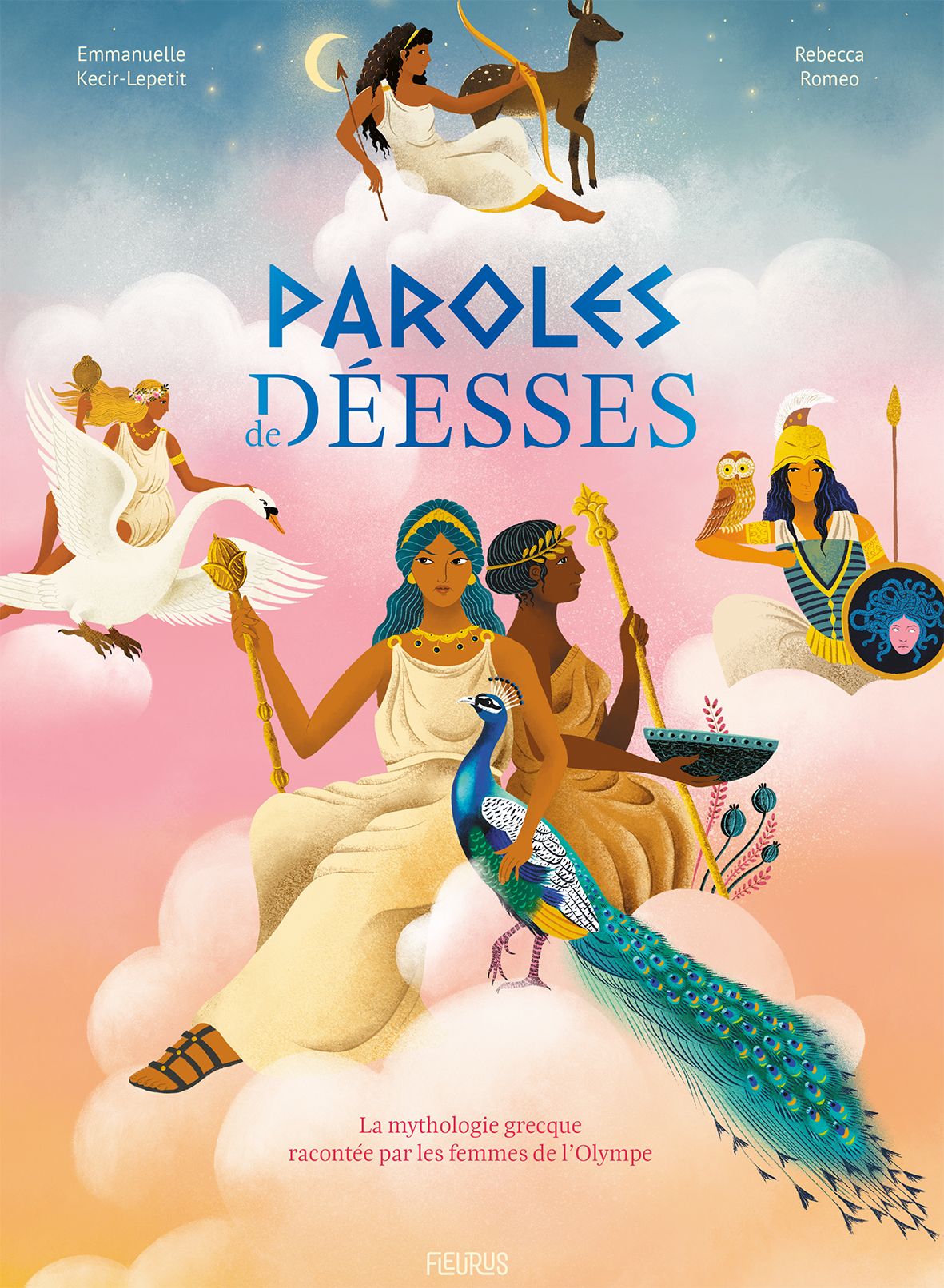PAGE — Tous vos livres se répondent, se complètent, forment ce que vous et votre éditeur appelez une grande « comédie urbaine ». Avec Les Cancres de Rousseau, vous revenez aux origines de cette grande œuvre. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’y revenir ?
Insa Sané — Ce que j’aime dans un bon livre, c’est qu’il nous hante longtemps après l’avoir refermé. Les personnages que l’on y trouve ne meurent jamais. J’aime aussi observer la façon dont ils peuvent évoluer dans le temps et selon les situations. Je me suis allègrement nourri d’auteurs comme Chester Himes pour tracer les contours de ma comédie urbaine. J’ai tout de suite voulu insuffler la vie aux acteurs de ma saga. Et une fois qu’ils savent marcher, ils doivent m’échapper, prendre leurs propres décisions, me surprendre, me décevoir – comme Icare, Adam et Ève, le Monstre de Frankenstein… Dans Les Cancres de Rousseau, on revient en 1994. À cette époque, les personnages principaux sont adolescents. Ils ont toute la vie devant eux – a priori. Ils sont en classe de Terminale. Une année décisive pour franchir le cap de l’enfance et se projeter dans l’avenir. 365 jours pour affirmer ses amitiés, conclure ses premières amours, soulever le Graal. Ils ont donc de nombreux problèmes à résoudre avant de devenir les adultes que la société, la famille, les institutions attendent qu’ils deviennent. Tant de questions et si peu de référents pour les aider à trouver de réponses ! Heureusement, il y a leur prof chéri : Monsieur Fèvre. Il tente avec ses armes d’accompagner leur initiation. Seulement, une fois hors de sa classe, une fois loin des principes de Jules Ferry, ces gamins retrouvent la tanière, la rue, la loi du talion… Cette histoire, je l’avais en tête depuis les premières lignes de mon roman Sarcelles-Dakar, en 2006. Je ne savais pas, à l’époque, quel contexte, quel cadre donner à ce récit. Et puis, j’ai fait du chemin. En publiant mes romans, j’ai rencontré des milliers de jeunes à travers toute la France, grâce aux ateliers d’écriture. J’ai entendu, ici et là, que les nouvelles générations avaient perdu le respect pour leurs anciens ; qu’ils n’avaient plus de valeurs ; qu’ils ne croyaient plus en rien. Dans le même temps, j’ai remarqué que les donneurs de leçons n’étaient pas exempts de tout reproche. « Ô ministres intègres ! Conseillers vertueux ! Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison ! » Quels sont leurs modèles : des notables au-dessus des lois, des dirigeants qui ne tiennent jamais leurs promesses, des politiciens qui prônent le chacun pour soi ? De ce point de vue, mon roman trouve écho dans les scandales qui ont émaillé la Cité, ces dernières années. « La nuit on assassine, et chacun crie : à l’aide ! »
P. — Vos personnages, avec leurs forces et leurs faiblesses, nous rappellent que vous êtes un merveilleux raconteur d’histoires. Comment naissent-elles ? Est-ce la volonté d’écrire sur des sujets qui vous inspirent ou celle de faire vivre des personnages ?
I. S. — « Mon histoire est née en ville. » C’était la phrase d’ouverture de mon roman Gueule de bois. La ville, son foisonnement, est le terreau fertile pour mes récits. La plupart du temps, je crée mes personnages en m’inspirant de gens que je rencontre, de figures qui ont attiré mon attention ou qui m’ont bouleversé. Quand ils sont dépeints avec justesse, on s’identifie à eux ; on oublie qu’ils sont des étrangers et on écoute leur histoire. Parce qu’au final, c’est dans le nombril du monde qu’on apprécie une aventure. Je suis effectivement un raconteur d’histoires, mais j’ai besoin d’une règle et d’une calculatrice pour construire mon œuvre. Ce n’est qu’après avoir balisé le chemin que je peux sereinement laisser courir la poésie. Si je suis friand d’intrigues, j’aime le verbe, la musique dans la langue ; il faut que la phrase résonne. Alors, parfois, j’utilise des mots de tous les jours – il y a 100 000 façons de dire « je t’aime ».
P. — On ne peut oublier Sarcelles qui est, comme toujours (peut-être encore plus), un personnage essentiel de votre roman, plus qu’un simple cadre. Quelle est votre relation avec cette ville ?
I. S. — Sarcelles est ma ville d’adoption. Quand je suis arrivé du Sénégal, je l’ai d’abord détestée. « Pelouse interdite » : je n’ai jamais vraiment compris comment on pouvait emprisonner la nature ! Et puis, j’ai appris à regarder les chiens souiller la belle pelouse. Et j’ai découvert ce qui se cachait derrière la dernière couche de peinture des immeubles HLM. Sarcelles, c’était « Les Petits Enfants du siècle ». Et c’est devenu le hip-hop, les bandes, le bagout, une jeunesse qui a la rage de vivre ; des gamins qui se sentent légitimes partout où ils sont. J’adore et j’adorerai toujours ce patelin pour tout ce qu’il m’a offert. Tant pis si, depuis, nos chers politiciens l’ont abîmé en niant sa culture et sa force.
À propos du livre
Djiraël a 17 ans, il entre en Terminale et il est plutôt optimiste pour l’année qui arrive. Ce n’est pas vraiment qu’il songe à réussir – il est avec ses amis plutôt considéré comme un cancre, une bonne source de problèmes pour le lycée et les institutions en général – mais il reste persuadé que cette année va être fantastique. Il est toujours avec sa bande dans la même classe au lycée Rousseau à Sarcelles et envisage de grandes choses pour cette dernière année. Ce roman est une nouvelle fois la preuve du grand talent d’Insa Sané. Les personnages, que l’on a croisé déjà de près ou de loin dans ses précédents romans, sont attachants et hauts en couleur. Ils nous font vivre avec émotion des moments aussi drôles que sensibles. Une chose est sûre, c’est qu’ils incarnent la vie, l’énergie et l’amitié. Et puis, il y a le style d’Insa Sané. Il a l’art de manier les mots. Dans tous ses romans, l’écriture et la langue ont une importance si grande que lire certains passages à voix haute s’impose. Ces mots ont besoin d’être clamés. Alors lisons-les, vivons-les et apprécions-les !