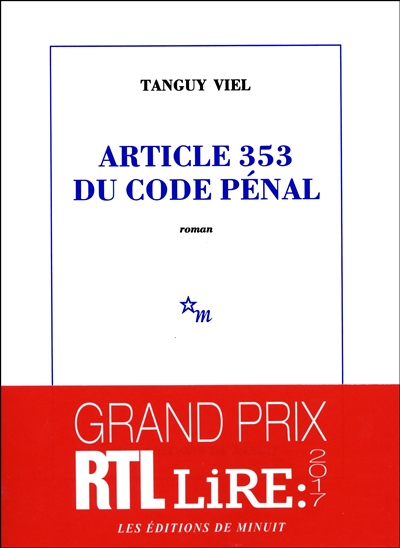Première sélection du Prix Renaudot 2017
Extérieur jour, partie de pêche dans la rade, au large du grand port ouvert sur l’océan. Un homard, deux tourteaux dans le casier que Kermeur et Lazenec viennent de relever. Ainsi commence le monologue de Martial Kermeur, ouvrier de l’arsenal au chômage, revenu seul à quai, accusé de meurtre. Devant le juge, il rembobine les dernières années de son existence ordinaire et fait dérouler les événements qui l’ont conduit inexorablement jusqu’à l’acte fatal. « La suite est écrite par les courants qui savent rejeter les corps le long des côtes. » C’est le récit d’une escroquerie immobilière qui a englouti sa prime de licenciement après une cascade d’échecs personnels. C’est l’histoire de la perte, d’une série noire de pertes gravées dans le cœur, dans la chair d’un homme, coup après coup reçus en silence. Un jour, comme malgré lui, la mécanique s’inverse, comme déréglée par un trop-plein d’injustices. La calme révolte d’un indigné poussé à bout. Fatalité ou liberté ?
Page — Après votre roman « américain », La Disparition de Jim Sullivan (coll. « Double », Minuit), vous voici de retour en Finistère, au bout du monde. Une ville atlantique détruite puis reconstruite. De l’autre côté du pont, une presqu’île, à la fois terrienne et maritime. Ces lieux ont un impact particulier sur les êtres que vous mettez en scène. Leurs comportements, leurs choix sont-ils induits par cette géographie singulière ?
Tanguy Viel — En un sens, je crois que oui. Il y a sûrement d’autres endroits sur terre, même en France, qui pourraient jouer ce rôle, mais le plus important, c’est que la géographie, le paysage aient un rôle dans la construction des personnages. Et plus qu’un rôle : les corps s’y perdent et s’y confondent. Au début de l’écriture de ce livre, pour moi il y avait cela, cette rade un peu vaseuse, verte et grise, et les personnages avaient l’air de sortir directement d’elle, de la brume, de la vase, et se débattaient avec cet engluement. J’ai l’impression que leur humanité, leur langage est un supplément à cette nature, un mal aussi quelquefois, parce qu’ils ressentent l’écart avec elle et préféreraient retourner à l’indifférence des arbres et de la roche. Il se trouve que je viens de là, que j’ai grandi là, et que moi aussi, peut-être, j’ai acquis le langage au milieu de la brume.
P. — De nouveau, vous démontez avec une subtile précision les rouages de la mécanique qui conduit à un acte inéluctable. Kermeur, celui qui opère un rééquilibrage des forces en exerçant sa propre justice, est-il, à sa manière, « l’homme révolté » de Camus ?
T. V. — Si la révolte, comme chez Camus, est la possibilité de renverser les valeurs et de retrouver sa propre souveraineté, oui, bien sûr, il lui ressemble. Mais peut-être qu’il y a chez Kermeur un ressassement, une passivité qui rend la question plus animale, où le passage à l’acte est presque un réflexe. Kermeur n’est pas héroïque dans son geste. Il est comme un élastique ou un ressort qu’on a tendu et qui a lâché. Il se trouve que son geste a quelque chose de juste et de réparateur malgré sa folie. Mais c’est un peu comme dans Taxi Driver (Scorsese), il y a une confusion entre la folie et le geste qui sauve. Dans tout ça au fond, il y a peu de libre arbitre.
P. — L’absence, l’abus de confiance, la perte, la solitude, la frustration, le manque d’argent, la spirale de l’échec, mais aussi le rêve d’une autre vie… Vous jouez souvent avec ces thèmes. Peut-être cette fois avec plus d’empathie pour vos personnages ?
T. V. — Oui, c’est vrai, quelque chose de plus brut irrigue ce livre. Mais comme je le disais l’autre jour à une journaliste, j’aimerais beaucoup que mon texte déteigne un peu sur les précédents, car – ce n’est certes pas à moi d’en juger – je sais qu’il y a dans mes autres livres, sous l’ironie ou la distance apparente, les mêmes tensions et les mêmes charges émotives. Peut-être avec plus de pudeur, c’est vrai, mais enfin, je crois qu’elles sont moins froides, moins « vitrées », qu’on ne veut bien le dire. De mon côté, en tout cas, j’ai autant d’empathie pour les narrateurs de chacun de mes livres. Celui-là est peut-être plus à vif.
P. — « L’œil de la mouette ne cille pas », dites-vous. Cette extrême lucidité du romancier, ainsi qu’une constante tension narrative et une architecture impeccable, caractérisent votre écriture. Est-ce la marque du cinéphile ? Du lecteur que vous êtes ? Vous avez dit en effet : « Quand j’écris, je convoque une bibliothèque »…
T. V. — Pour écrire, il faut voir, il faut même parvenir à garder intactes les images à l’intérieur de soi. Il se trouve que j’ai un défaut psychique : je ne fixe pas les images, mais que du flou et du mouvant, ça fuit de toute part. C’est pourquoi écrire m’est aussi salvateur que difficile, parce que pour écrire, il faut fixer. « Je fixais les vertiges », disait Rimbaud. Alors peut-être que le cinéma m’aide un peu à faire cette opération, à fixer, à « voir », à organiser la matière. Et cela, aussi bien à l’échelle de l’image, du détail, qu’à l’échelle de la narration et de l’architecture. Mais je voudrais dire aussi à quel point je dois à la littérature elle-même, car certains écrivains, comme Virginia Woolf ou Proust, ne nous apprennent pas seulement à fixer, mais aussi à vivre avec le mouvement, à l’épouser, à le suivre. Et ce sont eux aussi qui m’aident à écrire.