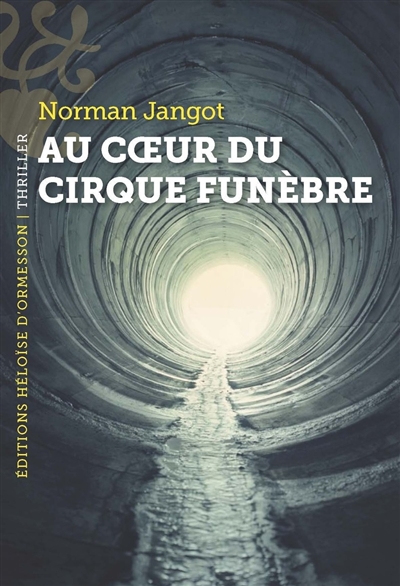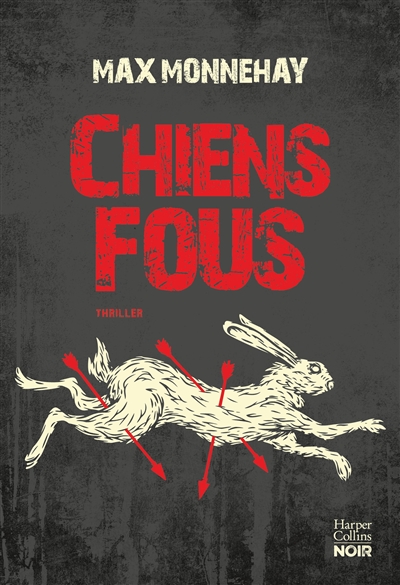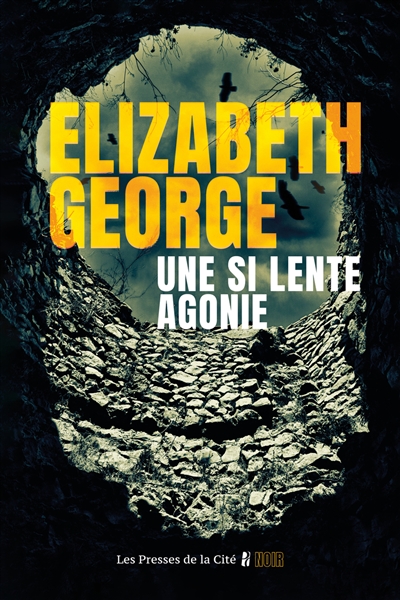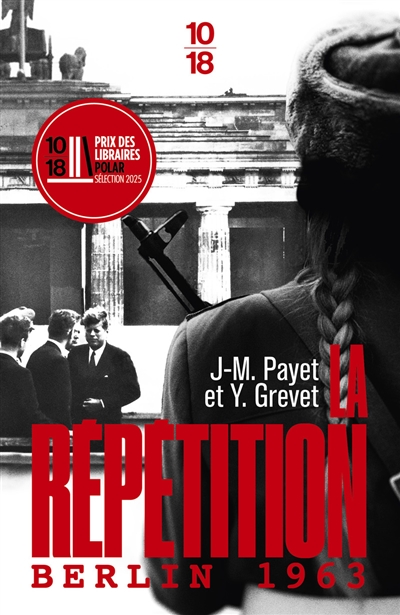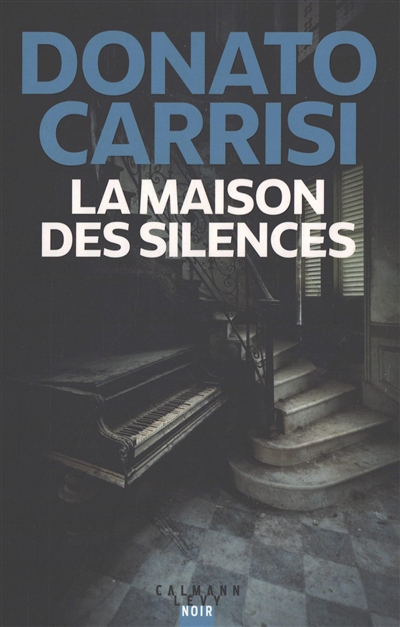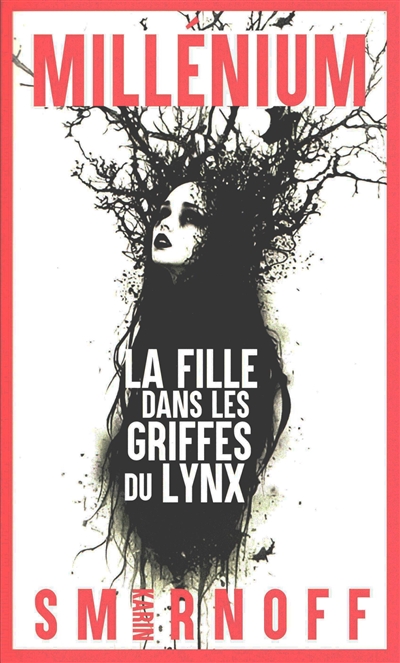Attendu ! Après Terminus Belz et son théâtre d’action breton, Emmanuel Grand revient avec un deuxième polar dont l’action, l’atmosphère et le rythme, sont orchestrés par le lieu. À l’issue d’une courte introduction indochinoise, puis algérienne, au terme d’une présentation « tout en douceur » de trois soldats français, Douve, Barjot et Dubus, le lecteur découvre la petite ville de Wollaing, sise entre Douai et Valenciennes. Les fastes années de l’industrie métallurgique sont désormais révolues. Le quotidien s’apparente parfois à un long parcours du combattant afin de boucler les fins de mois. Sévissent sur place des « organismes de prêts » aux méthodes mafieuses, règnent les dealers, la faucheuse faisant son marché ici et là. Pauline Leroy, toxicomane, est retrouvée assassinée. Tout conduit à accuser Wallet, commode ordure locale. Pourtant, le commandant Buchmeyer, adepte du « détail qui cloche », se penche un peu plus sur le passé industriel et syndical du Nord de la France. Polar social aux personnages ambigus, roman noir d’un présent sans boulot, un présent obscurci par la jalousie, la haine et la rancœur, ce deuxième roman d’Emmanuel Grand happe littéralement le lecteur.
Page — Le polar comme témoin ? Votre deuxième polar, après la Bretagne, entraîne le lecteur à Wollaing, petite ville proche de Valenciennes frappée de plein fouet par le chômage. Voyez-vous le romancier comme un témoin privilégié de notre société, et le polar comme une sorte d’outil photographique ?
Emmanuel Grand — « Privilégié »… je ne sais pas. Un témoin parmi d’autres, certainement. Car le roman permet, au-delà des stéréotypes et des statistiques, d’accéder à l’intimité des personnages. Comme le cinéma. Mais votre parallèle avec la photo est excellent. On ne photographie que des instants et ils sont parfois, par leur pouvoir d’évocation, emblématiques d’une époque. Le roman c’est pareil.
P — Les premières pages remettent en perspective le contexte historique dans lequel s’inscrit votre intrigue. Ensuite le roman opère des va-et-vient entre passé et présent, entre haine, rancœur, lutte syndicale, trahison… Connaître et comprendre le passé pour mieux appréhender notre société, est-ce selon vous la clé ?
E. G. — Je suis convaincu que nous sommes le produit de notre histoire. Cet ancrage revêt parfois une force considérable. Oui, le passé nous offre de nombreuses clés. D’abord parce qu’il représente un catalogue de conneries à ne pas reproduire. Regardez le xxe siècle. Il n’y a qu’à tourner les pages d’un manuel d’Histoire et choisir. Malheureusement, j’ai l’impression que le xxie siècle s’ouvre sur des perspectives franchement peu enthousiasmantes… Nous devrions être censés nous améliorer à chaque génération, mais, pied de nez du Créateur, nous semblons vouer à répéter inlassablement les mêmes erreurs. Nous sommes maudits. Et cette malédiction a un nom : l’oubli.
P — Après le succès de Terminus Belz (Points), avez-vous ressenti de la pression lors de l’écriture de votre deuxième polar ?
E. G. — Il faut être honnête : écrire un deuxième roman est beaucoup plus confortable que d’en écrire un premier : vous êtes attendu, parfois avec un flingue caché sous l’imperméable, soit, mais on vous demande où vous en êtes, on vous appelle. C’est rassurant. Cela dit, j’ai effectivement ressenti une certaine pression. Une pression que je me suis imposée à moi-même parce que, subitement, j’avais des lecteurs et que je ne voulais pas les décevoir.
P — Le commandant Buchmeyer, personnage décalé et attachant, est-il appelé à devenir un personnage récurrent de vos prochains romans ?
E. G. — Pourquoi pas ? Je n’avais pas spécialement cette intention à l’issue de mon premier roman, mais il est vrai que Buchmeyer pourrait être un bon candidat. Je garde son CV dans un tiroir. Sérieusement, le travail d’écriture est pour moi un véritable voyage, géographique et humain. Un voyage au long cours. Deux ans. J’aime l’idée qu’après un tel voyage, quand l’heure est venue de lever l’ancre à nouveau, on parte dans une toute nouvelle direction.