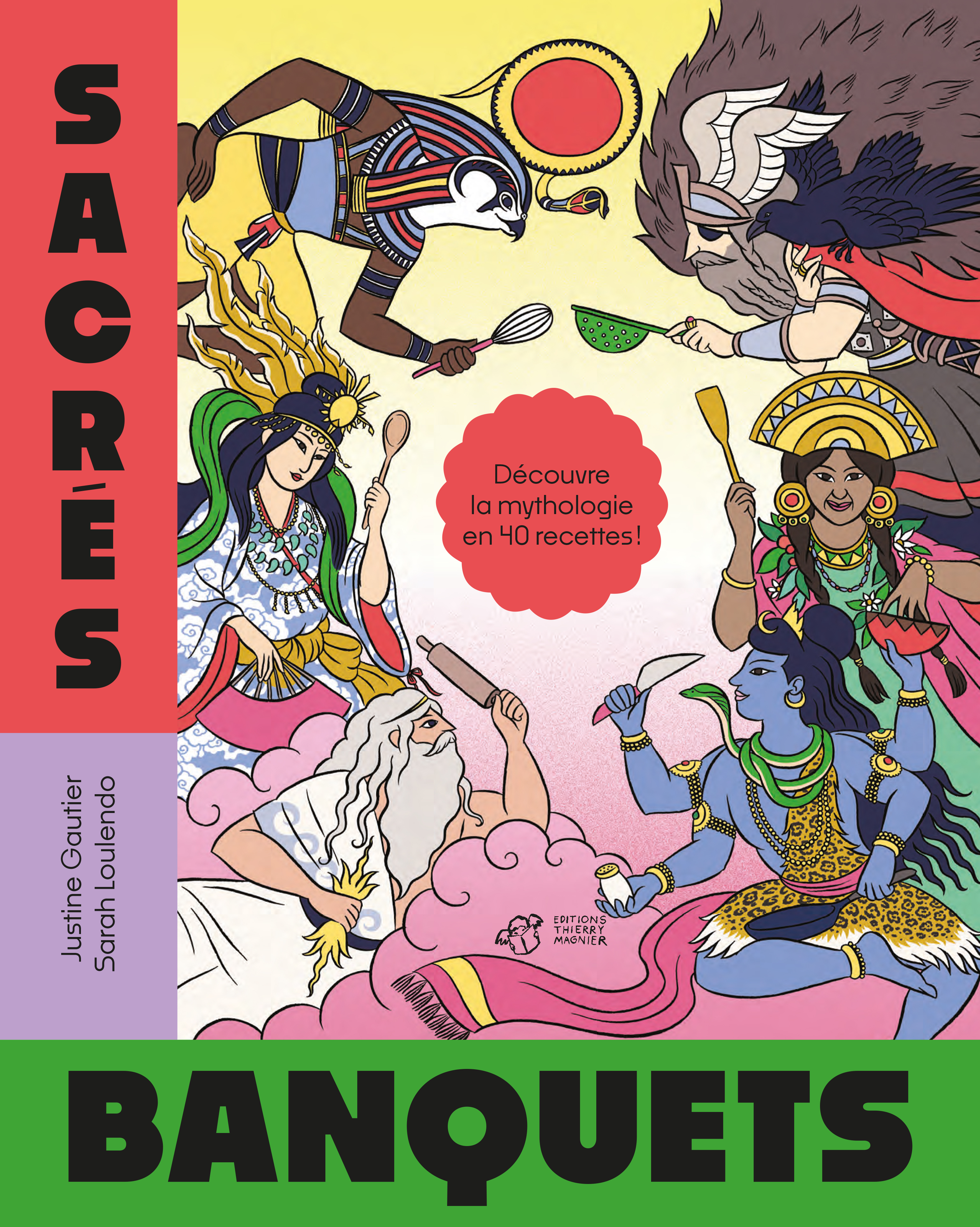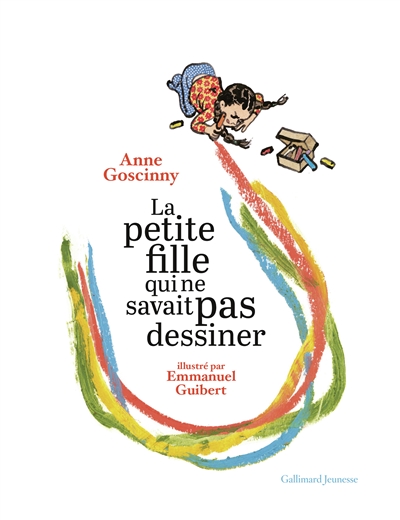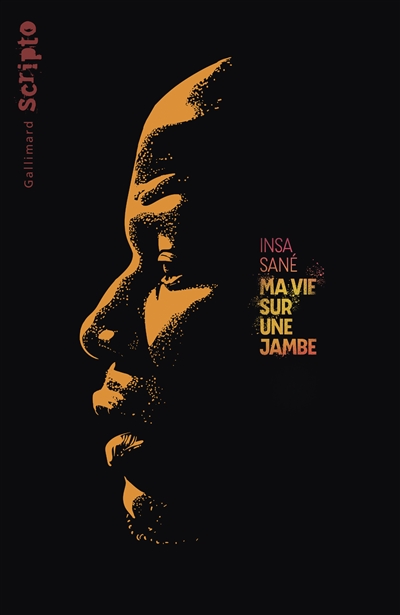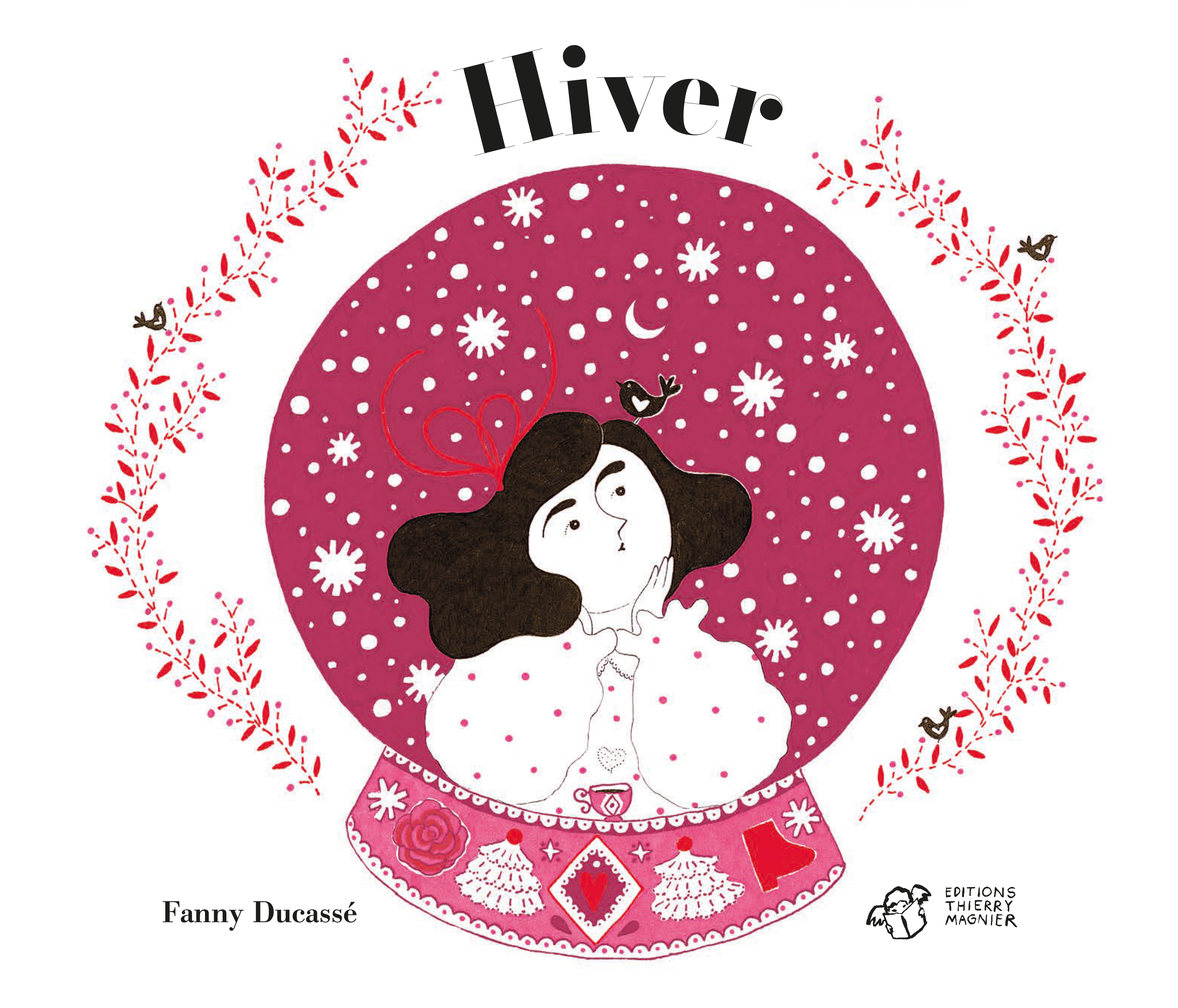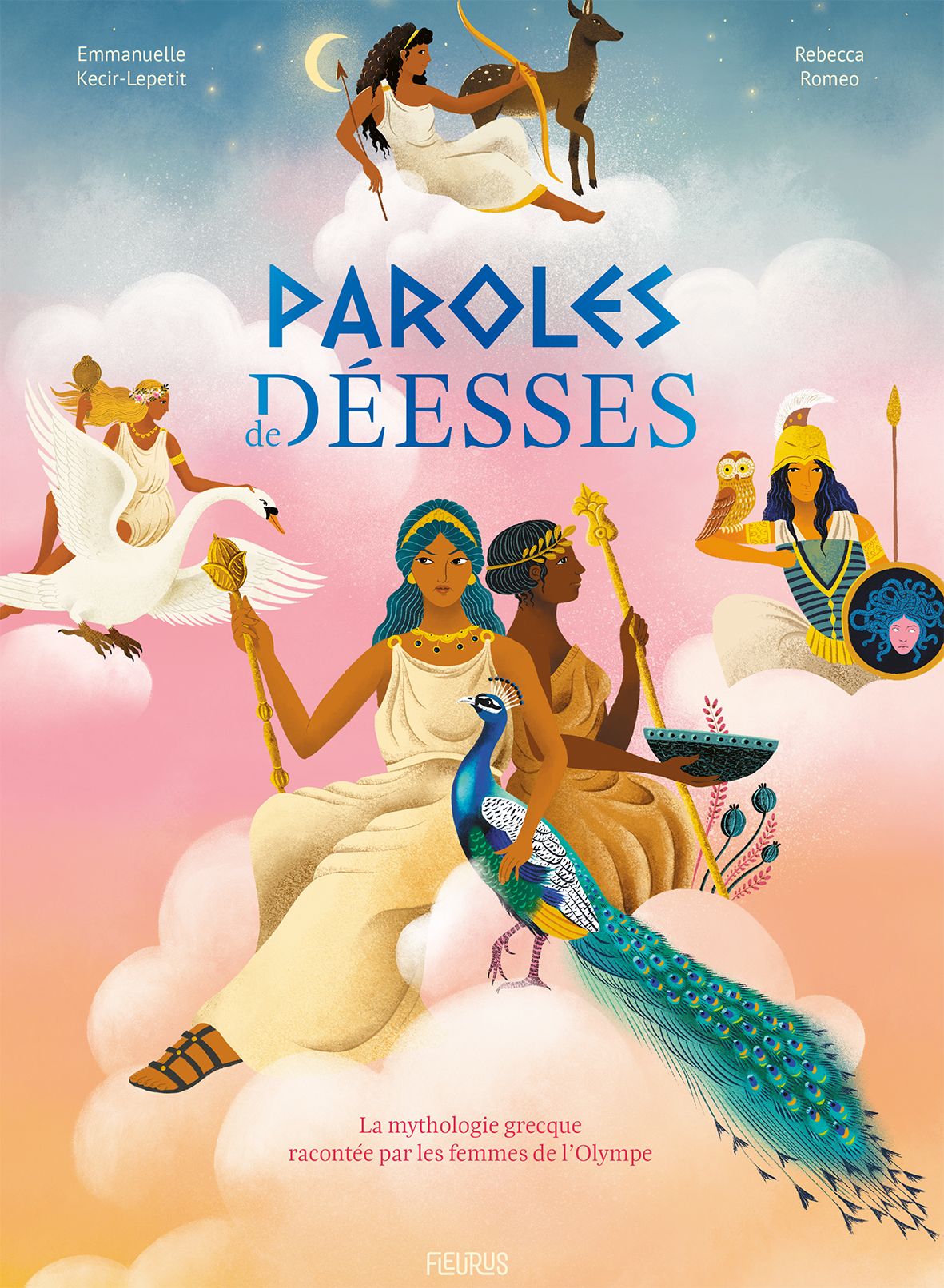Dans le désordre raconte l’histoire de sept personnages. Sept vies que l’on découvre au gré des chapitres, centrés chaque fois sur l’un des protagonistes. Ces sept-là ont l’envie de ne pas vivre comme les autres et c’est cela qui les réunit. Ils vont choisir – et ce mot a de l’importance pour eux – de vivre ensemble différemment. Pour cela, ils « empruntent » une maison abandonnée et la font revivre par leurs rires, leurs émotions, leurs débats engagés. La vie, l’amour, la lutte et la passion débordent de ce lieu. Loin des clichés autour des squats et de leurs occupants, Marion Brunet parvient à rendre chaque personnage furieusement attachant et sensible. L’histoire d’amour intense entre Jeanne et Basile en est évidemment le symbole le plus marquant, mais tous ont une histoire qui mériterait qu’on s’y attarde encore. La fin, terrible, est à l’image du reste : pleine de vie et d’émotions, d’amour et de désespoir. Comme un parfum désenchanté de notre époque que l’on se doit de combattre. Un roman tragiquement magnifique.
Page — Vous signez avec Dans le désordre un très beau et dur roman qui regorge de vie. Vos personnages sont particulièrement réussis, saisissants de réalisme et d’émotions. Pourquoi avoir choisi de situer votre histoire dans un squat ?
M. B. — Je voulais parler de révolte, de résistance – dans une époque où elle s’impose, mais aussi de façon plus intemporelle, et de ceux qui choisissent la marge, les marges. Les squats sont un beau terrain d’exploration de la lutte. Il y a la démarche illégale, qui vient mettre l’accent sur l’écart entre précarité et maisons vides ; il y a surtout la tentative de s’organiser en collectif. Je voulais dépasser le cliché du squat « zone », l’image négative qui est véhiculée. Plus jeune, j’ai connu pas mal de squats où l’organisation collective était au centre des préoccupations, où il y avait ce grand défi de penser autrement le groupe, le couple, la famille, le politique, l’art. Refuser les choses telles qu’elles étaient, tenter d’en inventer de nouvelles. Et même si ces expériences tiennent rarement dans le temps, il n’en reste pas moins qu’elles sont toujours riches, humainement, d’un point de vue collectif mais aussi individuel – une autre façon de penser, un désir de réinterroger le monde sans cesse. C’est précieux. C’est ce que j’essaie de dire à la fin du roman : les personnages sont marqués par leur engagement, par ce morceau de vie, quelle que soit la route qu’ils choisiront de prendre par la suite.
Page — Si vous aviez à choisir un personnage dans la maison, lequel incarneriez-vous ?
M. B. — Attendu que c’est le personnage de Jeanne que j’ai le plus creusé, on peut sans mal imaginer que je lui ai offert un panel de mes propres ressentis, mais ce serait réducteur de penser qu’elle est la plus proche de moi... déjà parce que je n’ai plus 19 ans depuis un moment. Ils ont sans doute tous un petit bout de moi en eux. J’aime particulièrement Tonio, parce qu’il est plus vieux et que c’est donc un personnage plus complexe que les autres, avec une histoire déjà derrière lui ; il est abîmé, décalé, moins intransigeant que Marc par exemple, dont j’aime cependant les colères. Alison me touche pour son petit côté chat écorché, son enfance douloureuse, et puis Jules pour sa bonhomie et ses silences. Bon, je les aime tous en fait, mais ils m’agacent aussi parfois, parce que j’ai vraiment essayé de créer des personnages justes, réalistes, donc ambivalents parfois, comme on l’est tous. Je voulais que des lecteurs puissent se dire : « Tiens, Jules, on dirait mon pote Yann ». Qu’ils offrent vraiment la sensation du vivant.
Page — J’ai particulièrement adoré la partie où les personnages doivent passer Noël en famille. Tous y mettent une importance et un enthousiasme différents. Dans Frangine (Sarbacane, 2013), la fraternité était essentielle. Que représente pour vous la famille (réelle ou celle que l’on se crée) ?
M. B. — Vous avez raison, il y a un écho avec Frangine et la construction d’une famille différente. Je n’en ai pas pris conscience en écrivant Dans le désordre, ça m’est apparu ensuite. J’ai même fait le lien avec L’Ogre au pull vert moutarde et L’Ogre au pull rose griotte (2014 et 2015, Sarbacane) : là encore, le foyer d’accueil fait office de famille. Noël, c’est la fête qui symbolise la famille, alors c’était le moment parfait pour explorer la situation familiale et sociale chez chacun des personnages, sans passer par un état des lieux trop linéaire. Et ça permettait de les mettre en regard les uns par rapport aux autres. C’est une bascule dans le roman, le moment où ils choisissent le groupe, justement. C’est vrai que j’aime l’idée de la famille que l’on crée, que l’on choisit et que l’on bricole. Qui devient creuset de chaleur, d’amour, même si on n’échappe jamais aux conflits, comme dans toute famille. Je pense qu’au final, elle s’avère parfois tout aussi cloisonnée que celle d’origine, mais au moins on la choisit, on l’invente, elle est en mouvement.
Page — Dans vos précédents romans déjà, vous abordiez des sujets sensibles. Peut-on parler de vous comme d’une auteure engagée ?
M. B. — Engagé, je crois qu’on l’est forcément quand on investit un projet artistique qui a du sens, qui n’est pas un pur divertissement. Le choix d’un sujet, d’un univers, l’origine des personnages, leur histoire, la façon dont on les traite, dont on les aime, tout ça c’est de l’engagement. En revanche j’espère éviter l’écueil du roman « à message », donneur de leçons ou de solutions. J’aime mieux l’idée d’ouvrir des questionnements. C’est une forme de résistance bien plus efficace que les grandes vérités. Il y a cette phrase de Gilles Deleuze que j’aime particulièrement et qui m’émeut pas mal : « Seul l’acte de résistance résiste à la mort. Soit sous la forme d’une œuvre d’art, soit sous la forme d’une lutte des hommes » ; j’y puise une certaine force, et elle m’a accompagnée au fil de l’écriture de Dans le désordre.
M. B. - Je pense que l’autre reste une belle solution pour avancer. La rencontre, la mise en commun des expériences, des savoirs, le conflit constructif, la confrontation, et l’amour évidemment – au sens large. Jeanne, elle s’en sortira parce que survivre au deuil, c’est comprendre qu’on peut continuer de vivre malgré la perte. C’est ce qu’elle va faire. Elle tombera à nouveau amoureuse, elle vivra des trucs déments, sublimes ou révoltants, et elle restera en guerre, une guerre essentielle, vitale. Ça vaut pour d’autres types de deuils que celui de la mort réelle, d’ailleurs. On passe notre vie à faire des deuils, et on continue de vivre, et on avance, un peu grandis.