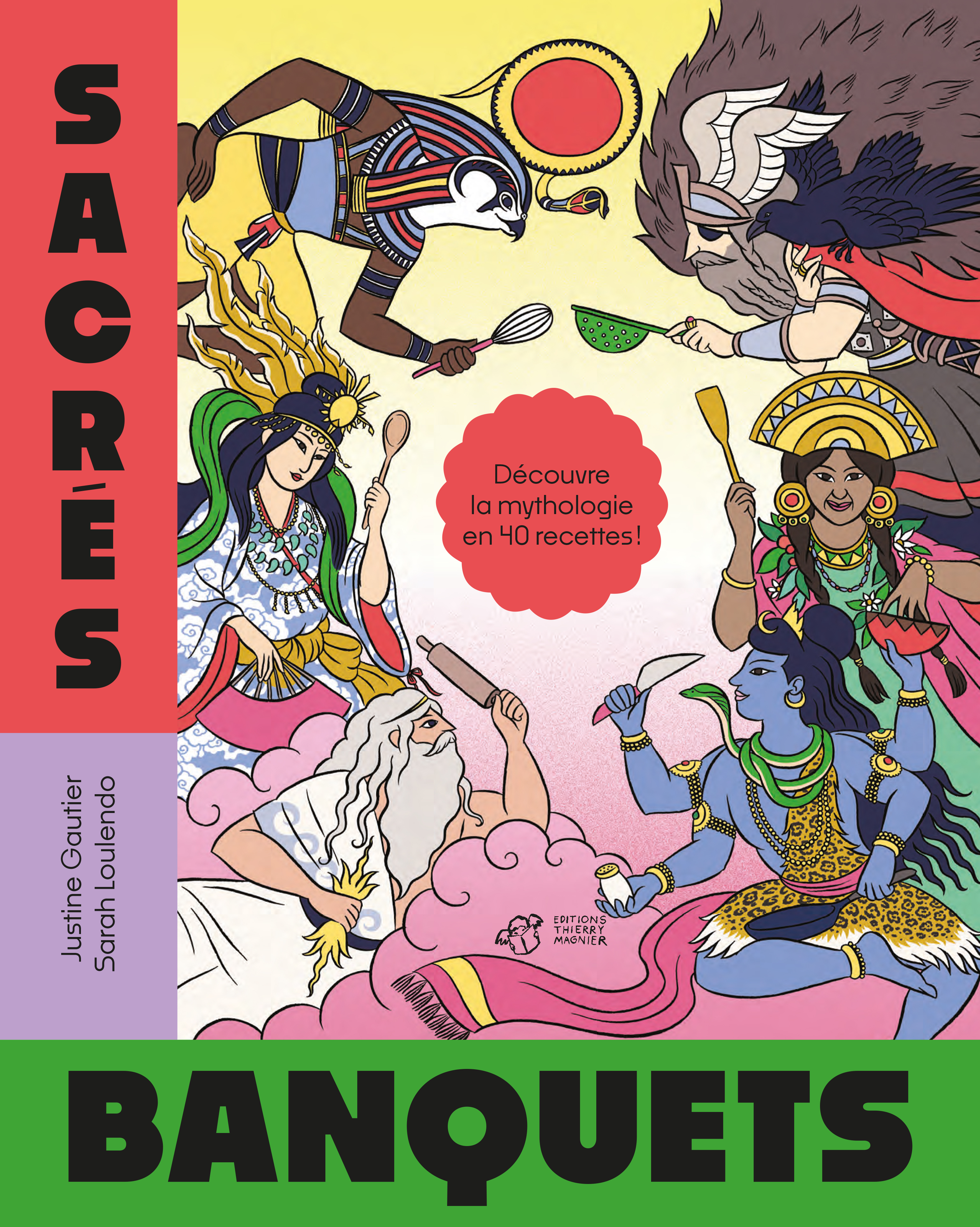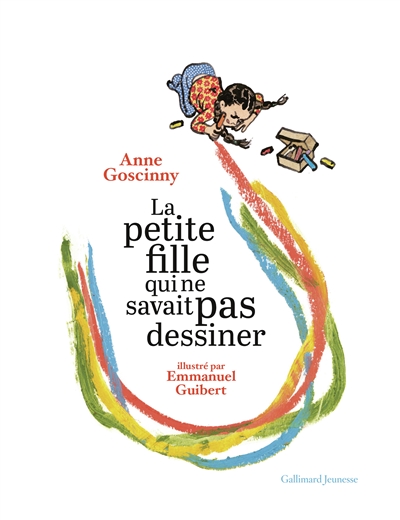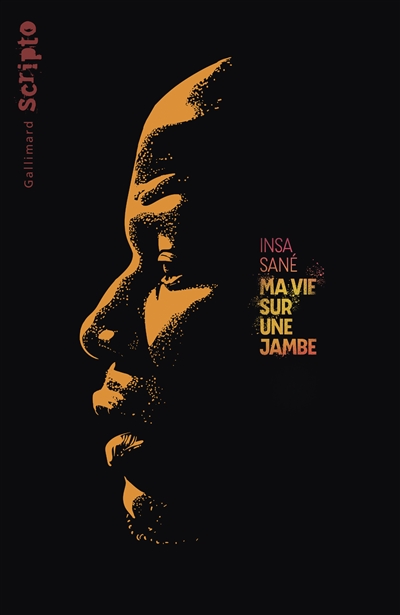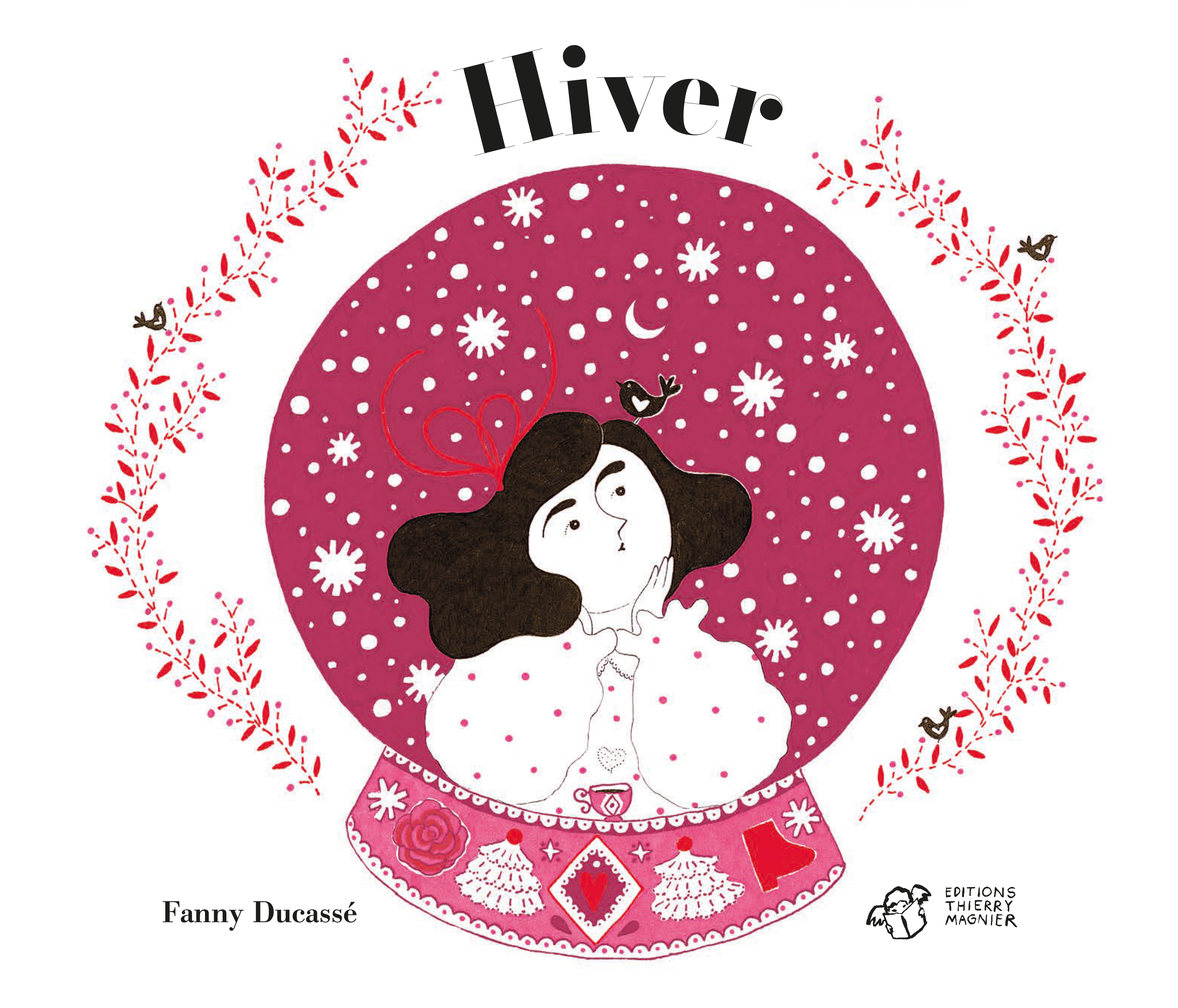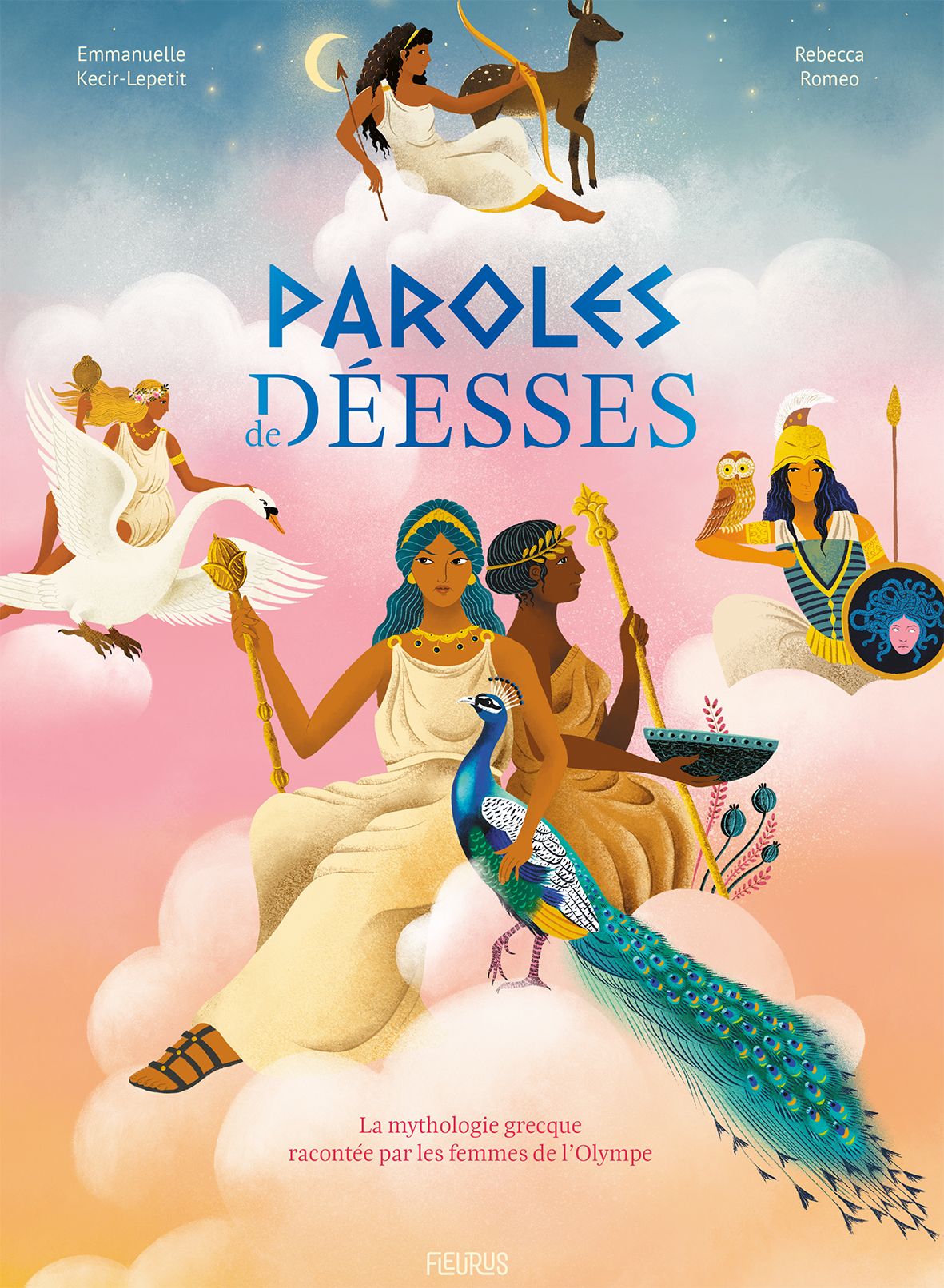Page — Dans Ma mère, le crabe et moi, vous abordez le sujet du cancer du sein. Est-ce une cause qui vous tient à cœur ?
Anne Percin — Le cancer atteint beaucoup d’hommes et de femmes, c’est devenu une maladie fréquente (je ne dis pas « banale »), hélas. J’ai perdu plusieurs membres de ma famille, emportés par diverses formes de cancer, et quatre de mes amies ont été touchées par le cancer du sein. Je suppose que cela m’a sensibilisée et j’ai trouvé urgent d’écrire sur ce sujet en m’adressant aux adolescents. Tout ce qui entre dans leur vie doit pouvoir entrer dans la littérature qu’on leur destine. Non pas pour les inquiéter, mais au contraire pour les rassurer. J’ai pensé souvent, en écrivant ce roman, aux jeunes qui sont pris dans cette tourmente avec un de leurs parents et qui se sentent seuls, parce que, autour d’eux, on n’en parle pas. La littérature, selon moi, peut et doit permettre de dire à un lecteur : « non, tu n’es pas seul ».
P. — Comment l’idée vous est-elle venue ? Quel était votre but en écrivant ce livre ?
A. P. — L’idée m’est venue à partir des conversations que j’ai eues avec une de mes collègues, élevant seule ses deux adolescents et que le cancer du sein a atteint. Avec beaucoup de franchise et d’humour, elle racontait les phases par lesquelles elle était passée, de l’annonce de la maladie aux différentes étapes du traitement. Chose formidable, elle était capable de raconter ça avec beaucoup de drôlerie. Lorsqu’on est confronté pour la première fois au monde médical, quantité de choses paraissent surréalistes, et pour peu qu’on rencontre un personnel soignant qui dédramatise, il est possible d’en rire. Pour autant, cette amie n’était pas inconsciente du danger qu’elle courait. Ses enfants non plus. Elle faisait le choix d’en rire, quand c’était possible, et d’en parler, surtout. Mon but n’est pas de dire que le cancer du sein n’est pas « grave » : bien sûr qu’il l’est, même avec 87 % de chances de guérison (si on se soigne… sinon… c’est 0 %) ! C’est une terrible épreuve. Mais il me semble que devoir passer sous silence ce dont on souffre en est une plus terrible encore. Il s’agit donc de lever un tabou, de permettre aux femmes que cette maladie touche, et à leurs enfants, de sortir de l’ombre, en quelque sorte. Comme je le fais dire à mon héroïne, Tania, « Ça ne suffit donc pas de souffrir, il faudrait encore le faire en silence ? » Voilà pour moi la pire des injustices : être condamné socialement à taire un combat dans lequel on engage pourtant toutes ses forces. Le silence gêné qui entoure le cancer est un ennemi à combattre.
P. — Dès le début du livre, Tania nous parle de son blog « Ellipse ».
A. P. — L’ellipse, c’est la faculté d’occulter certaines choses, non pour dissimuler des secrets, mais pour passer à autre chose de plus important. Dans cette figure de style réside tout l’art du récit ! Mais c’est aussi, il est vrai, un art de vivre. Je n’y avais pas pensé avant, mais cette faculté qu’a Tania d’éluder ce qui ne lui plaît pas (comme la situation avec son père et sa belle-mère), c’est peut-être ce qui lui permet de se concentrer sur ce qui lui importe le plus. Tout ne mérite pas d’être raconté dans une histoire. Il faut savoir aller droit au but. De même, tout ne mérite pas d’être vécu dans une vie. On a le droit de mettre des parenthèses avec des points de suspension, comme pour dire : « Cette partie-là de ma vie ne m’intéresse pas, je l’ai vécue parce que je n’avais pas le choix, mais je ne la retiens pas. » Ce n’est pas de l’amnésie ni du refoulement, c’est une façon de faire le tri. Je trouve très intéressant de transmettre cela à de jeunes lecteurs. Ils ont le droit de faire des choix.
P. — Tania a un blog, sa mère aussi. Elles se ressemblent et en même temps leurs rapports semblent assez conflictuels. Comment définiriez-vous leur relation ?
A. P. — C’est vrai qu’elles se ressemblent ! Le problème est que chacune marche un peu sur les plates-bandes de l’autre… Cette forme de concurrence arrive souvent entre mère et fille, surtout s’il n’y a pas une tierce personne pour y faire obstacle ! À mon sens, leur relation n’est pas vraiment conflictuelle. Tania est une adolescente qui cherche à s’affirmer face à un adulte qui est son seul repère. Rien de plus naturel. Lorsque ce repère s’effritera, elle fera tout pour restaurer la complicité qui les lie. Elle soutient sa mère comme on étaye un mur qui s’effondre. Si Tania continue à s’affirmer, ce sera face aux autres, face au monde. Ce qui est la tâche de tout adolescent, finalement !
P. — Le cancer est un sujet rude. Pourtant, votre livre est débordant d’humour. L’humour, une philosophie de vie ? Un choix d’écrivain ?
A. P. — C’est quand les situations qu’on vit sont les plus douloureuses qu’on a le plus besoin d’humour ! C’était aussi la morale d’un autre de mes romans, À quoi servent les clowns ? (Le Rouergue, 2010). Donc, oui, c’est une philosophie d’écrivain. Sur le plan personnel, bien que je sois quelqu’un de plutôt drôle, je sais que l’humour n’est pas disponible ni même souhaitable à tout instant. Mais je sais aussi que, quand le rire est possible, il est salutaire. On peut voir, parfois même dans les événements les plus tristes, une forme de bouffonnerie, une dinguerie qui échappe à la raison. Si on est sensible à ces moments, on devient plus léger. Et puis, l’humour vient aussi de la lucidité. Les adolescents sont souvent plus drôles que les enfants, je trouve, car ils sont moins naïfs. Ils repèrent avec acuité les petites hypocrisies des adultes. Tania, quand elle critique avec drôlerie le blog de sa mère au début du roman, illustre cette forme d’humour qui m’est chère. C’est le propre d’une vision lucide et honnête de la vie. Une forme de clin d’œil, une manière de dire qu’on n’est pas dupe. À ce titre, l’humour est tout sauf une démission face au drame. Ce n’est pas sous-estimer la gravité des choses que d’en rire. C’est au contraire une forme de combat. Rire de choses graves est une manière de lutter. Comme on s’arme de patience, on peut s’armer d’humour.
P. — Pourquoi Tania se lance-t-elle dans la course ? Que symbolise le sport pour elle ?
A. P. — Le sport, c’est la confrontation avec le corps, ses limites, ses possibilités. L’aspect « compétition » est pour moi très peu important. D’ailleurs, Tania se fiche de gagner quand elle court le cross final. Je trouve que c’est surtout par rapport à soi-même que l’effort a un sens. Ce qui est curieux, et que je ne m’explique pas vraiment, c’est que la course à pied est un sport symboliquement important à mes yeux. J’ai sans doute été marquée dans ma jeunesse par La Solitude du coureur de fond (Points) d’Allan Silitoe, lu au lycée… C’est un sport extrêmement solitaire et le plus naturel qui soit. Un sport intime, en quelque sorte. Pour Tania, la course est un moyen de traverser la maladie de sa mère. Elle fournit un effort qui lui donne l’impression de se battre et, ainsi, de soutenir physiquement sa mère. Et puis sa mère est une ancienne nageuse : elles ne sont donc plus en concurrence !