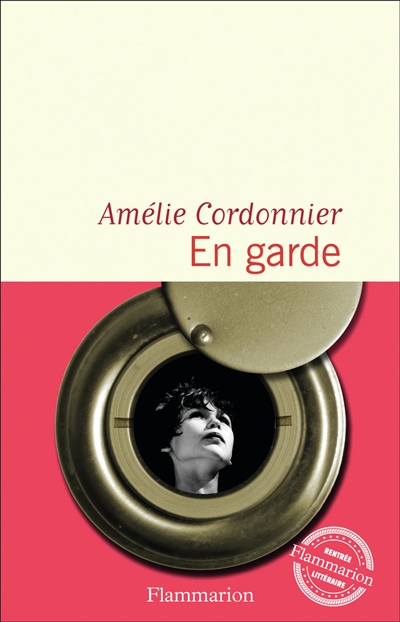Cette fois-ci, Amélie Cordonnier, c’est vous et votre famille qui vous trouvez au cœur de la tourmente. Dans un court prologue, vous écrivez que « ce ne sera pas de l’autofiction mais de la vivisection », qu’il faut que vous racontiez tout depuis le début. Il se trouve que tout commence en juin 2020 avec une lettre que vous recevez. Pouvez-vous nous raconter ce que contient cette lettre et l’effet qu’elle va avoir sur vous et votre famille ?
Amélie Cordonnier - Le jour où j’ouvre cette lettre, le ciel me tombe sur la tête. Je découvre qu’elle m’est envoyée par la protection de l’enfance et je comprends en la lisant que j’ai été dénoncée par un appel anonyme passé au 119. Du jour au lendemain, je me retrouve donc soupçonnée de maltraitance sur mes enfants. À partir de ce moment-là, tout bascule. Ce courrier nous impose, à mon mari, mes enfants de 14 et 7 ans et à moi, un rendez-vous avec une assistante sociale. Les semaines qui le précèdent, je n’arrive plus à dormir, je vis dans la sidération, une peur immense m’envahit. Les questions se bousculent d’autant plus dans ma tête que je crains d’être encore plus suspecte à cause de mes romans : Un loup quelque part (paru quelques mois auparavant) raconte l’histoire d’une mère à la limite de la maltraitance et Trancher parle de la violence verbale, une violence invisible, au sein d’une famille. Je tremble à l’idée que mes livres servent de pièces à conviction contre moi. C’est ma propre vie qui vient d’être brutalement percutée par la fiction.
Vous écrivez d’ailleurs dans En garde que vous avez peur que la fiction vous dévore vous et votre famille. Vous vous interrogez donc sur la frontière ténue entre fiction et réalité, et vous faites monter la tension en passant par l’émotion.
A. C. - Oui, parce que j’ai trouvé invraisemblable qu’aujourd’hui n’importe quel voisin puisse décrocher son téléphone, faire le 119, dire que les enfants du dessus crient ou pleurent beaucoup et qu’il se fait du souci, pour que la protection de l’enfance déclenche aussitôt une enquête sans demander aucune preuve au délateur et en lui laissant la possibilité de rester dans l’anonymat. En dehors des incidents de cours de récréation, c’était la première fois que j’étais accusée injustement. Et ce qui est terrible, c’est que je savais que je n’avais pas maltraité mes enfants et pourtant, je me sentais quand même coupable, j’avais honte et surtout terriblement peur que mes enfants soient entendus et leurs propos mal interprétés. Alors j’ai eu besoin d’écrire, non pas pour raconter ma vie mais pour comprendre ce qui s’était passé et de quelle façon je pouvais transmettre cette histoire au lecteur d’un point de vue romanesque.
D’ailleurs, pour vous aider à comprendre, vous vous appuyez à la fois sur la littérature et le cinéma.
A. C. - En effet, j’ai eu envie d’écrire un thriller domestique habité par une intensité dramatique sur lequel 1984 planerait comme une ombre. Je me suis d’ailleurs amusée à réécrire une ou deux scènes et à cacher quelques citations. À cause de cette dénonciation, je me suis interrogée sur ce que cela disait de notre société sous surveillance. J’ai à nouveau regardé des films d’Hitchcock (notamment Psychose que je cite en exergue) et puis, en cours d’écriture, je me suis souvenue du mémoire de philosophie sur lequel j’avais travaillé et qui s’intitulait Le problème de la transparence dans la démocratie représentative et je me suis replongée dans Surveiller et Punir de Michel Foucault. J’ai été inspirée par son modèle du panoptique, cette grande tour de contrôle placée au milieu de la prison qui permet aux gardiens de surveiller les détenus sans jamais être vus d’eux. Comme je suis obsédée par l’intimité, je me suis demandée quelles conséquences aurait ce dispositif s’il était importé au cœur du foyer familial ? Et puis, il y a eu un dernier déclic à la lecture, dans Le Monde, d’un article qui racontait la façon dont l’État chinois envoyait au sein des familles Ouïgours des cadres missionnés pour s’assurer qu’il n’y avait aucune résistance à leur sinisation forcée, ces cadres allant jusqu’à dormir dans ces familles. Je me suis alors dit que mon intention était précisément celle-là : raconter l’histoire cauchemardesque d’une famille sous surveillance.
Quand un roman s’ouvre par une citation tirée du film Psychose ‒ « On est toujours pris à son propre piège. Et personne ne peut s’en sortir. Nous grattons, nous griffons, mais dans le vide. » ‒ la curiosité du lecteur est aussitôt piquée et il ne lui faut pas longtemps pour embarquer dans la spirale infernale décrite par Amélie Cordonnier. Cette dernière est mariée à Alexandre, ils vivent avec leurs deux enfants dans un immeuble parisien mal isolé. Et puis, un jour, Amélie reçoit une lettre du Service social de proximité qui lui intime l’ordre de se rendre avec sa famille à un rendez-vous pour évaluer leur situation. Pendant le confinement, une personne anonyme a appelé le 119. Une tension psychologique s’installe immédiatement.