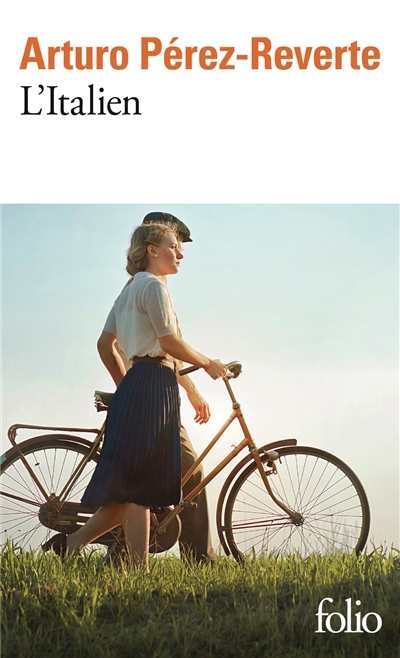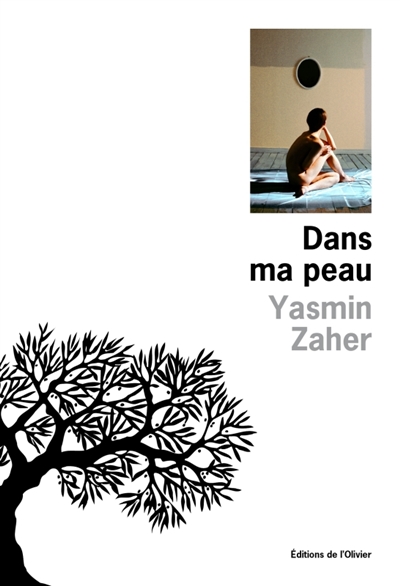Ce pourrait être une journée comme les autres pour Ilaria si elle n’avait trouvé un jeune Éthiopien devant sa porte. Il se dit à la recherche de son grand-père, Attilio Profeti, le père d’Ilaria. Est-ce un affabulateur ? Choquée, elle appelle son frère à l’aide, un jeune frère qu’elle n’a connu que tardivement, son père ayant pendant longtemps entretenu deux familles en même temps. Mais aujourd’hui, à quatre-vingt-quinze ans, il ne peut plus répondre aux questions sur son passé. C’est donc à elle de découvrir la vérité, en creusant dans la vie de son père, dans ses secrets, dans sa jeunesse, dans la période de la colonisation de l’Éthiopie à laquelle il avait participé en tant que chemise noire. L’histoire de cette famille, de trois générations inscrites dans la Grande Histoire, permet de soulever le voile sur une partie longtemps occultée du passé colonial italien : le racisme, la violence, les femmes vues comme objet de dégoût ou de désir, les massacres du fascisme, tout nous est révélé pour mieux comprendre notre actualité. Francesca Melandri nous convie à un voyage de découverte de l’Histoire et de la nature humaine, avec une habileté sans pareil.
PAGE — En italien, Sangue giusto, en français, Tous, sauf moi. Pourquoi cette différence ?
Francesca Melandri — Pour les éditions étrangères, nous avons constaté que le titre italien était intraduisible ! « Giusto » signifie « correct, meilleur » et il a des sens non couverts par un seul mot en français. Tous, sauf moi, dans sa version allemande Alle, außer mir, m’a été proposé par l’éditeur Wagenbach. C’est un titre qui réveille certaines associations chez ceux qui n’ont pas commencé le livre. Et qui en en provoque d’autres chez ceux qui l’ont terminé. Les titres devraient être comme ça : une porte pour entrer et une révélation ensuite.
P. — Vous employez souvent le verbe « sortir », en lieu et place de « émigrer ». Pourquoi ?
F. M. — C’est en écoutant les migrants que je l’ai entendu pour la première fois utilisé dans le sens « émigrer ». Cela veut dire « je suis émigré », mais c’est plus fort, plus radical. C’est la différence entre l’être chez lui, dans son pays, avec sa famille, et l’être dehors, dans le monde, sans protection.
P. — Tous, sauf moi raconte une histoire familiale dans la grande Histoire. Forme-t-il d’une trilogie de la mémoire avec Eva dort et Plus haut que la mer ?
F. M. — Les livres sont nés ensemble au printemps 2007. Bien sûr, les détails ont été construits au fur et à mesure, mais j’ai imaginé un triptyque de romans indépendants : la trilogie des pères. Je voulais raconter trois thématiques de l’Histoire italienne, à travers des histoires de pères recherchés, douloureux ou compliqués, comme dans le dernier livre. À mon avis, la grande Histoire et les plus petites histoires individuelles fonctionnent de la même façon : elles ont des structures identiques, mais à échelle différente.
P. — La littérature peut-elle être un instrument pour empêcher l’oubli ?
F. M. — La littérature a cette chose géniale en elle et elle fascine davantage que les essais. Les arts narratifs sont un moyen extraordinaire pour attirer l’attention des lecteurs sur des problématiques complexes, y compris l’Histoire contemporaine. Je me suis inscrite dans cette tradition.
P. — « Imagine que tu es en train de faire un rêve merveilleux alors que tu es perché sur les branches d’un arbre. Mais tu dois te réveiller toutes les minutes car il ne faut pas tomber et aussi parce que tu veux que ton rêve devienne réalité. C’est ça émigrer. » Cette métaphore est très efficace. Quelles sont les sources utilisées pour décrire cette réalité ?
F. M. — Cette métaphore n’est pas à moi. C’est le cadeau d’un garçon qui m’a raconté son voyage. Il me l’a dit comme ça, je n’ai rien changé. J’ai parlé avec beaucoup de personnes, je ne voulais pas être le narrateur occidental typique qui parle des histoires des autres comme des histoires d’objets. J’ai été vraiment très « pudique », j’ai demandé la permission de raconter les histoires et j’ai tenté de n’être que l’instrument de ceux que j’ai écoutés.
P. — L’Europe continue-t-elle à avoir des frontières ?
F. M. — Absolument et ce n’est pas seulement ma vision, mais l’avis de tous ceux qui étudient l’Europe du point de vue anthropologique. Je crois fortement au projet européen mais il reste encore beaucoup à faire. Pour l’instant, on a éliminé les frontières intérieures. Dans le même temps, on a consolidé la forteresse Europe et ses frontières extérieures.
P. — Combien de personnalités y a-t-il dans Attilio ?
F. M. — Je l’ignore ! Je remarque que chacun a son interprétation personnelle d’Attilio. Et je trouve ça enthousiasmant, parce qu’un personnage polyédrique comme celui-ci, dont chaque lecteur perçoit un aspect différent, est le rêve de chaque écrivain. Il y a autant de personnalités que de lecteurs !
P. — À la fin du roman, on assiste à un rebondissement. L’aviez-vous prévu dès le début de l’écriture ?
F. M. — Au cours de mes dernières années comme scénariste, j’étais head writer, je devais contrôler la cohérence dramaturgique d’une série de 24-26 épisodes. J’ai de l’expérience. J’ai travaillé à la structure du roman une année entière avant de commencer à écrire. Donc oui, je le savais déjà. Je ne veux rien révéler mais on peut dire que ce qu’on découvre à la fin du roman donne tout son sens au titre italien, et son sens à la narration entière.