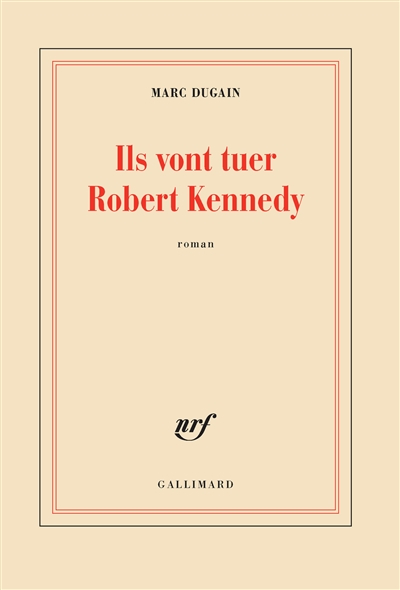Première sélection du Prix du Style 2017
PAGE — Ces derniers temps, vous vous êtes confronté aux défis du présent avec votre Trilogie de l’emprise (Folio), et votre essai L’Homme nu (Robert Laffont/Plon) sur la société face à la dictature du numérique. Qu’est-ce qui vous a fait repartir dans cette fameuse grande Histoire ?
Marc Dugain — D’abord parce que le monde politique français est tellement incroyable que je me suis senti battu ! (Rires.) Plus sérieusement, j’avais fait le tour de ce sujet. Ensuite, pour moi, le problème de la littérature, ce sont les obsessions. Les Kennedy en sont une pour moi parce que mon père était irlandais et que leur assassinat a été quelque chose de très violent. J’avais 6 ans pour celui de John et je me souviens encore du choc que cela a été. Après, quand j’ai fait mes études, je suis devenu spécialiste des Kennedy et ce travail d’investigation avait quelque chose d’obsessionnel puisque, évidemment, je suivais tous les progrès de l’enquête de Dallas et de celle de Los Angeles où Robert a été assassiné. Enfin, j’avais envie de revenir aux États-Unis qui ont beaucoup compté dans ma vie. Je ne sais jamais comment démarre un livre… Je voulais faire la lumière sur cet assassinat mais je n’allais pas refaire La Malédiction d’Edgar (Folio) qui était une sorte de biographie de Hoover. Je me suis dit que j’allais faire un vrai roman qui avalerait l’assassinat, racontant comment Robert décide de se présenter. Le pitch de cette histoire, comme on dit, serait : « Robert se présente, sachant qu’il va être assassiné, et il y va quand même », ce qui est d’une force exceptionnelle sur le plan romanesque. Et j’ai fait un truc que je n’avais jamais fait (parce que je ne parle jamais de moi dans mes livres) : j’ai inventé ce professeur d’histoire contemporaine à Vancouver qui est persuadé que la mort de ses deux parents a un lien avec l’assassinat de Robert. L’histoire de ses deux parents, c’est l’histoire de ma famille, notamment dans les services secrets. J’ai amalgamé tout cela de façon très naturelle.
Marc Dugain, Ils vont tuer Robert Kennedy (Gallimard) from PAGE des libraires on Vimeo.
P. — Effectivement, le roman ne s’ouvre pas comme on pourrait l’attendre sur Robert, il s’ouvre sur ce narrateur qui s’appelle O’Dugain.
M. D. — C’est mon vrai nom en fait. J’ai enlevé le O.
P. — Puis nous suivons Robert du jour où son frère se fait tuer à Dallas. Pouvez-vous nous rappeler qui il est à ce moment-là ?
M. D. — Les Kennedy sont une tribu, ils font tout en bande. Au moment où JFK est élu président, il décide de prendre son frère qui est très jeune – il a une trentaine d’années – comme procureur général des États-Unis, c’est-à-dire ministre de la Justice. Et c’est Robert qui, dans la vigueur de son jeune âge et son dévouement incroyable à son frère, va être responsable de tous les mauvais coups. En réalité, ceux qui ont tué JFK voulaient tuer Robert : sachant que JFK était parti pour être réélu en 1964, ils ont préféré tuer la tête plutôt que la queue – c’est ce qu’on entend dans les rapports d’écoute des principaux instigateurs de cet assassinat. Et donc, Robert est dans un sentiment de culpabilité absolument énorme. Désemparé, il décide malgré tout de ne rien dire car il ne veut pas discréditer sa famille aux nombreuses histoires (la baie des cochons, les tentatives d’assassinat de Castro…). De plus, Johnson remplace son frère et, pour lui, c’est un imposteur : il quitte rapidement le gouvernement. Il redevient sénateur mais il n’a plus la foi. Ensuite, on lui dit qu’il faut absolument qu’il se présente en 1968 et il ne veut pas. Il sait que ceux qui étaient au rendez-vous de Dallas seront là au rendez-vous de 1968 mais, à un moment, il bascule : il décide d’y aller quand même parce qu’il y a quelque chose de maniaco-dépressif chez lui qui fait que s’il n’est pas dans le mouvement, il dépérit : c’est cette dépression qui va l’entraîner vers la mort. Robert Kennedy est un personnage passionnant avec des idées très progressistes à un moment où l’Amérique est dans un virage, celui de 1968, du mouvement hippie, de la contre-culture et cette période me fascine. Il y a plein de choses que j’ai mises dans le roman dont je suis persuadé comme, par exemple, l’implication de Georges Bush père dans l’assassinat de JFK.
P. — Notre narrateur, lui, questionne le destin un peu particulier de son père, au métier lui aussi un peu particulier : thérapeute, celui-ci pratique l’hypnose, ce qui est un des grands thèmes du livre.
M. D. — En fait, c’est ce qui m’a donné l’idée au départ de créer ces deux branches parallèles dans le roman : en travaillant sur la mort de Robert, je me suis rendu compte, comme d’autres, que Shiram Shiram, le prétendu assassin, était sous hypnose et je sais qui l’a hypnotisé (maintenant on commence à le savoir).
P. — Beaucoup de scènes saisissent, comme celle où Jackie, qui revient avec le corps de John, ouvre son manteau : elle porte encore cette robe tachée de sang. On lui propose de se changer et elle répond : « non, il faut que les gens voient ce qu’ils ont fait à mon mari ».
M. D. — Oui, et il y a ensuite cette histoire chez les Kennedy : ils se succèdent toujours chez les femmes ; ça c’est un truc de tribu irlandaise dont je n’ai pas hérité ! (Rires). Jackie va ainsi avoir une relation très forte avec Robert et après, elle en aura avec Edouard, le dernier qui est resté simplement sénateur. Il y a quelque chose d’incroyable et de pathétique chez les Kennedy par rapport aux femmes, ce qui est un autre aspect du récit.