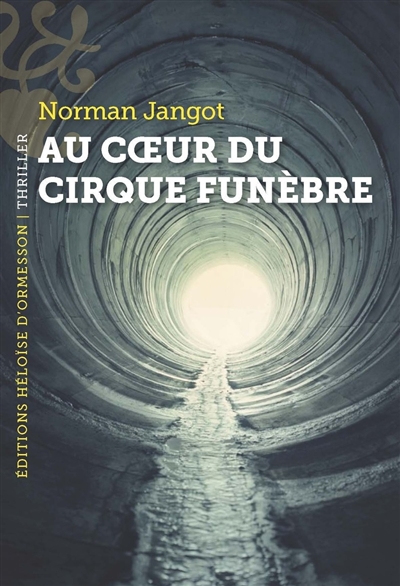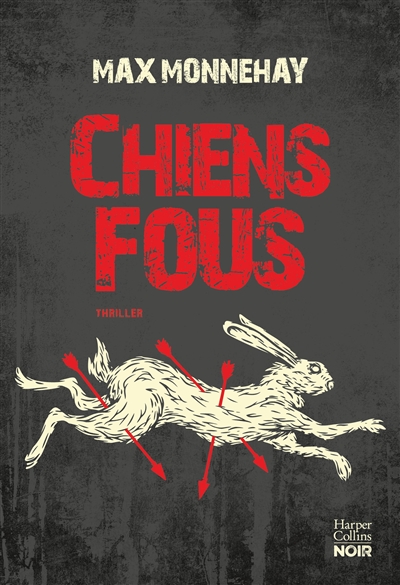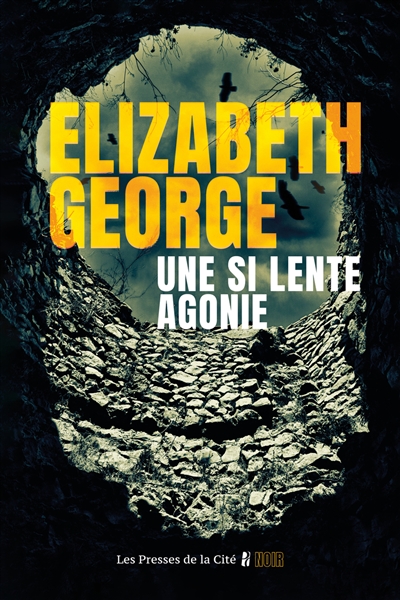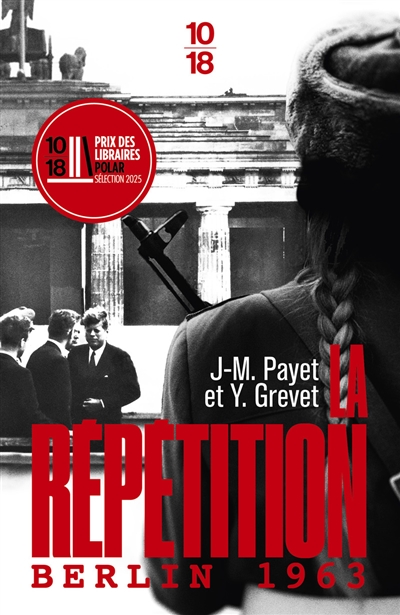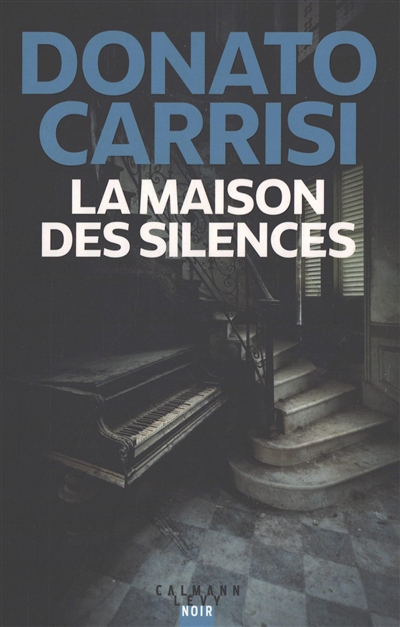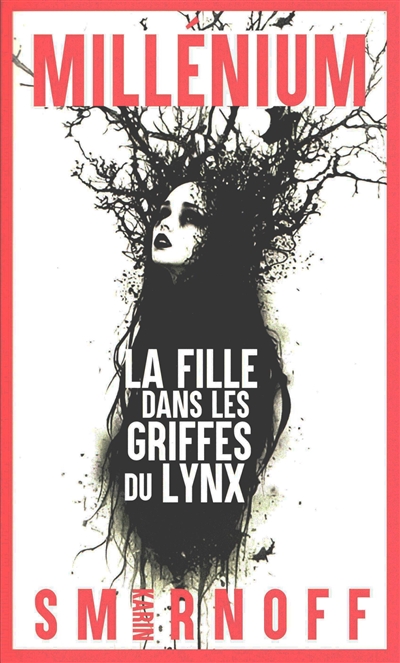Un canevas de départ des plus simples : une femme, Jane, la veuve du titre dont le mari est mort écrasé accidentellement par un autobus, répond aux questions d’une journaliste qui a réussi à s’introduire dans sa maison. Et le récit d’alterner alors les points de vue de l’une et de l’autre. Les deux femmes sonnent justes, chacune dans son histoire, chacune avec sa perception de ce qui ressemble très vite à une énigme. Que se cache-t-il donc derrière cet apparent fait divers qui semble déchaîner beaucoup de passions ? Et aux ombres de s’épaissir un peu plus encore lorsque le roman remonte quelques années en arrière pour nous amener au jour où la petite Bella disparut du jardin de sa mère. Une histoire à la structure impeccable qui joue sur deux époques, des personnages touchants et troubles à la fois, un dosage rare et redoutable d’efficacité et d’humanité à la tonalité toute anglaise, une absence bienvenue de ficelles et de rebondissements faisandés font de La Veuve un indispensable de ce début 2017.
PAGE — Vous avez longtemps travaillé comme journaliste. Comment en êtes-vous venue à écrire un roman ?
Fiona Barton — L’idée du livre était en germe depuis longtemps – il s’agissait davantage d’un sujet de fascination que d’un synopsis – mais journaliste à plein temps et mère, je n’avais pas le temps (ou la tête) pour la développer. C’est uniquement lorsque j’ai arrêté d’être reporter, en 2008, que j’ai trouvé le temps puis la voix de Jane. Cela paraît étrange mais des phrases qu’elle prononce dans le livre résonnaient en moi, en même temps que ses pensées, son désarroi, son incrédulité. Elle était présente à mes côtés et j’ai arrêté d’y penser pour me mettre à l’écrire sur un vieil ordinateur portable dans un appartement à Colombo (mon mari et moi étions dans l’aide humanitaire au Sri Lanka). J’en frissonnais malgré les 30°C ! Jane disait les mots que j’avais écrits dans ma tête mais c’était comme si je les entendais pour la première fois.
P. — Qu’avez-vous retiré de vos années de journalisme ?
F. B. — Tout ! On me dit que j’écris du « Domestic Noir », c’est-à-dire des romans où des choses terribles arrivent à des gens ordinaires. Mais je peux dire que toute ma carrière a été un apprentissage pour ce genre. Comme journaliste, j’ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux. Dans les grandes affaires, je me retrouvais à regarder les épouses d’hommes accusés de crimes affreux et je me demandais ce qu’elles savaient vraiment. Ou ce qu’elles se permettaient de savoir. Comment réagit-on face à l’idée que son mari, l’homme avec lequel vous avez choisi de vivre le restant de vos jours, est peut-être un monstre ? La Veuve a grandi dans cette fascination et m’a emmenée dans un voyage inattendu.
P. — Vous a-t-il été difficile d’oublier les règles d’écriture auxquelles vous étiez soumise en tant que journaliste ?
F. B. — Ce fut une grande épreuve ! Avant La Veuve, je n’avais rien écrit qui dépasse les 3000 signes et dans ce cadre, je pouvais rarement écrire avec ce que je peux appeler mon style : il fallait que je sois brève, objective et je devais mettre les faits en évidence au premier paragraphe. J’ai dû tout oublier. Mais j’en ai conservé le goût pour les phrases courtes et la capacité d’écrire vite. J’écris dans ma tête avant de mettre les doigts sur le clavier et j’arrange plus tard. Cela donne parfois une impression de danger, comme de marcher sur une mince corde mais l’adrénaline est un excellent carburant.
P. — Comment avez-vous construit cette histoire, sa redoutable architecture avec ses deux époques, ses différents points de vue ?
F. B. — Ha ! Je ne me simplifie pas la tâche ! Je voulais raconter l’histoire directement au lecteur, comme je le faisais en tant que journaliste, et je voulais n’utiliser qu’une narratrice, Jane. Toutefois, il est devenu rapidement évident que j’allais avoir besoin d’autres voix pour montrer ce qui se passait à l’extérieur de son monde claustrophobe. Alors j’ai créé d’autres personnages : le reporter, le policier, la mère de l’enfant kidnappé et j’en ai fait des narrateurs aussi. C’était compliqué mais j’espère que cela ajoute de la tension dans ce jeu de « qui dit la vérité ? ».
P. — Les personnages principaux provoquent beaucoup d’empathie sans que le récit ne leur enlève de leur complexité.
F. B. — Peut-être parce qu’ils s’écrivent eux-mêmes. J’avais la voix de Jane dans la tête depuis le départ. J’avais l’impression que je regardais au-dessus de son épaule l’histoire se déroulant. Mais pour les autres, mon plus grand challenge a été Glen, l’homme accusé d’avoir enlevé Bella. Je le voyais uniquement à travers les yeux de Jane. Puis en écrivant, j’ai aperçu les démons qui conduisaient son ambition : en premier lieu, un besoin désespéré de faire ses preuves face à un père intimidant et son sens du droit. Si ses aspirations s’étaient concrétisées, tout aurait été pour le mieux, mais j’ai vu en lui le modèle de noire colère et de violente déception que j’avais rencontré avec le recul chez certains accusés. Je ne savais pas vraiment où cela aller le mener mais cela a commencé à dessiner un chemin bien plus sombre.
P. — Considérez-vous La Veuve comme un roman anglais ?
F. B. — Les Américains le pensent ! La langue est vraiment très anglaise, avec beaucoup d’argot et d’expressions journalistiques qui ont posé des problèmes aux traducteurs. Mais les thèmes sont universels.