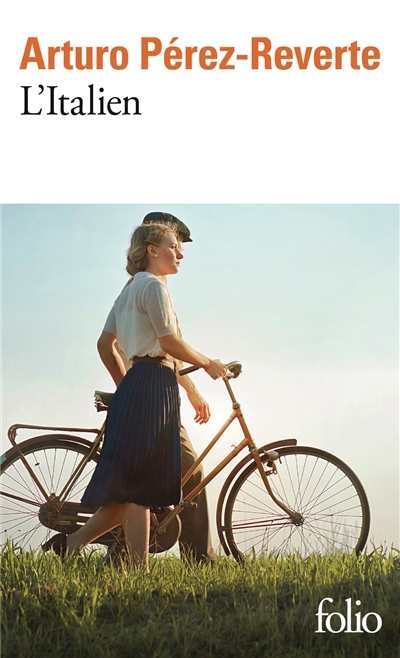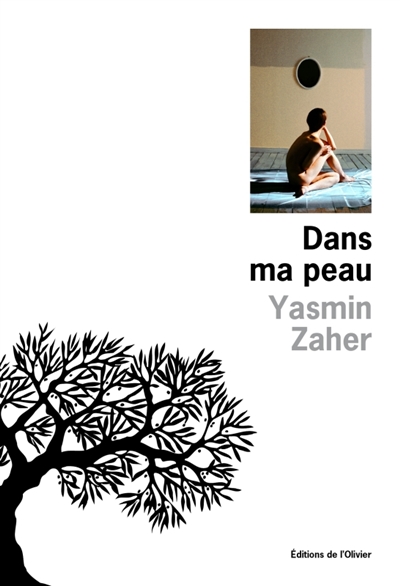« Connaître un livre par cœur est comme porter une maison à l’intérieur de sa poitrine », lit-on dans le fascinant La Terre qui les sépare. J’ajoute que s’immerger dans le livre d’Hisham Matar, c’est comme sentir une main amie sur ses épaules pour découvrir une terre mythique et fantasmée, la Libye, et interroger ce qui fait notre humanité. Car ce livre n’est pas seulement le récit d’un retour au pays natal, trente ans après la fuite de la famille, ni les éclats recomposés de l’histoire libyenne. (En)quête d’un fils pour découvrir ce qui est arrivé à son père, c’est aussi une variation sensible et universelle sur l’amour, la perte et l’exil. Une magnifique célébration de la vie et de la force créative de l’art dans un monde renversé. Alliant précision journalistique, prose riche et clins d’œil littéraires, La Terre qui les sépare est une œuvre totale et puissante. Un futur classique.
Page — Hisham Matar, dans vos deux précédents romans, il était question de pères disparus. La Terre qui les sépare est le récit plus personnel d’une quête pour découvrir ce qui est arrivé à votre propre père sous le régime de Kadhafi, une élégie puissante et incantatoire pour le faire revivre. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Hisham Matar — Ce qui m’a toujours fasciné, c’est combien peu on choisit. Le livre implique son auteur. Chacun de mes livres a été écrit à partir d’une série de préoccupations particulières ; en d’autres termes, ils n’étaient pas prémédités. Et ils ont engagé une conversation entre eux. Avec ce livre, je reviens, sur un mode différent, à certains des thèmes qui m’ont préoccupé : le poids de l’Histoire sur nos vies, la façon dont nous devrions répondre à ce qui se passe, ce que c’est que d’appartenir à quelque chose ou à quelqu’un, la distance mystérieuse qui existe entre ce que nous pensons et la façon dont nous agissons, la relation entre l’art et la vie… Cette fois, je le fais de façon personnelle.
P. — En partant sur les traces de votre père, vous recomposez aussi l’histoire moderne de votre pays, de la période coloniale italienne à la révolution de 2011, en passant par la dictature.
H. M. — Mon père et moi sommes des hommes différents. Je ne peux pas prétendre, si je parle avec un tant soit peu d’exactitude, avoir marché dans ses pas. À la place, justement, je me suis intéressé à ses pas et aux miens. Mais vous avez raison, au sens où nous sommes l’un et l’autre, de façon différente, préoccupés par la Libye. Lui comme activiste, moi comme artiste, et comme quelqu’un qui a reçu une couleur supplémentaire d’un autre pays. Après tout, il faut vous rappeler que je vis et écris en anglais. Une langue, c’est un mode de pensée, une philosophie, une sensibilité, et beaucoup d’autres choses encore. Le romancier égyptien, Naguib Mahfouz, un homme aussi talentueux qu’aimable, m’a dit un jour qu’en écrivant en anglais, j’écrivais « dans cette rivière ». Et il avait raison. Une langue est une rivière avec son écosystème. Du coup, l’endroit depuis lequel je me retourne pour regarder est un endroit complexe. De l’endroit où je suis, le pronom « nous » ne se réfère pas à une seule culture.
P. — « Encore aujourd’hui, être Libyen, c’est vivre avec des questions », écrivez-vous. Pouvez-vous expliciter votre pensée ?
H. M. — Oui, il m’a toujours semblé qu’il en était ainsi et ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, la Libye est à la fois ancienne et jeune. Elle a une histoire qui est infiniment longue, puisqu’elle s’étend sur des siècles, depuis les Phéniciens jusqu’à Platon, du royaume des Garamantes à Septime Sévère, de Tariq ibn Ziyad, qui entre en Espagne, jusqu’à l’expulsion des Maures huit siècles plus tard. Pourtant, comme nation, la Libye n’a guère que sept décennies et, comme on peut le voir aujourd’hui, c’est un oisillon très agité. Ajoutez à cela quatre décennies d’une dictature qui avait un génie particulier pour mettre de la peur dans les moments les plus calmes : tant de choses sont restées inexprimées et inexprimables. Bien sûr, la Libye n’est pas seule dans ce cas. Toutes les sociétés inventent leurs propres façons de faire durer leurs silences.
P. — Mais votre histoire n’est pas uniquement celle de votre famille et de la Libye. C’est aussi une méditation universelle sur la perte et sur toutes les terres qui séparent les pères de leurs fils. Sur l’histoire et la violence qui se répètent inlassablement.
H. M. — Cela vous étonnera peut-être mais, comme écrivain, je ne m’intéresse pas particulièrement à la Libye ou à ma famille, ou même à moi. Je suis au contraire beaucoup plus fasciné par la façon dont ces expériences peuvent me guider vers de plus grandes idées. Car – c’est évident pour moi – ce que nous avons en commun est bien plus important et intéressant que ce qui nous sépare.
P. — À la lecture du livre, on est sidéré par la douceur émouvante de ce magnifique chant funèbre et d’amour. Par son absence d’amertume. Les références littéraires et philosophiques donnent une intensité mesurée à votre récit. En quoi l’art, et la littérature en particulier, peuvent-il être un moyen d’affronter les épreuves de l’existence ?
H. M. — Notre époque nous a conduits, comme des somnambules, à la conclusion que ce que nous devons faire, c’est nous guérir du deuil, de la frustration, de l’ennui ou de tout autre émotion que nous ressentons. Or, c’est négliger ce qui pourrait être intéressant, voire même créatif dans ces états. Et c’est cette curiosité active qui m’intéresse. Bien sûr je peux être en colère. Mais l’art, pour moi, est un moment d’attention concentrée. Plus cette attention est appliquée de façon patiente et créative, plus elle pourra produire de propositions. C’est pourquoi l’art est, par nature plutôt que par intention, le contraire de la tyrannie.