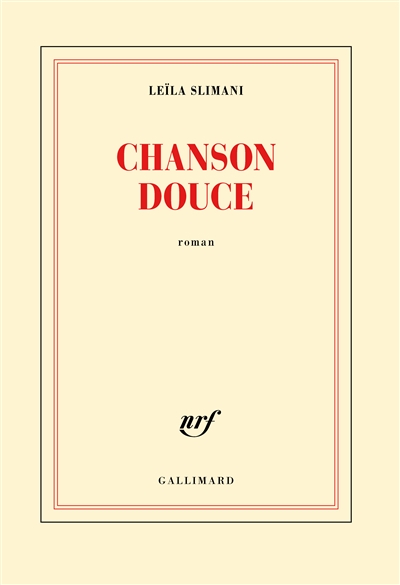Page — Obtenir le prix Goncourt, après avoir publié deux romans, cela représente une véritable consécration. Comment vous sentez-vous ?
Leïla Slimani — Je me sens heureuse, comblée. C’est un prix qui a un poids et une aura incroyables, en France et dans le monde. J’ai été distinguée par mes pairs (et quels pairs !) et c’est une grande fierté. Je me sens portée, aussi, par la grande affection que me manifeste le public, par la fierté des lecteurs marocains également.
P. — Chanson douce est une fable tragique, celle d'une nounou tueuse d'enfants. Comment une telle idée a-t-elle germé ?
L. S. — J’avais depuis longtemps envie d’écrire autour du personnage d’une nounou. Je trouvais très romanesque la relation qui se noue entre une mère et la femme qui garde les enfants. Et puis la découverte d’un fait divers, survenu en 2012 à New York, m'a aidée à trouver une trame romanesque.
P. — « Adam est mort. Mila va succomber. » Pourquoi commencer par la fin ?
L. S. — Je ne voulais surtout pas construire mon livre autour du suspens de la mort des enfants. En commençant ainsi, je pouvais d’une certaine façon « évacuer » cette question et déplacer le curseur du suspens. Finalement, le mystère tourne plutôt autour de : comment en est-on arrivé là ? Pourquoi Louise a-t-elle connu cette dérive ? En commençant ainsi, je voulais aussi attirer l’attention du lecteur, l’obliger d’une certaine façon à être actif, à devenir un enquêteur. Ainsi, il va être attentif au moindre détail, être affolé pendant toute la lecture du livre.
P. — La nounou occupe une place singulière dans le foyer. Elle incarne le double de la mère. Comment confier ce qui nous est le plus précieux à une parfaite inconnue ? Paradoxe, inconscience ?
L. S. — Il y a effectivement quelque chose de vertigineux, d’affolant dans le fait de confier ce que l’on a de plus précieux à une parfaite étrangère. Surtout à notre époque, où les enfants occupent une place centrale, qu’ils n’avaient jamais occupée auparavant dans l’Histoire. En même temps, n’oublions pas que les femmes ont toujours confié leurs enfants. Les bourgeoises pour s’adonner à des activités culturelles ou sociales, et les femmes prolétaires pour pouvoir travailler. « Le pire », comme vous dites, reste heureusement très rare et ce partage des tâches, en quelque sorte, est quand même très bien installé dans nos sociétés.
P. — Myriam et Louise incarnent toutes les deux la maternité. Quel regard portez-vous sur ces deux femmes en quête du même désir d'approbation, mais surtout d'amour ?
L. S. — En tant que romancière, qui a vécu avec ses personnages, je ressens pour elles beaucoup d’empathie. Pour Myriam qui veut tellement bien faire, tout en étant tiraillée entre plusieurs désirs. Et pour Louise qui vit dans une telle solitude et se montre incapable d’appeler à l’aide.
P. — Vos romans interrogent la place de la femme dans notre société contemporaine. Vous sentez-vous féministe ?
L. S. — Je suis évidemment féministe ! Comment peut-on ne pas l’être quand on regarde la situation des femmes dans le monde aujourd’hui ? C’est un engagement citoyen, ce sont des convictions très ancrées en moi. Mais pour le coup, cela n’a rien à voir avec mon travail de romancière qui est d’abord un travail sur l’imagination et l’émotion. Je n’écris pas pour délivrer des messages ou militer.
P. — Chanson douce insiste sur les inégalités sociales entre cette famille plutôt aisée – parfois peu consciente de son mépris à l'égard de son employée – et cette femme, Louise donc, qui vit dans une misère sociale et affective. Diriez-vous que c'est aussi un roman sur la lutte des classes ?
L. S. — Oui, mais là encore, le but n’est pas de juger les uns ou les autres, mais plutôt d’observer la façon dont se vit la mixité sociale aujourd’hui, la façon dont des « bobos » assument ou non les rapports hiérarchiques, et plus spécifiquement les rapports de domesticité. Ils ont tendance à occulter ces inégalités et ils se sentent coupables au point d’adopter des attitudes extrêmement maladroites, voire condescendantes.
P. — Le Goncourt, et après ?
L. S. — Je vais continuer à écrire. Des romans, des essais, etc. Écrire, c’est tout ce qui m’importe.