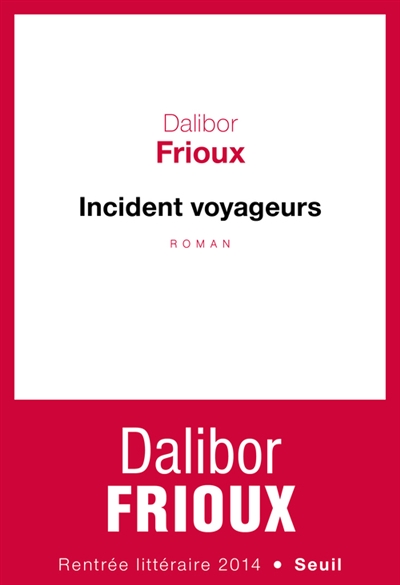Si le premier roman de Dalibor Frioux avait marqué les esprits, le deuxième risque fort de produire les mêmes effets. Fort et poignant, angoissant et oppressant, Incident voyageurs nous entraîne dans un univers clos et anxiogène. Une plongée dont le lecteur ne sortira pas indemne. L’auteur n’aime rien mieux que nous confronter à nos peurs et déranger notre confort. Il le prouve une nouvelle fois.
Dalibor Frioux nous entraîne au cœur d’un wagon d’une ligne de RER coincé dans un tunnel. Incident voyageurs raconte les deux premières années de cet enfermement dont on ne connaîtra pas la durée. Rapidement, les montres s’arrêtent, les batteries des portables sont déchargées et les passagers se retrouvent enfermés dans ce lieu confiné. Afin de garder un lien avec l’extérieur, les protagonistes imaginent des lettres qu’ils pourraient écrire à leurs proches ou à de simples connaissances. N’ayant aucun instrument pour écrire, ni stylo, ni papier, ces lettres sont rêvées. A l’aide de ces mots qui s’envolent, ils livrent leurs angoisses, leurs interrogations. Une introspection qui n’a en réalité aucun destinataire si ce n’est eux-mêmes. À la lecture du roman, le lecteur pense immédiatement qu’il a dû y avoir une catastrophe à la surface, comme le pense d’ailleurs la mère du petit garçon. Mais il ne connaît pas les raisons de cet arrêt brutal. Il est bloqué avec les passagers, à la fois dans leur tête et dans le wagon avec eux. Même le lecteur ne peut pas prendre de recul. Un très beau roman qui nous fait réfléchir sur notre société.
Page — Vous décrivez des voyageurs coincés dans un wagon de RER tombé en panne dans un tunnel. Mais pourquoi vos personnages ne tentent pas, plutôt que de céder à la résignation, d’échapper à cette prison…
Dalibor Frioux — Il me semble que la résignation est l’attitude la plus raisonnable à adopter dès lors qu’on est forcé de monter à bord d’un RER. Après des années de pratique, je crois vraiment qu’il est difficile de ne pas se sentir résigné quand on emprunte ce type de transport. Passées les premières heures d’un emprisonnement qui va durer une éternité, une nouvelle vie s’organise. Les personnages ne se résignent pas immédiatement. Ils font comme tout le monde, ils déclenchent les systèmes d’alarme et essayent d’ouvrir les portes. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre cette tragique situation. En vain.
Page — Ils n’ont plus de repères, les montres se sont arrêtées et la seule manière de mesurer le temps, c’est de regarder grandir le petit garçon prisonnier du wagon.
D. F. — Il y a trois personnages, un cadre qui travaille au Louvre, un chômeur et la mère de cet enfant qui sert, en effet, à marquer le temps. Il ne reste plus que la montre du cadre, que chacun remonte à tour de rôle, mais qui est devenue, à force d’être obsessionnellement tripotée, une espèce de galet baveux couvert de mousse. Ils sont là sans que l’on sache très bien pourquoi. Le livre est une métaphore du quart d’heure d’angoisse et de panique quand on est coincé dans les transports en commun : toutes les terreurs, tous les fantasmes défilent… J’ai étendu ce quart d’heure à l’infini afin de voir ce qui se passerait si cette situation devenait éternité.
Page — Vos personnages se seraient-ils livrés à une telle introspection dans d’autres circonstances ?
D. F. — Bien sûr que non ! Être prisonnier d’un RER en panne invite très fortement à l’introspection. Le cadre du Louvre, qui adore la représentation de la figure humaine, se met à détester le visage humain. La mère de famille pense qu’une catastrophe a eu lieu à la surface, qu’ils sont les seuls survivants et que son fils est né pour sauver l’humanité, qu’il est un messie dont la mission consistera à repeupler le monde. Pendant ce temps, le petit garçon s’emploie patiemment à défoncer l’acier du wagon avec son pauvre crâne. Kevin, le chômeur, est persuadé d’être en plein stage de réinsertion organisé par Pôle Emploi. Il est convaincu que des fonctionnaires suivent attentivement le moindre de ses faits et gestes par le biais de caméras. Chaque soir, il présente des rapports. Il est persuadé que s’il se comporte en bon manager de crise, il réussira à sortir. Bien sûr, le stage est un peu long, il aimerait que le stage se termine et pouvoir mettre en pratique ses acquis dans la vie réelle.
Page — On vous sent très sarcastique à l’égard de Pôle Emploi…
D. F. — Le roman part d’une situation extrême et délirante explorant nos peurs d’enfermement. Il s’agit aussi d’une réflexion sur la surpopulation. À quoi ressemblera l’humanité quand nos villes seront aussi densément peuplées que certaines mégalopoles indiennes ou chinoises ? À quoi s’emploiera-t-on les uns les autres ? Ce chômeur a été utilisé dans une multitude de petits boulots, que l’on n’appelle même plus « travail », ni même « emploi », mais « activité ». Je décris une société où, en dehors d’une élite constituée de 20 % de la population largement suffisante à gérer l’ensemble, plus personne n’est vraiment utile. Que faire de ces 80 % restants ? Kevin trouve là l’occasion de se requalifier humainement, d’abord en faisant la manche dans le RER, poste dont il est persuadé qu’il lui a été confié par les agents de Pôle Emploi. Au-delà de sa folie, l’activité qu’il déploie est une manière d’interrogation sur ce pour quoi il est fait, ce pour quoi il existe… Notre raison d’être, nous ne la trouvons plus en nous-mêmes, elle nous est donnée par d’autres, à qui l’on demande de nous employer. Nous ne sommes pas l’homme de la nature de Rousseau, mais l’homme de l’homme. À quel type de société humaine pareil fonctionnement peut-il aboutir, si ce n’est l’esclavage. Ou la mise en boîte, comme dans ce RER.
Page — En tant que philosophe, vous abordez le problème de la réalité du corps. Qu’est-ce que des corps entassés, privés d’intimité ? L’un des personnages comprend que la seule manière de s’isoler est de faire écran avec ses cheveux, de s’en servir comme d’un rideau.
D. F. — Au bout de quelques mois, les cheveux poussent à la faveur de l’humidité ambiante. Alors ils ferment effectivement les maisons ultimes de ces naufragés. Un savoir-vivre inédit s’instaure, de nouvelles formes de civilité se font jour. Pour ne pas faire irruption dans le visage de quelqu’un n’importe quand, n’importe comment, on lui demande si l’on peut écarter un peu ses cheveux afin de le voir et de lui parler. Il s’agit là de l’un des miracles de la vie, de l’adaptation.
Page — Ils découvrent aussi que la salivation leur permet de s’alimenter…
D. F. — À l’intérieur du RER se crée un bouillon de culture. Ils salivent donc continuellement. Leur salive se métamorphose en une espèce d’humus dont ils se nourrissent. Seulement, pour saliver, il faut parler sans cesse…
Page — Vous avez appelé le train EMOI…
D. F. — Les trains de banlieue portent tous un nom. Le jour où j’ai vu apparaître EMOI, je me suis dit : ça alors ! on a baptisé ce train bourré à craquer EMOI ! « Et moi ! Et moi ! Et moi », c’est Jacques Dutronc, mais EMOI, c’est la magie du RER.