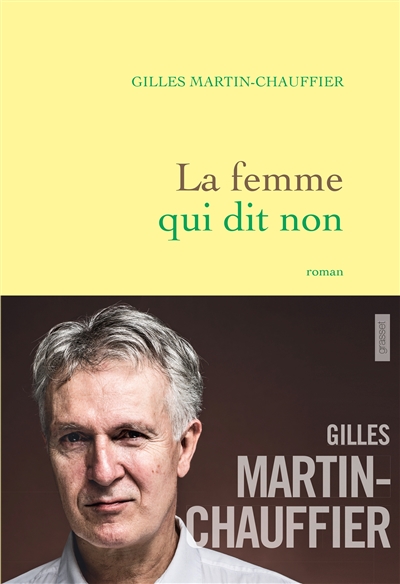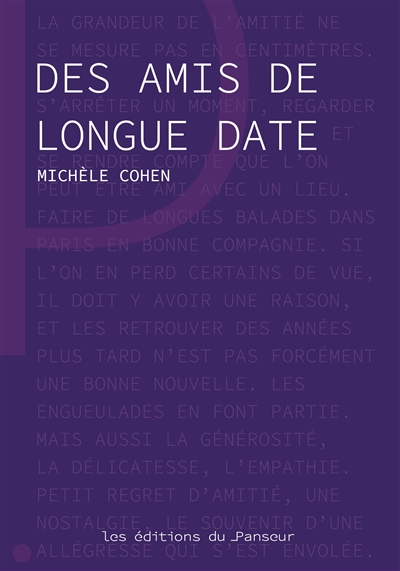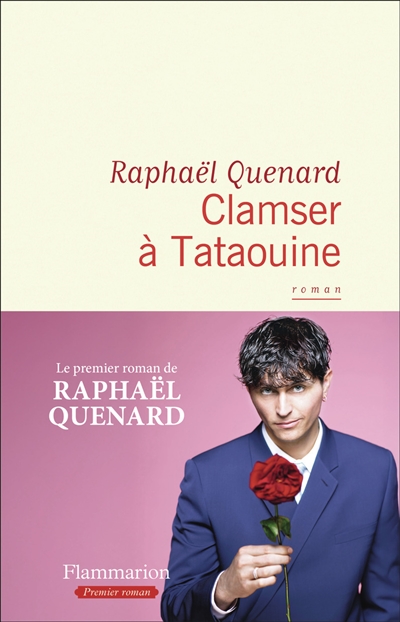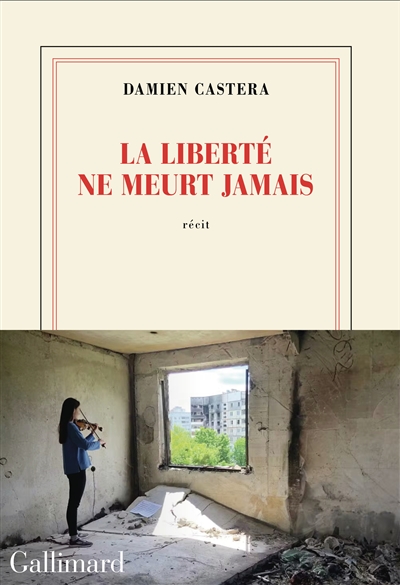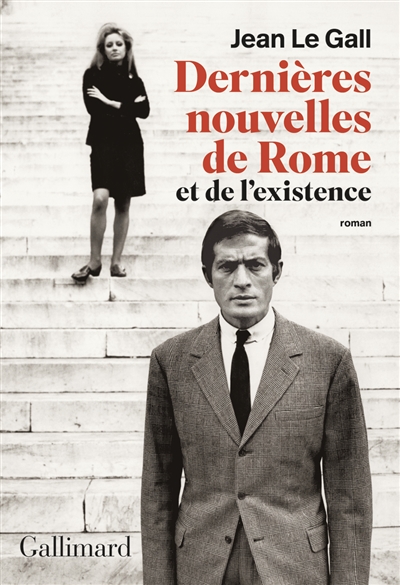Septembre 1938. À Munich, le destin de l’Europe s’apprête à sombrer dans le chaos. Mais sur l’Île-aux-Moines, la jeune Anglaise Marge a croisé les regards de Blaise et de Mathias. Le reste du monde importe peu aux jeunes gens dont la vie insouciante va brusquement basculer en 1940. Les deux hommes s’engagent, mais chacun dans un camp différent. Restée seule dans la demeure familiale, Marge décide de dire non. Non à la passivité, au conformisme, au manque d’amour. Vivre avec passion et assumer ses actes, tel devient sa devise. De la débâcle à la guerre d’Algérie, Gilles Martin-Chauffier lie avec beaucoup de réussite la petite et la grande Histoire. Ce roman aux multiples rebondissements retrace trente ans de notre Histoire, où les engagements politiques de chacun vont bousculer bien des certitudes et auront des conséquences parfois très inattendues. Un vrai bon roman avec des personnages très incarnés et surprenants.
Page — Qui est cette « femme qui dit non », dont on comprend vite que sa vie ne fut pas ordinaire ?
Gilles Martin-Chauffier — Marge arrive de sa Grande-Bretagne natale quand elle pose pour la première fois le pied sur l’Île-aux-Moines, alors qu’elle fait du bateau avec son père. Nous sommes le 30 septembre 1938, jour de la signature des Accords de Munich, et le père de Marge veut absolument descendre à terre, trouver une radio et savoir ce qui s’est décidé à Munich. Au cours de leur quête, ils rencontrent deux jeunes Bretons, Blaise, qu’elle épousera, et son meilleur ami Mathias. En juin 1940, Blaise décide de rejoindre le général de Gaulle, à Londres, en voguant sur son propre voilier. Mathias empruntera des voies très différentes de celles de son ami. Parti se battre contre les Allemands, il est fait prisonnier, puis libéré, comme beaucoup d’autres Bretons, dès juillet 1940. Convaincu que l’Allemagne aidera la Bretagne à devenir indépendante, il décide de collaborer. Marge est follement amoureuse des deux hommes. Quand elle tombe enceinte, tout le monde ignore qui est le véritable père de l’enfant qu’elle porte. Pendant trente ans, le secret restera bien gardé, puis la vérité éclatera – c’est le cœur du livre.
Page — Pour ce personnage haut en couleurs qu’est Marge, vous dites vous être inspiré de votre grand-mère.
G. M.-C. — Ma grand-mère était une femme très libre, comme mon héroïne, mais elle n’a pas eu le même parcours amoureux. Comme Marge, elle était une joueuse invétérée, au point d’avoir ruiné la famille. Ma grand-mère a été une résistante de la première heure, à l’instar de Marge. Elle est l’un des membres fondateurs du Réseau du musée de l’Homme et le premier stencil de la Résistance a été imprimé dans son salon, avenue Georges Mandel (Henri-Martin à l’époque). À travers le personnage de Marge, je voulais évoquer les traces laissées par l’aventure de la Résistance chez ceux qui y ont participé. Voilà pour la dimension politique du livre.
Page — Un autre aspect de votre roman concerne l’Île-aux-Moines dont vous faites de magnifiques descriptions.
G. M.-C. — Balzac a décrit la Touraine, Chateaubriand les Côtes-d’Armor, mais personne n’a encore jamais dépeint les paysages de l’Île-aux-Moines. En outre, j’avais envie de parler de ce sentiment qui habite ceux qui vivent sur une île. Où qu’elle se situe sur la planète, ils ont l’impression que c’est le centre du monde. Cela procure une force incroyable. Mon personnage est une aventurière, mais une aventurière de l’Île-aux-Moines – c’est un point essentiel de sa psychologie profonde, elle puise sa force dans cette conscience d’être attachée à une île. La Résistance s’est d’abord développée en Bretagne. Afin de mener le plus efficacement possible leur offensive contre l’Angleterre, les Allemands installent des bases le long du littoral breton. Depuis l’aéroport de Vannes décollait chaque soir une escadrille de la Luftwaffe, qui larguait des bombes fumigènes afin d’éclairer les cibles sur lesquelles les bombardiers déverseraient quelques instants plus tard leurs engins de mort. Cela rendait fous les Anglais. Alors, l’une des premières actions de la Résistance a consisté à empêcher ces vols de reconnaissance de continuer à nuire. Marge fera partie de cette équipée.
Page — C’est une femme déterminée et entreprenante, mais elle utilise parfois des moyens à la moralité douteuse...
G. M.-C. — Après la guerre, elle crée un journal qui la rendra riche. Pour écrire ce passage, je me suis inspiré de la rumeur qui court au sujet des origines de la fortune de Robert Hersant. En 1945, Robert Hersant, qui avait été proche des collaborateurs, a eu l’idée d’écrire un dictionnaire de la collaboration. Il a donc rendu visite à ses anciens amis en leur présentant son projet comme une espèce d’entreprise de réhabilitation, déterminée à démontrer que le maréchal avait sauvé la France, permettant au boulanger de continuer à confectionner son pain, aux entrepreneurs de nourrir leurs ouvriers… Les types qu’il sollicitait refusaient avec la dernière énergie de voir leur nom associé à ce dictionnaire. En revanche, ils se montraient prêts à financer l’autre projet de Robert Hersant, un journal consacré à l’automobile. En lui donnant de l’argent, ils achetaient en quelque sorte son silence. À son échelon, c’est un peu ce que réalise mon héroïne.
Page — J’espère que l’on n’associera pas totalement votre grand-mère au personnage de Marge...
G. M.-C. — Je vous assure que ça ne me gênerait pas ! Elle n’a pas fait fortune, mais elle possède tous les autres traits de la personnalité de Marge. Elle a eu beaucoup d’argent, l’a perdu, elle était drôle et libre… Dans le livre, trois personnages très proches de Marge sont envoyés en déportation. Les tourments par lesquels passe Marge sont les mêmes que ceux subis par ma grand-mère. Elle était certaine qu’elle ne reverrait ni son mari, ni son fils, et se demandait chaque jour avec terreur la mort duquel on viendrait lui annoncer. Finalement, l’un et l’autre sont revenus. Quand il a été arrêté, mon grand-père était un homme de 50 ans, il a pu tenir le coup psychologiquement, même s’il est rentré très affaibli. Les choses ont été plus compliquées pour mon père, gamin de 20 ans élevé dans une famille d’intellectuels, filleul d’André Gide, choyé, gâté, riche… Déporté à Buchenwald, il en est revenu à jamais traumatisé. Je relate une scène dans le livre, que je place en 1946, mais qui m’est arrivée en 1962 ou 1963, lorsque j’étais enfant. Mon père conduisait. Devant lui, une voiture a klaxonné, mais c’est mon père qu’un flic a arrêté. Mon père lui a assuré qu’il n’avait pas klaxonné, le flic n’a rien voulu savoir et lui a demandé ses papiers. Alors, j’ai vu la fureur s’emparer de mon père. Il est sorti de la voiture, a empoigné le flic et a hurlé : « Espèce de sale con ! Ce sont des salauds comme toi qui m’ont envoyé en Allemagne ! » J’étais stupéfait. En y repensant aujourd’hui encore, j’en tremble.
Page — Vos propos sur la Résistance sont parfois iconoclastes. Ne craignez-vous pas certaines réactions ?
G. M.-C. — Charles Péguy, qui dirigeait Les Cahiers de la Quinzaine, disait qu’un journal qui n’exaspère pas 20 ou 25 % de ses lecteurs ne mérite pas d’être imprimé. Ce que j’ai cherché à raconter à travers mes personnages, à travers l’Île-aux-Moines et le Morbihan, c’est cette partie de l’Histoire de France.