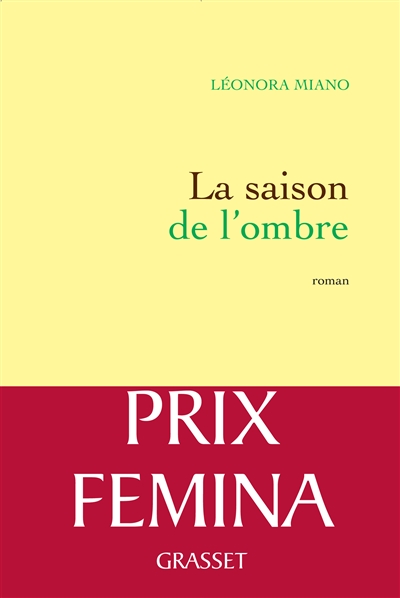Le peuple Mulongo vivait en paix jusqu’à ce qu’un grand incendie ravage son village. Depuis ce jour, dix jeunes initiés et les deux sages qui les accompagnaient « n’ont pas été retrouvés ». Face au mystère de cette disparition et pour circonscrire leur douleur, les mères des jeunes gens ont été regroupées dans une case à l’extérieur du village. Une seule, Eyabe, ose transgresser les consignes du clan pour partir à la recherche de la vérité concernant la disparition de son fils. Elle découvre alors le sombre destin des disparus, mais elle prend surtout la mesure de la menace qui pèse sur la communauté tout entière, sur l’équilibre du monde tel qu’il existait jusqu’alors. Dans son nouveau roman, Léonora Miano fait vivre la mémoire douloureuse de ce que fut la traite négrière pour les peuples d’Afrique de l’Ouest. À travers ses personnages à hauteur d’homme, elle éclaire les ombres du passé ; car la mémoire et les mots sont nécessaires pour que les blessures et les absents ne reviennent pas hanter les vivants, pour donner une chance à l’avenir.
Page — En racontant un épisode de ce que fut la traite transatlantique, La Saison de l’ombre semble constituer un lien entre deux pans de votre projet romanesque. En quoi le récit de ce qui n’est pas un mythe fondateur, mais un événement dramatique réel qui fut vécu par des millions d’hommes, de femmes et d’enfants, éclaire autant le contexte de l’Afrique contemporaine que le questionnement identitaire des Afropéens (ndlr : Africains européens dans l’œuvre de Léonora Miano) ?
Léonora Miano — Pour être tout à fait honnête, je n’avais pas pensé à ce thème du questionnement identitaire des Afropéens. C’est là une question intéressante… La traite transatlantique est, en tout cas, et depuis le début, un sujet que je ne cesse d’explorer, qui apparaît souvent comme un motif et constitue ici le cœur du livre. La traite négrière est un fait historique majeur. Pour comprendre ce qu’est aujourd’hui l’Afrique subsaharienne, du moins la partie d’où je suis issue, Afrique centrale et occidentale, il est essentiel de prendre en compte l’histoire du commerce des esclaves. Parce que, pendant cinq siècles, cette pratique a déplacé des populations entières, elle a englouti des communautés, elle a façonné de façon irrémédiable les relations entre Subsahariens, elle a, encore aujourd’hui, un impact majeur sur la perception que chacun a de soi-même… Pourtant, en dépit de ce que je viens de dire, c’est un événement très peu pris en charge en Afrique subsaharienne. Je conçois donc mon travail comme une manière de reconnecter cette région de la planète avec une partie cruciale de son Histoire. Pour seulement envisager de se projeter dans l’avenir, il est essentiel que cette histoire soit connue et appréhendée. Je ne pense pas que les sociétés africaines de ce début de xxie siècle puissent faire l’impasse sur la connaissance précise de cette longue période. Je travaille principalement sur la traite transatlantique parce que c’est par elle que je me sens concernée de façon immédiate. Je viens du littoral du Cameroun, où l’histoire du commerce négrier est très prégnante – bien que l’on n’en parle pas davantage ici qu’ailleurs. Cette histoire me constitue, elle me hante. La question du commerce humain relève pour moi de l’obsession…
Pour en revenir à votre question, en quoi tout ceci éclaire les questionnements identitaires des Africains d’Europe ? Pour un très grand nombre de Français noirs, la traite transatlantique, c’est le début de l’Histoire. Quand vous êtes Caribéen, c’est-à-dire Guadeloupéen ou Martiniquais, ou Français de l’océan Indien, c’est-à-dire de la Réunion, ou Français d’Amérique du Sud, c’est-à-dire de la Guyane, vous existez parce que ce passé de traite a existé ; c’est par rapport à cette histoire que vous vous définissez. Avec La Saison de l’ombre, je voulais évoquer certaines des figures les plus méconnues de l’histoire de l’esclavage. Quand on aborde cette question, on évoque presque toujours, et c’est bien normal, la figure du déporté, du captif transporté vers le Nouveau Monde, arraché à sa terre, à sa famille, à sa culture. On évoque aussi la figure du négrier, presque systématiquement dans sa version européenne, même s’il arrive, et de plus en plus souvent, que l’on parle de son double subsaharien… En revanche, on ne se penche jamais sur le sort des millions d’individus qui ne sont allés nulle part, qui sont restés en Afrique subsaharienne et auquel on a arraché un être cher, un parent, un frère, une sœur… Or, c’est sur ceux-là que je désirais écrire, les oubliés. Car j’ai le sentiment que ce qui entrave la prise en charge d’un travail de mémoire, en Afrique subsaharienne, sur les traites négrières, c’est l’accablement, la culpabilité, la honte. On retient surtout la figure du négrier international. Mais on a le plus grand mal à affronter la figure du négrier local ; celle de la victime restée sur place aussi. Ceux qui sont restés n’avaient aucun pouvoir, n’ont rien décidé, n’ont pas eu le choix, ils ont été embarqués dans quelque chose qui les dépassait.
Page — Les femmes ont toujours une grande importance dans vos textes, et peut-être encore plus avec ce nouveau roman. Une femme, l’une de ces mères, s’y distingue par son refus de se soumettre à l’exclusion dont la communauté la frappe. Elle ne se résigne pas à l’espèce d’opprobre silencieuse dont elle est l’objet et choisit de partir en quête de son fils, de chercher la vérité. Pourquoi cette femme décide-t-elle de se lever ? Qu’est-ce qui fait qu’elle choisisse de se mettre en marge de ce que le village attend d’elle ?
L. M. — Puis-je répondre la vérité ? C’est une vérité délicate… Elle agit de cette façon, parce que l’auteure l’a décidé. L’auteure est une femme qui ne marche pas dans les clous, qui ne suit pas le règlement et qui aime bien les personnages qui lui ressemblent. C’est la vérité vraie. En même temps, ceux qui fréquentent un peu mon travail auront sans doute identifié dans ce roman des thèmes qui traversaient mes textes précédents, comme celui de la communauté repliée sur ses propres usages ou des personnages féminins marginalisés en raison de leur audace ou de leur caractère un peu fort. Toutes choses qui n’ont rien à voir avec l’Afrique et tout avec ma propre histoire. Mes romans subsahariens se situent tous au sein de communautés, et je suis persuadée que, même il y a cinq siècles, les hommes et les femmes de l’Afrique subsaharienne et d’ailleurs étaient capables de démarches individuelles.
Il se trouve que cette femme, mon héroïne, a son tempérament, qu’elle a des audaces que d’autres n’ont pas forcément. Elle est connue pour cela dans le village. Je crois qu’en Afrique centrale et équatoriale, une telle situation est possible : une femme peut décider, s’affirmer contre le reste du groupe. C’est une région du continent qui a fourni des guerrières, des reines combattantes. Peut-être qu’une Sahélienne n’aurait jamais pu s’autoriser pareille liberté. Là d’où je viens, c’est envisageable. À partir du moment où de telles figures nous sont connues, il n’y avait pas de raison de ne pas créer un tel personnage. Il se trouve en plus que, depuis très peu de temps, je suis en paix avec le féminin en moi, et que je réussis à construire sciemment des figures féminines. Cette fois, je les voulais puissantes, flamboyantes, y compris dans des situations où elles ne peuvent pas complètement renverser la vapeur. Donc, vraiment, la réponse à votre question, c’est que l’auteure en a décidé ainsi. Parce que je trouve bon et juste que ce soit les filles qui ruent dans les brancards.
Page — Plusieurs communautés se côtoient à l’intérieur de l’intrigue : les Mulongo, les Bwele, les Isedu mais aussi les étrangers, désignés par les différentes communautés comme les « hommes aux pieds de poule ». À l’écart de ces populations, il y a le village de Bebayedi, « dont le nom évoque à la fois la déchirure et le commencement », peuplé de survivants, de gens qui fuient les captures. Comment avez-vous envisagé la place et le rôle de cette communauté porteuse d’espoir ?
L. M. — Je désirais consacrer ce livre à des figures subsahariennes méconnues. Et La Saison de l’ombre est truffé de ces figures. J’ai imaginé Bebayedi comme un hommage à une communauté d’Afrique de l’Ouest, qui existe encore aujourd’hui et se compose d’une population très pauvre, mais dont les ancêtres se sont regroupés afin de se protéger des razzias des marchands d’esclaves. L’histoire de ce peuple installé au Bénin n’est pas exactement identique à celle que je décris dans mon livre. Peut-être que les individus qui la composent ne sont pas issus d’horizons aussi variés, mais j’ai vraiment souhaité rendre hommage aux fondateurs de ce qui est aujourd’hui la cité lacustre de Ganvié, au Bénin. Ce lieu a été créé par des gens qui fuyaient les razzias et que leurs poursuivants ne pouvaient continuer de pourchasser parce qu’ils habitaient une terre baignée d’eau. Pour les assaillants, approcher des marécages relevait d’un grave tabou, alors, ils s’arrêtaient et renonçaient à leur proie. Aujourd’hui, Ganvié est un endroit qui se visite, malgré son peu d’attrait esthétique. Même si, au Bénin, on n’échappe pas à l’histoire de la traite négrière, cela ne signifie pas que tous les sites porteurs de cette mémoire soient conservés et entretenus de manière valable. Celui de Ganvié ne l’est pas, mais je trouve qu’il possède une histoire très belle, très forte et en même temps tragique. Car il s’agit d’une histoire de dépossession. Créer une nouvelle société, une nouvelle aire d’habitation, cela implique que l’on en a quitté d’autres. Quand les Caribéens, les Afro-brésiliens et d’autres racontent leur histoire, la perte semble bien sûr beaucoup plus évidente. Pourtant, en Afrique aussi, la perte a été multiple et dramatique. Des lieux, des traditions, des modes de vie se sont perdus, dont on a finalement assez peu conscience. Or, on ne sait pas réellement qui on est si l’on n’est pas capable d’affronter cette histoire-là, aussi. C’est ce que j’ai cherché à montrer avec La Saison de l’ombre.