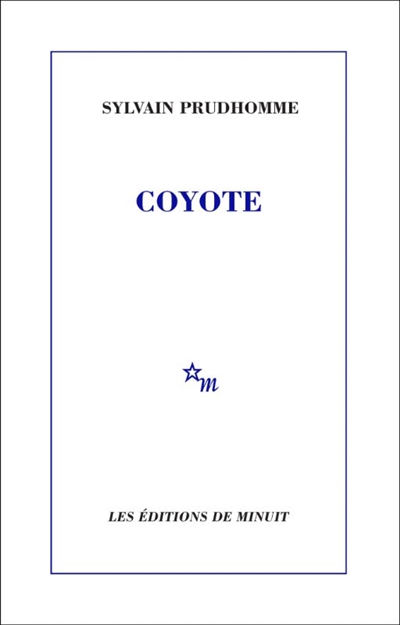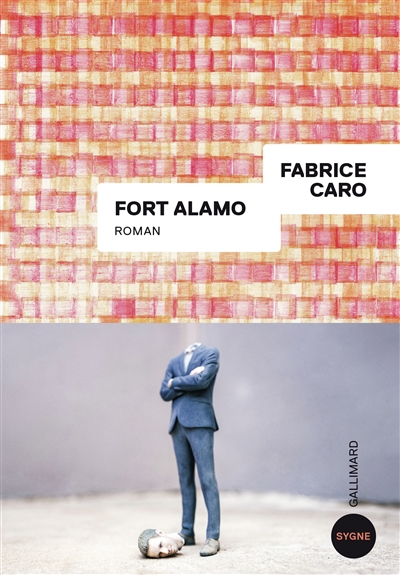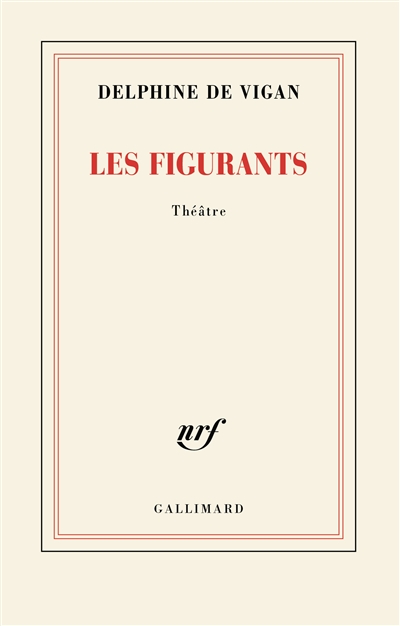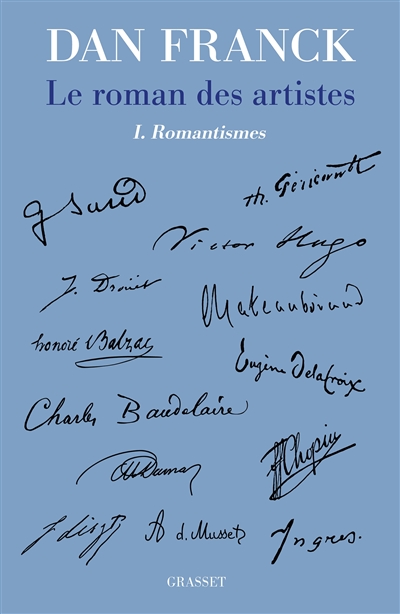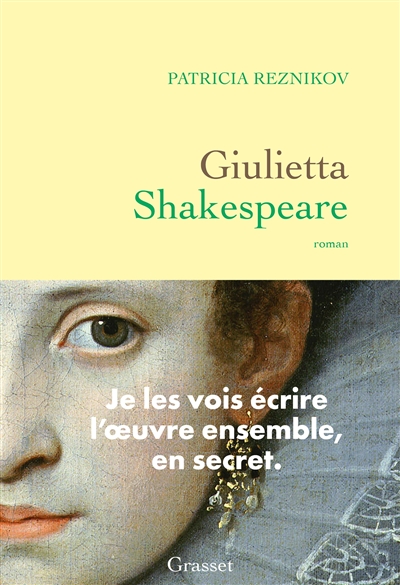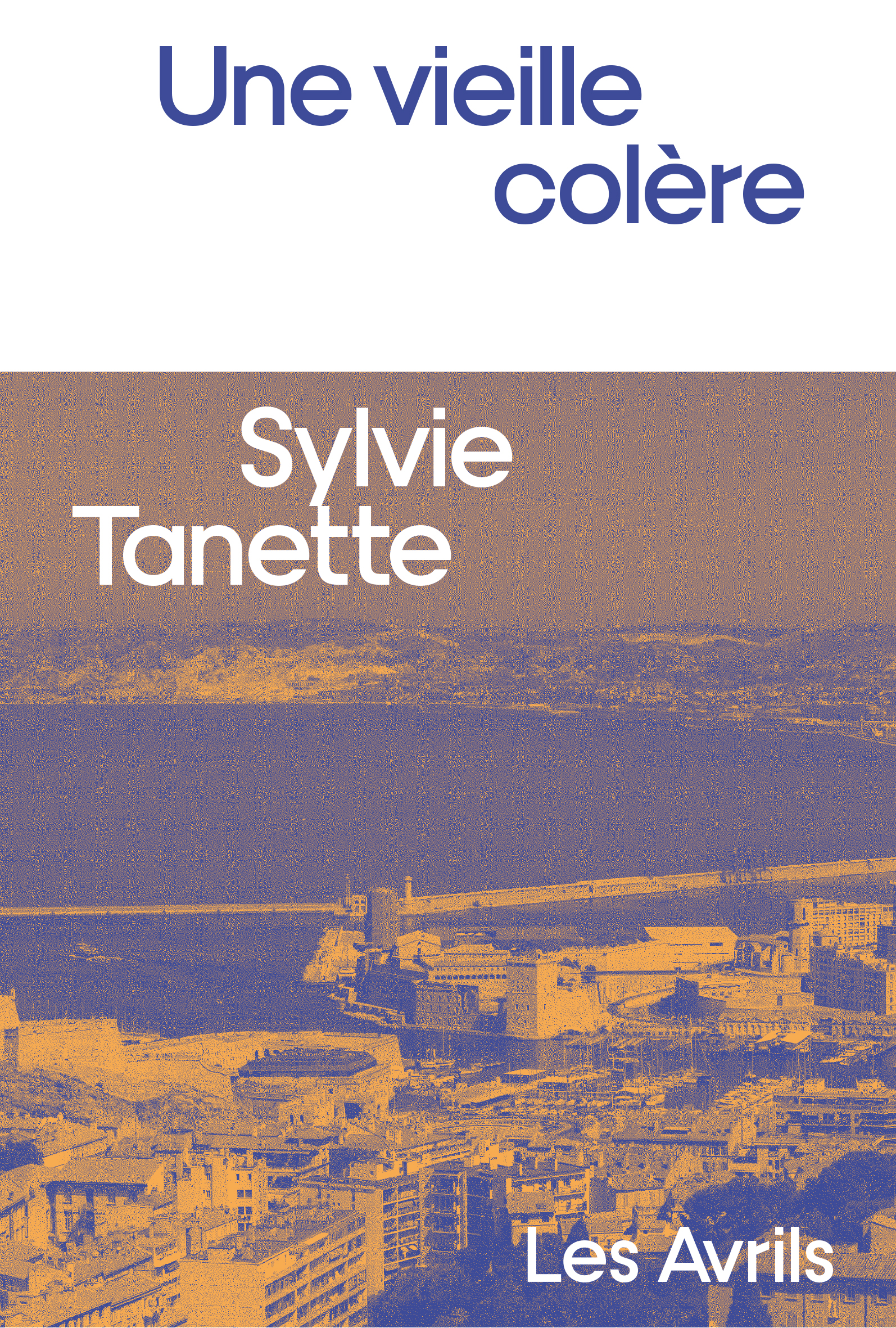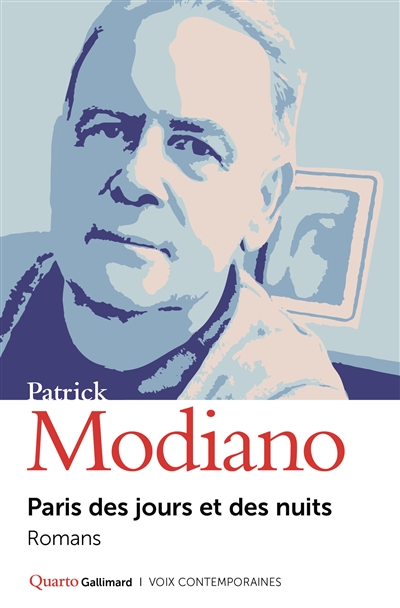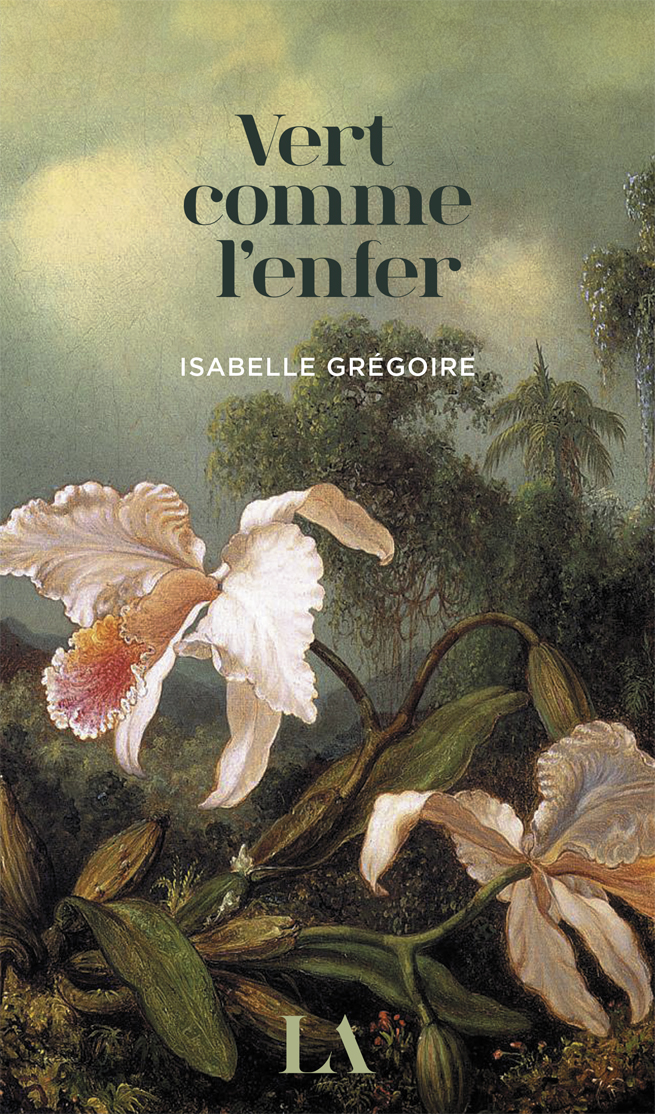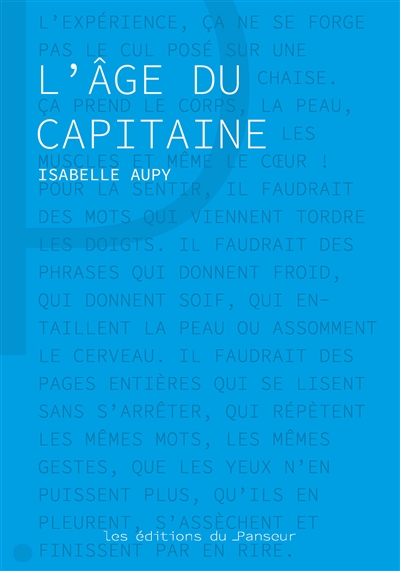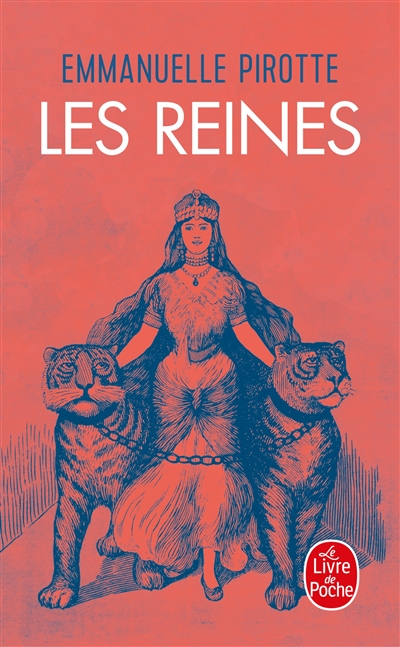Pourquoi avez-vous éprouvé la nécessité de poursuivre Le Journal de Yaël Koppman (Sabine Wespieser, 2007) ? Ou, pour être plus précise, de reprendre la forme du journal, puisque je m’empresse de préciser que Les Arbres ne montent pas jusqu’au ciel ne constitue pas une suite à ce précédent texte, et qu’il peut se lire indépendamment. En quoi le journal, dans sa forme romanesque, vous intéresse-t-il ?
Marianne Rubinstein — Pour ce qui est de mon personnage, Yaël Koppman, en l’accompagnant ainsi à différentes étapes de son existence, j’avais envie, en toute modestie, de créer mon petit Antoine Doinel féminin. La perspective de brosser la trajectoire d’une femme au long de sa trentaine – c’était Le Journal de Yaël Koppman –, de dépeindre ses difficultés relationnelles avec sa mère, ses préoccupations sentimentales, son désir de nidification… m’avait beaucoup intéressée. Poursuivre sur le même schéma, mais en l’accompagnant cette fois pendant sa quarantaine, avec les questionnements propres à cette période de la vie, m’a passionnée davantage encore. Je n’avais pas spécialement envie d’inscrire ce projet littéraire dans le cadre du journal. C’est pourtant la forme qui s’est naturellement imposée, notamment après avoir relu Une chambre à soi. Virginia Woolf écrit que pour donner vie à une femme, il faut la concevoir en même temps sous un jour poétique et prosaïque. J’ignore si j’y suis parvenue, mais il me semble que le journal permet justement de mêler ce qui relève du quotidien à la poésie, à la réflexion, à des questionnements touchant, par exemple, au sens de l’existence… Ce qui m’attirait aussi dans cette structure, c’était de raconter l’itinéraire d’une femme au cours d’une année, de rythmer les douze mois par le passage des saisons, en attribuant à chacune d’elle une couleur, en mettant en relief le temps qui s’écoule. Au début du livre, Yaël est complètement effondrée, très affectée par sa séparation. Je voulais montrer le lent processus de reconstruction, je tenais à ce que le lecteur le ressente, que ce soit presque palpable. Je crois que le journal est un moyen idéal pour produire l’impression du temps qui passe. Les aléas du quotidien mêlés aux préoccupations existentielles et le passage du temps, voilà les principales raisons qui m’ont incitée à donner à ce roman l’aspect d’un journal. Le journal crée aussi une manière de proximité, d’intimité entre le lecteur et l’auteur…
Le journal crée aussi une manière de proximité, d’intimité entre le lecteur et l’auteur…
M. R. — C’est juste. Je n’y avais pas pensé, mais c’est très vrai. Les pages d’un journal dévoilent l’intimité de son auteur, parce que rien n’y est dissimulé ou policé. Ce qui a trait au corps comme ce qui a trait à la pensée, aux émotions, etc. Le journal intime, de fait, se présente comme un accès direct à l’intimité de son auteur.
Yaël Koppman est une intellectuelle, et la première des solutions qu’elle envisage pour trouver un remède à son mal, de surseoir à sa colère, consiste à se plonger dans Montaigne et Sénèque – pour l’amour, elle se reporte à la poésie de Sei Shonagon et à son recueil Notes de chevet. Pensez-vous, comme paraît le croire votre personnage, que la littérature possède cette faculté de répondre à toutes les questions posées par l’existence ? Est-elle à ce point essentielle ?
M. R. — La littérature permet d’appréhender l’autre selon des modalités absolument différentes de celles que l’on expérimente avec des amis par exemple. Durant cette année où l’on suit Yaël Koppman, elle passe un premier automne très solitaire et le compagnonnage avec la littérature lui est d’autant plus essentiel. On suppose parfois qu’une femme en crise, comme l’est Yaël, s’en va, fuit, part ailleurs. J’ai exploré une voie alternative. Quand Yaël s’écroule, elle décide de ne plus bouger, de rester dans son appartement. À l’intérieur d’elle-même, c’est une espèce d’Hiroshima. Tout y est calciné même si tout y a conservé sa place et son apparente normalité. Alors elle économise ses mouvements afin de perpétuer cette illusion d’ordre. Relire Montaigne ou Sénèque l’aide à résister, à surmonter les phases de haine et de colère suscitées par cette rupture qu’elle ressent comme une trahison. L’isolement dans lequel elle passe l’automne n’est toutefois pas une solitude mortifère, dépressive. La compagnie des textes et des auteurs qu’elle aime l’empêche de sombrer.
Vous abordez des sujets très féminins qui toucheront vos lectrices : la maternité, l’amitié, la maladie, celle du cancer du sein, le temps qui passe, les hommes, les désillusions de l’amour et de la vie… Est-ce si difficile d’avoir 40 ans ?
M. R. — Je crois qu’en abordant la quarantaine, on se sent comme « au milieu du chemin de notre vie », pour reprendre l’expression de Dante dans les premiers vers de La Divine Comédie que j’ai mis en exergue de mon roman. Au début du livre, Yaël est brisée, atteinte dans sa féminité à cause d’une rupture. Elle a abandonné ses rêves de nidification – il est très peu probable qu’elle ait un autre enfant – et tous ses projets de vie ont volé en éclats. À l’orée de la quarantaine, elle doit reconstruire quelque chose de neuf. Alors, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu’avoir 40 ans soit particulièrement difficile, c’est un âge passionnant, mais la question est de savoir sur quoi se construire. Yaël va s’investir dans le travail, dans la création littéraire. D’ailleurs, elle ne cesse de répéter cette antienne familiale : « Seul le travail procure des satisfactions profondes et durables. » Sa vie part à vau-l’eau, son moral est au plus bas et l’unique chose qui résiste au délitement général, c’est sa capacité à travailler. Elle s’y raccroche comme à une bouée de sauvetage. Le travail est une bonne façon d’aborder la crise de la quarantaine ! Et pour « réparer » sa féminité blessée, elle s’entoure d’une société de femmes qui affrontent, elles aussi, un certain nombre de problèmes de la quarantaine. Par exemple, Clara, sa cousine, est atteinte d’un cancer du sein, ce qui la fragilise aussi dans sa féminité, avant que sa maladie ne lui permette de comprendre des choses sur elle-même, de réinvestir sa propre vie.
C’est aussi un livre plein d’humour. Il y a une chose que j’ai beaucoup aimée, c’est la sensualité et la sexualité que revendique votre personnage, la façon dont elle assume totalement, sans le moindre complexe, son désir. Et vous montrez cela avec délicatesse et retenue. Est-ce que le combat qu’elle reprochait un peu à sa mère de mener dans le précédent livre, n’est pas justement ce qui lui permet de vivre cette existence et de pouvoir assouvir pleinement ses désirs ?
M. R. — De ce point de vue, elle est absolument une enfant de 68, oui ! À ce propos, elle dit à un moment qu’elle voudrait réussir à parler du sexe de manière crue mais sans être vulgaire. Elle fait alors référence à une scène de Madame Bovary, où Flaubert suggère la sodomie d’Emma par Rodolphe, mais sans le dire explicitement, avec une extraordinaire retenue. Yaël est effectivement l’héritière des combats menés par sa mère. Elle porte un regard assez gourmand sur les hommes et en même temps assez lucide. Elle est à la fois gourmande et lucide, sur ce qu’elle est comme sur ce qu’ils sont, sur ce qu’elle représente à l’âge qu’elle a désormais et sur ses appétits.
Tenez-vous un journal intime ?
M. R. — J’en suis incapable. J’aurais adoré. J’aimerais conserver une trace écrite de mes journées, de certains moments forts, de choses personnelles ou intimes… D’autant que j’ai une mémoire un peu catastrophique. Sauf que si j’écrivais mon propre journal, je n’aurais plus ce prodigieux sentiment de liberté que j’ai dans la fiction.
Littérature française
Marianne Rubinstein
Une année dans la vie d’une femme
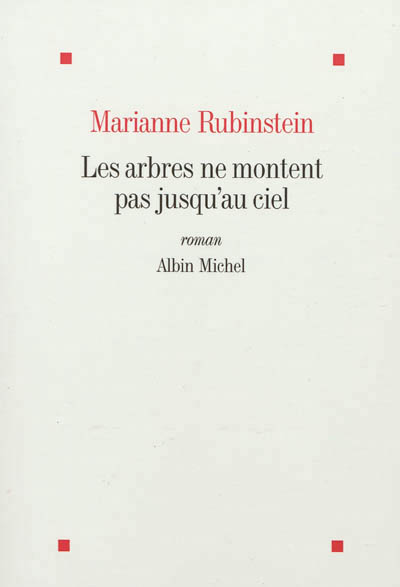
-
Marianne Rubinstein
Les Arbres ne montent pas jusqu’au ciel
Albin Michel
22/08/2012
140 pages, 17 €
-
L'entretien par
Véronique Marchand
Librairie Le Failler (Rennes) -
❤ Lu et conseillé par
6 libraire(s)
- Jean-François Delapré de Saint-Christophe (Lesneven)
- Delphine Bouillo de M'Lire (Laval)
- Lucile Donnart de L'Ecailler (Paris)
- Anne Dagorn-Lévy de Pages après pages (Paris)
- Georges-Marc Habib de L'Atelier (Paris)
- Aurélia Magalhaes de Hélène Oudoux (Massy)
VM
Entretien par Véronique Marchand
(Librairie Le Failler, Rennes)
Messieurs, si les femmes sont pour vous une éternelle énigme, lisez toute affaire cessante Les Arbres ne montent pas jusqu’au ciel qui vous prouvera, si besoin était, que l’on peut être intelligente, cultivée, drôle et que la quarantaine n’est
pas la fin de la séduction ni du désir. Mesdames, vous allez adorer !