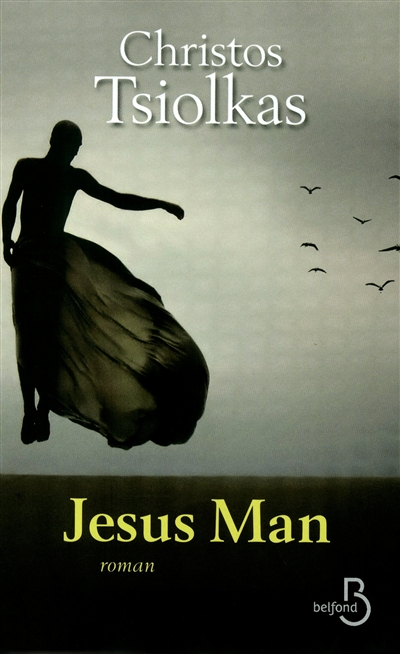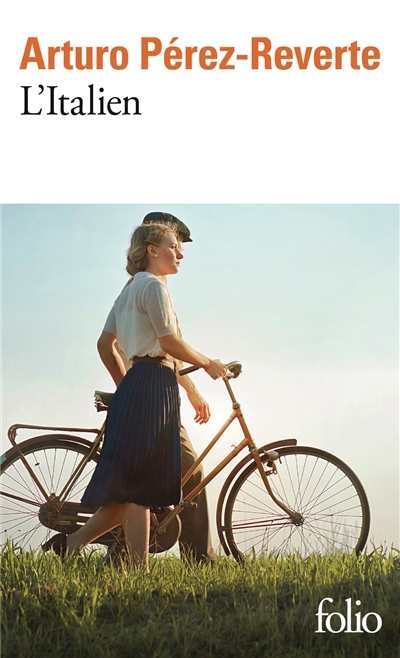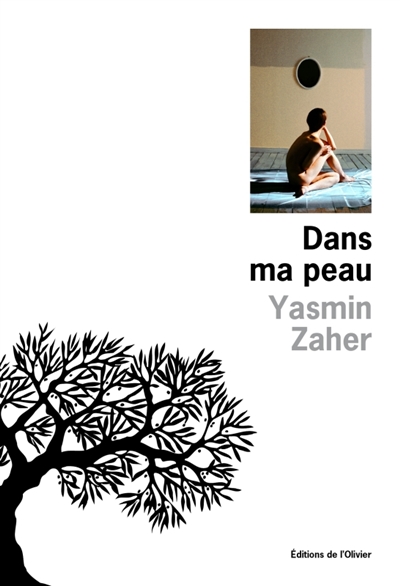PAGE : Dans ce livre comme dans La Gifle, votre précédent roman, vous montrez une famille à première vue ordinaire. Pourtant, à y regarder de plus près, on se rend compte qu’elle est sur le point d’exploser. Cela reflète-t-il l’état de la société australienne ?
Christos Tsiolkas : Je considère que le milieu familial constitue l’une des meilleures sources d’inspiration pour un auteur. Mais c’est aussi un sujet qui me dérange et me déconcerte. C’est à l’intérieur des familles que l’on assiste aux formes les plus extrêmes de comportements et c’est par conséquent là que les contradictions sociales s’expriment avec le plus d’évidence. Jesus Man s’efforce de montrer en quoi le contexte familial reste essentiel dans la formation des individus, malgré les bouleversements induits depuis une centaine d’années par la psychanalyse, le féminisme, les théories de l’identité et du genre. L’histoire de Tommy montre l’échec d’une éducation fondée sur le vieux modèle patriarcal, mais je continue pour ma part de défendre l’importance des liens filiaux et communautaires, nécessairement issus du milieu familial. Je pense que c’est essentiel. C’est la raison pour laquelle le livre se referme sur l’intervention de Lou. Il comprend les critiques visant la famille, mais sa philosophie le porte à tenter de réconcilier ces contradictions, à les reconnaître afin d’en pacifier les effets et de les intégrer au fonctionnement de la cellule familiale. Par bien des côtés, je pense que Lou est la voix la plus optimiste de mon œuvre. Je me demande parfois si mes écrits sur la famille ne sont pas aussi une réflexion sur l’histoire de l’immigration et de l’exil. Je suis un enfant de paysans. La famille paysanne traditionnelle est patriarcale, conservatrice, liberticide. Il a pour moi été capital d’entrer très tôt en lutte contre ce système éducatif, de résister et éventuellement de le fuir. Cependant, ni moi ni mes parents n’avons détruit les liens qui nous relient les uns aux autres.
P. : Tommy est un jeune homme en colère, d’où lui viennent cette violence et cette haine ?
C. T. : Un des plus gros mensonges de ces vingt dernières années a été de dire que les hommes ont vaincu leur agressivité. Nous en sommes plus conscients, nous apprenons à la comprendre et à nous y confronter, mais lutter contre l’instinct de violence reste un combat quotidien. Tous les jours, je dois me rappeler à moi-même que je suis un adulte, que je peux résister à mes mauvais penchants, que je peux dresser ces instincts. Je déplore la violence tout en la comprenant. Tommy est un homme qui ne bénéficie d’aucun soutien intellectuel apte à lui fournir des outils pour gérer ses peurs et ses fantasmes morbides. Je pense que sa colère vient de sa confrontation à une image de la masculinité impossible à atteindre. On peut répondre à cette difficulté par une explosion de violence envers les autres. Dégoûté par ses faiblesses, son incapacité à se maîtriser, Tommy se replie sur lui-même et s’abandonne à la violence. Beaucoup de choses ont été écrites sur l’homosexualité comme dégoût de soi. En tant que gay moi-même, j’ai expérimenté et vécu cela. Mais j’observe le même dégoût chez les hétérosexuels et j’aimerais explorer ce phénomène, je voudrais le décrire, l’interroger et le comprendre.
P. : La sexualité, la pornographie et les pratiques extrêmes sont très présentes dans ces pages. Pensez-vous que ce soit un fait contemporain ?
C. T. : Là je dois être prudent. Je ne veux pas être perçu comme un conservateur en matière de pratiques sexuelles. Je ne le suis pas ! Toutefois, je pense que la pornographie, la possibilité d’en télécharger et d’en regarder vingt-quatre heures sur vingt-quatre modifie progressivement notre rapport au corps, le nôtre et celui des autres. Après la publication de Jesus Man en Australie – beaucoup de critiques étaient scandalisés et en colère contre son côté explicite –, un critique a dit de moi : « Tsiolkas est un protestant ». Je trouve que c’est une observation intéressante. J’ai été élevé dans la religion grecque orthodoxe, puis j’ai cessé de pratiquer pendant des années. Pour autant, il me semble que je mènerai toute ma vie une bataille intérieure avec le puritanisme. Le revers de la médaille, c’est qu’il m’a fallu conduire une lutte similaire contre le libertinage. Je pense que, par le sexe, on se montre à nous-mêmes. Le mensonge puritain est de croire que l’on peut être soi-même sans le sexe. Le mensonge libertin est de croire que seul le sexe révèle ce qui est bon en nous.
P. : Comme dans La Gifle, vos personnages ne sont pas des Australiens de souche. Ils cherchent leur place, certains cultivent leur identité, d’autres la rejettent totalement. Les notions d’exil et d’’identité, l’importance des coutumes sont des choses importantes pour vous ?
C. T. : Le fait d’être un fils d’immigrés a eu un effet décisif sur mon identité. Quand j’étais jeune, j’avais pour tâche de traduire, d’interpréter l’Australie à mes parents, tandis qu’eux me racontaient ce lieu fantastique qu’était l’Europe. Je dois toujours traduire les significations, les coutumes et les façons de faire de la classe bourgeoise à mes parents. Je suis heureux qu’ils m’aient transmis les codes et les expressions de la classe ouvrière et de la vie paysanne. Sans cela, j’aurais été beaucoup plus dépourvu en tant qu’auteur et plus encore en tant qu’être humain. J’ai trouvé très intéressant de voir mon travail traduit dans d’autres langues européennes, de voir des Français, des Allemands, des Italiens réagir à un livre comme La Gifle. Je me demande si la mondialisation n’a pas fait que la classe moyenne est devenue à peu près la même partout dans le monde. Nous buvons tous le même vin, nous voyons les mêmes films, mangeons la même nourriture, passons nos vacances aux mêmes endroits... Où est la différence aujourd’hui ? Je suis content d’avoir grandi sans la pression des origines et des coutumes.